Charles Auguste Bordinat
du 151e régiment d’infanterie
Mémoires et
souvenirs des épisodes, passages vécus pendant cette grande guerre.
Période
1916-1919
Mise
à jour : octobre 2015

Préambule
Les
mémoires ont été écrites juste après la guerre à Mézières-en-Drouais, le 24
juillet 1919.
Ouvrage
manuscrit retranscrit par Ellen Le Roy (arrière-petite-fille de l’auteur) en
avril 2014.
Pour la petite histoire, ses sœurs sont parties au début du XXème siècle trouver du travail dans des fermes en Argentine. L'une d'elles s'est mariée avec un médecin et avait un peu plus de moyens.
Elle lui a donc fait la surprise de lui rendre son manuscrit relié, dont vous trouverez la photo ci-dessous.
En septembre 2015, une internaute, Myriam, a été très émue de voir le nom de son grand-père, Louis BOISSON, inscrit dans ce carnet. « Mon camarade de combat BOISSON L. »
Grand-père qu’elle n’a jamais
connu.
Sommaire
Ce sommaire n’existe pas
dans les écrits, je l’ai rajouté volontairement pour une meilleure navigation.
Mai-septembre 1916 :
Verdun, le Mort-Homme
Ø Arrivé première fois en tranchée, La terrible soif, Le
bombardement, L’ensevelissement
La bataille de la Somme, fin 1916
Ø L’attaque du cimetière de Rancourt, les Portes de
Fers, l’hécatombe, l’ignoble boue
Le chemin des Dames, Sapigneul, janv.-juin 1917
Ø L’attaque à Sapigneul, Gernicourt, l’attaque folle des
tanks, les mutineries, les embusqués
Verdun : L’attaque des Jumelles-d’Ornes :
août 1917
Ø Le pillage par les Français
Affaire de la ferme Porte (10 juin 1918)
Embusqué : Septembre-décembre 1918
![]()
Couverture du manuscrit
final, construit à partir des carnets de « terrain »
1914-avril 1916
Mes
changements successifs
Après avoir été appelé à passer une nouvelle visite en 1914 à Dreux, je fus reconnu apte au service armé et dirigé à Mâcon au 134ème infanterie (caserne Joubert), le 18 février 1915. De là, je subis une nouvelle visite et fus versé dans le service auxiliaire où on m’affecte au 58ème régiment territorial à Dijon (caserne Vaillant).
Ensuite on me dirigea au fort de Varois le 7 avril 1915 pour faire partie d’une compagnie agricole, destinée à aider les cultivateurs, à remettre et continuer leur culture, après la retraite ennemie de la bataille de la Marne.
Nous embarquons donc le 10
avril 1915 pour Bar-le-Duc, siège de notre compagnie où ensuite nous
fûmes répartis dans divers endroits aux travaux des champs.
Après des va-et-vient de Bar à Pouilly St Dizier je finis par me fixer à Laimont, à quelques kilomètres de Revigny, chez une cultivatrice du nom de Madame Jaeguesson. Son mari était mobilisé depuis le début, j’y passai l’été et une partie de l’automne où de nouveau je passai une visite le 28 octobre par la commission spéciale de Bar-le-Duc.
Je fus reversé dans le service armé et dirigé sur le dépôt du 27ème d’infanterie à Dijon, le 28 novembre 1915.
A mon arrivée une agréable surprise m’était réservée. J’étais rappelé en sursis au moulin où je travaillais avant mon départ. Je reste donc à travailler jusqu’à mi-mars 1916 et à nouveau je rejoins mon corps à Dijon.
A vrai dire, le début de ma
mobilisation fut plutôt un voyage d’agrément en comparaison de la suite.
J’étais tombé dans une bonne famille meusienne et très bien estimé de tous. Je m’employais de mon mieux et en plus, coïncidence bizarre, mes deux frères étant à Bar à la même époque, ce qui nous faisait grand plaisir de nous voir de temps à autres.
Bref ce fut pour moi un petit séjour agréable rempli de bons souvenirs et quel accueil je reçus quand par la suite de la campagne un beau jour je viens cantonner au même pays après bien de dures épreuves vous devez le penser.
![]()
L’emploi de mon temps dans le service armé
Commencé le 30 mars 1916 pour ne finir que le 20 mars 1919, pendant les préliminaires de la paix.
Mon séjour à Dijon fut très court, juste le temps de guérir une angine, où je fus soigné à l’hôpital de Tallant et de subir l’épreuve de vaccination anti-typhoïdique.
Mai-septembre 1916 : Verdun, le Mort-Homme
Le 5 mai, j’étais désigné pour partir en renfort au 151ème infanterie, 32ème corps, 42ème division.
Après un assez long trajet en chemin de fer, je fus tout surpris de débarquer à nouveau à Bar-le-Duc le 8 mai au matin.
On apprend que notre régiment 151 était engagé à la grande ruée boche de Verdun.
Néanmoins je m’échappe du détachement et je cours de la gare à la caserne Exelmans dire au revoir à mon frère Albert ; le deuxième, Paulin, étant trop éloigné, puisqu’il se trouvait au champ d’aviation de Béhome.
Je surpris donc mon frère vers 5h du matin et tous les deux on se restaure bien. Il ne me quitte qu’à la dernière minute et à nouveau je prenais le Meusien, bien connu de moi, pour la direction de Verdun, le cœur bien gros, hélas, en entendant la terrible canonnade au lointain à laquelle, dans quelques heures aussi moi à mon tour, je serai mêlé.
Donc vers midi, on débarque à Lemmes, point terminus car déjà ici le bombardement commence. On se renseigne et nous apprenons que notre régiment est bivouaqué à Jouy-en-Argonne où nous arrivons vers la fin du jour bien harassés. Nous restons là dans ce petit pays déjà abandonné de tous les habitants jusqu’au 11 ou 12 où je fus affecté à la 6ème compagnie du 2ème bataillon, commandée par le capitaine Olivier.
J’emploie le peu de temps que
j’ai à faire des camarades, chercher des compatriotes si possible, qui me
racontent leurs dures misères endurées là-haut au lieu-dit le Mort-Homme
où le 151ème y était engagé depuis la fin mars, coin maudit de tous.
Bref je ne perds pas courage tout de même, puisque le sort en décide ainsi, et comme tous ceux qui n’ont pas encore fait campagne. A entendre les camarades je me demande par quel miracle on peut en revenir et pourtant c’était la vérité et j’ai eu le temps d’en juger moi-même.
Le régiment à cette époque comptait encore 4 bataillons répartis ainsi : un en ligne, un en deuxième ligne à la côte 287, un autre à Chattancourt en réserve et le dernier au repos au noyau des services à Jouy-en-Argonne, où je me trouvais attendant le 2ème bataillon qui devait venir le soir à son tour au repos pour 8 jours. Pour tout repos on fabriquait des chevaux de frise barbelés car du moment les minutes étaient précieuses et en dépit de toute l’ardeur de nos soldats, les boches enregistraient toujours de petites avances, mais on savait avec quels sacrifices.
Malgré tout, l’ennemi ne se
rebutait pas et le soir du 19 mai,
le bombardement redoubla de fureur et, par un de ces soirs printaniers à cette
saison, on contemplait ce triste spectacle en rentrant de nos travaux avec le
pressentiment que le lendemain il y aurait du nouveau car, au dire des
habitués, c’était le présage d’une attaque et c’était impossible de clore l’œil
en pensant à tous les camarades accrochés là-bas.
Ce qui était prévu arriva à 6h du matin. Nous sommes alertés, notre bataillon 1er était dit-on anéanti (prisonniers ou tués) et ordre nous était donc donné d’aller prendre sa place dans le plus bref délai.
J’allais donc pour la première fois faire connaissance de ce Mort-Homme tant parlé et partager souffrances et dangers, comme tous.
Dimanche 20 mai 1916
Donc, ce dimanche 20 mai, nous partons par un soleil très chaud vers midi en nous dissimulant le plus possible sur la lisière des bois déjà remplie de feuilles où on recevait déjà pas mal de gros obus, mais pas trop offensifs.
Vous décrire mon impression en entier, ce serait impossible malgré mon faible en français. De là ma pauvreté en mon arrivée au monde, je vais essayer de vous repeindre cela, en ma plus pure expression.
Nous filons donc à la queue leu-leu et, déjà fatigués, on arrive à un petit village appelé Froméréville vers 5 ou 6 heures où nous cassons la croûte en nous cachant le reste du jour. Les ennemis ont déjà des vues à cet endroit, aussi faut-il être prudent car on risquerait fort d’être anéantis avant notre arrivée à destination aux tranchées.
On remplit donc nos bidons d’eau car on nous avertit que là-bas c’est très rare (et en effet on en a eu la preuve).
Donc à la petite brume, on se remet en route sous la conduite de notre vaillant capitaine Olivier (qui devait être tué plus tard dans la Somme le 25 septembre 1916).
On croise force voitures de ravitaillement qui nous rassurent un peu en nous disant que cette fameuse cote 287, Mort-Homme, la moitié était encore à nous. On arrive aux batteries lourdes qui ne cessent de tirer et à chaque départ jaillit une grande flamme rouge qui fait tressaillir et à chaque pas à droite, à gauche, c’est le même refrain. Toutes sont enfouies dans les profondeurs des côtes boisées si fréquentes dans cet endroit.
Plus nous marchons, plus le bruit est fréquent et on frémit malgré soi, par le départ imprévu des coups répétés autour de nous dans le silence humain, qui vont porter la mort au lointain à toute minute.
Vers 10h, nous sommes dans la zone battue par les canons boches et,
pour nous reposer un peu, on nous fait faire une petite pause et chacun s’étend
par terre déjà tous harassés par la marche et la charge de nos sacs.
Et, Dieu, quel silence, personne ne cause, ne se plaint, à quoi pense-t-on, on ne saurait le dire. Bien des choses hélas, et moi, comme novice, je regarde d’un œil inquiet les fusées éclairantes, le ciel en est illuminé.
Toutes ces choses sont nouvelles pour moi, ce qui me rappelle ces fêtes du 14 juillet au pays. Sur ces entrefaites, on assiste au bombardement d’un de nos dirigeables, qui revient sans doute d’une randonnée chez l’ennemi.
Quel contraste ! Ce n’est que feu partout en l’air, par terre et au lointain.
Sur notre gauche, des incendies dans un pays voisin illuminent aussi ces tristes plaines, triste vision ! Et je ne m’étonne pas du silence de tous, au même moment on reçoit une volée de marmites qui nous tire de nos rêveries et, d’un bond, on déambule de cet endroit pour suivre un boyau tout proche de nous et, cette fois, nous sommes arasés un peu partout.
On marche d’un pas ferme et sapristi qu’il est long ce boyau !
On a hâte d’être arrivés et tout trempés de sueur, dieu quelle fatigue !
L’ennemi est aux aguets et, de son monticule, lance des fusées éclairantes dans notre direction. Sommes-nous aperçus ou devinent-ils notre arrivée, que sais-je ?
Alors commence pour nous la danse infernale, ce marmitage effroyable. Qu’importe !
Il faut arriver avant le jour coûte que coûte, on marche à la file indienne d’un pas de course et de temps en temps, ce cri nouveau pour moi : ça suit-il ? On répond oui ou non, sans même regarder derrière soi car beaucoup déjà sont blessés ou tués.
On monte dessus sans s’occuper pour ne pas perdre la colonne et le spectacle devient de plus en plus effrayant. Beaucoup n’arriveront pas, déjà le boyau est garni de cadavres depuis un certain temps, on monte dessus, on tombe, on se relève en courant.
Et malgré notre fatigue physique, le système nerveux nous emporte comme un souffle tels des pauvres, les sacs lourds de tout à l’heure on ne les sent plus et malgré notre préoccupation au moindre arrêt, on avale force gorgée d’eau dans nos bidons déjà presque vides. Maintenant on sent une odeur âcre, nauséabonde, qui vous prend à la gorge.
Arriverons-nous avant le jour, sommes-nous encore loin du but ?
Beaucoup comme moi l’ignorent et la
chose la plus dure, je vais le voir par la suite. A quelle souffrance est vouée
une vie humaine dans des circonstances physiques et morales pareilles. Pour
moi, ce fut la soif dans cette période.
L’aube commençant à poindre,
on nous dit que nous sommes la deuxième ligne où dans cet enfer se tient une
fourmilière d’hommes, le 332ème Rgt, 251ème, 151ème,
notre bataillon de réserve.
Et pensez quelle difficulté pour doubler tout ce monde en des passages si étroits. On se hâte le plus possible, nous bousculons tout ce monde sans une plainte de leur part, dans leurs tranchées toutes bouleversées par le bombardement continu. Et tous, ahuris, nous demandent simplement si c’est la relève pour eux et si nous avons à boire à leur donner en passant, et dans un serrement de cœur on leur répondait que non, sans nous arrêter.
Lundi 21 mai 1916
Enfin, à force de courage, nous arrivons à notre ligne de défense sans trop de pertes mais dans quel état et quel chaos indescriptible !
Il est 4h et le jour est déjà suffisant pour se faire une vision à
l’endroit où nous allons vivre ou mourir les uns et les autres (21 mai 1916).
Ici nous n’avons qu’à attendre, avec la mission d’arrêter l’ennemi à n’importe
quel prix.
Vous expliquer notre vie dans cet endroit serait impossible, où pour toute vision au-dessus de nos têtes reste encore un petit buisson de prunelliers sauvages tous fleuris que l’on contemple, resté là par hasard, échappé au bombardement jusqu’à ce jour.
Cette tranchée, que nous habitons, creuse d’environ 1m70, des endroits 2m, dans un sol pierreux, est bardée d’hommes de plusieurs régiments. On est coude à coude et obligés de rester à la même place sous un marmitage sans précédent dans les années passées au front, au dire de tous.
On est réduits, pour se déplacer,
à monter les uns sur les autres, afin de laisser circuler brancardiers et
agents de liaison, car passer en plaine c’est à peu près la chance d’être
blessé ou tué, tellement les obus tombent drus et la multitude d’éclats
mélangés aux pierres brisées qui retombent sur nos têtes et résonnent sur les
casques tels de la grêle.
Tous les combattants sont là, attendant la mort sous cet enfer et, vers 8h, le soleil commence à chauffer, et la canonnade reprend de plus belle des deux côtés. C’est un bruit assourdissant de miaulement et, par ce temps sec, la fumée mêlée avec la poussière forme un nuage opaque qui nous prend à la gorge, d’un goût âcre qui nous donne la soif avec rien à boire.
Si seulement on avait encore de l’eau !
Et de plus en plus ce mal se fait sentir.
Vers midi, on est assommés par le soleil et en plus l’odeur
putréfiée des cadavres autour de nous nous incommode fortement. Mais que faire
? C’est le martyre qui
redouble cette soif, quelle terrible maladie et que ne donnerait-on pas pour
avoir un peu d’eau.
Moi et mes camarades, nous prenons un peu d’alcool de menthe envoyé, dans un petit colis récent, par celle qui en ce moment doit aussi maudire ceux qui ont déchaîné cette horrible chose qu’est la guerre actuelle. Nous nous mouillons les lèvres déjà fiévreuses, ce qui contribue davantage à notre soif.
Bref, on recommence tout de même, si bien que le soir le flacon était vide. Ma pitié pour mes pauvres compagnons m’en avait réduit au rang de tous et maintenant je ne possède plus rien pour apaiser ces lèvres brûlantes. Nous attendons maintenant la grande nuit et une accalmie si possible de l’artillerie pour tâcher d’avoir de l’eau, mais hélas nous sommes déçus, la mitraille au contraire redouble d’intensité.
Et qui donc oserait parcourir ces 1500m, nous dit-on, pour aller à Chattancourt à une fontaine ou source et comment trouver où l’on risque après 10m d’être tué. Nous passons donc une partie de la nuit ainsi, et que les heures sont longues pour tous ces pauvres êtres qui ont échappé à la mitraille du jour pour souffrir ainsi !
Mardi 22 mai 1916
Sur les 2h du matin, l’artillerie se ralentit un peu et quelques-uns des camarades, qui connaissent le terrain des séjours précédents, se dévouent quand même. Je donne mon bidon à un que j’avais soulagé avec mon alcool, vingt heures auparavant.
Mais que le temps semble long de les attendre.
Cruelle déception, que sont-ils devenus, on ne les a plus revus, pas plus que les bidons, sans doute des cadavres de plus et des malheureux de moins.
Mercredi 23 mai 1916
La nuit se passa ainsi et le jour au lever du soleil qui s’annonce chaud.
La machine infernale continue toujours. Nous sommes survolés par des avions ennemis qui règlent le tir de leur pièce, maintenant les obus se rapprochent de notre tranchée, des gros 210. Nous sommes repérés me disent les camarades.
En effet c’est le bouleversement, le carnage, beaucoup sont engloutis, pulvérisés, décapités. Notre tranchée est à moitié refermée, ceux qui ne sont pas blessés, comme moi, restent impassibles, stoïques, attendant aussi la mort. On reçoit la terrible secousse des éclatements, bien souvent à un mètre ou deux de nous et quelques instants après il en tombe un à 1m50 de moi et de mon camarade de combat Boisson.
Notes :
En septembre 2015, une internaute, Myriam, a été très émue
de voir le nom de son grand-père, Louis BOISSON, inscrit dans ce carnet. Grand-père
qu’elle n’a jamais connu.
Mais par miracle il n’éclate pas ce qui quand même éboule notre tranchée.
Maintenant tous les survivants sont presque à découvert, sans aucun abri. Enfin l’ennemi cesse ses gros calibres vers 8h. Seul le 77 crache, mais c’est un jouet pour nous, on ne s’en occupe pas, on nous apporte des outils, pelles, pioches.
D’où viennent-ils ? On n’en sait rien.
On remue ce terrible
chantier afin de dégager, si possible, les camarades enterrés vivants. Mais
cette soif maudite qui nous fait tant souffrir ne nous quitte toujours pas. On
en retire quelques-uns, au bout de 2h on rétablit un peu la ligne.
On est exténués et cette
soif qui nous dévore à la vue de ce soleil brûlant en la circonstance et quelle
gorgée absorberait-on si on avait de quoi la satisfaire.
Bref, moi et mon jeune compagnon de combat de la classe 56, un lyonnais, on se décide coûte que coûte d’aller chercher cette eau sacrée. On emporte pas mal de bidons épars, par-ci par-là aux camarades présents ou tués.
Pas une minute à perdre, toujours que le 77 qui tire, y réussira-t-on ?
Qu’importe, nous partons au pas de course faire ces 1500m à découvert en plein four, on a su après que c’était défendu de circuler en plaine, mais la plaine et les boyaux ne faisaient bientôt qu’un. On entend bien siffler quelques balles, l’ennemi sans doute nous aperçoit de sur la crête qui nous domine, mais rien nous arrête, nous courons après notre sauveur, Eau.
Peu nous importe la mort en
ce moment, nous enjambons les cadavres tant allemands que français, tués à l’attaque
du 20 mai et vers 500m nous trouvons d’autres soldats qui font comme nous et
connaissant l’endroit de la source, vont nous conduire à cet endroit béni.
Nous arrivons enfin et à quatre pattes, à plat ventre, nous nous régalons à qui mieux-mieux et dieu que c’est bon de l’eau dans des moments pareils !
On emplit nos bidons avec nos quarts, mélangés de terre et on y resterait volontiers à cette source bienfaisante, au pied de Chattancourt à feu et à sang, si le souvenir de nos camarades ne nous revenait pas de temps en temps à la mémoire, et qui attendent eux aussi notre retour pour calmer leur fièvre de soif.
La vie renaît en nous et avant de la quitter, cette source bienfaitrice, on avale encore maintes gorgées et le cœur content on reprend notre chemin de retour, chargés de nos bidons boueux et après plusieurs tours et détours arrivons de nouveau au milieu des camarades sans encombre qui nous sautent au cou. Les bidons, les uns après les autres, disparaissent avec enchantement, réussira-t-on à en conserver quelques-uns pour finir le jour.
On ne sait trop, bref il
était temps que nous arrivions, le tonnerre recommence et l’envie de manger un
biscuit après avoir bien bu est passé, la faim n’est rien en ces moments. On a
la fièvre et toutes ces odeurs du diable vous empoisonnent la bouche, à 2h
encore plus d’eau mais impossible de songer à y retourner car les gros noirs à
nouveau comblent notre tranchée.
Le spectacle désolant recommence, l’ensevelissement vivant continue, on se remet à l’œuvre pour tâcher de sauver quelques vies encore et, armés de pelles et pioches à nouveau, ceux qui sont encore debout remuent cette terre et ces pierres innocentes.
On arrive enfin à en retirer quelques-uns vivants, les autres sont asphyxiés dix minutes après.
L’abri du capitaine est à son tour écroulé avec son entourage, les lieutenants et quelques hommes, tous étouffent dans leur trou sans air ; on recommence le déblayage et au bout de quelques temps on entend des plaintes et gémissements qui nous redonnent un peu de courage et enfin on parvient à les dégager.
Le capitaine et les lieutenants sont indemnes et notre chef nous dit de continuer, que plusieurs encore sont au fond. On essaie encore un peu de piocher mais les forces nous manquent et il nous est impossible de continuer.
Nous sommes épuisés et abandonnons tout ; sur une vingtaine de survivants qui restent là, pas un seul n’est capable de donner un effort, que faire ?
Donc les camarades enfouis, malgré notre bonne volonté, resteront des cadavres sous cette crête maudite.
C’est toujours le même
infernal bombardement, on dirait une faucheuse fantastique qui rase tout,
tellement elle fait la navette de droite à gauche.
On est complètement démoralisés et incapables de bouger tellement on est étourdis par ce roulement de tonnerre.
On s’endort enfin par ce bruit, jusqu’au moment où un éclatement tout proche vient nous tirer de nos rêveries. De stupeur la secousse vous remue un peu, on tressaille et cinq minutes après on se rendort de plus belle.
Combien sont longues ces journées atroces, en attendant la mort en sommeillant et quand le sommeil nous quitte, cette maudite soif nous ronge d’un autre côté et il faut l’endurer quand même. On pourrait manger, mais qui voudrait rentrer dans ce gosier desséché et brûlé par cet alcool que nous avons bu précédemment. Et cette odeur que nous ne pouvons chasser de nos bouches, voilà pour nous le véritable ennemi.
Ce n’est pas le boche, au contraire quelle joie pour nous si nous voyions seulement arriver cette race détestée en des jours pareils. Ce serait d’abord le bombardement interrompu et pour nous la vie ou la mort chèrement disputée. De temps en temps le moral nous revient et chacun se dit que chez eux, aussi sans doute, ils endurent les mêmes souffrances que nous autres en ces moments.
De temps à autre, nous
regardons d’un œil hagard les brancardiers transportant des blessés, véritables
loques humaines et on envie malgré tout leur sort, s’ils réussissent à se tirer
de cette fournaise pour des lieux plus cléments.
Nous restons là accroupis avec notre soif, sous cet ouragan de fer et de feu, qui passe au-dessus de nos têtes. Par terre que traînées de sang, quelle vie et vue atroces, comment chasser à jamais ces terribles choses de notre cerveau ?
Et n’importe où nous nous trouverons, nous ne pourrons jamais oublier cette vie atroce gravée dans notre esprit.
Tout maintenant nous semble
indifférent, tout a une limite dans les forces humaines.
Si le bombardement cessait, peut-être pourrait-on faire quelque chose d’utile ?
Aussi chacun reste où il se trouve, moine silencieux, seul le cerveau travaille, on pense à tout et à rien, on se pare des éclats, maintenant avec notre sac, puisque nos tranchées sont comblées au trois quarts, du moins ceux qui le retrouvent encore dans ce fouillis où tout est enterré, fusil, équipement, musettes. Nous sommes transformés en vraies épaves de pierres vivantes. Seul le regard brillant de fauve nous reste encore, nous avons le teint jaune cireux et c’est avec pitié que l’on attend. Quoi ?
On ne saurait le dire. De quoi sommes-nous capables si ce n’est de nous faire tuer si la destinée bon lui semble.
Jeudi 24 mai 1916
La nuit et une autre journée se passent ainsi et vers sept heures du soir tout s’arrête en moins de cinq minutes ; on croirait une action de fée qui, avec sa baguette magique, aurait tout apaisé ou alors un miracle.
Oh quel impressionnant silence !
« Debout ! »
crie notre capitaine
« Baïonnette au canon
et montez tous sur les parapets, les boches viennent ! »
Ce cri aigu retentissant dans ce moment calme agit sur nous comme un ressort.
Le fusil en main chargé tout prêt et d’un bond on grimpe à la rencontre et on se demande d’où sortent toutes ces loques humaines. Mais qu’importe, tous bien décidés à faire payer cher à l’ennemi ces souffrances sans nom depuis notre arrivée.
Les fusées rouges partent de
toute la ligne, c’est le signal pour notre 75 qui, maintenant, lui aussi se
réveille et à son tour joue la danse que les boches connaissent bien. Et ce
changement de bruit, mêlé au crépitement de nos quelques survivantes
mitrailleuses, nous fait sortir des bravos de notre long silence. La vague
ennemie est décimée à son tour ne croyant sans doute ne trouver que désolation
et cadavres.
Viendront-ils jusqu’à nous ?
Le tonnerre bat son plein,
les bras, les jambes volent en l’air, en cinq minutes tout est balayé, cinq ou
six arrivent sans armes, les bras en l’air au pas de course, en criant « Kamerades, kamerades »,
tous à peu près blessés, et hélas aussi pâles et l’air fatigué autant que nous.
Tout n’est pas rose aussi sans doute chez eux. L’attaque pour eux a donc échoué, tout rentre dans le silence à présent et on revient dans notre ligne de départ le cœur content malgré tout. Les boches, furieux sans doute de leur dure leçon, recommencent la séance d’artillerie mais c’est plutôt sur les artilleurs, qu’ils croyaient bien aussi tous anéantis.
Mais cette soif un instant oubliée, mêlée avec la fatigue, nous reprend toujours aussi féroce.
Mais soudain on vous annonce la relève pour six heures, nous patientons. Donc la relève de l’espoir de pouvoir bientôt assouvir notre souffrance première.
Minuit, rien encore, vont-ils arriver ces remplaçants ?
Mais on n’ignore pas aussi les difficultés sans nombre qu’ils vont trouver sur leur route et il nous suffit de nous rappeler notre triste randonnée quelques jours auparavant pour arriver au four et, sans murmurer, on est aux aguets pour partir.
Enfin, vers une heure et demie ou deux heures, nous voyons arriver le 150ème en silence.
On se hasarde à leur
demander un peu d’eau et d’un bon cœur ils nous autorisent à avaler une lampée
dans leur bidon, n’osant pas trop
abuser sachant que demain eux aussi auront à lutter comme nous avec cette ennemie,
la soif, si le temps se maintient ainsi.
Maintenant, pour nous, il s’agit de pouvoir s’en aller et faire au
moins tout son possible pour sortir de la zone dangereuse avant le jour. On se
demande comment on va faire, on est engourdis, courbaturés, fiévreux.
Aussi nos chefs, n’ignorant point l’état où nous sommes, nous donnent
un point de rassemblement où les traînards pourront trouver les premiers
rendus, sage précaution.
On part donc et, par petits groupes dans la plaine, nous marchons dans
la direction de l’arrière, arrosés de temps à autre par la rafale. Mais peu
nous importe, arrivera qui pourra, les plus forts lâchent les plus faibles, on
se tire de ce mauvais pas comme l’on peut.
Et quand au petit jour, morts à moitié d’épuisement, nous arrivons au
lieu-dit les bois Bourrus, là, quelle aubaine !
Nous attend un ruisseau « Oh ciel ! La Claire » nous dit-on, pourtant
bien trouble.
A quatre pattes, comme des moutons, on se régale, que c’est bon et bien
repus on lave un peu nos visages crasseux et de peur de manquer de cette si
bonne eau, on se remplit plein nos bidons.
Car nous avons encore quelques heures de marche nous dit-on, pour nous
embarquer en autos jusqu’à Brillon, loin
d’environ 50 km
de cet enfer du Mort-Homme, si justement bien nommé en la circonstance
(24 mai 1916).
25 mai 1916
Notre voyage dans ces autos fut bien monotone car je serais bien en peine de dire par où nous sommes passés (sauf en traversant la ville de Bar-le-Duc où nous fîmes un long arrêt) car sitôt installés, le sommeil s’empara de nous et rien au monde nous empêchera de dormir sinon qu’à cet arrêt de Bar où les gens aimables nous secouaient de sur nos banquettes pour nous donner soit friandises ou cigarettes.
Et sortant de notre torpeur c’est à peine si on leur dit merci et pourtant cette ville me rappelle maints souvenirs.
Là tout près, habitent mes deux frères qui sans doute sont inquiets de mon sort. Vite, sortant de ma rêverie je griffonne deux mots et par l’intermédiaire du premier passant, je passe ma lettre où on l’accueille d’un gracieux sourire.
Et nous repartons donc pour Brillon, laissant Bar, où je ne me serais jamais douté qu’un an plus tard je devais à nouveau refaire le même voyage dans des conditions guères meilleures.
A quelle heure sommes-nous arrivés à destination, on ne saurait le dire. Il a presque fallu nous tirer de nos postures pour nous conduire à nos cantonnements où très tard le lendemain on se réveille de nos granges au milieu de braves gens s’apitoyant de nos misères et de nos mines cadavériques.
Désormais, c’en était fait de mon entrée dans cette grande guerre et pour mon baptême du feu, au dire des camarades, on ne pouvait pas demander mieux.
Et, à cause de mon nom Bordinat, étant un peu long, il fut abrégé en Cadorna, nom du général italien à cette époque.
Dorénavant, je ne fus connu que par ce nom et loin de m’attendre en ce temps là que je devais traîner mes guêtres avec le 151ème sur tous les champs de bataille, par la suite, jusqu’à ma démobilisation.
Notre séjour à Brillon fut assez court, juste le temps de se refaire un peu l’estomac délabré et de reformer notre régiment, hélas bien amoindri ; et pour renforcer notre premier bataillon je change de compagnie et passe à la 2ème sous les ordres du capitaine Bertrais, que je connus par la suite, pour un des officiers, le meilleur ami de ses hommes et que plus tard, après avoir été blessé, je fus sous ses ordres, étant chef de bataillon provisoire.
Donc je profitais de ce petit séjour pour aller causer avec mes frangins étant toujours à Bar n’étant distant que d’une dizaine de kilomètres de mon cantonnement et chargé comme bien on le pense, leur racontant mes premières impressions arrosées avec du bon pinard.
Accompagné de mon frère Paulin, je rentre avec lui au cantonnement où on trinque à nouveau avec les camarades d’où il repartit un peu triste malgré tout.
30 mai 1916
Le 30, à quatre heures du matin, déjà nous traversons la ville de Bar encore toute endormie pour aller nous embarquer à Longeville et c’est d’un œil inquiet que je passe vers le cantonnement de mon frère Albert, sans doute ne se préoccupant pas le moins du monde de moi en ce moment, en me disant, le reverrai-je à jamais. (30 mai 1916)
Juin 1916
Après avoir traîné pas mal de temps en wagon, nous venons échouer à Barisey-la-Côte où il nous faut faire encore 8 à 10 km à pied pour enfin arriver dans un petit pays des Vosges appelé Autreville. Très bien reçus, nous trouvons du bon lait, des œufs, enfin de quoi nous donner de nouvelles forces.
On comptait après nos dures misères y rester quelques temps lorsqu’au diable du 8 juin, nous remontons à nouveau dans ces satanées autos où à chaque fois dorénavant ce sera de mauvais présages pour nous, pauvres fantassins.
Car si on nous a baptisés « héros » par ce mot célèbre connu à Verdun, on pouvait bien ajouter martyr infanterie, car pendant cette longue guerre, si quelqu’un a plus souffert que le fantassin, celui-ci ne le croira jamais.
Après avoir traversé les villes et villages de Tantonville, Bayon, Lunéville, nous arrivons le soir dans un beau petit pays lorrain appelé Thiébeauménil où le lendemain nous devons relever le 100ème de ligne où les hommes du secteur nous disent que nous avons beaucoup de chance de venir dans ces parages mais quelques-uns en voyant nos compagnies de 30 à 40 hommes nous demandent où sont les autres.
« Allez à Verdun » leur répond-on et vous les verrez endormis à jamais et nous avons su par la suite qu’eux aussi devaient faire la connaissance de Verdun, réellement pas si tranquille qu’en Lorraine.
Alors réconfortés par les uns et les autres qu’ici c’est le rêve, nous partons donc le 9 au soir faire la connaissance de cet endroit charmant en passant par le village de Laneuville-au-Bois évacué depuis 1914, pour aller occuper la gauche nord-est du hameau d’Emberménil à une quinzaine de kilomètres de la frontière, dans des tranchées merveilleuses et bien aménagées.
Nous passons une huitaine aux avant-postes où étant un soir avec un camarade de Dijon, Bernay blesse par erreur un sergent, croyant avoir affaire à un boche. Après avoir été en réserve quelque temps à proximité de Laneuville à côté d’une source d’eau minérale dite La Laxière, très bonne ma foi et à bon compte vous le pensez bien, car nous sommes propriétaires dans ces parages.
L’activité dans notre secteur consistait plutôt à s’armer de la pioche et la pelle, laissant nos fusils en repos, à moins que d’être patrouilleur comme il arrive de temps en temps.
Et je me souviens qu’un soir notre lieutenant ayant organisé une embuscade, nous tirons un sergent et le rapportons à Emberménil où sur son livret nous apprenons qu’il est père de petits enfants et porte le numéro 4ème Bavarois des premières troupes allemandes du début 1914 qui fusillèrent deux civils du bourg d’Emberménil.
Et où nous partons tous les jours, leurs noms étaient inscrits sur un mur à la sortie gauche du pays, face à l’ennemi.
À part quelques petites escarmouches et chicanes, d’un côté et de l’autre où chacun joue au plus rusé, notre temps se passa ainsi tout l’été 1916.
Juillet-août 1916
Après avoir été une huitaine de jours à Marainviller où nous nous trouvions le jour de la fête du 14 juillet où nous avons le plaisir de déguster cette bonne bière lorraine si usitée dans la contrée, à Croismare également nous y passâmes un petit repos et mon plus grand souvenir en ce pays, c’est d’avoir été dévoré, ainsi que mes camarades, par les puces.
Entre temps, des bruits de départ du secteur circulent. On apprend que dans la Somme, une offensive anglo-française est commencée et on murmure fort d’y aller aussi prochainement.
Et, effectivement, le 22 août nous sommes remplacés par des cuirassiers fantassins et de nouveau recouchons à Marainviller.
Le lendemain à 9h du matin nous repartons par un beau temps, traversons Lunéville où nous rencontrons mon ancien régiment 27ème ligne se rendant dans nos secteurs que nous quittons et arrivons à Blainville-sur-L’eau pour repartir encore le lendemain dans un petit pays appelé Moriviller où nous restons une huitaine de jours au repos.
Le 29 août, à l’occasion de l’anniversaire de la petite ville martyre de Gerbéviller, notre compagnie s’y rendit en hommage. Une poignée d’hommes en 1914 retardèrent plus de 24h une armée ennemie, et, pour se venger, l’ennemi brûla le tiers du pays et grâce au dévouement de sœur Julie qui par ses supplications sauva un quartier rempli de nos blessés, aidée du prêtre de la paroisse.
Après nous être entretenus quelques instants avec eux, nous les quittâmes en les félicitant et à tour de rôle nous leur serrons cordialement la main et rentrons à notre cantonnement.
Le lendemain, nous visitons Rozelieures, célèbre par la bataille du 27 et 28 août, qui arrêta la ruée ennemie et la repoussa même à quelques lieues de là, dégageant à jamais Gerbéviller et la contrée.
Nos chefs nous refont le tableau de ces jours mémorables et nous quittons cet endroit tous émus à la vue de toutes ces petites croix, où reposent nos frères à l’ombre de ce clocher élancé de Rozelieures, que l’on aperçoit devant nous dans cette belle plaine lorraine.
Au bout de quelques jours passés d’un côté et de l’autre en excursion, le 4 septembre nous quittons notre cantonnement, en passant par Froville et Bayon où le Général Berthelot commandant notre corps d’armée 32ème à cette époque, nous passe en revue de défilé au milieu de la ville et allons coucher dans un petit village appelé Crèvechamps sur les bords du canal de la Marne.
Après avoir stationné quelques jours, le 10 à midi par une chaleur torride, nous partons embarquer à Pont-Saint-Vincent, le soir pour une destination inconnue alors, mais nous nous doutons fort bien que ce serait la Somme où chaque jour nous apprenons quelques nouveaux succès à notre avantage. (11 septembre 1916).
La bataille
de la Somme 1916
Septembre 1916
Notre trajet en chemin de fer s’effectua très doucement sans encombre quoique nous ayons tous un brin de cafard. Cette maladie imaginaire qui veut dire beaucoup de choses.
Et quand notre train fut autour de Paris, car le transbordement de l’est au nord-ouest pendant la guerre se fit toujours par cette route, grande ceinture Versailles, et comme on le pense si on a le cœur gros quand on revoit des villes et villages connus et qu’il suffirait d’un saut hors du train pour accourir chez soi, en se disant encore une fois : « reverrai-je les miens ? ».
Il faut se raidir entre les tentations qui vous taquinent de tous côtés.
Bref, tout rentre dans la normale et le 13 septembre nous débarquons dans l’Oise, à Granvilliers, et allons cantonner à Dargies, à quelques kilomètres de là, où le bruit du canon déjà retentit à nos oreilles à nouveau.
Après avoir passé quelques jours dans ce petit pays où je suis logé chez la sœur d’un prêtre (lui étant mobilisé), nous prenons les autos en passant par Amiens, Villers-Bretonneux et à Bray-sur-Somme où nous campons dans un champ sur la terre mouillée car il pleut à torrent.
Nous passons une mauvaise nuit et déjà la misère noire va recommencer.
Le lendemain tout de même, on nous conduit dans des baraques à Priant, bien connues du troupier.
Le 20 septembre de nouveau, nous remontons en auto et quelle ne fut pas ma grande surprise en embarquant, de trouver mon frère Aristide, employé dans ces services et que n’étant jamais parvenus à nous rencontrer encore depuis de début de cette malheureuse guerre.
Que d’émotion !
On ne sait quoi se dire, bref je grimpe avec tout mon fourbi à côté de lui sur le siège et chemin faisant, nous reparlons un peu de toute la famille. Que de choses n’avons nous pas dites jusqu’à Maricourt où on descend et c’est le cœur bien gros, encore une fois, que l’on se quitte.
Et après des adieux touchants, chacun y va de sa larme en se souhaitant bonne chance surtout pour moi car j’ai su plus tard, quand l’orage fut passé, que mon frère pendant la tourmente ne cessait de se dire en lui-même s’il doit y rester là-bas, j’aurais toujours un remords de conscience me disant que c’est moi qui l’ai conduit au tombeau, et c’est avec joie qu’un mois plus tard nous nous retrouvons à nouveau cette fois en permission à Paris.
De Maricourt, pour aller en ligne, nous faisons comme toujours le reste du chemin à pied.
Où enfin après mille péripéties, nous arrivons à une heure du matin relever le 25ème bataillon de Chasseurs à pied, en avant de Rancourt sur la route de Bapaume à Péronne, en face du cimetière que nous avons pour mission d’enlever une fois l’ordre donné.
Nous restons donc en place quelques jours et, la nuit, allons chercher notre ravitaillement à Maurepas ou Leforest où nous ne retrouvons même plus la trace de pierre et le véritable aspect de Verdun nous frappe à nouveau.
La soif ne fut pas si dure, nous buvons l’eau verdâtre des trous d’obus à proximité de nous.
25 septembre 1916
Le 25 par un soleil de septembre magnifique (en revanche de notre échec de Champagne l’année précédente où le régiment subit des pertes très élevées), appuyés d’une artillerie formidable qui bombarda les positions ennemies soixante dix heures durant, nous partons à l’assaut vers une heure du soir, enlevant ce fameux cimetière, le village de Rancourt et les tranchées fortifiées dites Portes de fer, sans trop de pertes, en trois quarts d’heure sous les ordres du commandant Oblet. Le bataillon avait capturé 400 prisonniers et conquis 1500 mètres de terrain en profondeur.
Ma compagnie, sous les ordres du capitaine Bazailles et du lieutenant Conduzorgues, s’acquitta de sa tâche avec un entrain merveilleux, malheureusement le soir nous eûmes à déplorer la mort de quelques-uns de nous par le tir de nos 75, sans doute mal réglés, si bien que nous dûmes rétrograder quelque peu.
En ce moment, je fus décoiffé brusquement par une balle ennemie ricochant sur mon casque (je l’avais échappé belle). (25 septembre, 4h du soir).
Nous passons la nuit l’œil aux aguets, dans la crainte d’une contre-attaque ennemie, mais en vain. La dure leçon du jour leur avait sans doute suffi.

Charles BORDINAT semble assis à droite,
à l’arrière du camion
Le 26 au soir le 3ème bataillon nous remplace. Il devait continuer et entamer le bois St-Pierre-Vaast si possible mais, après des pertes sévères, il dut tout abandonner et organiser le terrain conquis.
Nous autres, 1er bataillon, placés en réserve dans Rancourt même, sur le bord d’une grande route traversant le pays et marmités effroyablement de l’ennemi. Et nous aussi, on travailla dur et ferme à l’organisation d’une tranchée de deuxième ligne en bordure de cette route.
On creusa sans relâche et la chaleur était encore assez forte. On subissait une période de sécheresse et pas de ravitaillement comme bien souvent il arrive dans ces conditions.
On chercha de l’eau dans ce pays car il y a bien une mare derrière nous mais l’eau est tellement verdâtre et en plus l’ordre nous est donné de n’en pas boire et même de celle des puits dans la crainte d’être empoisonnée par l’ennemi et en plus du fait de nos obus à gaz lancés dans le pays pour en chasser les boches.
Nos recherches, malgré tout, ne donnèrent aucun résultat et la soif comme toujours nous fait le plus souffrir du fait qu’en ces moments durs on est toujours fiévreux.
Malgré les ordres, vers 10 heures nous nous hasardons à boire tout de même de cette eau de mare pourtant guère appétissante. On verse quelques gouttes d’alcool de menthe et, à petites gorgées, on satisfait tout de même notre douleur. On se renhardit même plusieurs fois et elle nous semble de plus en plus bonne.
Nous étions sauvés de la soif encore une fois car l’eau était rare aussi dans ces parages.
Il en existait sûrement dans le pays mais où la trouver dans ce tas de décombres car notre artillerie avait tout pulvérisé, et en ce moment celle de l’ennemi achevait de détruire ce qui pouvait rester car il n’y fait pas bon, je vous assure.
Car si nous avons des canons en quantité, l’ennemi nous répond bien et comme il arrive chaque fois après l’offensive, le maintien de la position conquise est toujours aussi meurtrier sinon plus que l’attaque. L’ennemi rassuré, voyant nos travaux de défense, se vengea de son échec en nous marmitant avec rage.
On se gare comme on peut dans nos tranchées creusées à la hâte, nous efforçant sans cesse de les améliorer le mieux possible.
Vers trois heures, un méchant obus du calibre 88 à tir rapide éclate en plein dans la tranchée, tuant et blessant huit de mes camarades de la section.
Moi, je suis à moitié enseveli vivant, quoique fortement commotionné, ne me rendant pas compte du dégât, j’appelle au secours et tout ahuri on me dégage sans égratignure, mais je vomis le sang à pleins poumons.
M’estimant heureux malgré tout en voyant la triste hécatombe autour de moi, on me conduit auprès du capitaine Bazailles, lequel me dit d’aller me faire soigner au poste de secours, mais ne me sentant malgré tout aucun mal, je refusai de m’y rendre.
Néanmoins, il insista et me pria par la même occasion de conduire en même temps notre malheureux aspirant (*) blessé aux yeux, ne pouvant s’y rendre seul. J’obéis puisque moi je voyais bien et à nous deux, on part, risquant d’être écrabouillés à chaque pas et ne connaissant pas bien notre direction dans ce nouvel enfer.
Enfin avec de la patience et du sang-froid, on arrive à trouver ce fameux poste de secours.
(*) : Il s’agit certainement de l’aspirant VERREMAN Albert de la 2e compagnie,
matricule 10613.
Vous décrire mon trajet serait impossible, en conduisant mon malheureux camarade par la main me priant de faire le plus vite possible, gémissant de sa terrible blessure, m’insultant au besoin en attendant l’éclatement proche d’un obus, me disant que sûrement je me trompais de chemin que j’allais le faire tuer, trouvant le trajet interminable.
Voyez avec quel courage je devais faire face, je le réconfortais de mon mieux, de prendre patience que nous allions arriver bientôt, et que le major allait le guérir certainement, lui répétant plus d’une fois :
« Dans cinq minutes nous allons arriver »
Et, sans rien
exagérer, le poste étant bien éloigné de 1500 mètres de nous.
Dans ce terrain bouleversé, battu sans relâche par la mitraille, demandant le chemin le plus court à celui que l’on rencontre rarement dans des tourmentes semblables et toujours pressé on le devine, on vous répond évasivement :
« Vous êtes dans la direction, marchez toujours »
Ou bien encore :
« Je n’en sais
rien, débrouillez vous ! ».
Bref, en fin de
compte, c’est le meilleur système ce système « débrouille », alors débrouille
qui peut, c’est la guerre et au petit bonheur la chance, comme on dit en ce
cas-là.
Après avoir fait peut-être bien plus de deux kilomètres, je remis mon protégé dans les mains du docteur ou major, il m’embrassa comme un grand enfant de son visage ensanglanté, me remerciant de son mieux et me souhaitant le bonheur le plus inimaginable, et, tout confus, j’attendis le pansement de lui et de plusieurs autres gravement atteints et explique mon cas, mais que voulez-vous me répondit-on, nous n’avons absolument rien de réconfortant, reposez-vous dans la tranchée ici derrière et demain vous retournerez rejoindre vos camarades.
Ne croyez point que ce petit poste est en lieu sûr, loin de là, les obus n’y regardent pas.
Je me reposai du mieux que je pus et le matin au petit jour, je repartis à mon poste sans rien dire à personne car là bas au moins il y a de l’eau de la mare, tandis qu’à ce poste de secours, si on peut appeler cela de ce nom, on y meurt de soif et de faim.
Au diable ce poste !
J’arrivai sans trop de fatigue, le bombardement était un peu ralenti et après avoir de nouveau bu un coup, je racontai mon voyage au capitaine qui me félicita et me proposa derechef pour la croix de guerre. (27 septembre 1916, Rancourt).
Pendant ces 5 jours de combats, le régiment déclare la perte
d’environ 500 hommes tués, blessés et disparus (JMO)
Fin septembre 1916
Nous restons donc à cet endroit encore quelques jours. On organisa le ravitaillement et par ces nuits d’automne, nous allions jusqu’à Maurepas ou Leforest à plusieurs kilomètres, trébuchant à tout moment dans les trous d’obus, rapportant bien peu de choses : de l’eau de vie, du vin, et un peu de pain avec quelques morceaux de viande saupoudrés de terre et de poussière.
Jusqu’au 30, samedi soir, nous vécûmes dans ces conditions où le 154ème releva les débris de notre régiment.
Nous quittons donc ce coin historique pour notre régiment qui lui valut une citation élogieuse et, en plus, acquit le nom de régiment de Rancourt en souvenir de la prise du pays où, le même jour, les Anglais, aidés aussi des français, enlevaient le village fortifié de Combles, de même que Bouchavesnes à notre droite.
Octobre 1916
Sans trop d’encombre, nous allons cantonner dans un camp auprès de Chipilly, dans un bois, construit en baraques, du nom de camp des Celestins où, pour la première fois depuis mon entrée dans ces misères sans nom, j’allais revoir ma famille en permission, et d’où je pars le 1er octobre pour 6 jours, tout exténué et heureux malgré tout, comme on le pense bien, de m’en être tiré encore une fois à si bon compte.
La permission, quelle joie pour les troupiers !
Désormais on ne vivra que pour cela, car le poilu qui arrive à la décrocher, après avoir subi des contrecoups semblables, est assez rare surtout à cette époque de 1916. Par la suite elles furent améliorées, et il faut entendre les camarades attendant aussi leur tour, vous crier :
« Ah le veinard ! Mon tour ne viendra-t-il jamais à moi
? ».
Après avoir serré la main à tous ces pauvres compagnons de lutte se lamentant à leur triste sort, on part le cœur allégé d’un énorme fardeau.
On se dit peut-être y aura t-il du nouveau. La guerre finira-t-elle pendant ce temps là ?
Que de projets éphémères ! On croit n’en pas voir le bout de ces six jours hélas !
Si vite écoulés pourtant.
Aussi ma permission fut complète étant cinq de la famille mobilisés.
J’eus la joie en passant à Paris de me trouver avec trois et au pays avec le quatrième et ce fut un grand hasard de nous trouver tous en permission à quelques jours près, chose rare et qui n’arriva plus par la suite.
Bref les jours s’envolèrent et il fallut repartir à nouveau et ce ne fut pas sans un serrement de cœur de quitter cette famille, avec toujours l’espoir que la prochaine fois, peut-être ce sera fini et alors ce retour mélancolique et ce cafard dont on a tant parlé.
Car c’est le moment le plus critique de ce mal inimaginable en pensant que peut-être ce sera la dernière fois que l’on se voit.
Et revenant d’être choyé comme on le pense bien et se rappelant ces dures fatigues qu’il faut aller surmonter de nouveau, et dieu seul sait dans quelles circonstances, je rejoignis donc mes camarades au même endroit où je les ai quittés une dizaine de jours auparavant, et chacun vous demande des nouvelles du pays, ce que l’on dit et ce que l’on pense et c’est le cœur bien gros qu’on raconte ce que l’on sait, avec un cafard terrible qu’il faut pourtant chasser de son mieux pour ne pas paraître ridicule et au bout de quelques jours, on reprend sa vie de troupier errant.
Le 13 octobre, ordre nous est donné de remonter en ligne au bois de St-Pierre-Vaast à l’endroit dont on avait arrêté lors de notre premier séjour en avant de Rancourt. Cette fois notre mission était de mettre le secteur en bon état et de maintenir l’ennemi coûte que coûte.
Dans cette deuxième période le temps était changé.
La pluie ne cessait de tomber tous les jours et dans ce sol argileux,
nous dûmes rester 21 jours dans la boue gluante jusqu’à la ceinture, nuit et
jour.
Si dans la première période nous avons eu à souffrir de la soif, cette
fois ce ne fut pas le cas.
De mémoire d’homme, ceux qui comme moi eurent à subir ces passages- là,
appelèrent la mort plus d’une fois.
En plus, la position était mal placée, l’ennemi étant à la lisière du
bois, mieux caché de nous, nous harcelant sans relâche de toutes sortes
d’engins où enlisés dans cette boue, il nous était très difficile de nous
mouvoir pour éviter ses coups.
Tous les soirs, à la tombée de la nuit, nous subissons des feux de
barrages où les obus par bonheur, dans ce sol boueux, n’éclataient que
difficilement, mais anéantissaient tous nos frêles travaux.
Et je me rappellerai toujours, ayant réussi à me construire un petit
abri dans la paroi de la tranchée, qu’un 77 eut l’audace de traverser le
parapet et de rentrer dans un petit trou, juste à côté de ma tête, et verrai
toujours cette chose brillante devant mes yeux, voulant y toucher avec ma main
et me sentant brûlé, je lâchais tout en déambulant au plus vite de crainte
qu’il n’éclate, inutile précaution car s’il avait eu à éclater, je ne serais
plus de ce monde.
Fatigué de rester debout dans cette nuit noire, pataugeant dans l’eau,
je demandai conseil au camarade le plus proche qui me pria de ne pas le
toucher, pouvant éclater d’un moment à l’autre. J’attendis donc encore quelque
temps sous la pluie battante et, fatigué, je m’armai de courage et avec
précaution je jetai mon hôte malfaisant derrière le parapet, sans le moindre
accident. Me repentant de n’avoir pas agi plus tôt et tranquille, je rentrai
dans mon petit trou tout transi de froid par la pluie.
Désespérant à jamais de sortir de ce bourbier, les pieds ankylosés, on
souffrait de la faim. Car la chose encore la plus pénible était le
ravitaillement, d’où il était forcé de fait, de faire à tour de rôle plus de
quatre heures dans la nuit.
À chaque instant, on s’enfonçait dans les trous d’obus remplis d’eau et
impossibilité d’en sortir seul ou forcé à y mourir comme ce fut le cas pour
beaucoup, voyez d’ici le tableau.
Bien souvent le ravitaillement était perdu dans ces trous et à l’arrivée, on partageait en frères ce qui avait pu arriver (vin ou pain) pour ne pas mourir de faim. J’ai été souvent obligé de partager un quart de vin et un tout petit bout de pain, sale de boue, avec quatre camarades, pour toute la journée.
Aussi les rangs diminuaient à vue d’œil, la moitié d’entre nous ont les pieds gelés à force d’humidité.
Les murmures commencent de toutes parts, on nous supplie de rester encore quelques jours, et malgré la bonne volonté de tous, on est démoralisés. Si le temps était beau on s’ennuierait moins mais pas un jour sans pluie. Nous sommes dans un état lamentable et remplis de boue, des pieds à la tête, engourdis de tous nos membres, nous maugréons à notre triste sort.
Enfin toute souffrance a un terme.
Novembre-décembre 1916
Après vingt et un jours passés dans ce bourbier ensanglanté, nous
sommes relevés par je ne sais quel régiment de Chasseurs (*) et
avec mille difficultés à marcher avec
nos pieds gonflés et, me souvenant que quelques-uns ayant eu le malheur de
quitter leurs souliers, ne réussirent plus à les remettre, et contraints
d’aller nu- pieds.
Tous, on a la sensation de marcher sur des épines ou des petits
cailloux tranchants, quelle souffrance ! Mais le courage nous aide et arrivons
au lieu-dit la ferme Le Priez où nous
passons encore trois jours en réserve dans des anciennes tranchées boches.
Pour tout abri, aux abords de
cette ancienne ferme, dont nous ne parvenons même pas à trouver l’emplacement,
nous couchons comme d’habitude en plein air et à proximité de notre artillerie,
ce qui contribue à nous faire marmiter et vraiment on attendait mieux que cela.
Moi et mon camarade Moreau,
désireux de nous reposer et de nous déchausser, depuis ces vingt jours, nous
piochâmes toute la journée pour dégager l’entrée d’un ancien abri boche, comblé
par les obus.
A la nuit, nous parvenons enfin à nous installer, si
on peut appeler cela confortablement, mais à l’abri de la pluie et du froid et
notre grand dessein de pouvoir nous étendre en toute sécurité était réalisé.
Déchaussés, quel soulagement et de quel profond sommeil dormions-nous quand,
soudain, dans la nuit nous fûmes réveillés par un bruit sourd et recouverts de
terre et de débris de toute sorte. Pas de doute, un obus sans doute
s’écrie-t-on, mais n’étant pas en trop mauvaise posture, nous y restâmes malgré
tout jusqu’au jour. Nous nous rendons vite compte du danger auquel nous avions
encore échappé cette fois.
Notre travail du jour précédent était à refaire mais, pour nous, il
s’agissait de sortir de notre trou, chose assez difficile, pas d’outils avec
nous. Nous sommes forcés de retirer cette terre boueuse avec nos mains pour
tâcher de nous faire entendre des quelques camarades non loin de là.
Au bout de quelques temps, nous sortons de cette mauvaise posture et
tant bien que mal, recommençons notre tâche, arrive qui voudra.
(*) : Il s’agit du 64e bataillon
de Chasseurs qui a relevé le 151e le 2 novembre 1916.

Extrait du
JMO : La boue…
Les deux autres jours se passèrent sans encombre et, reposés un
peu, le 13 au soir (*) nous partons très loin nous dit-on. Nous
traversons Combles tout en ruines et au jour arrivons enfin dans un petit
village.
Quelques heures après, gelés, exténués, hideux, sales, remplis de vermine, nous embarquons en auto au lieu-dit Suzanne, dans une petite vallée de la Somme et repassons à Villers-Bretonneux, Amiens et débarquons dans la nuit du 14 novembre à Gournay-en-Bray, loin encore une fois de ces champs de désolation.
Nous y restons une huitaine, nous réconfortant un peu avec ce bon lait de Normandie et rembarquons en chemin de fer, passant par Paris, Versailles et arrivons à Épernay. (**)
Nous allons cantonner dans un petit village appelé Le Baizil où nous nous reposons une quinzaine pour aller occuper un nouveau secteur entre Pontavert et Berry-au-Bac (***), sur les bords de la Miette, face à la ferme du Choléra le 14 décembre 1916.
L’année 1917 allait encore ajouter de nouvelles misères aux anciennes en ne voyant aucun résultat pouvant amener à la fin.
(*) : Il s’agit du 6 novembre,
les souvenirs d’Auguste sont inexacts.
(**) : Le régiment y est arrivé
le 14 novembre au soir.
(***) : Le régiment y est arrivé
le 3 décembre.
1917
Après avoir occupé ce nouveau secteur très calme en ce moment là, où de temps en temps nous allions passer quelques jours au repos soit à Roucy ou à Bouffignereux. Enfin, c’était plutôt un secteur de repos où nous trouvions à peu près ce que nous voulions et n’étions pas trop malheureux.
Entre temps arrive un nouveau capitaine à la compagnie, du nom de Vernas.
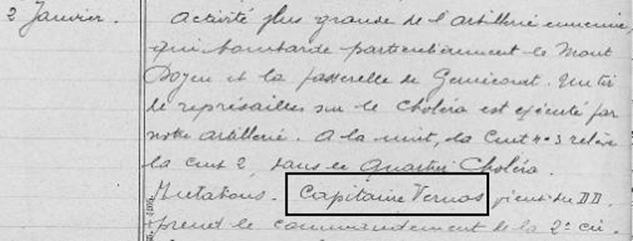
Un brave Parigot qui me choisit comme ordonnance et le 22 janvier 1917, nous partons tous les deux à Ay où il devait faire un stage de quinze jours et moi lui soigner son cheval.
Bien nous en prit car la gelée à cette époque prit si fort que, de mon existence, je ne me souviens pas avoir vu. Je plaignais les camarades laissés aux tranchées par ce froid terrible pendant que moi je couchais, chose rare, dans un bon lit bien chaud, me trouvant un privilégié en la circonstance.
Mon stage à Ay me rappelle encore un heureux souvenir.
Que ne vois-je pas un beau matin en allant déjeuner : la section d’autos du numéro de mon frère Aristide, celui que déjà j’avais le bonheur de rencontrer dans la Somme. J’eus tôt fait de le trouver et pensez quelle nouvelle joie encore.
Cette fois nous étions plus gais qu’à notre première rencontre sur la Somme.
Nous passâmes une bonne journée malgré ces froids si durs et le soir partageai mon lit avec lui. Il devait repartir dans la nuit dans la direction de Châlons-sur-Marne.
Dans la maison où nous logions au 58 rue de Châlons, la concierge, une Berrichonne comme nous, nous reçut en vrais compatriotes ; bien réconforté, je pris congé de mon frère vers 2 heures du matin. Je ne pus refermer l’œil de la nuit en pensant aussi à toutes nos misères, lui, dirigeant sa voiture d’un froid pareil où on risque à tout moment d’être congestionné et j’avais presque honte dans ce bon lit en réfléchissant à toute sorte de chose.
Février 1917 Aisne : Gernicourt
Le 7 février, je prépare les malles de mon capitaine, nous quittons Ay le lendemain, moi avec le cheval, mon capitaine plus heureux obtint une permission pour aller embrasser les siens à Paris.
Toujours par un froid aussi vif, après avoir couché en route, je trouve mon régiment le 10, dans un petit pays à quelques kilomètres de Condé-en-Brie où je regrettais mon bon lit d’Ay, car n’ayant pu trouver pour coucher comme toute fortune que la porcherie du maire où, enfoui dans la paille avec mes camarades, nous avons de la peine à nous réchauffer.
Le 16, une revue est effectuée par le Général DEVILLE et le général de corps d’armée où on décore le drapeau de notre régiment de la croix de guerre. (*)
En même temps les officiers, sous-officiers et soldats m’ont décoré par la même occasion en raison de ma belle conduite à Rancourt le 25 septembre 1916, on me décerna la croix de guerre.
Le Général Deville, ancien colonel du régiment, félicita le régiment 151 de Rancourt, retraçant ces glorieux passages à cette époque et réconfortant tous ces hommes aux trempes d’acier de ne point faillir à leur devoir, que la lutte serait encore longue mais certaine du triomphe.
(*) : La 42e division d’infanterie (8e et 16e chasseurs, 94e, 151e et 162e RI) est
citée :
« Division
d’élite, qui a pris la part la plus glorieuse à toutes les opérations les plus
importantes de cette campagne, la Marne, l’Yser, l’Argonne, la Champagne,
Verdun. Sous la direction énergique du général DEVILLE vient de donner en
septembre 1916, de nouvelles preuves de son esprit d’offensive sue la Somme, en
enlevant des positions fortement organisées et âprement défendues.
Les
8e et 16e chasseurs, 94e, 151e et
162e RI se sont acquis de nouveaux titres de gloire. »
Nous quittons donc cette belle cérémonie qui avait lieu à Condé-en-Brie et rentrons à notre cantonnement où j’ai dû arroser ma belle croix avec mes camarades, comme c’était la tradition. Je me couchai tout ému dans ma porcherie où la température commence à se radoucir (16 février 1917).
Le 19, avisé de mon départ pour ma deuxième permission où profitant de deux jours supplémentaires, comme c’est réglementaire à tous les décorés. J’en profite pour passer voir mes vieux parents dans le pays où j’ai été élevé à Farges dans le Cher, où je fus reçu à bras ouverts, ainsi que tous les amis de mon enfance.
Me restant 7 jours, je me rendis par les voies les plus rapides au domicile conjugal où ma femme m’attend avec impatience, heureux encore une fois d’être réunis.
Après mille gâteries, il faut repartir avec cet infernal cafard, recommencer cette vie de manant et de bohémien.
Comme à l’habitude, je passai par Paris où je profite pour rendre visite à ma famille où à chaque fois je fais une halte d’une journée après un voyage monotone comme il arrive à un permissionnaire qui rentre. Je retrouve mon régiment en ligne au même endroit où nous étions auparavant. Pour moi il y avait du changement : pendant mon absence, mon capitaine a été nommé adjudant-major au 3ème bataillon.
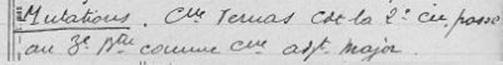
Je le rejoignis dans le petit village de Gernicourt, j’allais donc quitter mes vieux compagnons d’armes car les bataillons d’infanterie à cette époque se remplaçaient les uns aux autres de la 1ère ligne à la deuxième.
Depuis notre retour dans le secteur, bien des changements étaient faits. C’est ainsi que deux régiments de la 42ème division d’infanterie et 162ème formaient la 69ème division avec le 267ème de réserve et de même que les bataillons, on se relevait réciproquement à tour de rôle (6 mars 1917).
Mars-Avril 1917 : Aisne : Gernicourt, Sapigneul, L’attaque du Chemin des Dames
On murmurait fort aussi qu’une attaque de grande envergure se préparait à cet endroit et les grands travaux entrepris à ce sujet nous permettaient de n’en pas douter.
En cette année 1917, les perfectionnements de notre outillage de guerre commençaient à se faire sentir : fusils mitrailleurs en abondance, tromblons à lancer les grenades, revolvers pour les grenadiers, fusées de cinq ou six sortes, bref ce qui augmentait le poids toujours croissant du fantassin.
De plus, le masque à gaz était rectifié, vu le nombre de plus en plus nombreux des obus à gaz. Jusqu’à cette époque, je n’ai pas eu à souffrir de cette méthode monstrueuse quoique l’emploi dans plusieurs endroits nous causait des pertes douloureuses.
Mais aussi, à partir de cette époque, ce fut un développement toujours croissant de part et d’autre et un ennemi de plus pour les combattants qui devenait de plus en plus terrible tous les jours, faisant autant de ravages dans notre artillerie que dans l’infanterie.
Le seul moyen de s’en préserver était le masque qu’il fallait toujours porter avec soi aussi précieusement qu’un talisman et retransformé de temps en temps suivant les progrès du gaz employé entre temps.
À cette époque nous nous trouvons donc en réserve au village de Gernicourt, recouvert d’une épaisse couche de neige, très tranquilles et bien à l’aise dans ce petit village, n’étant presque jamais bombardé malgré qu’ayant beaucoup souffert en 1914-1915.
L’ennemi se rendait compte de nos desseins futurs, il entreprit le bombardement systématique du pays où il nous causa d’énormes pertes. De ce changement si soudain et à partir de ce jour, le secteur changea d’aspect. Il devint meurtrier de plus en plus où il nous fallait malgré tout exécuter des travaux en vue de cette attaque projetée et désormais recommençait pour nous la vie d’enfer de nos jours malheureux.
Le 10 mars, notre bataillon 3ème, que je ne devais plus quitter de ma campagne, alla passer quelques jours de repos à Bouffignereux. Nous croyant en sécurité, nous fûmes copieusement marmités où pas un obus n’était tombé depuis 1914, d’où force aux habitants civils de quitter le pays pour échapper à une mort inutile et tous les jours il en fut ainsi dans des villages avoisinants tel que Rouey et autres dont les noms m’échappent.
De notre côté, notre artillerie toujours croissante de jour en jour s’installait en silence, ne tirant que le moins possible afin de ne pas se démasquer avant l’heure venue et le 15 au soir nous allons à notre tour relever un bataillon du 162ème aux lieux-dits Sapigneul et la Sucrerie, où après la fonte des neiges, nous pataugions encore une fois dans la boue implacable.
En face, la fameuse cote
108 d’où l’ennemi nous dominait de partout, très nerveux, il nous harcelait
au moindre geste. Soit qu’il était impatient de nos gestes ou craignant
l’attaque imminente (car nous savions que Noyon et les environs étaient
reconquis) et l’ennemi battait en retraite. (*)
Il ne nous laissa pas le moindre repos faisant des coups de mains fréquents avec ou sans résultat mais d’une nervosité à toute épreuve.
(*) : Non, les Allemands ne
battaient en retraite, ils venaient d’exécuter un audacieux recul stratégique,
pour raccourcir leurs lignes.
Le 23, le deuxième bataillon de 267 nous remplace et allons en réserve dans le village de Cormicy où l’ennemi ne cesse de bombarder tous les jours et là, malgré tout, nous couchons dans les maisons où je suis cantonné avec mon capitaine dans la maison abandonnée du docteur le 24 mars 1917.
Après avoir passé quelques jours de repos, nous partons de nouveau occuper Berry-au-Bac, complètement démoli, et nous sommes installés sous la voûte de l’Église, transformée en poste de commandement.
Comme partout le marmitage faisait rage afin d’empêcher nos préparatifs qui commencent à prendre tournure. Ne l’oublions pas, la préparation d’une attaque à cette époque nécessitait un travail monstre d’au moins quelques mois et au moyen de l’aviation, l’ennemi était renseigné sur nos points sensibles, gênant l’accomplissement au prix d’immenses sacrifices pour nous, nous coûtant plus de pertes bien souvent que l’attaque.
De même que l’organisation du terrain, une fois l’avance faite et d’où, bien souvent, on ne se rend pas compte de la grandeur de cette tâche accomplie par les unités y contribuant à ces moments pénibles.
De notre côté, notre aviation, perfectionnée et augmentée, commençait à se donner de l’air et tenir tête à celle de l’ennemi, si supérieure jusqu’à ce jour. On espérait en son concours pour cette grande offensive proche, dont on se voyait l’éloge vantée un peu trop par nos gens d’arrière car à cette époque, aux yeux des fantassins, on la considérait comme une arme de fantaisie sans se soucier le moins du monde de son utilité.
Quelques-uns malgré tout de ces aviateurs embusqués, comme on les appelait à cette époque, faisaient bravement leur devoir et en voyant le grand nombre voler au-dessus de nos têtes, on commença à attendre de son emploi une aide matérielle et morale en nos jours pénibles, si souvent abandonnés à nos tristes sorts, et nos chefs nous la définissaient à nos yeux comme le cavalier éclaireur d’antan.
Notre temps de secteur accompli vers le 7 ou le 8 avril, nous allons cantonner dans des baraquements situés dans un petit bois au-dessus de Vaux-Varennes pour nous préparer et nous initier à la ruée proche, nous dit-on, qui aura peut-être le bonheur d’amener un résultat décisif de cette malheureuse guerre.
On nous fit des conférences nous démontrant l’ennemi épuisé, las de la guerre, possédant un matériel usagé, n’ayant plus de pain et d’une qualité infectée (c’était un peu vrai) si bien que j’ai rarement vu par la suite le moral de tous ces hommes fatigués de cette lutte sans résultat, élevé à ce degré, tous ayant foi dans le succès final si proche.
Nous attendions cet assaut formidable presque en chantant et c’était aussi le cœur joyeux que nous voyions arriver sans relâche des canons de tous calibres nuit et jour, dont les artilleurs nous vantaient l’efficacité, escomptant eux aussi le succès assuré.
De nos cantonnements tout remplis de verdure par ce printemps 1917, nous faisions déjà des projets de retour dans nos familles prochainement et c’est dans ces circonstances que nous apprîmes que l’attaque était pour le 15 avril puis retardée d’un jour.
Ce serait le 16 et, joyeux après avoir pris toutes les précautions possibles, on nous donne l’ordre de nous rendre à notre emplacement désigné à l’avance, par un temps assez beau le 15 après-midi.
L’attaque du 16 avril 1917
Vers 4h du soir, nous fîmes une petite halte afin d’éviter l’encombrement où surgissaient des milliers d’hommes de tous côtés faisant comme nous afin de se rapprocher le plus possible avant la nuit pour pouvoir se rendre, au jour, au point désigné.
Mon capitaine et moi ainsi que les guides de notre bataillon recevons l’ordre de partir en avant pour reconnaître l’emplacement des compagnies et revenir ensuite au-devant de la colonne afin de bien aiguiller tout ce monde au bon endroit pendant la nuit.
Nous retraversons Bouffignereux où les premiers obus faisaient rage. Un bataillon du 145ème Territorial occupe le pays pour effectuer différents travaux et c’est déjà la débandade parmi ces pauvres vieux pépères comme on les appelle, subissant eux aussi des pertes, pourtant si loin du champ de bataille.
Nous autres n’avons pas de temps à perdre. Nous traversons le pays tout fumant et une fois arrivés au lieu-dit Bois Blanc, nous empruntons un petit boyau destiné aux troupes de relèves et d’attaques. Dans ce petit bois que nous traversons, nos batteries subissent un marmitage terrible.
Quelle avalanche d’obus pour traverser ce petit bois où notre boyau était enchevêtré de gros arbres coupés par la mitraille.
Nous arrivons à Gernicourt et au canal que nous traversons ; déjà bien du changement était survenu depuis notre dernier séjour en ces endroits que nous connaissons admirablement bien. C’est ainsi que le pont en fer du canal était coupé et gisait en deux tronçons au fond de l’eau.
Nous dûmes le traverser sur des ponts improvisés (*) par le génie et de même nous passons l’Aisne sans encombre et arrivons juste à la nuit à nos emplacements de départ pour demain matin. Après avoir bien vérifié l’emplacement de chaque compagnie numéroté sur une pancarte, les guides repartent attendre la colonne.
Moi, je reste avec mon capitaine garder tous les effets de ces camarades repartis.
(*) : La traversée de l’Aisne (sur
une passerelle) s’effectua de nuit, sous la pluie et les bombardements. Le JMO
dit :
« Le
temps est épouvantable, les chemins défoncés, l’obscurité profonde (…), après
des efforts inouïs, le régiment atteint péniblement sa position…»
Ici c’est le marmitage continu et fort heureusement je suis bien tombé à côté d’un petit abri où je me mets avec mon capitaine attendant la colonne et notre commandant Boulanger qui commande le 13ème en ce moment.
Et c’est le cœur joyeux malgré tout, que je réfléchissais à notre journée de demain et pensant aussi aux difficultés inouïes que vont avoir les camarades pour traverser ce bois meurtri (*) que nous autres avons eu de la peine à franchir pendant le jour. Car tout le monde était chargé comme des bourriquots.
Au départ, on avait distribué 4 jours de vivres, une musette de grenades, des fusées, bref, c’est au prix d’une fatigue que seul on peut surmonter en ces moments là et il faut les avoir faites ces marches de nuit pour bien s’en faire une idée. Malgré cela tout le monde avait bien espoir en voyant le nombre de nos pièces se touchant presque sur notre parcours.
Malgré la fatigue et la nuit blanche durant laquelle nous avions appris que l’heure de l’attaque était à 6h, tout le monde était prêt et, quelques minutes avant, les cœurs se gonflent, nous raidissant de courage en nous disant peut-être sera-t-il la dernière fois.
Mille pensées vous reviennent en ces douloureux moments, on pense à la famille et c’est dans ces rêveries que juste à 6h nous bondissons hors de nos tranchées comme des enragés afin de nous soustraire aux tirs de barrage ennemi car quel est celui qui ne connaît pas ce danger meurtrier en le traversant.
(*) : Le régiment avait comme
mission de s’emparer du bois du Claque-Dents. (JMO)
Notre progression a été si vite qu’en moins de cinq minutes, nous sommes déjà dans les positions boches de premières lignes où jadis se trouvait la ferme dite Le Choléra où l’ennemi s’était installé copieusement depuis 1914. Nous cherchons de tous côtés les défenseurs en remontant d’un entonnoir à l’autre où nous nous rendons compte de l’effet de destruction de notre artillerie de tranchée.
Sous ses coups, les abris bétonnés s’étaient effondrés, on avait beau regarder mais en vain, les quelques survivants restants à cet endroit étaient cachés dans leurs abris surpris de notre arrivée si soudaine. Voyant le peu de résistance, nous nous attardâmes pas plus longtemps, laissant le soin de capturer ces damnés aux troupes spéciales désignées à cet effet appelées nettoyeurs de tranchées.
Nous sûmes plus tard que ce fut une lutte d’un terrible corps à corps souterrain lorsque quelques jours après nous eûmes l’occasion de visiter cette forteresse souterraine. On n’eut pas de peine à le croire. Si bien que trois jours après notre passage on recevait encore des coups de feu de part et d’autre dont quelques entêtés ne voulaient pas croire à notre succès, attendant un retour offensif des leurs, car ce n’était que tunnels se croisant d’un côté de l’autre sous cette fameuse crête du Choléra.
Nous continuons donc notre marche en avant, suivant nos obus de 75 tel un chasseur suit son chien, afin d’enlever la deuxième position sans plus de mal.
Soudain l’ennemi déclenche son tir de barrage et chacun rit de bon cœur en voyant ces obus tomber devant nos tranchées de départ où maintenant toute la vague en est déjà loin et on s’en émeut pas davantage. Et, contents du bon tour joué à ces rusés de boches qui comptaient bien nous anéantir avec leur barrage au départ, chacun disait :
« Ils en sont pour leur frais ».
Mais tout allait trop bien, les choses se gâtèrent, maintenant la pluie commençait à tomber et on s’impatientait de marcher trop lentement. Nos obus n’avançant pas assez vite, force était de faire pareil et malheureusement le calcul de cette cadence n’était pas bon, l’ennemi d’arrière mitrailleur, pour la plupart dissimulés dans la plaine, le long de la Miette, avait tout le temps de faire ses préparatifs, même devant notre barrage roulant peu fourni.
Si ne voyant aucun de nos avions à cette heure matinale sauf un avion divisionnaire qui essaya de faire son devoir en faisant des signaux convenus à l’artillerie ou autres services compétents, il n’en fut pas de même de l’ennemi qui déjà avait lancé son aviation au-dessus de nous, nous mitraillant.
Ses aviateurs eurent tôt fait d’abattre nos malheureux avions inoffensifs qu’on nous a tant vantés. On en voyait point, cependant malgré la pluie, les avions ennemis ne nous quittaient pas d’une semelle réglant le tir de leurs canons dont maintenant, nous recevons ses coups.
Les pertes commencèrent et à ce moment un gros 210 tua notre brave Rémy, adjudant de notre bataillon, ecclésiastique originaire de Verdun, et en blessant plusieurs autres dont l’ordonnance du commandant, bref, ce fut un moment pénible qui désorienta notre bel entrain.
Maintenant, l’ennemi, averti de toutes parts, nous harcèle. Les balles sifflent et en plus ces vilains oiseaux légers nous mitraillent à guère plus de cent mètres de haut. Nous tirons dessus mais sans résultat et quel réconfort moral si nous voyions arriver aussi quelques-uns de nos avions chasser ces chiens maudits au-dessus de nos têtes, mais toujours rien.
On se demande à quoi attribuer cette non-apparition un jour comme celui-ci où tout le monde fait bravement son devoir. Et puisque la pluie n’empêche pas à l’ennemi de voler, pourquoi les nôtres ne volent-ils pas, ce que l’on a jamais su, nous autres pauvres martyrs, et encore une fois on en était réduits à nos propres moyens subissant tout sans récriminer.
Aussi l’entrain se raffermit de plus en plus, mais il faut avancer coûte que coûte nous dit notre brave colonel Moisson, passant en ce moment, nous réconfortant de son mieux, nous disant que ce soir il faut aller coucher à Prouvais, village que je ne connus jamais, distant d’au moins 8km d’où nous sommes.
C’est au prix de durs sacrifices avançant par des bonds sous la mitraille et les obus à gaz et à force de courage, que l’on arrive à la troisième position boche dite tranchée du Ruisseau vers onze heures et demie.
Maintenant notre barrage roulant est au moins en avance de 3km sur nous où d’après les calculs de nos états-majors, nous devrions être à cette distance, belle organisation ma foi.
Décimés, ne pouvant plus avancer, nous restâmes dans cette tranchée un bon moment quand tout à coup, vers midi, nous voyons arriver des tanks. Tout ébahis en voyant arriver ces espèces d’autos blindées dont on nous avait bien parlé un peu ces derniers temps mais à peine voulait-on y croire.
Et quand on nous eut dit que ces machines étaient destinées à nous aider pour la prise du bois Claque-Dent, objectif final de notre régiment, le courage nous reprit que de plus belle. Si notre aviation nous était nulle, du moins nous allons avoir la compensation de ces tanks, nouveauté pour nous, pensez donc !
Ils allaient marcher en avant et à leurs signaux convenus, aux plus grands dangers écartés, les suivre à notre tour. C’est le rêve, disions-nous, gare les boches et on repart de bon cœur.
Mais pas pour longtemps. Car les avions boches ont tôt fait de découvrir ce nouveau danger et, lançant des fusées spéciales à leurs artilleurs, anéantirent toutes ces machines. Il déferlait une avalanche d’obus de toutes sortes, incendiaires pour la plupart, mettant le feu à l’essence qui brûla les courageux combattants employés à leur maniement, si bien qu’à une centaine de mètres autour, c’était intenable.
Oh, quel spectacle cruel de voir brûler tout vifs ces malheureux, qui réussissaient à sortir de l’intérieur pour agoniser à quelques mètres autour. Comment leur porter secours ?
Cela nous est matériellement impossible. Bien peu échappèrent à la mort, sauf un ou deux, de ces tanks restés en panne où le personnel sauva le matériel en armes, déchargeant tout ce qu’ils purent sur l’ennemi, avant de s’en aller. Sans se soucier le moins du monde du danger, ils repartirent avec leurs mitrailleuses sur l’épaule, avec un sang-froid admirable et vers la nuit tombante revinrent à nouveau et réussirent à ramener une de leur machine à l’arrière.
Chacun admira leur bravoure. Quelques-uns, causant un peu avec nous, nous racontèrent que leur commandant, le propriétaire du Bois Claque-Dent, voulait en personne assister à la prise, connaissant parfaitement sa disposition et afin de contribuer au succès.
Celui-ci venait de mourir entre leurs bras de brûlures et ils étaient très émus de sa perte.
C’est avec fierté que nous rendîmes hommage à tous ces héros qui ont été braves entre tous ces braves. Malgré tout, nous rendîmes un énorme service en écrasant les réseaux ennemis, restés intacts jusqu’à leur arrivée, ce qui nous livra des passages appréciables pour vaquer à nos travaux d’aménagement du terrain par la suite.
Maintenant c’en était fait de notre avance et, à trois heures du soir, l’attaque était totalement enrayée en face de nous et on nous donne l’ordre de nous maintenir sur place.
Notre artillerie maintenant est muette et c’est avec stupéfaction que nous voyons installer une malheureuse batterie de 75, dans la plaine, à moins de cinq cents mètres de nous. D’un signe de l’avion ennemi, elle subit le sort des tanks, sans avoir tiré un coup.
Les survivants courent de tous côtés et, voyant cela, l’avion, avec une audace inouïe, descend à quelques mètres d’eux et mitraille tous ces malheureux terrifiés, ne sachant où se fourrer.
Bêtes et gens gisent lamentablement sur cette plaine, endormis pour toujours. (16 avril 1917)
Malgré notre désappointement, en voyant nos espérances encore une fois envolées, on nous apprend que c’est notre régiment qui a encore le mieux réussi de notre corps d’armée.
Le 267 et le 162ème, faisant partie à cette époque comme nous de la 69ème, sont encore bien en retard sur nous. Des soixante-dix kilomètres de front où l’attaque était projetée, on nous dit que les ailes n’ont pu déboucher du côté du Chemin des Dames et à notre droite sur Brimont. Comme nous nous trouvions à peu près au centre, il eût été dangereux pour nous de pousser plus en avant.
Nous restons donc sur nos nouvelles positions ; à moins de 500 mètres des premières maisons de Juvincourt et presque derrière la fameuse cote 108, que l’on ne put enlever entièrement. Après les mille dangers de toutes sortes où nous subîmes comme toujours, après les attaques, un marmitage effroyable, diminuant encore nos rangs déjà bien faibles, nous nous installons tant bien que mal, bien tranquilles.
Conclusion, comme bilan de notre attaque, nous avons capturé une centaine de prisonniers, pris quatre canons de 150 mm, abandonnés sur les bords de la Miette, et avancé en profondeur environ de quatre kilomètres au prix de durs sacrifices.
Du côté du haut commandement, il y a eu certainement faute, car même au dire des artilleurs, ils ne pouvaient tirer, leur manquant plus de mille coups par pièce. Dommage car à voir la masse humaine échelonnée derrière nous, la 154 et 155 infanterie ont subi des pertes sans effet. Malgré notre mauvaise chance, tout ce monde fit vaillamment son devoir, sauf notre aviation ; n’en parlons pas, ce jour là, elle a été indigne et à nos yeux, elle a totalement perdu la confiance.
Pourquoi ? L’histoire nous le dira.
Nous en sommes donc réduits à attendre encore une fois, la prochaine affaire et bien peu s’en fallut pour que les suites de notre échec amènent un désastre au point de vue moral.
fin avril 1917
Le 21, nous revenons un peu en arrière, aux anciennes positions boches du Choléra où nous admirons l’installation souterraine avec installations modernes, moteurs électriques intacts, chambres confortables enfin, tout ce que l’imagination pouvait leur être utile. On se demande comment ils purent construire ce village souterrain à cette profondeur, au moins à 25 pieds sous cette crête qu’ils durent abandonner si brusquement, ainsi que le matériel de toute sorte.
On passait une huitaine jusqu’au 26 où, un peu reposés, nous remontons en première ligne où le mécontentement de notre unité commençait à se faire sentir.
Ainsi, beaucoup désertèrent et nos chefs, à force de nous maintenir dans le droit chemin, nous promettaient la relève prochaine, tout en avertissant le haut commandement de nos lassitudes et de notre découragement.
Mai 1917 : Les mutineries, les embusqués
Le 1er mai, nous recevons enfin l’ordre de nous préparer à quitter cet endroit funeste, si chèrement acquis, loin de nous douter qu’un an plus tard, l’ennemi devait à nouveau fouler aux pieds tant de camarades restés à jamais dans cette vallée de la Miette.
Nous allons cantonner dans des baraquements non loin de Bouvancourt où les avions ennemis nous rendent visite toutes les nuits, nous causant encore des victimes. Nous profitons de ce petit séjour pour nous nettoyer un peu, afin de nous débarrasser de cette vermine de poux. Un peu reposé, j’assiste à une messe dans la petite église de Bouvancourt, célébrée à la mémoire des camarades restés là haut pour toujours, chantée par notre aumônier du bataillon, le père Blanc.
Le lundi 7 mai, nous recevons un ordre formel de refouler encore plus en arrière, à la grande joie de tous. Après avoir marché toute la journée, nous arrivons à Villers-Agron, dans un camp de baraques Adriant (*), au moins à trente kilomètres de la ligne du feu. Nous revivons un peu de cette vie depuis si longtemps tenue qu’à un fil et par un soleil de mai radieux, on oublie encore une fois ces tristes jours passés dans la tourmente.
En cet endroit, nous recevons comme renfort le 351ème de réserve, venant de Belgique pour combler nos pertes.
(*) : Du nom de l’inventeur de ces baraques : ADRIANT
Après une quinzaine de jours passés en ce pays, nous recevons l’ordre de remonter en ligne d’où un mécontentement presque général, causé par toutes sortes d’injustices.
Cette malheureuse attaque de l’Aisne du 16 avril 1917 a eu une répercussion dans l’armée et même à l’intérieur, au dire des permissionnaires où on criait trahison de notre part. Beaucoup d’unités se mutinèrent, refusant catégoriquement de retourner en ligne avant d’avoir eu leur permission. Le temps réglementaire était depuis longtemps écoulé du fait que, chaque fois qu’il y avait une offensive quelconque, les troupes combattantes se voyaient supprimer ce grand réconfort moral sous prétexte d’entraver les opérations.
Aussi, c’est avec juste raison que l’on voyait tous les gars d’arrière aller voir leur famille sans être astreints, comme nous l’étions, aux pires difficultés de tout genre. Et tous ces embusqués, comme on les appelait, ne se génèrent en rien de nous traiter d’imbéciles.
Exaspérés, en fin de compte, de tous ces abus à notre nez, on ne se gênait pas de faire voir le danger croissant sans cesse à nos chefs, ils devaient en référer le plus vite possible à qui de droit, les invitant à prendre enfin ces doléances en considération, en améliorant notre sort le mieux possible.
C’est par exemple, que depuis 1915, on était écœurés de voir des tas de jeunes gens employés au service d’arrière, se pavaner tranquillement des mois, voire même une année dans un même village ou ville, à l’abri de tous les dangers et les misères, tandis que l’autre catégorie des combattants échappait à un danger pour recommencer un autre de plus belle, toujours aux mauvais endroits.
Il n’était pas rare de voir des gens blessés plusieurs fois, revenir se faire tuer au champ d’honneur, tandis que les employés frais et dispos, pleins de santé, ne manquant de rien, ni même d’arrogance, vivaient tranquilles, même le plus souvent ne sachant quoi faire.
Et c’était la même chose pour les officiers : l’officier de tranchée était un zéro à côté de celui d’arrière. C’est devant toutes ces injustices éhontées que les poilus chantaient leurs souffrances morales et physiques devant nos chefs mêmes et qui bien souvent ne nous encourageant pas comme il était de leur devoir. Ils n’en écoutaient pas moins de toutes leurs oreilles, avertissant sans cesse du danger toujours croissant.
Je me souviens encore de quelques couplets enflammés, dont se composaient quelques-unes de ces chansons qui firent le tour du front dès l’année 1916-1917, ainsi que les quelques strophes composées dans les tranchées les jours de désespoir.
A l’extérieur, la situation n’était guère plus encourageante.
La révolution russe, suivie de leur paix honteuse, ainsi que la malheureuse Roumanie écrasée de toutes parts, on savait très bien que nous aurions bientôt le contrecoup de tout cela sur nos fronts anglo-français ou italien. On avait eu aussi la proposition d’une paix boche à leur manière dans le courant des premiers jours de l’année 1917, et depuis notre dernier échec, on osait guère espérer une issue avantageuse pour nous.
Je crois que si on avait demandé un vote pour la continuation de la guerre aux combattants, il y aurait eu beaucoup de chance pour la négative à cette époque.
Un seul espoir nous restait, puisque l’on venait d’apprendre la déclaration officielle de l’entrée en guerre de l’Amérique. Mais comment arriveront-ils, ces Américains, jusqu’ici avec leurs sous-marins ? D’après les résultats de l’Angleterre, en ce moment, on aurait jamais cru qu’un an plus tard l’armée américaine serait forte d’un million d’hommes à nos côtés.
Bref, on surmonta toutes ces difficultés. On commença par améliorer notre sort :
On nous distribua un demi-litre de vin, on intensifia les coopératives jusqu’aux tranchées où il nous était plus aisé de nous procurer les choses les plus utiles à nos besoins.
On nous donna en outre une indemnité de combat, évaluée à trois francs, dont la moitié en argent de poche et l’autre moitié en pécule.
On s’arrangea aussi de nous faire aller en permission au moins trois fois par an, pour dix jours, et en plus on créa des cantines dans les gares où on trouva des repas gratuits dans les centres destinés à cet effet et quantités de petites choses utiles à notre bien-être.
On s’informa aussi de ne pas laisser des unités toujours en ligne au détriment d’une autre, on remplaça beaucoup de jeunes des services inutiles de l’arrière par des pères de famille les plus âgés.
De même, dans les usines de guerre, on fit la chasse aux embusqués, tâche qui n’était pas des plus aisées, au dire des gens chargés de ce service. Dans chaque compagnie, on créa un compte-rendu moral des hommes où on examina avec soin toutes nos doléances et, bien souvent, satisfaction nous était donnée derechef, si bien que petit à petit tout revint dans le calme.
On sentait qu’il y avait tout de même un peu plus d’égards envers le combattant et, tous, nous nous sentions moins abattus et mieux considérés, ce qui n’était que juste.
Jusqu’à la fin, notre sort alla toujours en s’améliorant, si bien que les gens d’arrière étaient souvent obligés de venir nous trouver en ligne pour se procurer des douceurs dont depuis si longtemps ils détenaient le record.
Juin 1917
Alors, c’est dans ces conditions, que le 30 mai, à quatre heures du matin, où la veille on s’était préparés à retourner en ligne, qu’à notre grande stupéfaction on prenait le chemin inverse. Il n’en fallut pas plus pour nous réjouir de cette surprise agréable, nous allons cantonner le soir à Marcilly-sur-Marne. Nous repartons de ce petit pays pour Blesmes, à quelques kilomètres de Château-Thierry où également nous y passons quelques jours.
Le 6, nous repartons de nouveau pour Montlevon et Pargny-la-Dhuys où nous avions cantonné dans l’hiver.
Le 7, nous repartons encore et à cette époque la chaleur était très forte, nous étions obligés de nous lever de très bonne heure afin de ne pas trop avoir à souffrir de son effet. Ce fut pour nous une série de marches très fatigantes ; malgré tout, personne ne se plaignait, vu que la souffrance morale était pendant ce temps soulagée. Après avoir traversé Montmirail dès 6 heures du matin, nous allons échouer dans un maigre patelin du nom de Bergères où nous restons jusqu’au 12 juin 1917.
A quatre heures du matin, nous recommençons notre randonnée et arrivons au lieu-dit Courjeonnet où nous passons la nuit.
Le lendemain, départ à trois heures par un temps toujours splendide. Nous longeons les marais de St Gond, restés célèbres depuis la bataille de la Marne en 1914 où la garde impériale allemande fut en partie décimée. Beaucoup de camarades de mon régiment, qui combattaient eux aussi dans ces parages, nous racontent l’odyssée de cette unité et, chemin faisant, nous retrouvons les tombes des soldats du 151ème tués à cette ruée formidable.
Nous arrivons enfin à Fère-Champenoise qui a vu se dérouler des combats acharnés et, en voyant encore sa gare incendiée, on devine ces jours tragiques à la quantité de tombes semées ça et là aux alentours. Une partie du régiment cantonne et mon bataillon va à Euvy, à quelques kilomètres plus loin, passer la nuit.
Le lendemain, après avoir fait encore 26 kilomètres, nous arrivons au camp de Mailly, bien fatigués de ces marches avec cette chaleur. Croyant y passer quelques temps, nous fûmes déçus. On nous dit que le lendemain, il y a encore une étape de 22 kilomètres pour arriver à destination.
En effet, le 15 à midi, nous arrivons à Ramerupt où en général nous fûmes mal accueillis de la population civile, toujours encombrée de soldats. Néanmoins, je ne fus pas mal tombé avec quelques camarades, nous sommes logés chez le ferblantier du nom de Maresa où nous n’avons pas à nous plaindre.
Après avoir eu un peu de repos de quelques jours, il m’arriva à cet endroit une petite histoire assez désagréable le 21 juin. Ayant eu la curiosité de visiter le moulin construit sur un bras de l’Aube, il fut détruit par le feu une heure après mon retour. Je suis parmi les accusés et à tout moment, je suis embêté par les gendarmes.
N’y étant pour rien, je finis par les envoyer promener et depuis je n’en ai jamais eu de nouvelles. Cette petite histoire amusa beaucoup mes camarades et me valut maints chinages par la suite.
Jusqu’au 27, nous sommes occupés à faire des manœuvres dans les terrains du camp de Mailly et, pour récompenser le régiment de sa belle conduite jusqu’alors, on nous donne la fourragère aux couleurs de la croix de guerre.
A cet effet, on organisa une fête magnifique dans le pays de Ramerupt.
A déjeuner, on nous distribua Champagne, biscuits, cigares, un litre de vin par homme, le soir, grand concert par notre musique, et, à la nuit, retraite aux flambeaux au grand contentement de tous.
Le 28, j’apprends mon départ en permission. Je prends le train à Arcis-sur-Aube et pour la troisième fois, je me retrouve au beau milieu des miens.
Après avoir employé mes jours du mieux que je pus, quelle ne fut pas ma surprise à ma rentrée. Je retrouve mon régiment à Laimont où tant de souvenirs m’y avaient attaché deux ans auparavant.
En arrivant, ma première visite fut d’aller déjeuner chez cette brave dame Jacquesson où je fus reçu à bras ouverts. Elle me dit qu’elle s’était renseignée sur mon sort, ne me voyant pas parmi les hommes et craignant un malheur. Elle est allée trouver mon capitaine qui lui annonça que je me trouvais en permission et que je devais rentrer prochainement.
Mon séjour dans ce pays, où de nouveau je refis la connaissance de ces braves gens, me fut des plus agréables. Cette fois je connus guère cette maladie du cafard et ce fut une nouvelle permission pour moi. Mais toute chose a sa fin et c’est au milieu des poignées de mains de ces braves gens de Laimont, après avoir passé la fête du 14 juillet ensemble, que le 15 au soir nous embarquons en auto pour Verdun.
Nous passons encore une fois à Bar-le-Duc, et nous arrivons à 3 heures du matin dans la caserne, toute meurtrie où tenait garnison mon régiment, avant la guerre.
Sans perdre de temps, sous la conduite de mon capitaine qui commandait le bataillon à cette époque, nous montons le soir aux tranchées, au bois et à la ferme des Chambrettes.
Après avoir suivi cet interminable boyau de Loumède, nous arrivons à 4h du matin, harassés, où nous remplaçons le 94ème d’infanterie du même corps d’armée que nous. Nous nous reposâmes tant bien que mal ; le secteur n’étant encore à cette époque point trop agité. Nous étions point trop malheureux jusqu’au 22 où les boches, après un marmitage sérieux, font un coup de main sur notre droite et enlèvent une cinquantaine d’hommes du 129ème régiment, voisin de nous.
Nous vivons en ermite dans des abris profonds, comme il en existe dans ces contrées là où partout règnent la désolation et la ruine à chaque pas.
Le 31, nous sommes relevés et allons cantonner dans un camp au lieu-dit la Louvière, sur une crête boisée, non loin de Belrupt.
Nous restâmes dans ce petit bois un bon moment et, malgré la pluie persistante en ce mois d’août, on se laissa vivre sans grand tourment tout en faisant quelques corvées de part et d’autres. On allait travailler parfois jusqu’en ligne où on se rendait parfaitement compte qu’une attaque imminente était en train de se préparer par notre 32ème corps dont l’esprit de rébellion n’avait pas trop été atteint dans les derniers évènements.
Entre temps, pendant mon séjour au camp de la Louvière, j’apprends que mon frère Albert est cantonné au petit pays d’Ancemont dans une formation sanitaire américaine S.S.U.21 où il est affecté. J’obtiens assez aisément la permission d’aller lui dire bonjour et pour la troisième fois depuis ma campagne, nous sommes réunis à nouveau. Avec ses compagnons américains, je suis choyé en brave et fêté et à chaque fois que je pus je m’y rendis, allant même jusqu’à pêcher à la grenade dans le canal tout embouteillé à cet endroit.
Mais malgré tous ces plaisirs de guerre, si triste dans ces parages de Verdun, l’orage au lointain commence de plus en plus fort. Comme tous les briscards (*) habitués à ces roulements de canons, on attendait, un peu anxieux, le travail de nos artilleurs pour achever leur besogne si on a la chance de réussir. Je me souviens que tous les soirs, avec mes camarades, nous nous rendions à la nuit tombante sur le faîte de cette crête aride, au-dessus du fort de Belrupt pour contempler le spectacle lugubre du départ de nos pièces.
A chaque étincelle sortant de ces fameux ravins, nous pouvions juger du nombre colossal de canons de tous calibres mis à notre disposition. Au dire de nos grands chefs, ce fut la première fois à cette époque que l’on vit à l’œuvre plus d’artilleurs que de fantassins. Malgré tous nos revers du passé, on recommençait à reprendre confiance et, devant le courage de tous encore une fois, notre effort a été presque vain.
(*) : L’appellation de « briscards » ou « vieux
briscards » vient de brisques. Les brisques étaient portées sur les
manches de l’uniforme, près des épaules. Brisques de blessures sur la droite et
brisques de présence au front sur celui de gauche.
Certains soldats avaient jusqu’à 7 brisques de présence au front (4
ans) et quelques brisques de blessures.
Verdun : L’attaque des Jumelles-d’Ornes
20 et 26 août 1917 – 8 septembre 1917
Le 19 août au réveil, ordre nous est donné de nous préparer à monter le soir au fort de Douaumont, en réserve, prêts à intervenir le lendemain. L’attaque était destinée à enlever, si possible, les Jumelles d’Ornes afin de nous donner l’aisance dans les plaines d’Étain pour les opérations futures. La 42ème division devait donner le premier choc avec la 40ème et la nôtre en réserve.
Donc le soir, nous voyons arriver sans trop d’anicroches une partie du bataillon au fort de Douaumont où je me trouvais avec mon capitaine. L’autre partie était au ravin du Helly avec le commandant Boulanger. Nous attendions le résultat du premier choc qui devait se produire au petit jour le 20 août 1917.
Nous attendions donc anxieux, dans le reste de cette citadelle de ce fort, à jamais célèbre, que fut Douaumont. Le bruit infernal de cette mitraille me rappelait tant les douloureux souvenirs du mois de mai 1916. Nous suivions des yeux les phases de la bataille et aux vagues renseignements que nous pûmes avoir, tout s’annonçait pour le mieux pour nous.
On apprenait que le village de Beaumont était pris par nos chasseurs et que malgré tout, la tâche était rude.
Le jour se passa de la sorte et vers la nuit, nous recevons l’ordre de notre colonel de nous préparer à intervenir seuls, afin de soulager le 232ème de ligne dont une partie était dans une situation critique du fait d’une contre-attaque ennemie. Sur les quatre ou cinq cents mètres d’avance de la journée, la moitié était reperdue vers le soir, et le bataillon était à cet endroit tout à fait désorienté.
Ordre nous fut donc donné de remettre les choses au point, tâche assez difficile et ingrate car il ne faut pas oublier qu’un bataillon détaché de son unité dans une autre est considéré comme un étranger dans une famille et est obligé d’obéir au chef de l’unité que nous renforçons. Nous quittons donc notre vieille citadelle et par une de ces nuits sereines comme on en rencontre à cette époque de l’année, après avoir marché toute la nuit dans les sentiers crevassés comme tous ceux des champs de batailles de ces endroits, nous arrivons sans encombre au poste de commandement du 232ème, appelé poste Louise, dont nous avions déjà fait connaissance à notre premier séjour.
Aussi, dans quel état nous trouvons ce qui reste de ce bataillon encore tout chaud du terrible spectacle du jour et, en nous voyant arriver, ils n’ont qu’un désir : sortir à tout prix de ce charnier.
On devine la difficulté de trouver la ligne avancée où se cachent les survivants du jour encore tout abrutis du marmitage continuel de l’ennemi.
Plusieurs de nos secteurs passent la ligne, ne trouvant personne du 232ème, sont mitraillés à bout portant par l’ennemi. Ils refluent en désordre et demandent enfin où on veut les mettre. Mais personne ne sait rien, c’est la pagaille, comme on dit !
Le jour arriva et forcés de se terrer dans un trou d’obus jusqu’à la nuit, essayant de s’orienter un tant soi peu pendant le jour. Il était impossible de naviguer dans le jour et l’ennemi, ayant vu du mouvement, en profite pour arroser le terrain, croyant à une nouvelle attaque de notre part à cet endroit. Néanmoins nos chefs, pendant une petite accalmie, essayent de comprendre car ils ne peuvent obtenir aucun renseignement sur des hommes ni même des officiers que nous relevons, tellement tous sont démoralisés. On discute dans les abris ici ou là, mais celui qui sait n’y va pas, telle fut notre situation le 21 au soir et toute la journée du 22.
Malgré tout, on réussit à établir une ligne, de trou d’obus en trou d’obus, et le bataillon est enfin réuni et installé dans les trous exposés à tous les coups de l’ennemi. Nous subissons des pertes énormes. Après bien des rapports de nos chefs au colonel du 232ème sur nos dures positions, on reçoit l’ordre d’évacuer cette ligne pendant le jour et de revenir un peu en arrière afin de permettre à notre grosse artillerie de démolir la tranchée dite du Chaume qui résista le 20.
La malchance nous poursuivit chaque jour, matin et soir.
A chaque mouvement, nos pauvres compagnies se trouvaient toujours sous les feux de barrages ennemis. Cette histoire dura jusqu’au 26 août où l’ordre nous est donné de rester à nos emplacements pour attaquer à 5h30 du matin. Mais quel vide dans notre pauvre bataillon !
Sur 450 que nous étions le 20, nous restons à peine 250 le 26, au matin de l’attaque. Aussi, chacun se regarde et, après cette cruelle période en plein air si meurtrière, le moral des hommes et même celui des officiers dans ces moments n’est guère brillant et personne n’a bien confiance dans la réussite.
Notre objectif est de conquérir la tranchée du Chaume et l’ouvrage dit du Lama, un repaire de mitrailleuses. Par bonheur, le ravitaillement était bien arrivé cette nuit-là, c’est à dire le vin, l’eau et une bonne ration de gniole, ce qui remonta un peu le moral de tous, si bas quelques minutes auparavant.
A cinq heures et demie, sous une grêle de projectiles de tous calibres de notre artillerie, ce qui n’empêche pas celle de l’ennemi d’y répondre, et aidés d’une compagnie du 232ème et d’un groupe d’assaut du 94ème, nous partons à l’assaut par un temps gris après une petite pluie tombée la nuit. En moins de deux minutes, les hommes sont dans la tranchée du Chaume, surprenant les boches en pleine relève sans trop de résistance de leur part.
Moi, j’étais resté avec mon capitaine au point de départ, avec quelques hommes de réserve, ayant pour mission d’assurer le ravitaillement en munitions aux troupes de choc dont mon capitaine avait le commandement.
Notre bataillon dépasse la Chaume, pénètre dans l’ouvrage du Lama, mais les hommes, mitraillés à bout portant, sont obligés de revenir à la tranchée du Chaume et de défendre le boyau du Thibet, seul chemin accessible aux boches. Malgré deux contre-attaques de l’ennemi dans la soirée, le Chaume reste à nous.
L’attaque nous a coûté la mort du capitaine Moraguin et une vingtaine d’hommes disparus dans l’ouvrage du Lama. L’opération purement locale a été menée rondement et la réussite est due à la relève ennemie, complètement surprise par nous.
Nous avons capturé dans cette affaire 350 à 400 hommes appartenant à plusieurs régiments différents, côtés des meilleurs de nos ennemis.
Le résultat fut meilleur qu’en attendaient nos chefs car une opération de ce genre à cette époque n’a pas beaucoup de chances de réussir si l’ennemi a le temps de s’apercevoir de notre dessein et qu’il concentre toute son artillerie sur le même point, généralement c’est l’anéantissement complet.
Nous sommes relevés le lendemain, le 27 août, par le 161ème de notre division, pour aller nous reposer un peu et chercher du renfort afin d’achever notre mission, huit jours plus tard si possible. Malgré nos dures fatigues et bien qu’étant séparés de notre chef de corps, il ne nous abandonna point. Il se dépensa sans compter, venant même jusqu’à nos lignes.
Bien qu’étant à moins de quatre kilomètres de nous, il assura notre ravitaillement en liquide au-dessus de tout éloge. Il en fut de même du colonel du 332ème, pour le compte duquel nous opérions qui ne nous donna signe de vie que par écrit. On peut dire aussi que si son régiment avait eu de l’énergie, notre pauvre 3ème bataillon n’aurait peut-être pas été aussi durement éprouvé en pertes dont nous déplorions la mort de plusieurs bons de nos officiers : le lieutenant Jubert, le lieutenant Colinet, arrivé la veille en renfort, et plus de 250 de nos compagnons de misère.
Notre attaque s’est encore faite sans l’aide de l’aviation et on peut rendre hommage à notre commandant de s’être tiré du bourbier où on était cloués.
Après avoir passé quelques jours au Ravin de la Caillette, nous descendons jusqu’à Senoncourt à quinze kilomètres de Verdun et à quatre kilomètres d’Ancemont où, malgré ma fatigue, je cours embrasser mon frère, inquiet de mon sort, me sachant dans la mêlée depuis ma dernière nuit.
Quel réconfort en nous retrouvant sains et saufs tous les deux. Car lui aussi a eu à souffrir un peu de la répression de l’attaque, par le bombardement à longue portée et par avions. Je lui ai dit que ce n’était rien, en le rassurant un peu, mais, à la guerre, plus le danger est grand et moins on a peur.
Après m’avoir restauré de son mieux, me gâtant même ainsi que ses compagnons, je rejoignis, le cœur content, mon unité à Senoncourt, lui promettant de revenir lui dire adieu puisque dans quelques jours nous allions à nouveau recommencer cette vie d’enfer, puisque ni la mort ni la maladie ni la blessure ne veulent de moi.

Après quelques jours passés dans ce petit pays en repos, nous recevons pas mal de renforts d’un peu partout. Après bien des murmures, surtout de la part des nouveaux arrivés, le 6 ou le 7, nous recevons l’ordre d’aller coucher à Verdun pour retourner à nos anciens emplacements.
Je cours annoncer mon départ à mon frère et, en versant chacun une larme, on se dit encore une fois adieu, me souhaitant bonne chance et le cœur bien gros encore une fois, je rassemble toutes mes forces pour les évènements tout proches.
Comme toujours, après avoir marché toute la nuit dans ces lieux maudits que sont tous les alentours de ce Verdun où tout n’est qu’amère désolation à 5 lieues à la ronde, nous revenons à notre dernier arrêt du séjour précédent.
Cette fois-ci, tout le régiment doit prendre part à l’attaque ; le 1er et 2ème bataillon en première vague et le nôtre en réserve.
Notre objectif est d’enlever à tout prix cet ouvrage du Lama, la tranchée Hadimé, ainsi que le boyau du Thibet par où se fait toute la navette boche, comme chez nous ce fameux boyau Loumède qui part de Fleury jusqu’aux Chambrettes, long d’au moins dix kilomètres.
Le départ de l’attaque a lieu à 5h34 et cette fois-ci, l’aviation joue son rôle en mitraillant à faible hauteur les boches qui résistent. L’entrain est admirable, le Lama cette fois-ci est pris, la tranchée Hadimé tombe à son tour, on attaque le boyau aux tranchées du Thibet. Une compagnie de notre bataillon va renforcer les combattants de l’avant sous les ordres du lieutenant Valine qui est tué à la tête de ses hommes.
L’ennemi résiste mais finalement le Thibet tombe à son tour. Nos objectifs sont atteints, on est sur la crête du bois des Fosses, vers trois heures de l’après-midi tout est fini.
Malheureusement le premier bataillon a oublié de fouiller tous les abris, généralement profonds et bien aménagés, nos ennemis étant maîtres dans cet art, abritant parfois des compagnies entières. Croyant l’ennemi complètement chassé, ils se mirent à creuser, à aménager la tranchée, quittant leurs armes pour manier pelles et pioches quand soudain ils furent assaillis à la grenade et au revolver, par derrière et un peu de partout.
Ne sachant ce que cela voulait dire, on se battit avec pelles et pioches mais devant cette ruée si soudaine ils abandonnèrent le Thibet devant ces farouches revenants et peu s’en fallut que cette faute entraînât tout le monde à la retraite.
Cependant, on réussit tout de même à se maintenir à une vingtaine de mètres de cette tranchée du Thibet et c’est encore notre bataillon 3ème qui fut désigné à reconquérir cet endroit si précieux pour nous. Les boches savent que nous ferons l’impossible pour leur arracher encore une fois et ils en profitent pour nous harceler d’une manière effroyable dans notre mauvaise posture.
Deux compagnies du bataillon seulement sont désignées pour tenter cette opération, sous les ordres de mon capitaine.
L’assaut a lieu à 5h15, mais tout est à notre désavantage.
L’ennemi se méfie et, dès 5h, son tir de barrage, mêlé avec ses mitrailleuses, fait rage. En plus, un brouillard épais empêche de se guider en bon chemin. On a le pressentiment que l’affaire avortera mais il faut essayer coûte que coûte. Et à l’heure dite, sous cette avalanche de fer et de feu où tout est pulvérisé, ceux qui sont encore vivants partent comme des fauves, mais l’ennemi est sur ses gardes et les premiers arrivés sont reçus à coups de grenades et de mitrailleuses.
C’est la vraie boucherie !
Les jeunes de la classe 17 se sauvent en arrière où ils sont hachés par le barrage sans se soucier de ce danger derrière eux. Peu s’en fallut que les premières positions soient évacuées à leur tour devant la démoralisation de tout ce monde.
Le lieutenant Mondion est tué et tous les autres officiers blessés, sauf mon capitaine qui s’en sort comme moi indemne. C’est grâce à son sang froid si les quelques survivants regagnent la ligne de combat. Le résultat de cette malheureuse affaire fut nul et, comme toujours, si on ne réussit pas ce genre de petites opérations là, c’est généralement l’anéantissement du détachement.
Force nous fut donc de nous réinstaller tant bien que mal sur nos positions de départ sans abris.
Nous fûmes relevés le lendemain par le 348ème de réserve, troupes fraîches venant d’Alsace, leur laissant le soin de continuer notre tâche le mieux possible. Nous partons avec ce qu’il reste de notre malheureux bataillon, encore une fois bien épluché, en laissant un dernier adieu aux camarades, couchés à jamais dans ce lieu de souffrance et de désolation de ces alentours de Verdun, véritable tombeau humain.
Pour les journées des 8, 9 et 10 septembre, le régiment déclare
environ 600 tués, blessés et disparus.
13 septembre 1917.
Nous arrivons le soir au lieu-dit la Blancharderie où nous nous reposons un peu et repartons le matin. Nous prîmes les autos sous une pluie battante, en haut du village d’Haudainville où, quelque temps avant, une automobile fut projetée sur le haut d’un toit d’une maison par l’éclatement d’un gros obus ennemi. Nous recommençons donc encore une fois notre voyage Verdun - Bar-le-Duc sous le cahotement de nos camions, par ces routes défoncées du fait du nombre infini de véhicules de toutes sortes, passant nuit et jour sans relâche depuis les quelques années de cette guerre horrible.
Nous retraversons ce Bar-le-Duc, si connu de beaucoup, et arrivons le soir à la brune dans un petit pays du nom de Neuville-lès-Vaucouleurs, loin encore une fois de tous ces bruits de canon et de cette vision de bataille, si gravés dans nos esprits.
Nous restons une huitaine de jours et, un peu reposés, nous partons de nouveau en camion le 22.
Nous passons au petit village de Domrémy où naquit Jeanne d’Arc puis à Neufchâteau, où nous voyons les premiers américains, à notre grande stupéfaction nous souhaitant le bonjour et contents tout de même de voir ces grands gaillards arrivés, avec l’espoir en eux d’abréger nos longues souffrances, sans aucun espoir d’en voir le bout.
Nous allons cantonner à Manois, à une quinzaine de kilomètres de Neufchâteau, où nous sommes bien reçus de la part des habitants. Je suis logé chez un employé de chemins de fer du nom de M. Digout.
Nous y restons jusqu’au milieu d’octobre où nous aidons les territoriaux à la confection des baraquements destinés à recevoir les américains. On visite les alentours de Neufchâteau et de Chaumont dont la principale curiosité du pays est le cul du cerf, connu de beaucoup de touristes. Sur ces entrefaites, je pars en permission où j’arrive le 4 octobre à la grande joie des miens.
Tout se passa pour le mieux et comme les précédentes, les jours furent vite écoulés et, après les adieux de coutumes, on se quitte avec l’espoir de la nouvelle puisque rien ne fait prévoir la fin de ce cauchemar.
Je retrouve mon régiment à Manois d’où j’étais parti et reprends mon ancien cantonnement chez mon employé de chemins de fer jusqu’au 20 où nous quittons ce petit pays de tranquillité pour aller à St-Ouen-les-Pareys instruire une division américaine toute nouvellement arrivée.
Nous sommes un peu réconfortés, nous disant que peut-être ces nouveaux combattants atténueront un peu nos souffrances morales et physiques.
Nous passons donc tout le commencement de l’hiver dans ce bon petit coin des Vosges, bien vus de tous les habitants si généreux, à nous donner un petit verre d’eau-de-vie comme on en fabrique beaucoup dans la contrée. Nous employons une partie de notre temps à creuser des tranchées avec nos braves Américains, les initiant de notre mieux à la guerre actuelle, et le parfait accord régnait entre nous malgré la difficulté de la langue, finalement on arrivait toujours au bon résultat.
Chacun d’entre nous serait volontiers resté finir la guerre dans ces conditions.
Mais tout a une fin et un beau jour, il a fallu quitter ce bon petit pays où tous avions gardé un bon souvenir. Moi et mon capitaine, avec quelques camarades, logions chez Madame Clanet, une marchande de vins en gros, que dans nos heures de repos nous aidions au travail de la maison.
En somme, la vie de famille était revenue parmi nous, toutes les souffrances passées étaient presque oubliées. On avait beaucoup de petites faveurs, entre autres on nous donna des petites permissions pour visiter les villes d’eau comme Contrexéville, Vittel, Martigny.
1918
C’est au milieu de toutes ces rêveries, après des adieux touchants de toute la population civile, par un temps épouvantable vers les premiers jours de janvier 1918, que nous quittâmes St-Ouen-les-Pareys pour remonter aux tranchées.
Nous passons par Châtenois, Autreville, où le régiment avait déjà cantonné en 1916, et ensuite Colombey-les-Belles et, de là, nous traversons Toul, toujours à pied, et allons coucher à Pargnez-les-Toul où nous restons quelques jours. Nous allons relever le premier régiment de la légion étrangère à gauche de Flirey, au lieu-dit le bois du Jury, secteur assez calme à cette époque.
Si ce n’est quelques escarmouches de temps à autre du côté où les Américains font connaissance avec les boches, ne voulant en rien céder à l’ennemi, et les harcèlent sans répit, ce qui fait agiter le secteur.
Nous y restons jusque dans le courant de février et devant le nombre toujours croissant d’Américains venant dans les parages, nous leur laissons place et retournons un peu plus à droite (secteur Limey-Remenauville) où notre plus grande occupation consiste à des travaux de défense afin de conjurer la ruée ennemie dont celui-ci nous menace dès le printemps de cette années 1918.
Comme à l’ordinaire, je pars en permission où je retrouve l’angoisse des miens se demandant quand est-ce que cette vie là sera finie, car à l’arrière comme à l’avant, la lassitude se faisait fort sentir et nul n’envisageait l’avenir bien brillant devant la défection russe, l’écrasement de la Roumanie.
Tout le monde savait que le moment approchait où de sérieux évènements allaient se dérouler, ce qui en effet ne tarda pas à venir. Tous, à cette époque, attendaient avec calme l’issue des évènements. Le seul espoir restant était l’arrivée en masse de ces braves Américains, arrivant sans relâche de l’autre côté de l’océan.
Après avoir passé mes dix jours, je retrouve mon régiment au même endroit, un peu au repos dans les coteaux meurtris du bois-le-Prêtre où, le cœur bien sombre, je reprends mes anciennes habitudes.
Nous passâmes les premiers jours du printemps dans ces endroits déserts et regardons pousser les violettes et pâquerettes, attendant avec calme l’orage qui commençait à se dérouler au lointain, car nous apprenons que la première nuée venait de se faire sentir dans le nord sur les Anglais qui, malgré leurs efforts, durent céder pas mal de terrain.
Ensuite, ce fut la ruée sur Amiens où tous nos efforts de 1916 puis notre village de Rancourt, où tant de nos camarades sont restés entre les mains de l’ennemi, et en trois jours ils sont à Villers -Bretonneux à quelques kilomètres d’Amiens.
Dans notre secteur, on redouble de vigilance, on est énervés de part et d’autre. L’ennemi nous taquine avec ses canons à obus asphyxiants, on tâte le terrain et dès le mois de mai on commence à comprendre le jeu de l’ennemi. Le véritable danger n’est pas de ce côté-ci. Déjà les divisions de notre corps d’armée déambulent au plus vite de ce coin de Lorraine.
Notre tour s’approche, aussi les permissions de toutes sortes sont supprimées, néanmoins je réussis à aller embrasser ma femme et ma fille Solange, venant de naître dans le plein de cette tourmente, ce que du moins j’aurai l’occasion de connaître avant de rentrer à nouveau dans la mêlée (10 mai 1918).
En rentrant au régiment, déjà les bruits circulent fort du départ de notre division 69 pour aller arrêter le flot. Notre brave colonel nous quitte pour aller prendre un nouveau poste au champ de bataille.
Son remplaçant, le colonel Perchenet, nous donne plutôt une mauvaise impression, punissant presque tout le monde à tort et à travers pour de méchantes bagatelles de rien.
Bref, mon capitaine me quitte à son tour pour aller dans une formation de tanks dont l’emploi devenait de plus en plus fréquent, et c’est avec un serrement de cœur que je l’accompagne jusqu’à Toul, ayant vécu près de deux ans avec cet homme dans de bien dures conditions parfois.
Notre nouveau capitaine Pey, prenant le commandement du bataillon, me garde à la liaison et, toujours sur le qui vive, apprenant encore la nouvelle ruée ennemie dans l’Aisne, juste à l’endroit de notre arrêt de 1917 en face Juvincourt, jusqu’aux alentours de Reims.
L’ennemi reconquiert tous nos succès de cette malheureuse attaque de l’Aisne de 1917, le Choléra, Berry-au-Bac, poussant bien plus loin jusqu’à Fismes et Château-Thierry, menaçant Paris et la Marne, encore une fois atteinte.
Vers la fin du mois de mai, nous recevons enfin l’ordre de quitter notre secteur, laissant le soin aux Américains, déjà très nombreux dans cet endroit, de se débrouiller avec les boches. Ils s’en chargèrent à merveille puisque quelques mois après ils attaquèrent et reprirent St-Michel.
Après avoir passé quelques jours à Foug, à côté de Toul, nous nous embarquâmes, malgré une forte épidémie de grippe dont presque tous étions plus ou moins atteints et qui diminua beaucoup notre effectif de combat. Néanmoins, c’est dans ces conditions que nous roulons pendant trois jours.
Comme à l’habitude, nous faisons le tour de Paris, tous biens anxieux de ce que réservera encore une fois l’avenir si sombre en ces moments.
3 Juin 1918.
Nous débarquons le 5 dans la petite gare de Liancourt, dans l’Oise et commençons à voir tous les malheureux, errant sur les routes avec leurs hardes les plus précieuses, fuyant devant l’envahisseur.
La Bataille de l’Oise
9 – 19 Juin 1918
Affaire de la ferme Porte (10 juin 1918)
De Liancourt, les autos nous conduisent jusqu’au petit village de Lamécourt, en passant par Clermont-sur-Oise. Nous y passons la nuit du 6 au 7 juin, comptant bien y passer encore quelques jours afin de nous remettre un peu de ce voyage.
Bien reposés de notre fatigue du train, nous employons une partie de la journée à nous nettoyer un peu de la poussière dont nous sommes tous couverts.
Le soir, on se rendort un peu tranquilles lorsque, vers deux heures du matin, nous sommes tous réveillés par une canonnade des plus intenses, au lointain. Pas de doute, quelque chose de sérieux se passe de ce côté.
En effet, au petit jour, nous sommes alertés pour partir d’un moment à l’autre. Pensez l’anxiété des habitants, tous se préparent aussi à quitter le village. On les rassure de notre mieux qu’ils ne viendront pas jusque là, mais le sait-on ?
Enfin, après avoir touché quantité de boîtes de conserve, vers midi arrive une section d’autos pour nous conduire, soi-disant, à Montmartin. Nous roulons sur les routes depuis bientôt six heures, nous croisons quantité de charrettes de toutes sortes, fuyant devant cette nouvelle ruée ennemie.
Vers six heures et demie, nous traversons Montmartin et nous apprenons que le cantonnement est changé. C’est à la ferme Porte (désormais fameuse pour nous) que nous allons bivouaquer.
En effet, après avoir passé Gournay-sur-Aronde, où déjà quelques obus tombent, les autos nous débarquent en plaine, non loin d’une petite usine de sucrerie. A peine débarqués, on nous fait déployer en tirailleurs, dans les blés déjà hauts en ce mois de juin. Par petits bonds, on atteint cette fameuse ferme Porte, arrosée d’obus à gros calibres de la part de l’ennemi (beau cantonnement ma foi). Nous commençons à comprendre que les boches ne doivent pas être loin de là.
En effet, le commandant nous rassemble et dit que l’ennemi a pris Ressons et la forêt du même nom, le 9.
Notre mission pour le lendemain matin, le 10, est de leur reprendre par surprise, aidés par quelques tanks. Nous repartons donc vers dix heures du soir, afin d’avoir le temps de bien nous placer avant le jour, sur la route de Compiègne à Roye, en avant de la ferme Porte.
On devait commencer notre marche en avant pour attaquer ce bois de Ressons à la baïonnette. Combien il est dur et difficile pour nos chefs de nous conduire à l’endroit fixé, en pleine nuit, dans les blés jusqu’au cou ! Si bien que nous avons galvaudé toute la nuit pour trouver les quelques éléments du 32ème et du 66ème qui avaient subi tout le choc du 9.
Les officiers en profitent pour leur demander des renseignements, si précieux en ces circonstances.
Après avoir parcouru encore deux ou trois cents mètres au grand jour, où déjà le soleil luit, nous sommes reçus par une grêle de balles de mitrailleuses.
En traversant cette malheureuse route, tant de nous devaient y trouver la mort. Moins de deux ou trois minutes après, on voit arriver à nous des rescapés de différents régiments, nous disant que l’ennemi attaquait en masse, sans canons.
En effet, on les voit sortir par paquets de ce fameux bois de Ressons que l’on devait attaquer. Trop tard maintenant, il faut s’organiser à défendre notre route coûte que coûte, afin de leur barrer l’accès vers Compiègne, but de leur offensive.
Nous faisons des signaux à notre artillerie 268, avec des fusées destinées à cet usage, mais nous attendions en vain ce barrage dont ces effets auraient été si efficaces. Nous avons su plus tard qu’il n’y avait pas de canons, notre régiment d’artillerie n’étant point encore arrivé et les anciens étaient capturés. Nous étions donc réduits à agir par nos propres moyens.
On tire sans arrêt sur cette vague humaine qui hésite devant nos feux de mitrailleuses et de fusils qui crépitent de toutes parts. Les boches s’arrêtent et font de même.
Deux heures durant, ce n’est qu’un sifflement de balles sans aucun coup de canon d’un côté comme de l’autre. On nous avait dit que l’aviation prenait part à la guerre actuelle et on attendait anxieux son aide. Nous ne voyons rien arriver, ni avions ni canons et nos munitions s’épuisent. On a beau fouiller nos camarades tués à nos côtés, nos fusils ralentissent, maintenant il nous faut tirer qu’à coup sûr.
Notre brave commandant Pey, la jumelle aux yeux, fait les cent pas sur la route et voit la situation s’empirer sans cesse.
Gêné par un blé magnifique devant nous, il rassemble ce qui reste du bataillon à cet endroit et nous fait charger à la baïonnette dans ce blé afin de nous donner de l’air. Nous parcourons environ les trois cents mètres de la largeur du champ sans trop de casse, nettoyant les quelques enragés boches qui avaient déjà installé des mitrailleuses.
La principale ligne ennemie que nous apercevons à moins de cinquante mètres de nous, tapie dans un champ attenant au blé, recule en désordre, face à notre audace. Mais à droite et à gauche, l’ennemi avance.
Voyant cela, notre capitaine nous ramène à nos anciens emplacements, sur les bords de notre route, hélas peu nombreux. La situation devient critique, le cercle se ressert à droite et à gauche, en face de nous les boches ne bougent pas.
On épuise nos munitions, notre capitaine est blessé au poignet par une balle explosive. Je me hâte, sous la mitraille, avec un camarade Leclerc, de lui faire son pansement. Malgré sa douleur, il refuse de nous quitter, nous exhortant sans cesse à avoir du cran. Mais notre petite troupe diminue, celle de l’ennemi grossit, les autres bataillons reculent en combattant.
Voyant cela, mon capitaine me charge d’une mission auprès du commandant Vigne du 2ème bataillon pour lui dire que notre poignée de survivants soutiendra sa retraite jusqu’à la crête de la ferme Porte, et qu’ensuite il se repliera à son tour et lui disant de le soutenir si possible jusqu’à sa hauteur.
Je pars, sac au dos, fusil à la bretelle, au pas de course, au milieu des balles, dans les blés et avoines, arrosé de pluie fine qui contribue à retarder ma course faisant des flac-flac dans mes godillots. Qu’importe, j’ai hâte de parcourir ces mille cinq cents mètres environ. Chemin faisant, je suis pris à partie par une mitrailleuse, devinant sans doute mes projets. Les balles coupent les épis autour de moi, percent ma capote.
Un instant je me couche, faisant mine d’être touché. Reposé un peu, je repars de plus belle au pas de charge, au plein milieu d’une avoine, je ferme les yeux, arrivera ce qu’arrivera. Je cours au plus droit, sans utiliser les couverts.
Tout en marchant dans un champ de luzerne, je trouve deux belles cailles dans un nid. Dans la tourmente, je les ramasse et les met dans ma cartouchière vide. Dans quelle intention ?
Je ne saurais le dire.
Enfin sans anicroche, dans ces passages pénibles, je rejoins le deuxième bataillon, se disputant le terrain pied à pied avec l’ennemi. Je cherche le commandant Vigne mais je ne trouve que son adjoint, le capitaine Thomas, qui me renseigne. Le commandant est à un kilomètre plus en arrière. En maugréant, je retourne donc et enfin je le trouve, dans un abri avec le commandant du premier bataillon.
Sans cérémonie je lui explique ma mission et après il me fait cette réflexion injustifiée :
« Qu’est-ce qu’il fout votre capitaine pour ne pas
pouvoir défendre cette route dont il est chargé ? »
Force me fut de ne rien dire devant le grade, quoique je lui dis en partant que, blessé au poignet, il était à son poste et n’était pas dans un abri comme celui-là, attendant tranquillement la suite des évènements !
Ne m’attardant pas, je repris ma course pour rejoindre mon bataillon, mais en inspectant dans la direction, j’aperçus que devant le nombre de l’ennemi, il rétrogradait à son tour. Je fis une oblique à droite et bien m’en prit car à peu de distance, les boches approchent à grands pas. Il faut faire attention de ne pas se faire prendre dans tous ces blés où il est si facile de ramper sans être vu.
Avec prudence, je rejoins le bataillon, se disputant le terrain pas à pas avec l’ennemi. Je cherche mon capitaine pour lui rendre compte de ma mission, mais on me répond qu’il est parti se faire soigner et que le capitaine Bertrais le remplaçait, je me décharge de ma mission au plus vite auprès de lui.
Talonnés de près par l’ennemi toujours grossissant, on se replie sous une pluie de balles, un peu en désordre. Les boches, enhardis, ne nous laissent aucun répit. Tout est mélangé, c’est la pagaille en terme militaire.
Vers dix-huit heures, les boches tiennent la ferme Porte. Sur ces entrefaites, un bataillon de Sénégalais appartenant à notre unité contre-attaque. Il reprend un peu la ferme, les refoule un peu mais à son tour rebrousse chemin, accablé par le nombre.
Désormais c’était fini. Nous étions tous démoralisés ayant fait notre devoir.
Plus de munitions, point d’artillerie ni aviation. Chacun se demande qu’est-ce que cela veut dire. On a l’impression, en apercevant au loin la forêt de Compiègne, que si l’ennemi réussit à y pénétrer, c’était fini. On perd la crête, face à la ferme Porte, on retraverse la route de Gourmay et route de Compiègne on rétrograde tout doucement, ne cherchant même pas à tirer tellement nous sommes déjà harassés. Personne pour nous secourir.
En baissant la tête, nous faisons encore un kilomètre comme cela. Sur une autre crête en avant, nous trouvons quelques petits détachés qui creusent à l’orée d’un blé.
On s’arrête, en voyant cela nos quelques chefs nous rassurent un peu, disant que les boches sont arrêtés et qu’ils n’avancent ni à droite ni à gauche. Gourmay est repris et il nous faut rester sur place. On se met donc à creuser. On forme une ligne de tirailleurs avec tout ce qui tombe sous la main de nos chefs.
On reçoit enfin des cartouches et vers trois ou quatre heures nous voyons éclater quelques obus français. Le courage nous reprend un peu.
L’ennemi s’installe, on le voit amener des petits canons à bras, leur ligne avancée grossit et on a l’impression que d’ici peu il va tenter un nouvel assaut. On ne tire pas craignant encore de manquer de cartouches et nous nous raidissons tous pour avoir encore la force de surmonter ce passage pénible. On fait des signaux à notre artillerie pour lui signaler les mouvements de l’ennemi au cas où elle était arrivée, mais rien.
On a un peu d’espoir si quelquefois elle arrivait.
Quelle bonne besogne mais à nos signaux aucune réponse. Elle venait en effet d’arriver et voyait l’ennemi aussi bien que nous grossir sans cesse sur cette route de Gourmay à Compiègne, prêt à tirer au moindre mouvement de sa part.
Soudain, vers quatre heures et demie, toute cette masse grisâtre sort de cette route, on se raidit pour les recevoir, le doigt sur la gâchette, attendant le signal de tirer.
Tout à coup, un barrage de tous calibres se déclenche de chez nous. Pendant que nous les recevons à coups de fusils et mitrailleuses, on rit et on danse même, face à ce bon tour joué aux boches par nos artilleurs. Les bras, les jambes, volent en l’air, le boche apeuré se sauve et essaye de retraverser notre barrage. Presque tous sont écrasés par ce barrage infernal.
S’il était arrivé à temps le matin, nous n’aurions pas eu à subir cet échec, si démoralisant pour nous. C’est avec peine que notre capitaine Bertrais, un brave très aimé de ses hommes, commande ce qu’il reste de notre bataillon et parvient à nous empêcher de courir au derrière des boches, car il ne faudrait pas maintenant se faire tuer inutilement par nos obus.
Quelle débandade maintenant chez l’ennemi, c’en était fait de leur avance pour la prise de Compiègne. Les artilleurs arrivèrent juste à temps pour sauver la situation. Gloire à notre 268ème régiment de notre 69ème division d’infanterie.
Voilà comment par miracle on arrêta, de quatre heures à cinq heures du soir, trois divisions ennemies.
On creusa des tranchées, notre artillerie grossit de jour en jour.
Quand nous apprîmes dans quelles conditions nous entrâmes dans cette mêlée, sans aucun moyen efficace, c’est un miracle si l’ennemi ne réussit pas ses projets d’atteindre la forêt et la ville de Compiègne le 10 juin.
Nous restâmes dans cet endroit une huitaine de jours où l’ennemi se vengea de son échec en bombardant à portée de canons avec des obus de gros calibres, tous ces petits hameaux prospères comme Gournay, Monchy-Humières, Coudun, Baugy…
Nous sommes relevés le 20 pour aller cantonner quelques jours à Coudun, pour ensuite aller à Venette et de là, à Jaux où nous restâmes quelque temps.
Quelques notes, en passant, sur le soldat.
Notre stupéfaction fut grande en traversant ces pays des environs de Compiègne, arrosés de quelques coups de canons de temps en temps, pillés, mis à sac par les services d’arrière français, non seulement la boisson et les victuailles mais aussi le mobilier éventré, le linge traînant épars, le tout saccagé d’une manière abominable. Les gens restants, car il s’en trouvait quelques-uns m’affirmait-on, ne virent pas pareille chose de la part des hordes lors de leur passage de 1917.
A Venette et à Jaux ainsi que beaucoup de magasins de Compiègne, j’ai vu voler des machines à coudre, des vélos, sous le nez des gens. On leur disait que les boches allaient venir leur prendre. J’ai connu une canonnière où les marins avaient entassé des machines de toutes sortes, en face de Jaux, dans l’espoir de les écouler une fois à l’arrière.
Un jour la canonnière et tout le bazar furent coulés au fond de l’eau par des obus à longue portée par l’ennemi, au grand contentement des gens restants à Jaux, en ces moments pénibles.
Nous partons le 29 de Jaux pour aller cantonner à Lachelle-St-Rémy.
Toutes les nuits, nous employons notre temps à faire des travaux de défense, le secteur assez agité la nuit est en général calme le jour. De là, nous allons passer huit jours à la ferme Calfeu.
Juillet 1918
Dans la nuit du 13 et 14, nous descendons, soi-disant au repos, dans un petit pays appelé Arsy où nous fêtons un peu la fête nationale du 14 juillet.
Le 15, nous sommes alertés, on venait d’apprendre que l’ennemi venait de tenter encore un gros effort dont on ignorait les résultats.
À partir de ce jour, commencèrent pour nous des marches de nuit pénibles.
La nuit du 15 au 16
Nous retraversons Compiègne et cantonnons le jour dans un beau parc à côté du village et château de Francport.
Le lendemain, nous partons à deux heures et traversons la forêt de Compiègne dans toute la longueur. Elle cachait en cette époque de juillet 1918 du matériel de guerre moderne de toutes sortes, tanks, artillerie lourde, véhicules.
Il était bien aisé de deviner le but de notre arrivée à marche forcée dans ces parages. Après avoir passé le château de Pierrefonds, célèbre par sa beauté et son site, nous allons passer le restant du jour dans le bout de cette fameuse forêt, aux environs de St-Etienne où on rassembla toute la 69ème division dont je fais partie.
En cet endroit, dans le plus grand secret et en silence, nos chefs nous disent que demain matin à trois heures trente, on attaque l’ennemi par surprise, par des moyens puissants, depuis Villers-Cotterêt jusqu’aux environs de Soissons.
Notre division a pour mission d’occuper et de nettoyer le terrain à mesure de l’avance. Il est vrai que depuis notre dernier choc, l’effectif a été bien restreint.
N’ayant pas ou très peu de renforts, on se prépare à partir sans repos, à la tombée de la nuit, afin de nous rapprocher le plus possible du champ d’action pour jouer notre rôle. Par une nuit orageuse, avec des averses à flots, tous les services sortirent de cette forêt. Si la nuit avait été claire, l’aviation ennemie se serait sûrement aperçue de tous ces mouvements. Mais rarement on avait vu un orage pareil et c’est avec mille maux qu’on réussit à sortir de cette forêt. On ne voyait ni ciel, ni terre, éblouis par les éclairs pouvant un instant nous tirer d’embarras.
Après culbutes sur culbutes, nous sortons enfin et l’infanterie est obligée de passer dans les champs, les routes étant assez encombrées des autres armes de toutes espèces. Trempés jusqu’aux os, esquintés, nous arrivons au petit jour dans un trou, abritant quelques maisons, appelé les Bourbettes. En cet endroit, nous attendons patiemment les résultats et vers huit heures, nous apprenons que le début a très bien réussi, à l’aide des tanks et aidés d’américains dont l’effort, paraît-il, fut foudroyant.
À midi, par une chaleur torride, nous partons rejoindre les troupes d’assaut et nous arrivons au pied de Coeuvres et Laversine là où fut lancée l’attaque du matin. Nous traversons les anciennes positions ennemies recouvertes de cadavres et, par un temps magnifique, nous croisons quantité de files de prisonniers conduites fièrement en lieu sûr par ces braves américains, heureux d’une aussi bonne journée. 18 juillet, six heures du soir.
Par une nuit très différente de la précédente, nous sommes éclairés par la lune brillante et l’ennemi, averti maintenant de nos desseins, a lancé son aviation sur nos services vitaux d’arrière. A l’aide de fusées éclairantes, ils cherchent à atteindre et à paralyser leur effet. Mais malgré les bombes, rien n’arrête cette fourmilière bien décidée. Quel triste aspect que ce champ de bataille où bêtes et gens ne se soucient que de leur service, où ce n’est qu’un-va et- vient continu, nuit et jour.
Nous passons la nuit et la journée du 19 ainsi que celle du 20 en réserve, au plein milieu d’un champ d’avoine. Nous admirons la vaillance et le courage de ces diables d’Américains qui, malgré leurs efforts, n’ont pu chasser l’ennemi des carrières et hauteurs en avant de Soissons et sur la Crise.
Nous repartons le 21, pour tenter à notre tour de déloger ces maudits boches, en haut des carrières de Saconin où ils sont restés accrochés.
Malgré cinq assauts dans la même journée, tous les efforts ont été vains. C’est au premier bataillon que revient l’honneur de se mesurer le premier et au dernier moment, on reçoit l’ordre de ne plus insister et de se maintenir sur place en organisant le terrain.
Nous employons notre temps à nous organiser le mieux possible et pendant notre séjour en ligne nous avons la déveine d’être tous les jours arrosés par la pluie, pataugeant dans la boue.
Août 1918
Nous y restâmes jusqu’au 1er août où, toutes les nuits, nous subissons des marmitages à gaz.
Sous la pluie persistante, malgré la saison chaude, nous sommes transis sous nos loques humides et boueuses, cela nous rappelle le tableau de la Somme. Sur ces entrefaites, bien que l’ennemi en face de nous était assez tranquille, il n’en était pas de même sur la droite où sans cesse on était attaqués d’un coin ou de l’autre et ils s’étaient encore enfoncés de quelques kilomètres.
Aussi quelle ne fut pas notre surprise, le 1er août au matin, de les voir déguerpir et comme nous comptions bien aller nous reposer un peu, ce n’était pas le jour. Sous la conduite du capitaine Thomas, nous partons donc dans un état lamentable à la poursuite de ces boches damnés.
Après avoir traversé la Crise sans accident, nous traversons Vignolles et Courmelles sans trouver âme qui vive.
Le soir, nous recevons l’ordre de pousser jusqu’au contact de l’ennemi et harassés, nous allons échouer en pleine nuit au lieu-dit La Petite Chaumière, dans les faubourgs de Soissons et là nous apprenons que l’ennemi s’est retiré derrière l’Aisne, dans leurs anciens emplacements de 1915-1916.
En cet endroit, nous subissons un marmitage effroyable et après deux jours passés là, nous allons occuper des carrières en haut du bois d’Orcamps et village du même nom.
Là nous subissons un peu de répit et nous en profitons pour nous laver un peu. Très bien placés, nous dominions le château de Belleu où les boches avaient installé un dépôt de cuivre volé d’où ils les expédiaient chez eux, en maîtres.
Nous restons là jusqu’au 10 et ensuite, allons occuper le nouveau secteur que nous avions organisé à Villeneuve ainsi que la cote 94 qui domine toute la vallée de l’Aisne, distante de guère plus d’un kilomètre au nord-est de Soissons.
C’est d’ici que je pars en permission le 15 août 1918. Elle se passa comme à l’ordinaire, dans l’inquiétude de la prochaine, on en profita pour fêter le baptême de ma petite fille Solange.
Entre deux combats, je rejoins mon bataillon ou plutôt ce qu’il en reste, au Faubourg-St-Waast de l’autre côté de l’Aisne, en face de Soissons, où j’appris que sans moi, le régiment s’est couvert de gloire.
En effet, il a repris Vauxrot et Crouy, au prix de durs sacrifices. Nous sommes relevés et après avoir passé quelques jours de repos dans un petit pays appelé Villers-Saint-Genest, nous nous embarquons à nouveau pour la Lorraine.
Directement nous allons occuper le secteur Xon et Lesménils le 30 septembre, où nous apprenons, avec joie, les succès répétés des alliés qui nous font revivre des jours heureux. Dans ce secteur, mon capitaine de l’affaire de la ferme Porte, revient commander le bataillon, guéri de sa blessure.
Il me choisit comme ordonnance et je finis la campagne avec lui.
Rien de bien intéressant, comme tous les secteurs de Lorraine, sauf quelques escarmouches. Nous sommes relevés le 9 octobre et allons coucher deux ou trois nuits à Nancy, à la caserne Molitor.
Embusqué : Septembre-décembre 1918
Pendant ce court laps de temps, mon commandant Pey est désigné pour être directeur de l’école d’armée de Blainville-sur-l’Eau et m’emmène avec lui pour soigner le cheval. Je passai un mois en père peinard, dévorant les journaux où se déroulait avec rapidité le sort de cette malheureuse guerre, avec l’espoir cette fois de bientôt en voir la fin.
Suivant pas à pas, la marche des évènements, on apprit avec joie l’abdication du Kaiser, les démarches et le délai de soixante-douze heures accordé par le général Foch aux Allemands. Néanmoins, nous recevons l’ordre, avec mon commandant, d’être arrivés avant le jour du 11 novembre, en prévision d’une attaque projetée dans toute la Lorraine, dont le départ était fixé à midi.
Je partis seul avec mon cheval, le commandant étant parti en automobile.
Aussi quelle joie, le matin du 11 novembre, vers sept heures, en passant à Nancy, j’appris que l’armistice était signé. Sur tous les fronts à partir de midi, il y a eu cessations immédiates des hostilités.
Je me dis : « Adieu l’attaque de midi ! ».
Avec un ou deux soldats, nous arrosâmes cet heureux jour, d’un vieux coup de pinard Nancéen. N’étant point trop pressé maintenant, je fis la route tranquillement et retrouvai mon bataillon en fête sur les bords de la Seille, en face Manhoué d’où devait partir le régiment si l’attaque avait eu lieu. Quel chambard, pensez-vous !
Avec quelle joie la nuit, on fit un célèbre feu d’artifice comme jamais de mémoire d’homme. Ainsi que les boches, on épuisa tous les stocks existants et ce ne fut qu’illuminations durant toute la nuit et une partie du jour, d’un camp comme de l’autre.
Maintenant nous attendions le jour de franchir la Seille et la frontière pour aller de l’autre côté faire exécuter les clauses de l’armistice. Nous employâmes les quelques jours de répit, du 11 au 17, à pêcher dans la Seille avec les grenades où les boches en firent autant.
Donc le 17, à six heures du matin, nous partons le cœur content, non sans précautions, traversant cette Seille faisant frontière depuis 1870 dans ces parages. Nous étions impatients de savoir ce qui se passait de l’autre côté et, pétillants de joie, nous traversons les organisations que l’ennemi avait accumulées depuis bientôt cinq ans dans ces endroits.
Nous étions heureux de pouvoir traverser librement ces tristes champs lorrains, plantés de fils barbelés et en pensant que combien de nous dormiraient encore en ces endroits si nous eussions dû les enlever de vive force. Nous traversons des pays abandonnés, sans trouver une seule âme et vers le soir nous arrivons à Delme, un petit canton lorrain.
Nous voyons avec joie les canons à longue portée, abandonnés à jamais par l’ennemi. Nous voyons très peu de civils, les boches les avaient évacués pour les voler plus facilement.
Le soir, assez fatigués, nous allons cantonner dans un petit village appelé Bacourt où tout le monde nous embrassent et pleurent de joie en nous voyant et nous racontent leurs misères noires depuis quatre ans, souvenirs inoubliables.
Nous couchons chez le curé, un bon vieux âgé de près de quatre-vingts ans, exerçant déjà avant 1870. Il embrassa le commandant en lui disant que maintenant il pouvait finir ses jours, ses vœux étaient exaucés. De braves lorrains se mettaient à genoux devant ces poilus, remerciant le bon St-Martin de les avoir délivrés, souvenirs touchants.
Nous repartîmes le lendemain de bonne heure pour Faulquemont, que les boches avaient surnommé Falkenberg.
Dans tous les petits villages notre musique jouait, les habitants, après avoir décoré de guirlandes, de drapeaux faits avec des moyens de fortune, criaient à plein « Vive la France, vive les Soldats ». Dans tous ces villages ce fut à quelque chose près les mêmes accueils touchants.
Vous décrire notre arrivée dans Faulquemont serait impossible, nous fîmes notre entrée musique en tête, drapeaux avec étendards déployés. Des milliers de Lorrains qui avaient arboré nos trois couleurs, ont accouru du fond de leur campagne pour nous faire cette réception grandiose et simple dans son ensemble.
On y resta une huitaine, on organisa des bals, on joua des vieux airs lorrains.
Jeunes et vieux, filles et femmes dansèrent à cœur joie dans les bras des poilus, débordés de toute part. On refit connaissance avec les vieux qui causaient toujours admirablement bien leur ancienne langue.
Au milieu de toutes ces braves familles lorraines on partageait leurs friandises, tandis que de notre côté, nous leur donnions du bon pain blanc et un peu de vin dont depuis si longtemps ils n’avaient vu la couleur.
Comme à Bacourt, à Faulquemont nous sommes logés chez le curé, l’âme désolée de ne pouvoir rien nous offrir. En échange c’est nous qui partagions pain, viande et vin avec eux, bref quoique l’on dise, les moins patriotes étaient émus malgré eux.
Le 25 novembre, nous quittons ce brave curé, désolé de nous voir partir.
Après une petite étape, nous traversons St-Avold, admirablement bien décorée où, à notre stupéfaction, les habitants avaient pendu des mannequins habillés en soldats teutons.
Partout ce ne fut que fête sur fête, dans beaucoup de maisons on voyait installée aux fenêtres la statue de Napoléon.
De là, nous allons coucher à Freymingen où le même accueil nous attendait, avec tous les égards dus à des soldats, chose oubliée depuis si longtemps dans les zones du front français.
Nous séjournons encore près de huit jours dans une bonne vieille famille française du nom de Hager travaillant aux mines de charbon de ce pays. Durant notre séjour, nous sommes choyés par leurs enfants, si heureux de voir des soldats français.
Nous repartons vers les premiers jours de décembre et allons cantonner au lieu-dit Geislautern où nous commençons à inspirer de la méfiance à nos anciens ennemis.
En effet, maintenant la frontière d’avant 1870 est dépassée et nous rentrons en Prusse rhénane. Cependant les gens se mettent à nos pieds et nous nous installons à notre aise chez un châtelain du pays.
Mais nous ne sommes plus en Lorraine et il est facile de voir les habitants nous maudire dans leur jargon à la boche. Au son de nos clairons, nous traversons la Sarre à Völklingen où il existe des usines de fer magnifiques. Les habitants ferment leurs portes à notre passage.
Nous passons Puttlingen et allons cantonner à Heusweiler où nous restons un mois et demi, employés aux différents services de places pour le maintien de l’ordre, dans ce riche pays de mines de charbon et de fer.
De ce pays, je repars pour la dernière fois en permission le 6 décembre où il nous est accordé vingt jours à l’occasion de l’armistice.
1919
A mon retour, je retrouve mon régiment toujours au même endroit et nous apprenons que nous allons quitter notre 69ème division d’infanterie pour être réservés à notre ancienne 42ème dont nous faisions partie jusqu’en 1917 sur l’Aisne.
Nous quittons donc Heusweiler le 18 janvier et nous parcourons à nouveau ces belles routes et forêts du bassin de la Sarre.
A tout moment surgit une mine de charbon en plein travail, cachée derrière ces petits mamelons boisés, si fréquents en ces endroits.
Après avoir passé une nuit à St-Ingbert, nous poussons jusqu’à Homburg où on nous fait une revue superbe sous le nez des habitants plutôt hostiles à la France.
De là, nous reprenons la grande route de Kaiserlautern et allons cantonner dans un petit hameau du nom de Nieder-Miesau (*) où nous passons le restant de janvier 1919.
Dans ce petit pays entièrement agricole, nous n’avons pas eu à nous plaindre et au dire des habitants de ce coin du Palatinat aux yeux desquels on nous représentait comme de pires brigands en souvenir de l’incendie de leur pays sous le Consulat après la révolution de 1789. C’est peut-être un peu la cause s’ils étaient si empressés auprès de nous.
(*) : Ville ayant été remaniée en 1937 : territoire appartenant
aujourd’hui à la ville de Bruchmühlbach-Miesau
Vers le 1er février, une fois complètement réinstallés à notre nouvelle division, nous apprenons que nous devons aller en Alsace, direction Hagenau.
Nous nous remettons donc en route et par étape nous effectuons le trajet en passant une nuit tout près de Homburg, au lieu-dit Schwarzenbach.
Ensuite nous passons par Zweibrücken, en français Deux Ponts et allons cantonner à Hornbach, ville située sur une hauteur où subsiste encore un vieux château antique du style François 1er.
Nous y passons une huitaine de jours où, avec quelques camarades, je suis logé chez le Chournard c’est à dire le cordonnier, dans ce petit pays. Nous sommes très bien reçus et les mœurs sont plutôt françaises, du fait qu’avant 1870 la frontière d’Alsace n’étant distante que de quelques kilomètres, cinq tout au plus.
Nous repartons après avoir pris toutes les précautions en vue d’effectuer la traversée des Vosges alsaciennes, recouvertes d’une épaisse couche de neige en cette époque. Nous couchons le 7 au soir au premier village alsacien appelé Urbach. Nous trouvons abondance de gniole, fabriquée avec des prunes qui poussent admirablement sur le pied des Vosges. Nous causons de choses et d’autres, heureux de retrouver notre langue au lieu du jargon boche.
Après une bonne veillée de famille, devant ces grandes cheminées alsaciennes, nous nous couchons bien au chaud dans les étables, heureux de notre soirée
8 février 1919
Le matin, nouveau départ et, à notre grande surprise, la terre était recouverte d’une épaisse couche de neige, tombée pendant la nuit.
Avec cela, une brise glaciale comme on ne l’avait jamais encore vue en hiver, aggrava fortement nos fatigues pendant la traversée de ces chaînes de montagne.
Après avoir passé la petite ville de Bitche, pendant une pause, notre colonel nous rappela son glorieux passé pendant la campagne de 1870, devant les survivants rassemblés autour de nous, les yeux émus. Nous repartons, drapeaux déployés et musique en tête, acclamés de bravos de ces braves gens patriotiques.
Après avoir traversé Lemberg, situé sur le faîte de la montagne, nous allons coucher à Baerenthal, par un froid intense, en plein milieu de la montagne, après avoir parcouru trente kilomètres. Nous nous étendons, harassés, sans paille autour d’un grand poêle dans l’école de ce pays perdu dans les neiges, au fond de ces montagnes. Nous repartons le matin de bonne heure, sous un givre, les souliers rétrécis par la neige, ce qui occasionne de fortes douleurs accompagnées d’engelures. Nous côtoyons un petit ruisseau entre deux montagnes, sous ce manteau de neige, pendant des kilomètres et des kilomètres.
Nous trouvons enfin le bout, au soir, où, de nouveau très fatigués, nous cantonnons à Zinweiller, beau petit village alsacien. Nous sommes reçus assez froidement et nos chefs durent se fâcher avec le maire afin d’avoir de la paille pour nous coucher par cette température si dure. Sans relâche, nous continuons notre randonnée toujours sous une épaisse couche de neige par un soleil accompagné d’une brise glaciale.
Maintenant, sous ce manteau blanc, nous apercevons ces clochers élancés une fois sur le haut des monts à perte de vue. Nous nous demandions vers lequel nous allions échouer à la fin du jour.
Nous arrivons enfin à Olhungen, en pleine campagne, à sept kilomètres d’Haguenau où nous restons quelques jours, bien reçus de ces braves campagnards alsaciens. Ils font l’impossible pour nous abriter des rigueurs de la température qui sévissent toujours d’une façon intense.
Le 13, après avoir passé une nuit à Uhlviller, nous contournons Haguenau et le 14 au soir nous allons échouer à Hoertd à quatorze kilomètres de Strasbourg.
Nous nous reposons un peu de notre longue randonnée. Dans ce beau petit pays alsacien, nous nous installons chez les habitants, bien contents de nous recevoir. Entre temps, la température se radoucit, ce qui nous permit de naviguer de part et d’autre, entre autre à Strasbourg. Il nous était accordé toute facilité de nous y rendre et nous allons admirer, le 18, cette cathédrale tant vantée et son horloge remarquable.
Bref, nous ne nous ennuyâmes pas le moins du monde en ces lieux charmants.
A notre grande stupéfaction, nous admirons les cigognes arrivant dans leurs anciens nids, juchés sur le haut des cheminées, dont beaucoup, comme moi, ne les avaient vues qu’en image, sur les bancs de l’école.
Entre temps, je me décide à aller rendre visite à la famille de mon frère Aristide, habitant Graffestaden, à cinq ou six kilomètres de Strasbourg.
Après quelques petites difficultés pour trouver la rue des canards, où ils habitent, je parviens quand même à m’y rendre. Nous fûmes tous ravis de nouer connaissance, je passai une agréable journée, en promettant d’y revenir à la prochaine occasion.
Nous quittons Hoertd pour Brumath à quelques kilomètres de là. Nous sommes cantonnés avec plusieurs camarades dans un hôpital dirigé par une religieuse protestante. Elle fut plutôt maussade avec nous, nous disant même que les soldats allemands étaient plus gentils que nous.
Un peu outrés de sa réflexion, nous lui répondîmes qu’elle aurait bien dû les suivre dans leur retraite, et que la France n’aurait pas perdu grand chose.
Pendant ce temps, la démobilisation de la territoriale s’avançait à grand train.
Déjà mes trois frères étaient de retour et je venais d’apprendre que ma classe était en voie de démobilisation. Je renouvelai mon voyage pour Graffestaden, profitant de mon séjour en ces parages.
À chaque voyage, je reçus le même accueil et j’en profitai pour visiter la ville de Strasbourg de fond en comble, jusqu’au Rhin, au pont de Kehl.
Cela me fit passer les jours plus vite en attendant mon retour.
Démobilisé
Enfin j’apprends officiellement que ma libération est fixée au 15 mars.
Quelle joie !
Ce jour tant désiré est enfin arrivé. Après avoir rempli les multiples petites formalités qu’exige ce métier de soldat, je me rendis à Graffestaden pour faire mes adieux. Tout comme mon frère Aristide qui me devança de quelques mois, c’était une joie pour les siens de nous savoir enfin libres, sans aucun mal de cette terrible guerre.
Armé d’une énorme musette que la belle sœur de mon frère me confectionna avec une toile de tente, je la remplis de mes quelques hardes et objets pour les rapporter au foyer conjugal. Je me rendis ensuite à Haguenau en compagnie de mon camarade Peynet, avec lequel je vivais depuis bientôt deux ans.
Nous passâmes un dimanche en cette ville, attendant le départ de ce train, si long à se préparer.
Il nous fut facile d’arpenter de rue en rue, toutes les curiosités de cette ville, qui n’avait rien de bien intéressant pour nous. Nos pensées étaient bien loin de ce pays, notre seul souhait était d’être à jamais débarrassés de ce cauchemar qui pesait sur nous depuis tant de temps.
Entassés dans des wagons à bestiaux, sans paille, j’arrive enfin, transi de froid, à destination le 19 mars, au milieu des miens, débarrassé à jamais de ce cauchemar.
Mézières-en-Drouais,
le 24 juillet 1919
![]()
Les plateaux Lorette, Somme, Verdun
1er couplet
Quand au bout de huit jours, le repos terminé
On va reprendre les tranchées
Notre place est si utile
Car sans nous on prend la pile
Et le cœur bien gros et sans sanglot
On dit adieu aux cyvelots
Sans tambours ni trompettes
Nous partons, hélas, en baissant la tête
Refrain
Adieu la vie, adieu l’amour
Adieu toutes les femmes
Ce n’est pas fini, c’est pour toujours
De cette vie infâme
C’est à Lorette sur le plateau
Que nous laisserons notre peau
Car nous sommes tous des condamnés
Nous sommes des sacrifiés
2ème couplet
Huit jours de tranchées, huit jours de souffrances
Pourtant on a l’espérance, car ce soir peut-être la retraite
Que nous attendons sans trêve
Lorsque tout à coup et dans un silence
On voit quelqu’un qui s’avance
C’est un officier de chasseurs à pied, qui vient pour nous remplacer
Et tout doucement dans l’ombre, sous la pluie qui tombe
Nos petits chasseurs viennent chercher leur tombe
3ème couplet
A Lorette là-haut, on va se faire descendre
Sans pouvoir même se défendre
Car si nous avons de très bons canons
Les boches répondant à leur son
Et forcés de nous terrer
Là, dans nos tranchées
Attendre l’obus qui viendra nous tuer
Nous tuer
4ème couplet
C’est malheureux de voir, sur les grands boulevards
Tant de cossards qui font la foire
Si pour eux la vie est rose
Pour nous ce n’est pas la même chose
Au lieu de se cacher
Tous ces embusqués
Feraient mieux de venir aux tranchées
Défendre leurs biens, puisque nous n’avons rien
Pauvres purotins
5ème couplet
Oui mais maintenant nous en avons assez
Personne ne veut plus marcher, aussi c’est fini
Car nos trouffions vont tous se mettre en grève
Ceux qu’ont le pognon, ceux-là reviendront
Puisque pour eux l’on se crève
C’est à votre tour, Messieurs les gros, de monter sur les plateaux
Puisque vous voulez toujours la guerre
Payez-la de votre peau
Les Embusqués
A l’arrière, dans tous les patelins
On voit des types gondains
Tringlots, brancardiers, secrétaires
Des gens qui sont tous militaires
Ils sont là depuis le début
Mais personne les a vus
Monter la garde dans les tranchées
Cela pourrait les déshonorer
Refrain
En attendant sans se biler
La fin des hostilités
Ils dorment bien heureux, dans des lits moelleux
Pendant que l’on se fait tuer pour eux
C’est toujours en sirotant de l’eau, qu’ils font leur bridge, leur tarot
Surtout il ne faut pas s’en moquer
Car ce sont messieurs les embusqués
2ème couplet
Ce sont tous des fils à papa
Crevés, casés par là
Froussards ayant un bon piston
Richards ayant beaucoup de pognon
Ils vous racontent un tas d’histoires
Des boyaux, des entonnoirs, mais tout ce qu’ils savent du front
C’est qu’ils l’ont vu sur l’Illustration
3ème couplet
Vous me direz qu’il est nécessaire
Pour les besoins de l’arrière
Qu’il y ait des gens qui nous ravitaillent
Et d’autres qui s’escrimaillent
Cela je l’admets, mais dans votre choix
Vous vous trompez parfois
Remplacez ces jeunes gens pleins de sang
Par des pères de trois ou quatre enfants
4ème couplet
Quand la guerre sera finie
Que la France envahie
Sera enfin débarrassée, de cette horde détestée
Ceux qui auront fait le coup de feu
Vu le danger pris d’eux
Sauront si la victoire nous l’avons
Ce n’est pas grâce à cette bande de cochons
Secouez tous votre turpitude, laissez là vos habitudes
Armez-vous vite d’un fusil, car il y a place pour vous ici
Car nous ne sommes pas des méchants
Nous pardonnons aux repentants, quand vous serez ici
On sera des amis, combattant tous pour notre pays
Vous entendez le bruit du canon, car c’est notre seule distraction
Et si la croix de guerre vous l’avez, c’est qu’alors vous l’aurez méritée.
Délépine, mort pour la France
A Verdun, 1917

![]()
Je
désire contacter le propriétaire du carnet
Vers d’autres témoignages
de guerre 14/18
