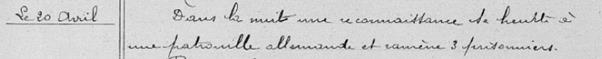Souvenirs de Gaston Chevillard, du 44ème régiment d’infanterie,
Caporal commandant le 1er groupe
de nettoyeurs de tranchées.
Mise
à jour : Octobre 2022

Henri-Claude nous dit :
« Bonjour je possède le carnet de guerre de mon grand père qui relate ses 4 années de guerre 14-18 au 44ème
régiment d’infanterie
Il a été numérisé. Je me
propose de vous le faire parvenir...
Le chtimiste :
« Les noms de villages ont été corrigés dans le
texte. J’ai ajouté du texte en bleu pour la
compréhension de certains termes et pour aller « plus loin » dans l’analyse
du récit. J’ai aussi ajouté des dates pour pouvoir mieux se repérer dans le
récit. »
![]()
Gaston
CHEVILLARD est né le 1er janvier 1896 à Geneuille
dans le Doubs. Incorporé au 44ème régiment d’infanterie en avril 1915 ; il
y effectue ses classes jusqu’en mars 1916, puis part au front dans cette même
unité. Ses souvenirs débutent dès avril 1915.
Le
44ème régiment d’infanterie fait partie de la 14ème division d’infanterie qui est
composée en 1914 pour l’infanterie de 2 brigades : la 27ème brigade (44ème
et 60ème régiments d’infanterie) et la 28ème brigade (35ème et 42ème régiments
d’infanterie) et pour l’artillerie d’une partie du 47ème régiment d’artillerie.
Ces régiments sont fréquemment nommés dans le récit de Gaston CHEVILLARD. Il
est décédé en 1971.
![]()
Mon incorporation
Affecté à la 29ème compagnie, caserne Michel, à Lons-le-Saunier.
École du soldat pendant 1 mois.
Ensuite, dirigé à Pontarlier, camp des Pareuses, nous étions 2
compagnies : la 29ème et la 30ème. Il en fut fondé une 3ème dans ces 2
compagnies : la 26ème, dont je fis partie.
Nous étions tous des bisontins, du Doubs, du Territoire de
Belfort, du Jura et de l’Ain ainsi que de la Saône-et-Loire.
La 26ème, donc la mienne, était commandée par des officiers
revenus au dépôt comme blessés de guerre. Dont un, en particulier, que je ne
peux pas passer sous silence, très brave, déjà blessé 5 fois. Très gentil, très
bon instructeur, qui aimait très particulièrement les gens débrouillards, et
faisait débrouiller ceux qui ne l’étaient pas. Il voulait faire de nous des
bons soldats et il a réussi pour une très grande partie des hommes qu’il a
instruits.
C'était le lieutenant (Jean
Désiré) Froidurot, de
Saint-Claude (Jura) de la classe 1913. (*)
En novembre 15, nous sommes venus cantonner à Vercel, une quinzaine de jours, avant de retourner à Lons-le-Saunier,
nous faire équiper à neuf. Tenue bleu-horizon et tout l’équipement à neuf.
Nous étions fiers d’être devenus des soldats, mais notre
instruction n’était pas terminée, ou plutôt, la France n’avait pas encore bien
besoin de nous.
(*)
: Il s’agit du sous-lieutenant Jean Désiré FROIDEROT, 27 ans, originaire
d’Orgelet, mais habitant bien à Saint-Claude au moment du recensement. Sa fiche
matriculaire indique qu’il était bien affecté au 44ème régiment d’infanterie en
mars 1915. Il avait déjà été 3 fois blessé à cette date. Il mourra intoxiqué
par les gaz en mai 1918 à l’hôpital de Zuydcoote
(59). Il sera 5 fois blessé et 6 fois cité.
A
cette date de fin 1915, il sort de sa seconde blessure, puis il va ré-integrer le 44ème régiment d’infanterie et il apparaitera très souvent dans les souvenirs de Gaston
CHEVILLARD. Il est inhumé à la nécropole nationale de Zuydcoote
(59).
Jean Désiré FROIDUROT. Photo tirée de l’amicale des
anciens du 44ème régiment d’infanterie

Bataillon de marche
Départ début décembre 1915. Direction inconnue ?
Arrêt prolongé à Auxerre, en face d’un train de marchandises qui
servit un peu au ravitaillement.
Un fait ! Dans mon compartiment, un jeune poilu rentre avec une
demi-livre de beurre frais, et, comme beaucoup d’entre nous, il faisait partie
des éternels fauchés, ce n’était pas avec sa paye de 7 sous et le paquet de
tabac qu’il avait pu le payer.
La question lui fut posée :
« Alors, on t’a fait crédit ? - Oui, la crémerie est en face ».
Finalement, c’est une caisse de demi-livres de beurre qui est
rentrée dans le compartiment et, dans les compartiments voisins, ce sont les quartaux de vin qui firent leur rentrée.
Par la suite, il y avait pas mal de chanteurs dans le train. A
notre arrivée à destination, perquisition dans le train, mais, bien entendu, il
n’y avait plus de pièces à conviction, elles étaient évacuées sur le ballast.
Notre terminus était Le-Mesnil-sur-Oger, gros village dans la
Marne, pays du vin de Champagne Moët-et-Chandon, dans
lequel nous étions formés en bataillons dits de marche.
Anecdotes à signaler : Nous logions chez l’habitant. Ma section
avait échoué chez une vieille femme, dans un grenier. Pas commode, la dame ! La
première nuit, nous avions été bien sages, comme des gens un peu fatigués du
voyage. Mais le lendemain matin, surprise très désagréable, le lieutenant
commandant de la compagnie vient nous rendre visite avec un rapport du colonel.
La petite vieille dame avait porté plainte au colonel pour grand tapage
nocturne.
Elle n’avait pas perdu son temps car, par la suite, elle a été
servie ! Elle a même réussi à faire passer pour fou ce bon camarade ClÉment qui, par la suite, a dû aller
passer une visite dans un hôpital à Châlons-sur-Marne. Il est vrai qu’il s’en
était donné la peine. (*)
Dans ce bataillon de marche, ce n’était pas la pause.
Entraînement poussé à fond. J'y suis resté jusqu’au 12 mars 1916.
(*) : Étienne Eugène CLÉMENT, né à Chagny (20
ans, sera cité plus de cinquante fois dans les souvenirs de Gaston CHEVILLARD.
Il est de la même classe, affecté à la même escouade et survivra aussi à la
guerre. Son surnom, certainement donné par Auguste sera « TiÉnot » ; certainement tiré
de son premier prénom. Ils seront ensemble dans les moments les plus durs de la
guerre et aussi les plus cocasses. Nous ne savons pas s’il se
sont cotoyés après la guerre.
Un troisième soldat, Georges
Louis CHOLLET, de la même escouade aussi, fera partie de cette
« triplette » très liée. Nous le retrouverons plus loin dans le
récit.
Départ en renfort pour le front
Quelques jours après avoir été passés en revue à Vertus par le
général Langle de Cary, commandant
en chef d’un groupe d’armée qui avait son quartier général à Avize, à 7
kilomètres du Mesnil-sur-Oger, une demande de renfort arrive, demande de
volontaires. Il s’en est proposé 800, dont moi et l’ami (Étienne Eugène) ClÉment.
Nous avons rejoint le reste du régiment dans un petit village
qui s’appelait Punerot (Vosges).
A l’entrée du village, le colonel Nieger, commandant le 44ème régiment, nous reçut et voici son
accueil :
« Jeunes soldats de la classe 16, je sais que vous êtes tous des volontaires et je vous en félicite, mais, nous sortons de Verdun, et je dois vous dire que nous y avons laissé 1700 hommes et 54 officiers. Les camarades que vous allez trouver au cantonnement, respectez-les bien, ils seront bons pour vous ».
Premier contact avec la 9ème compagnie
Nous n'avons pas passé la nuit avec les anciens et pour les
raisons que voici :
Au début de la matinée, le capitaine (Jules Bernard) Laulan (*), commandant de la 9ème compagnie dit :
« Rassemblement ».
La rue et une petite cour nous séparaient de lui et du petit
groupe de 4 hommes. Nous attendions le reste quand, tout à coup, le capitaine
s’écrie, avec son accent méridional :
« Bande de petits bleus, voulez-vous venir au rassemblement, qu'est-ce que vous attendez ? »
Réponse du brave
(Georges) THolLet (**), tué dans la Somme :
« Nous attendons la compagnie. »
« Eh bien, la voilà la compagnie ! »
Elle se composait de deux seuls
combattants, le capitaine et le sergent-major Mercier.
Par étapes, avec le barda et traînant les godasses, nous
arrivons à Jouy-sous-les-Côtes, secteur à droite de Saint-Mihiel, pour y faire
des travaux en attendant de remonter en ligne.
(*)
: Le capitaine Jules Bernard LAULAN, 29 ans,
passera au 42ème régiment d’infanterie le 12 juin 1916. Natif
de Barsac en Gironde. Caporal, puis officier de réserve en 1910 affecté au 44e
RI. Chevalier de la légion d’honneur en octobre 1915. Capitaine-adjudant-major,
il devient instructeur de fusils automatiques, puis directeur des cours de
perfectionnement de gradés en septembre 1917, puis des gradés polonais en
octobre 1918. 4 citations.
(**) :
Georges THOLLET, 21 ans, soldat au 44ème régiment d’infanterie sera tué dans la
Somme le 12 août 1916. Voir
sa fiche.
Premier sifflement d’obus
Nous étions à environ 5 kilomètres des lignes que nous
apercevions un peu, secteur tranquille à cette époque. Un beau matin, un obus
assez gros nous passe sur la tête et s’enfonce en terre, sans éclater, à 200
mètres de nous. Ma première pensée et réflexion :
« Et puis, c’est cela les obus, bien il n’y a pas de quoi en faire des histoires ».
Par
la suite, j’ai eu le temps de changer d’avis.
Un soir, à la chute du jour :
« 2ème section, faites vos sacs, on part dans une heure ».
Le matin, il y avait eu la 2ème piqûre de vaccination et
beaucoup étaient mal en point, pas moi : je n’y étais pas passé...
Sac au dos, et en route pour rejoindre notre cantonnement à côté
de Lay-Saint-Rémy.
Arrivés à 2 heures du matin, nous retrouvons la vieille paille
et les « totos » (poux).
Réveil à 5 heures, rassemblement sur deux rangs. 2 boîtes de
sardines, 1 boîte de singe (corned-beff), 4 boules de
pain, et en route pour Foug, à environ 15 kilomètres,
où les camions nous attendent.
Embarquement et en route pour la Voie Sacrée, direction Verdun.
Arrivée devant Verdun à la tombée de la nuit pour voir les 210 qui s’écrasent
sur la cathédrale, cantonnement, un manège par bataillon à Bévos,
caserne. Il n’y faisait pas chaud, et les cuisines roulantes n’étaient pas
arrivées.
Ravitaillement = ceinture. Il y avait quelques mercantis qui
venaient profiter de l’occasion.
Un camembert et un litre de pinard bon marché. On déambule, avec
toujours l’ami (Étienne
Eugène) ClÉment, nous tombons sur un
mercanti :
« Combien ton camembert ? »
« 3 francs »
« Et le pinard ? »
« 5 francs »
(A
cette époque le fromage coûtait 15 sous et le vin 20 sous). Nous nous servons.
« Et maintenant, si tu veux être payé, viens avec nous vers le colonel ».
Comme il a
refusé, nous avons été ravitaillés à bon compte.
Duel d’artillerie épouvantable
Le capitaine rentre au cantonnement :
« Bordel de foutre (c’était son juron), venez voir, c’est inimaginable | »
En effet, le ciel était complètement embrasé par les lueurs des
coups de départ et, malgré la nuit noire, on aurait pu lire le journal comme en
plein jour. On ne distinguait que les coups de départ des très grosses pièces à
longue portée, 240 et 380, c’était incroyable. Oui, mais voilà, le lendemain
soir, le 12 avril, il fallait passer
là-dessous.
Un bon conseil
Des blessés qui passaient voyant nos jeunes figures de bleus nous
recommandèrent :
« N'oubliez pas la croûte car il n’y a pas de ravitaillement possible ».
Chose que je n’ai pas oubliée, 2 musettes de biscuits, 2 de
boîtes de singe et encore tout ce que j’ai pu caser dans le sac, plus 250
cartouches, cela faisait du poids qu’il fallait porter, à chacun des arrêts :
vite le canon du fusil sous le sac.
Une chose qui fait disparaître le poids : les obus.
Premier contact avec les obus
Toujours accompagné de (Étienne) ClÉment, à la
sortie de Verdun. Très curieux, nous les bleus :
« Dis-donc, TIÉNOT (*), c’est des culots d’obus qu’on voit là ? - Penses-tu, on est
encore loin ».
Vion, vion,
boum, bom’ sur la route, entre les sections, et en
voici, et en voilà, il y en arrivait toujours, et tous ceux qui passaient sur
nos têtes. Je ne savais pas si je portais un sac et des musettes, nous
marchions par escouades, en file indienne, défense de s’arrêter, même pour un
copain blessé.
(*) :
C’est à ce moment du texte que l’on est certain que Étienne Eugène CLÉMENT
devient « TiÉnot »,
surnom certainement donné par Auguste.
Une belle frousse.
Dans un bois, à un tournant, pas très loin du Cabaret Rouge, un
coup dans les jambes et une détonation formidable à 4-5 mètres à ma droite, je
me baisse et je baisse la tête.
« Avance Chevillard »
« Je suis blessé »
« Où ? »
« Aux jambes. »
« Sacré c.…., si tu étais blessé aux jambes, tu ne marcherais pas, c’est un coup de départ, t’as pas vu la grosse pièce ? Je te dirai quand ce sera pour nous ».
C’était ce bon vieux caporal Piton
(*) qui me
donnait ce conseil, et, à partir de cet instant, la frousse avait à peu près
disparu.
(*)
: Joseph Marie François Édouard PITON, 32 ans, a été nommé caporal que le 27
juillet 1916, donc quelques mois plus tard que le récit. Mais comme ce sont des
souvenirs, Gaston CHEVILLARD s’en souvient comme caporal. Il vient d’arriver au
44ème régiment d’infanterie à la date du 17 mars 1916.
Blessé
le 12 août 1916 à l’attaque de Maurepas (Somme), revenu au 44ème, il sera
finalement tué lors de l’offensive du Chemin des Dames en avril 1917.
Une forte émotion
Après bien des plats ventres et bien des saluts de la tête, nous
arrivons à une croisée de route, à 200 mètres du fort de Tavannes.
Endroit bien choisi pour se faire canarder. Tout à coup, j'aperçois une masse
noire de l’autre côté du chemin. Toujours curieux :
« Dis, TIÉNOT, qu’est-ce que c’est que çà ?
« Ce n’est rien, viens. »
« Non, je veux aller voir. »
« Non, viens ».
Comme
on ne voyait pas clair, je tâte, oh que c’est froid, à me glacer le sang.
« C’est bien mieux maintenant ! ».
J'avais empoigné la main d’un camarade du 1er bataillon qui
avait été tué la veille, Je crois que c’est la plus forte émotion que j’aie eue
pendant la campagne, j’en ai cependant vu d’autres, tués à mes côtés.
Ma première arrivée aux tranchées
La première arrivée du 3ème bataillon à la ferme Dicourt se situe le 15 avril (JMO)
Position : ferme Dicourt, sur la
droite du fort de Vaux, à côté de la batterie de Damloup,
sur la gauche du bois de la Laufée.
Cette ferme était complètement démolie, sauf une toiture d’un
hangar, il y existait une espèce de cave dont la voûte était en briques rouges,
pas solide du tout. Un escalier sortait dans la cour, dans la journée, nous y
étions 3 sections bien tassées, mais il ne pleuvait pas dedans.
Dans cette cave, il y avait un piano et aussi un sommier dont je
m'étais emparé à mon arrivée pour nous servir de couchette, à nous deux TIÉNOT
:
« On n’a que le confort que l’on se donne, même en guerre »
J’avais aussi trouvé une boîte de singe de 1 kilo, elle était
bleue. Bien sûr, je l’ai mise aussi de côté, et j’avais bien fait, je l’ai
ouverte le dernier jour de tranchée, quand nous étions en réserve à côté du
tunnel de Tavannes.
Position de la ferme DICOURT
Première nuit au front de Verdun. La patrouille
Dès que nous fûmes installés dans la tranchée, il y eut une
patrouille d’organisée pour reconnaître un peu le secteur.
Un beau choix de patrouilleurs ? Une douzaine de jeunes de la
classe 16 commandés par un sous-officier du midi que nous avions reçu en
renfort quelques jours avant, blessé en 14, et qui n’était pas encore revenu au
front. Il se nommait ESTULIER.
Dès la sortie de la tranchée, nous commençons à charger nos
fusils :
« Qu'est-ce que vous faites ? »
Réponse
: « Où allons-nous ?
« Eh bien, en patrouille ! »
Alors, j’ai toujours cru qu’il avait eu peur qu’on le tue.
Heureusement pour nous, les boches n’étaient pas de sortie, et, malgré notre
bavardage, nous n’avons fait aucune mauvaise rencontre.
La patrouille terminée ; réparer le réseau de barbelés en partie
détruit par les 210. Cette première nuit, nous n’en avons pas reposé beaucoup.
Nous avons été copieusement arrosés de 210, sans trop de dégâts, le terrain
était très mouillé, de ce fait, les obus entraient profondément en terre : 2 ou
3 mètres, les éclats montaient en l’air et nous ne recevions que les mottes de
terre.
Pendant ce bombardement, il s’est passé une scène assez comique,
malgré la très mauvaise position des spectateurs.
A côté de nous, il y avait un tombereau de culture (chariot à 2
roues) qui était dressé, D’abord je dois vous signaler que, dans ma section, il
y avait une nouvelle recrue dénommée ROUX Cyprien.
Phénomène très particulier qui se disait trop bête pour aller en
patrouille, trop bête pour prendre le petit poste... trop bête aussi pour aller
au ravitaillement, en fait, trop bête pour tout.
Dès les premiers obus, il se planque contre le tombereau. Le
sergent ESTULIER voulait, lui aussi, s’y mettre, mais ROUX ne voulait pas lui
céder sa place.
Le sergent :
« Soldat ROUX Cyprien, je vous donne l’ordre de me laisser la place ».
ROUX
: « Moi, je me donne l’ordre de rester là ! »
Cela
a duré pas mal de temps.
Quand un obus arrivait trop près, ils se couchaient tous deux et
fermaient leur ‘boîte’. A la pointe du jour nous rentrions dans la cave en laissant
quelques hommes pour surveiller.
Les 420 sur le fort de Vaux
Un matin de ses premiers jours de tranchée, j’étais donc de
garde avec (Georges
Louis) CHOLLET (*), de Geneuille nord de Besançon , le frère de Léontine NEVERS.
Comme tous les jours, il y avait duel d’artillerie. Beaucoup
d’obus nous passaient sur la tête, mais assez haut. A un moment donné, CHOLLET
me dit :
« Ecoute donc, on dirait le tacot ».
C’était un drôle de tacot
: un des premiers 420 qui tomba sur le fort de Vaux. Le fort se trouvait à
environ 800 mètres de nous, à vol d’oiseau. Le spectacle était beau à voir. La
terre et la fumée étaient montées au moins à 100 mètres de haut.
À cette époque, je n’étais pas sourd, heureusement pour moi !
Entendant un ‘flou-flou’ qui venait de mon côté, j’ai baissé la
tête juste à temps pour ne pas être décapité par une lame d’acier de 80
centimètres de long provenant du 420, qui s’est piquée dans la paroi de la
tranchée, à 10 mètres de moi. Cela ne sert à rien d’être curieux (j’ai profité
de la leçon).
(*)
: Georges Louis CHOLLET, 20 ans, soldat au 44ème régiment
d’infanterie. Né aussi à Geneuille (25) était ouvrier
d’usine et fait partie de la même section, même escouade que Gaston. Nous
verrons plus loin ce qu’il est devenu.
Le premier mort de ma section
Il y avait environ 10 minutes que j’avais quitté mon tour de
garde, remplacé par un nommé (Claude) COUILLEROT (*), qui était du département de l’Ain, quand
un camarade vint nous dire qu’il était blessé.
Un obus fusant de 130 avait éclaté au-dessus de lui, un éclat
l’avait traversé de part en part. Poumon perforé, son agonie a été très dure,
surtout pour nous tous.
Il eut encore la force d'écrire à ses parents qu’il allait
mourir, qu’il serait enterré au cimetière de Bévos,
et qu’ils viennent sur sa tombe après la guerre. Un de ses pays qui était allé
le chercher devait remettre la lettre à ses parents. Il avait été blessé à cet
instant d’un éclat à la fesse, il croyait avoir la bonne blessure.
Sa blessure s’étant infectée, il est mort, lui aussi. (**)
(*)
: Claude COUILLEROT, 19 ans, soldat au 44ème régiment d’infanterie, mort pour
la France le 24 avril 1916. Sa fiche indique sa mort le 23, mais le JMO du
régiment indique le 24. Voir
sa fiche. Il est inhumé à la nécropole nationale
de Douaumont (55).
(**)
: Le seul blessé du 24 avril au 44ème régiment d’infanterie qui est décédé
suite de ses blessures est Claude Eugène RUGET, 20 ans, mort le 30 avril à
l’hôpital de Revigny (55). (JMO). Il était bien de la
même région que Claude COUILLEROT. Voir
sa fiche.
Histoire de ravitaillement
Pendant les 17 jours de tranchées, 15 soirs de suite, accompagné
de TIÉNOT, je suis allé au ravitaillement. Il se faisait à environ 300 mètres
du fort de Tavannes, sur la route. Les cuisines
roulantes n’étaient pas toujours aux rendez-vous. Comme il se faisait pour
toute la brigade 44ème et 60ème d’infanterie, il y en arrivait presque toujours
une sur deux.
La nuit, les chats sont gris, cela servait parfois. Nous commencions,
TIÉNOT et moi, par nous servir personnellement, ensuite, nous demandions de
quelle compagnie était la cuisine, L’endroit n’était pas bien favorable, il ne
faisait pas bon y rester longtemps car les marmites que les boches nous
envoyaient ne contenaient pas beaucoup de rata.
Le pinard du colonel DE PIREY du 60ème d’infanterie
Un soir très mouvementé où il y avait eu beaucoup de feux
d’artifices, dont pas mal de gros, nous étions arrivés seuls, les deux, avec
TIÉNOT. Il y avait eu beaucoup de casse, Les chevaux tués au milieu de la
route, quelques cuisines roulantes éventrées ou culbutées, les boules de pain
éparpillées un peu partout.
En cherchant un peu partout, nous trouvons du rôti de veau, du pain,
il y en avait un peu partout quand, tout à coup, TIÉNOT s’empâture
dans un quartaut, c’est peut-être de l’alcool solidifié, il en arrivait
parfois.
Nous secouons le tonneau, il faisait glouglou, la belle aubaine,
ce n’est sûrement pas de l’eau ? A cet endroit, la route était encaissée d’un
talus juste du côté d’où venaient les obus. Vite, le quartaut sur le talus, la
baïonnette sortie et voilà une bonne vrille, et comme naturellement le quart
fait partie intégrale du soldat, nous goûtons, comme c’était bon !
Nous nous installons et commençons à bien nous restaurer, et,
chaque fois que nous buvions un coup :
« Encore un que les boches n’auront pas ».
Les obus continuaient à tomber, étant un peu longs, ils allaient
s’écraser dans un ravin, en contrebas :
« Oui, mais ce n’est pas le tout, mon vieux TIÉNOT, tout à l’heure, le jour va se montrer, et il ne faut pas servir de carton aux boches ».
Nos chaussures étaient devenues un peu à bascule et il y avait
aussi beaucoup de boue, et pas question de laisser le pinard.
Tant bien que mal, avec le concours du talus, après avoir mis un
douze pour boucher le trou que nous avions fait, TIÉNOT le prend sur ses
épaules. Il était très costaud et puis il avait du nerf.
Nous arrivons au bord de la ligne du chemin de fer, le ravin qui
précède le tunnel de Tavannes. TIÉNOT s’empâture et voilà notre cher pinard qui dégringole. Bing ! Contre le rail ?
Nous dévalons presque aussi vite que lui, oh ! miracle ! Il n’avait pas de mal. Et nous voilà repartis
portant et roulant le quartaut. Il faisait presque grand jour quand nous sommes
arrivés au petit poste.
Presqu’aussitôt, voici l’agent de liaison :
« CHEVILLARD, CLÉMENT, le capitaine vous demande ».
Capitaine
(Jules Bernard) LAULAN, réserviste, assez sévère, mais
juste, qui nous connaissait particulièrement, mais pas encore punis:
«D'où venez-vous à cette heure ? »
« Du ravitaillement ! »
« Qu’avez-vous fait pour ne rentrer qu’à cette heure ? »
Il
n’avait pas besoin de le demander, cela se voyait bien ! Moi, au capitaine :
« Du pinard et de la viande, il
y en a pour vous, mais pas pour FALUEL» (adjudant de bataillon dont je vous parlerai plus tard)
A noter que, sur les 17 jours passés dans ce secteur, il y a plu
pendant 15 jours. De plus un peu avant d’arriver au tunnel de Tavannes, il y avait un petit ruisseau, les obus ayant
détruit son lit, il s’était répandu un peu partout, il y avait quelques
planches par endroits, mais la nuit, il arrivait souvent que l’on mettait les
pieds à côté.
Où mon cœur a battu très fort, au petit poste
Nuit du 19 au 20 avril 1916
(JMO)
Chaque soir, à la nuit tombée, un petit groupe d’hommes allait
prendre la garde en avant des barbelés.
Ce soir-là, j'étais de garde avec, comme chef de poste, le caporal
ROQUE, mon aîné de 20 ans, un belfortain nommé GIRARDET, un breton nommé VAL,
et moi.
A l’emplacement, il y avait une haie, d’habitude, le poste se
plaçait au bout de la haie. En arrivant à l'emplacement, le caporal fit une
remarque qui était bien justifiée :
« Nous ne sommes pas bien, si les boches nous ont repérés, ils viendront nous prendre. Mais comme un soldat français ne doit pas reculer, nous allons avancer ».
Heureuse initiative qui nous a permis de faire 3 prisonniers au
lieu d’y être nous-mêmes.
Nous prenons notre place, j’étais en tête, à côté d’un petit
pommier. La nuit était noire comme de l’encre, on n’y voyait pas à 4 mètres.
Tout à coup, j’entends un peu de bruit en avant de moi, une espèce de succion,
cela faisait doucement. Pas moyen de communiquer avec les camarades, c’était
risquer de prendre quelques grenades, et le bruit s’approchait de plus en plus.
Que faire ?
Mon cœur de 20 ans battait très fort. J'étais sûr que c’étaient
des boches, des français auraient fait plus de bruit.
Je prends une décision.
Je m’appuie contre le petit pommier, ma baïonnette au canon,
sans faire le moindre bruit,
Portant mon fusil à l’avant, je me dis ceci :
« Le premier qui se présente, je tire et je dis halte là »
Ils
approchaient de plus en plus. Je me baisse pour tenter de voir à l’horizon. Ouf
! Il y en avait un à 1,50 mètre de moi, qui allait presque me dépasser.
« Halte-là. - Camarade »
Il a jeté son fusil et malgré cette nuit noire, j’ai vu briller
sa culasse de fusil. 3 se sont rendus, à leur dire, ils étaient 5
sous-officiers volontaires pour venir nous prendre, ils avaient repéré le petit
poste la veille, en patrouille, Quand ils ont vu qu’on ne les fusillait pas,
chose qui leur était chantée chez eux, ils étaient heureux d’être prisonniers.
Où le caporal Roque remet le fameux adjudant FALUEL à sa place
Lorsque la compagnie eut appris qu’il y avait 3 prisonniers, le
fameux FALUEL s’est présenté pour venir les chercher. Arrivé au petit poste, il
sort son pistolet pour tuer les prisonniers. Bel acte de courage !
Le caporal ROQUE :
« Espèce de bourrique, tu vas les laisser ces hommes, si tu veux en tuer, il y en a encore, mais ils sont en avant »
Mais il n’est
pas allé plus loin, et a dû remettre le pistolet dans son étui.
Après avoir été questionnés par le capitaine, ils furent
conduits au colonel au fort de Tavannes. Très heureux
d’être prisonniers et de ne pas être fusillés.
Comme souvenir de ces 3 prisonniers, j’ai eu le couteau de poche
de l’un d’eux.
Révélations de l’interrogatoire des prisonniers
Suivant leurs dires, nous devions être attaqués le lendemain.
Décision du capitaine : en place d’une sentinelle dans la
tranchée, une demi-section, dont la mienne.
Un bien mauvais moment à passer
Dans la matinée, 2 pièces de 210 commencent leur tir avec un
objectif bien précis, l’une directement sur la 1/2 section et l’autre à 150
mètres sur notre gauche. Le premier obus : un peu court, à environ 50 mètres de
nous, pas éclaté ; le deuxième, un peu plus près, pas éclaté.
Le brave (Georges) THOLLET, parisien : (*)
« Eclatera pas ! Éclatera pas ! »
Eh bien non, pas éclaté. 3e, 4e et autres, donc tout près de
nous, et qui auraient dû nous faire beaucoup de mal, dont un qui m’a drôlement impressionné
: il a traversé la paroi de la tranchée à environ 80 centimètres de moi.
Je vois encore le trou, et ce brave (Georges)
THOLLET
a mis quelques temps pour reprendre son souffle et dire : « Eclatera pas ».
Nous avons reçu, ce matin-là, 16 obus de 210, une dizaine
auraient dû nous occasionner beaucoup de pertes. A noter que pour l’autre pièce
qui tirait sur notre gauche, les obus éclataient bien, à côté d’une pièce de
mitrailleuse qui finit par s’en tirer sans grand dommage.
Le capitaine, prévenu de cet événement, nous a dit que notre
survie était sûrement due à un alsacien qui ne débouchait pas les fusées des
obus. Je crois qu’il y a du avoir quelque chose de ce genre,
(*)
: Georges THOLLET est né à Malakoff.
Un jour de Pâques mouvementé
Le dimanche de Pâques 1916 (23 avril 1916), le
seul jour sur les 17 jours passés à Verdun, il ne pleuvait pas.
A part les sentinelles dans la tranchée, les 3 sections étaient
camouflées dans la cave. Un obus arrive au milieu de la cour, un gars sort de
la cave et va tenter de retrouver la fusée qui, à cette époque était en
aluminium et qui servait à découper des rondelles pour faire des bagues, mais
il n’avait pas regardé en l’air et, à ce moment, il y avait un avion boche qui
n’a pas manqué de le voir et de comprendre qu’il n’était pas là tout seul. Et
voilà les gros noirs qui rappliquent.
Combien y en est-il arrivé qui ont entouré la cave ? Beaucoup,
et le temps nous a paru bougrement long. Pendant ce temps-là, le brave et
jovial (Georges) THOLLET
jouait du piano et se faisait enguirlander :
« Ta gu.…, ta gu… ».
Tout
à coup ‘bôum baôum” !
« Merde, je ne joue plus ! »
Un 210 était tombé, à environ un mètre d’un trappon
qui entrait dans la cave, envoyant pas mal de gravats et de fumée dans cette cave,
mais à part quelques égratignures à quelques-uns, aucun ne fut touché, ce fut
le dernier, ce jour-là, car il avait volatilisé le toit du hangar qui touchait
la cave et les boches ont cru nous avoir anéantis.
La pose des fils de fer, la bonne eau sucrée, et un coup de chance
Chaque nuit, nous réparions les dégâts causés aux réseaux de
barbelés par les bombardements.
Chose un peu idiote, en arrivant aux réseaux, on nous faisait
former les faisceaux et, avec un rouleau, à deux, nous devions boucher les trous.
Comme toujours, TIÉNOT était mon partenaire et, quand nous
avions trouvé le bon bout pour dérouler la bobine, cela allait à peu près. Il y
avait énormément d’eau, tous les trous d’obus étaient pleins, à part pour ceux
qui venaient de tomber.
Quoiqu'il n’y faisait pas chaud, nous avions souvent soif, il y
avait un trou que nous connaissions particulièrement, un dans lequel l’eau
était un peu sucrée, nous y allions donc toutes les nuits, jusqu’au soir où
TIÉNOT (Étienne Eugène CLÉMENT) souleva
un pan de capote (*), alors
nous avons changé de trou.
(*)
: Présence d’un cadavre.
Le coup de chance.
Une nuit, nous avions reçu l’ordre de rentrer dans la tranchée à
la première alerte, coup de fusil, ou autres.
Tout à coup, un coup de fusil sur notre droite et un ‘ah’
d’agonie. C’était un soldat du 60ème d’infanterie en liaison avec nous qui
avait tiré sans sommations sur une patrouille française et avait tué un de ses
camarades.
Nous deux TIÉNOT qui étions les plus éloignés des faisceaux,
nous arrivons les derniers mais nous ne trouvons pas nos fusils qui étaient
tombés dans la boue, Finalement nous les avons retrouvés et, quand nous nous
sommes présentés devant la tranchée où tout le monde était en position de tir,
on nous a tiré dessus, nous prenant pour l’ennemi, et toute la section s’était
mise à tirer. Bien sûr, nous avions fait un beau plat ventre.
Celui qui avait lâché son coup de fusil s’appelait JORON, il
était de Voray. (*)
Heureusement il y avait un angle mort devant la tranchée et
toutes les balles nous passaient sur la tête que nous avions bien soin de ne
pas relever. Tout à coup, j’entends la voix du caporal ROQUE :
« CHEVILLARD, CHEVILLARD »
« Voilà, voilà, je suis là. »
« Mais où es-tu donc ‘macarel” ? »
« Je suis là devant. »
« Où donc ? »
« Là ! »
« Mais que fais-tu donc là devant ? »
Je baisse la tête tant que je
peux.
« Faites arrêter le tir et je me montrerai, ainsi que l’ami TIÉNOT».
Après un temps assez long, le tir finit par s’arrêter, et nous
avons réintégré la tranchée. JORON (*) a reconnu de suite que c’était lui qui
avait tiré le premier et dans la surprise, il n’avait pas pris le temps de
viser : « Heureusement ».
(*)
: Il s’agit de Louis JORON originaire de Voray
(Haute-Saône). C’est le seul JORON qui a été affecté au 44ème régiment
d’infanterie.
Affecté
dans ce régiment à la date du 16 mars 1916. Blessé en 1917, puis gazé en 1918,
il ne sera pas tué durant le conflit. Voir
sa fiche.
Des W.C. pas tranquilles
Un beau matin, une nécessité m’oblige à quitter la cave, mais à
peine avais-je commencé qu’une fléchette passe à côté de mes oreilles et éclate
contre un tronc d’arbre, derrière moi.
Bien sûr, je n’ai pas attendu la 2ème, Celui qui me l’avait
envoyée n’était pas loin, mais je ne l’ai pas vu. De misère en misère et après
s’être transformés en hommes-boue, le soir du 17ème jour la relève nous arrive,
le 52ème d’infanterie.
Le fameux adjudant FALUEL commence, un peu tard, à ouvrir sa grande
gueule. Il aurait beaucoup mieux fait de la fermer. Voici le fait :
Le commandant de compagnie, capitaine (Jules Bernard) LAULAN,
devait passer les consignes à son successeur. Il avait donc chargé FALUEL,
adjudant de bataillon, de rassembler la compagnie. Se croyant peut-être à la
caserne, et comme nous allions au repos, le courage a surgi en lui. Il s’est
écrié très fort :
« Le 44 sortez, le 52 rentrez ».
La réponse n’a pas été longue à attendre. Des lueurs des coups
de départ nous apparaissent du côté d’Étain. Ça c’est pour nous ? En effet
quelques secondes s’écoulent et voilà une rafale d’obus de tous calibres qui
tombe à une cinquantaine de mètres en avant de nous. Aussitôt la rafale passée,
FALUEL se lève et dit : « En avant » mais personne ne bouge. Ceci pour savoir
si les boches allongeraient leur tir, il était inutile de s’enfiler dessous ;
2e rafale à la même place. La compagnie se lève pour franchir le barrage, mais
FALUEL se lève, pistolet au poing :
« Le premier qui se lève, je le brûle ».
Toutes les culasses des fusils bougent pour mettre une cartouche
dans le canon, il a compris tout de suite ce qui allait lui arriver, il s’est
mis par terre et nous sommes passés, sauf un qui eut peur de lui et prit un
éclat dans les reins, mais pas gravement, il revint nous retrouver avant de
monter en ligne, 3 mois après.
Il se nommait (Robert
Auguste) CHEVIET (**) et était d’Avanne : il fut tué dans la
Somme.
(*)
: Le 44ème régiment d’infanterie est relevé par le 52ème régiment d’infanterie
les 24 et 25 avril 1916.
(**)
: Robert Auguste CHEVIET, soldat au 44ème régiment d’infanterie, mort pour la
France le 8 août 1915, au bois de Hem (Somme). Voir
sa fiche.
Une odeur persistante
À un moment donné, je sens une odeur pas très agréable, je me
dis « Nous passons vers des feuillées ».
Un peu plus loin, toujours l’odeur, et un peu plus loin,
toujours la même odeur. J'avais devant moi un breton de la classe 15. Comme
l’odeur persistait toujours devant moi, je lui pose la question :
« (Michel) BONJEAN, t’as fait dans ton
froc ? » (*)
« Oui » me répond-il.
J’avoue que j'étais aussi capot que lui.
(*)
: On retrouvera plus loin dans le texte ce fameux Michel BONJEAN (qui n’est pas
breton, mais auvergnat)
La mauvaise surprise
Nous arrivions presque à l’entrée du tunnel de Tavannes et espérions bientôt respirer sans avoir la
crainte de recevoir un obus sur la tête... Mais ce n’était pas encore pour ce jour là :
« Prenez le boyau à droite » (Hein ?)
« Oui, nous sommes en réserve cette nuit pour soutenir le 35e et le 42e qui sont au Fort de Vaux et qui ont bien du mal à contenir la ruée boche, et, s’il le faut, nous remonterons pour attaquer »
Quelle tuile !
Toute la nuit les blessés descendaient, il fallait laisser la
place aux brancardiers.
Enfin le 35e et le 42e ont pu tenir.
Un 1er mai sans muguet mais avec une surprise
Mai 1916
Le jour se lève et il fait beau, accroupis dans le boyau où nous
avions parfois sommeillé, j'ouvre les yeux et qu'est-ce que je vois ?
Un petit gars hirsute, barbu comme un sapeur, les yeux
renfoncés, sale par la figure comme le reste de l’homme, et qui me sourit,
c’était TIÉNOT.
Il cherche dans la poche intérieure de sa capote et me sort un
morceau de miroir cassé, et me dit ceci :
« Regardes-toi, Tonton, t’es pareil ».
Et, ma foi oui, c’était vrai.
Un 88 qui me fait serrer les fesses
Après avoir bu cette eau sucrée et, de l’autre, mangé du singe,
pas mal d’entre nous avaient ramassé la dysenterie et même le typhus, ce qui
nous mettait dans l’obligation de se déculotter souvent. (*)
À un moment, j’étais dans ce cas. Je sors du boyau et je
m'installe un peu plus bas, dans le renvers du tunnel
de Tavannes, derrière des petits sauvignots,
petits arbrisseaux..
« Vion, boum » sur le balastre
plus bas, il était passé si près que si j’avais été debout, il me coupait en
deux. Sans me reculotter, je saute dans la tranchée, et mon brave petit TIÉNOT
:
«Il est passé bien près, il voulait te torcher le c… »
Et
cette récrimination :
« Pas moyen de poser culotte tranquille ».
(*)
: C’est exact quelques jours plus tard, après la relève, l’épidemie
s’étend. Le JMO dit :
30
avril : « …La maladie qui ateint un plus grand nombre d’hommes, prend nettement un
caractère epidémique. (…) »
2
mai : « …Les malades augmentent. On voit
des hommes se trainer pour aller aux feuillées (toilettes). (…) »
Jusqu’au
20 mai, environ 400 hommes sont évacués. Ont-ils bu l’eau des trous d’obus
comme l’a fait Gaston ?
La vraie relève
Le soir, le capitaine était à nouveau parmi nous et nous dit
ceci :
« Les gars, débrouillez-vous, vous êtes libres, rassemblement à Haudainville. Vous aurez plus de chance d’y arriver par petits paquets qu’autrement ».
Et nous avons réussi d’y arriver sans pertes.
Arrivés vers les 3 heures du matin, les cuisiniers nous y
attendaient. Le ravitaillement était abondant, il y en avait pas mal qui n’y
goûterait plus. Un rôti de veau et pinard presque à volonté.
Première journée de repos
28 avril 1916
Le matin, grande lessive, à Haudainville il passait un ruisseau
dans lequel nous avons lavé les capotes et les bandes molletières ; à la sortie
du village ce n’était pas de l’eau qui coulait mais un flot de boue. Nous
avions pataugé dans la boue pendant 17 jours, sans même quitter les
équipements.
Le 2e jour de repos, je rends visite à Émile PINAIRE qui était
conducteur au 60e régiment d’infanterie ainsi qu’à Charles ZÉDET, adjudant. (*)
Je rencontre Léon ANDRÉ (**), conducteur lui aussi de la cuisine
roulante au 60e, et qui me dit :
« Tu ne sais pas qui c’est que je viens de voir qui arrive en renfort ? »
« Non »
« Eh bien,
Gabriel BESSIA, il est à tel endroit ». (***)
Il avait été blessé au débarquement des Dardanelles et remontait
pour la 1e fois au front au 52e d’infanterie, le
régiment qui nous avait relevé. Je me dirige donc vers le cantonnement de
Gabriel, que je devine presqu’aussitôt par sa forte taille :
« Tiens, voilà Gaston », prénom que me donnait son frère Joseph.
Première
question de Gabriel :
« Est-ce que çà chie, on n’entend pas le canon ? »
Ce
que je pensais :
« T’en fais pas, Gabriel, tu vas bien l’entendre ».
Et
ce ne fut pas long.
A peine arrivé à mon cantonnement, voici un 210 qui tombe en
plein milieu de la route, à 30 mètres de mon cantonnement, 4 tués : 2 contre le
mur et 2 au milieu de la route.
Le 3e avait touché le dessus du couvert où était Gabriel et le
4e était tombé sur la cuisine roulante de Léon ANDRÉ, heureusement il n’était
pas à côté.
(*)
: Charles Jean-Baptiste ZÉDET, 36 ans, habite le même village (Geneuille, 25) que Gaston CHEVILLARD. Il effectue ses
classes au 60ème régiment d’infanterie en 1901-02. Reste au même
régiment en 1914 – caporal en 1915 – Sergent en mai 1915 – Adjudant en mai 1916
– Blessé en août 1916, jambe droite – Hôpitaux de Paris, puis Besançon jusqu’en
mars 1917 – Repart au 60ème régiment d’infanterie, mais plus au
front – Croix de guerre étoile de bronze.
(**)
: Léon François Joseph ANDRÉ, 30 ans, est natif du même village que Gaston
CHEVILLARD. Dragon d’origine, il passe au 60ème régiment
d’infanterie le 18 octobre 1914 et y fait toute la guerre.
(***)
: Gabriel BESSIA, 22 ans, est natif du même village que Gaston CHEVILLARD.
Artilleur d’origine, il passe au 98ème régiment d’infanterie le 16
octobre 1914 – Passe au 175ème régiment d’infanterie en février
1915, part aux Dardanelles et est blessé par balle, machoire
cassée – Passe au 52ème régiment d’infanterie en février 1916 –
Blessé à Verdun en juin 1916, amputation de la cuisse droite – Réformé
définitivement - Croix de guerre avec palmes – Légion d’honneur en 1947. Décédé
après 1960.
Un peu plus de connaissance avec l’adjudant FALUEL
Un de ces premiers matins passés à Haudainville, j'étais sur la
porte de mon cantonnement quand arrive l’adjudant et le caporal (Alexis Prosper) Humbert (*).
J'entends :
« Et celui-là ? »
« Oui, oui, oui ».
Je
commençais à me tirer des pattes :
« Chevillard ! - Voilà. - Est-ce que tu veux faire un cabot ? »
(**)
Réponse
:
« Je trouve que je ne suis déjà pas assez intelligent pour me conduire, ce n’est pas pour conduire les autres, il y en a déjà assez de comme cela sans en remettre un de plus ! »
« Rompez ».
La guerre était
déclarée entre nous deux.
(*) : Il s’agit très
certainement du caporal Alexis Prosper HUMBERT, 22 ans. Il sera tué à
Bouchavesnes dans la Somme en septembre 1916. Voir sa fiche.
(**) : Devenir caporal.
Réveil matin assez bruyant
Nous étions encore dans la paille, vers 6 heures du matin,
quand, tout à coup, nous entendons la D.C.A. qui tire. Un avion allemand venait
nous souhaiter le bonjour, et venait de lâcher une bombe, tâchant de couler une
péniche qui était dans le canal, servant de cantonnement, ainsi que beaucoup
d’autres.
À ce moment là s’y trouvait Henri
TURILLON qui était au 4e Génie. Par un grand hasard, l’avion fut descendu au 3e
coup de canon.
Une nouvelle rencontre fâcheuse avec l’adjudant FALUEL
Dans l’après-midi, il y eut rassemblement de la compagnie,
j’arrive le dernier de ma section et, pour ne déranger personne, je me place en
bout de la section. Le caporal, gentiment, me dit :
«T'es pas à ta place ».
Réponse,
aussi gentiment :
« Bein merde, qu'est-ce que cela peut
foutre ? »
L’adjudant
FALUEL, en courroux :
« Qu'est-ce que tu dis, t’insultes ton caporal ».
Réponse
:
«Je ne te dis rien, à toi. »
« Qu'est-ce que c’est ? Caporal, vous allez porter une punition pour manque de respect à un supérieur ».
Le caporal ne voulut rien savoir, et c’est moi qui ai porté la
demande de punition au bureau.
Quelques instants après, l’agent de liaison vient me chercher :
« Le capitaine te demande ».
Le
capitaine :
« Qu’est-ce que c’est, Chevillard, tu manques de respect à ton
caporal ? Cela m’étonne de toi ».
Réponse
:
« Mon capitaine, il n’y a pas manque de respect, il y a simplement faute de langage, vous savez que le vocabulaire que nous employons n’est pas toujours bien correct, c’est là toute la faute.
Permettez-moi aussi de vous dire que c’est l’adjudant FALUEL qui a forcé le caporal à porter plainte, et c’est moi qui ai porté la punition pour que le caporal n’aie pas d’ennuis avec lui. Maintenant que nous sommes au repos, l’adjudant fait du service, il n’en était pas de même ‘la-haut’ ».
Le capitaine fait appeler l’adjudant FALUEL :
« Il ne s’agit pas, pour l’instant, d’emmerder les hommes avec des chinoiseries pareilles, je ne veux pas de cela. Rompez ».
FALUEL ne l’a pas
avalé et ce n’est qu’en 1938, à la nouvelle mobilisation, que j’ai pu m’en
apercevoir. De complicité avec un sergent-major nommé MERCIER, dont je parlerai
plus tard, j’avais quand même 4 jours de prison de marqués sur mon livret
matricule.
« Ah ! La vache
».
Points de vue sanitaire
Il y avait environ 80 à 90 % des hommes atteints de dysenterie
très prononcée et pas mal atteints du typhus. Ce qui n'empêcha pas au fameux
colonel GERST, faisant fonction de général de brigade, de vouloir nous faire
remonter en ligne, peut-être pour essayer de gagner une étoile à son képi. Un
bataillon avait déjà pris le départ, il dut retourner, sans regrets.
Grâce à un commandant-major qui s’y était opposé, le colonel
GERST a du baisser pavillon, mais a néanmoins fait
révoquer le commandant. (*)
Il fut quand même réhabilité avant la fin de la guerre. Je l’ai
appris par la voix du général MUDENT, en 1920, à Besançon.
2 jours après cette intervention, nous avons quitté
Haudainville. Il y avait 5 kilomètres pour aller prendre les camions qui
devaient nous emmener en grand repos, dans un petit village de l’autre côté de
Bar-le-Duc, il s’appelait Trois-Fontaines.
En cours de route, entre Haudainville et Dugny-sur-Meuse, (Marcel Élie) DUBOIS dit CHAMBROT (**),
l’homme aux 7 boches dans la Somme, est tombé dans le fossé de la route. Il a
été hospitalisé à Dugny-sur-Meuse et, finalement, après 8 jours, il est revenu,
C’était un petit homme, mais il n’y en restait plus. C’est tout juste s’il
pesait 50 kilogrammes avec son sac (pauvre CHAMBROT).
(*)
: En effet, le régiment recoit l’ordre de remonter en
tranchée dans le secteur du fort de Vaux. Le colonel du régiment adresse un
compte-rendu au général sur l’état sanitaire du régiment. Finalement la brigade
entière (44e et 60ème régiment d’infanterie) embarque le 5 mai pour un repos
secteur Trois-Fontaine, Sermaize, Le Fays.
Pour
exemple, le 3e bataillon ne comptait plus que 80 fusils pour 1000 à l’effectif
normal. Le JMO
de la 17ème brigade précise que 800 hommes incappables
de marcher sont emmener en camions.
(**)
: Marcel Élie DUBOIS, terrassier, 20 ans est bien de Morteau. Il sera
prisonnier en avril 1917 durant l’attaque du Chemin des Dames. Voir
sa fiche.
Mais
pourquoi le surnom de Chambrot ??. Il sera cité de nombreuses fois dans le récit.
Notre vie à Trois-Fontaines
Au grand repos, sans exercice, nous sommes restés un mois à un
régime spécial : riz au chocolat. Les premiers jours, nous trouvions cela bien
bon.
Une rencontre : le père FOEHRLE, En nous promenant, je rencontre
des hommes du 54e territorial, les grands-pères. A tout hasard, je leur demande
s’ils ne connaissaient pas de bisontins, et c’est par eux, et leurs
renseignements, que je suis allé surprendre le père Foehrlé
qui était en train de fabriquer du bois dans une forêt, il était assez surpris
de nous voir, moi et (Georges Louis) CHOLLET. Il fut démobilisé guère de temps
après, comme père de famille nombreuse.
Départ de Trois-Fontaines
21 mai 1916
Le repos avait assez duré. Il fallait nous remettre dans
l’ambiance et reprendre l’entraînement.
Et, un beau matin, sac au dos et en route à pied pour l’Alsace.
Après pas mal d’étapes, nous arrivons à Saulxures-sur-Moselotte puis Le
Thillot. Passage au col de Bussang, étape assez mémorable,
Salut ferre d’Alsace
Partis dès les 4 heures du matin avec 1/4 de jus, nous passons
le col de Bussang. Dans les lacets qui suivent, le fameux colonel GERST nous
entasse tout le régiment, il y faisait très chaud à 10 heures, serrés comme des
harengs, sac au dos et au ‘présentez armes’. Il nous fit un petit discours et,
de temps en temps, le bruit d’une gamelle qui tombait (mais avec le
bonhomme)...
En passant à Wesserling, je le vois
encore foncer en avant de ma section avec son gros cheval rouge et d’un coup de
son plat de sabre taper sur le fusil d’un gars qui, pour lui, ne le tenait pas
assez droit.
Le salaud, il nous en fit bien d’autres.
Arrivée à Oderen (*)
Loger chez l’habitant, dans les greniers ou granges, bien
entendu.
Ma section était tombée chez des alsaciens au coeur français. Il y avait 5 jeunes filles de 10 à 18 ans
et 2 garçons, l’un dans l’armée allemande et un aux zouaves, chez nous.
Le premier n’avait pu se sauver à temps, c’est pour cette raison
qu’il était de l’autre côté, c’étaient de très braves gens.
(*)
: Le 3e bataillon du 44ème régiment d’infanterie cantonne à Oderen
à partir du 1e juin après arrêt dans quelques cantonnement-étapes.
Le coup du lapin
TIÉNOT et LACHEVILLE étaient des turbulents mais débrouillards
pour la fauche au ravitaillement, assez bien estimés des sous-officiers
GIRARDET de Belfort et PLONGEON ainsi que du brave et gentil aspirant (Jean Auguste) ROSET (*) de
Lons-le-Saunier.
Un beau jour, ils me demandent ce que j’avais en réserve :
singe, sucre et café. Et puis de leur trouver un lapin, car ils voulaient faire
un petit repas chez les alsaciens chez qui nous logions.
Me voilà parti en reconnaissance dans le patelin, mais hélas,
pas de lapin. J’en connaissais bien un, mais c’était chez la patronne.
Sur le soir, je vais chercher le lapin, je le saigne et le
dépouille et je le porte à la cuisinière qui devait préparer le repas, pour le
faire cuire. Après le repas, j'étais invité, ainsi que TIÉNOT, pour le dessert,
Au moment des comptes, l’aspirant demande la note.
La pauvre, elle oubliait le lapin :
« Mais ce n’est pas moi qui l’ai acheté. »
« Si. »
« Non. »
« Si. »
« Non, c’est le soldat, là, qui l’a apporté. »
« Oui, c’est bien moi, mais je l’ai pris dans la cabane ».
La
pauvre femme, les larmes lui viennent aux yeux :
« Moi qui le gardais pour la permission de mon fils qui est aux zouaves. »
« Tranquillisez-vous, madame », lui fut-il répondu, « vous en aurez un autre »
Ce qui fut fait.
La bonne femme, me regardant et finissant par sourire : «
Coquin, farceur ».
Quelques jours après, je venais en permission de 6 jours.
(*)
: Jean Auguste Alexis ROSET est bien de Lons-le-Saunier. Il est passé aspirant
depuis décembre 1914. Le 29 août 1914, il obtient une première citation à
l’ordre de l’armée :
« Aspirant trés couraguex, le 12 août 1914 a entrainée
ses hommes à l’assaut d’une position fortifié allemande malgré……… ».
Légion d’honneur et croix de guerre avec palmes.
Nous
le retrouverons plus loin dans le récit.
La plaie des ‘totos’
La veille de mon départ, après bien des difficultés de la part
du sergent-major MERCIER, assez copain avec l’adjudant FALUEL, et après
l’intervention du capitaine, je trouvais quelques habits propres dont une
chemise.
Le lendemain matin, après une seule nuit dans la paille, je
passais l'inspection de la chemise, j’y ai trouvé et tué 47 totos, je me
rappellerai toujours du nombre.
Je prends le train à Bussang pour arriver à Geneuille.
Le lendemain, (Georges Louis) CHOLLET, de mon escouade vient m’y
retrouver.
Après les 6 jours de perme allongée, nous arrivons à Oderen. Le cantonnement était vide, la compagnie était
montée en ligne la veille. Comme il était tard, et que nous n’étions pas
pressés, nous décidâmes de coucher dans la paille, mais la bonne alsacienne s’y
opposa, il y avait un beau lit à l’emplacement du bureau, avec de beaux draps
blancs.
Il a fallu que nous couchions là, et le lendemain matin, c’est
la musique d’un régiment de chasseurs, que le régiment 44 avait relevé, qui
nous a réveillés. Mais cela faisait déjà 3 fois que la dame venait voir si nous
étions réveillés. Elle nous apportait à chacun un grand bol de chocolat avec du
pain beurré.
Je l’ai embrassée de bon coeur avant
de remonter en ligne.
Mon arrivée à Mittlach, bureau de la compagnie
On peut situer ce passage
vers mi-juin 1916
Mauvais contact avec le sergent MERCIER qui ne m’aimait pas
beaucoup, rapport à l’adjudant FALUEL, et qui finit par devenir copain :
« Comment se fait-il, soldat Chevillard, que vous ayez du retard ? »
Il y avait
beaucoup de coups de tampons sur ma perme et je crois qu’il aurait fini par s’y
perdre. Après pas mal de discussions et de menaces, je finis par lui dire :
« Peu importe la punition, cela ne va pas nous empêcher de boire une bonne goutte. »
« Je n’en veux pas, de votre goutte ».
Réponse
: « Bien sûr, vous ne savez pas d’où elle vient ? Mais quand je vous aurai dit
qu’elle vient de Vallerois-le-Bois. »
« De Vallerois-le-Bois ? Tu connais
quelqu'un à Vallerois ? »
Réponse
: « Oui ».
Lui
: « J’avais un bon copain à Vallerois, il était
sergent et s’appelait CHAUDÉ. »
« Eh bien, cette goutte, c’est son père qui l’a fabriquée et c’est
mon cousin, et sa fille Marguerite c’est aussi ma cousine. Et son frère, le
sergent CHAUDÉ qui est mort il y a quelques années, s’appelait Lucien. »
« Mais tu ne pouvais pas le dire avant ? »
« Vous ne me l’avez pas demandé chef ! »
« Sacré Chevillard, si j’avais pu savoir, enfin, il n’est pas trop tard. As-tu assez de ravitaillement ? Tiens, voilà des cervelas et du jambon. Quand tu auras besoin de quelque chose, viens me trouver ».
J’ajoute
: « Même un pantalon ? », chose qu’il n’avait pas voulu me donner avant mon
départ en perme.
« C’est entendu. »
Et là dessus, j’ai pris le chemin de Metzeral, retrouver les copains.
Metzeral, Alsace
Secteur dit tranquille, où il n’y avait plus d’attaques. Ma
section était située à un endroit assez dangereux, isolée d’un côté, pas de
tranchée ni boyau pour y parvenir, À peu près à mi-côte de la montagne dénudée
d’arbres, la tranchée allemande, à environ 100 mètres. Il ne fallait pas se
montrer car les voisins d’en face avaient l’oeil et
ne nous saluaient qu’avec des balles.
La tranchée boche se trouvait en bordure des sapins où il y
avait sûrement des miradors d’installés. A part cela, le secteur n’était pas
mauvais. La sortie de notre petit blockhaus était bien surveillée et bien
repérée. 3 mitrailleuses tiraient la nuit à tir bloqué qui battait le sentier
sur une longueur d’environ 60 mètres. Elle tirait toujours par surprise, il y
avait de gros risques à traverser ce passage.
L’aspirant (Jean) ROSET fait des propositions Il y avait une
petite source à environ 200 mètres en contrebas de notre position et chaque
nuit il y avait corvée d’eau, mais pour y aller, il fallait traverser le
barrage des mitrailleuses, ce qui était très dangereux. Les volontaires pour
cette corvée n’étaient pas épais.
L’aspirant s’adresse à la section :
« Y a-t-il des volontaires pour la corvée d’eau ? »
Néant.
«Ils seront exempts de garde au petit poste ».
Néant.
« Exempts de patrouille ».
Néant.
« Exempts de toutes autres corvées... La nuit après leur corvée,
ils resteront de garde dans la tranchée ».
Malgré tout cela, pas de volontaires.
« Puisqu’il n’y a pas de
volontaires, je vais en désigner deux, mais après, il ne faudra pas rouspéter
qu’ils sont trop favoris.
Premièrement ClÉment,
dit TIÉNOT. »
« Merci mon aspirant ».
Réponse
: « Il n’y a pas de quoi ! »
« Le deuxième, il est facile à trouver puisque vous ne marchez pas
l’un sans l’autre : CHEVILLARD, dit Lacheville. »
« Merci mon aspirant ».
Nous allions chercher l’eau dans un perco, genre de gros bidon à
lait qui pouvait contenir de 15 à 20 litres.
C’était toujours TIÉNOT qui le portait au départ. Pour passer,
il fallait choisir juste entre 2 rafales de mitrailleuses et ne pas s’arrêter
en route. Un beau soir, qui n’était pas fait comme les autres, nous bondissons
du trou comme des lapins. Hélas, les fils téléphoniques avaient été coupés par
les balles et réparés en vitesse.
Malheureusement, ils étaient posés en travers du sentier et
voilà mon TIÉNOT qui s’empâture, dégringole, moi par dessus, et le perco lâché par TIÉNOT se met à dévaler
la pente en faisant naturellement du bruit qui fut vite intercepté par les
boches.
Les mitrailleuses entrent en action et nous arrosent
copieusement : les balles nous entouraient et ricochaient partout sur les
rochers, il n’était pas nécessaire de nous dire de baisser la tête, et ce
pauvre TIÉNOT, dans un acte de courage, pour nous remonter le moral :
« T’en, t’en fais pas, Tonton, y, y savent pas pointer ».
Combien cela a-t-il duré, je ne saurais le dire, il est bien
difficile de mesurer le temps dans de telles conditions. Enfin, cela s’arrête,
nous nous relevons en vitesse, et nous voilà partis à la recherche du perco que
nous retrouvons un peu plus bas. TIÉNOT s’en empare et nous repartons.
Dans le parcours, il y avait un petit pan de rocher et voilà mon
TIÉNOT qui glisse dessus et lâche à nouveau la gamelle. ‘Ra ta ta ta’ voilà les mitrailleuses
qui nous tirent à nouveau. Etant abrités un peu d’un côté par le rocher, deux
mitrailleuses ne nous pouvaient rien et la 3ème qui aurait pu sûrement nous
tuer, n’a pas tiré.
Il y avait aussi un endroit dangereux, c’était à l’instant où
l’eau tombait dans le perco, cela faisait du bruit, et nous étions à nouveau
dans un champ de tir d’une mitrailleuse. Alors, pendant que l’un plaçait la
gamelle, l’autre arrêtait l’eau de sa main, sitôt que c’était fait, nous
sautions dans un trou d’obus qui se trouvait à proximité.
Souvent, les balles coupaient l’herbe au-dessus de nos têtes.
Et, ma foi, au petit bonheur la chance, nous remontions doucement jusqu’au
passage dangereux que nous passions le plus vite possible.
Ce soir là, quand nous sommes arrivés
à l’entrée de la tranchée, nous avons été littéralement enlevés par les copains
qui nous croyaient bien morts. Je vois encore ce pauvre (Jean) ROSET
avec les larmes aux yeux nous disant ceci :
« Et c’est moi qui vous aurais envoyés à la mort ».
Pauvre et brave (Jean) ROSET, nous l’aimions bien aussi.
Rentrés dans la tranchée, nous avons bu une bonne goutte.
Ma première blessure
Un bel après-midi, TIÉNOT me dit :
« Viens, on va chercher les bidons de la 7ème escouade »
elle se trouvait à 150 mètres
de nous. C’était la première fois que j’y allais. La tranchée était une tranchée
couverte, il y avait des créneaux pour le tir. Nous arrivons à un endroit où il
fallait bien se baisser pour sortir, et, à l’autre extrémité, où ce n’était pas
couvert, il y avait une grosse butte de terre par dessus
laquelle on voyait les sapins qui étaient derrière la tranchée boche.
A cet instant, je me suis posé cette ques-tion
:
« Tiens, comment se fait-il qu’elle ne soit pas couverte à cet endroit ? Bon. »
Nous allons à la 7ème escouade et nous revenons.
À cet endroit, TIÉNOT était devant moi, étant plus petit que
moi, les boches ne l’ont pas vu tout de suite. Lorsqu’à mon tour j'arrive, une
rafale de mitrailleuse arrive elle aussi. TIÉNOT plonge littéralement dans le
trou, mais ne s’étant pas assez baissé, il donne un coup de tête dans le madrier
qui supportait l’entrée de la tranchée, enfonçant son casque jusqu’aux
oreilles, moi, je lui roule par dessus et je me sens
piqué à la fesse gauche, les balles avaient touché chaque côté de la tranchée.
TIÉNOT, qui ne pouvait pas retirer son casque et rouspétait :
«Ah ! les salauds ».
Malgré la brûlure que je ressentais à la fesse, je ne pouvais
pas m'empêcher de rire, tout en regardant mon pantalon pour voir s’il était
traversé à l’avant. Nous arrivons vers (Jean) ROSET :
« C’est sur vous qu’ils ont tiré ? »
« Oui, Tonton est blessé à la fesse ».
Le
sergent CASÉRIOT, qui était là aussi, me dit :
« Viens voir ».
Je
baisse mon pantalon et aussitôt il me dit :
« Ne bouges pas, passes-moi ton couteau, je la vois ta balle ».
Il me fait une petite incision et retire un éclat de pierre qui
avait bien traversé ma culotte, Un peu de teinture d’iode, et me voilà guéri.
J’avais quand même eu un peu la frousse.
Un parachute de fusée qui faillit me coûter cher
À une quinzaine de mètres de notre tranchée se trouvait un noyer
sur lequel se trouvait un parachute accroché après les branches. Avec ces
parachutes en soie, on fabriquait des pochettes mouchoirs. Je m'étais bien
gardé d’en parler et, le soir tombé, sans prévenir personne, pas même TIÉNOT,
je me glisse en rampant jusqu’au noyer et je commence à grimper. J’allais
atteindre le parachute quand une rafale de mitrailleuse arrive et les balles
crépitent dans les branches. Je dégringole en vitesse et je ne bouge
plus. :
« Tout le monde aux créneaux »
mais il en manquait un.
L’aspirant appelle et je finis par me faire entendre et je rentre dans la tranchée.
Et ce bon (Jean) ROSET, à
brûle-pourpoint, me pose cette question :
« D’où viens-tu ? Que faisais-tu seul devant la tranchée ?»
Question posée comme si j'avais fraternisé avec les boches.
Comme il m’avait fait mal au coeur. ROSET :
« Alors expliques-toi ».
Je
le conduis devant un créneau et lui montre le noyer ainsi que le parachute, et
je lui dis :
« C’est le parachute que je voulais aller chercher, pour faire une
pochette, et c’est sur moi qu’ils ont tiré, mais m’ont manqué ».
(Jean) ROSET,
redevenu lui-même :
« Sacré Lacheville, t’en feras pas
d’autres, et c’est pour cela que tu as risqué ta vie ? Viens, je vais t’en
donner un ».
Il prit une fusée qu’il cassa et me remit le parachute.
Et après, c’est TIÉNOT qui me fit dreproches
de ne pas lui en avoir parlé.
Soir où j’enguirlande le lieutenant Froidurot, et je crois que je lui ai
sûrement sauvé la vie.
Un soir que j’étais de garde dans la tranchée, je vois arriver
un homme qui s’arrête juste dans le champ de tir des 3 mitrailleuses. Je
l’appelle, il ne me répond pas, je l’enguirlande et le traite de c..., lui
demandant s’il cherchait à se faire tuer.
Finalement, il bouge et en même temps qu’il arrive, les balles
crépitent où il s’était arrêté. À ce moment, je reconnais le lieutenant et je
m'excuse de l’insulte. Le lieutenant :
« C’est donc toi, mon vieux Lacheville, peu importe l’insulte ! J’aime mieux que tu m’aies traité de c... que d’être macchabée ».
Le lieutenant :
«Mais comment se fait-il que je ne sois pas au courant de cette chose ? »
Et, sans rien dire à personne, il fit
sa petite reconnaissance qui lui permit de repérer une de ces mitrailleuses,
car, à cette époque, les pare-flammes n’existaient pas encore.
Et le lendemain, parti seul, avec pistolet et grenades, il est
allé chercher les mitrailleuses en tuant les deux servants.
Un allemand qui cherchait peut-être à se faire tuer
Un jour que j'étais de garde aux créneaux, j’aperçois un boche
qui faisait la chasse aux rats, car il y en avait beaucoup dans ces tranchées
qui n’avaient pas bougé depuis un an, depuis la grande bataille d’Alsace en
juin 1915. Nous avions ordre de ne pas chercher la bagarre et, chez les
allemands, je crois qu’ils avaient la même consigne. Le front de l’Alsace était
soit disant un secteur de repos pour les troupes qui venaient d’en prendre un
bon coup. Cet allemand ne se croyait peut-être plus en guerre, il était dégagé
jusqu’à mi-corps et j’aurais pu le tuer au moins 9 fois sur 10.
J’appelle le caporal (Alexis Prosper) Humbert et lui dis :
« Regarde voir celu-là »
Il me demande mon fusil. Je lui
réponds :
« Non, que, si j’avais voulu le tuer, il y serait déjà ».
Je lui fais remarquer que « Ce
n’est pas d’assassiner cet imprudent que ça fera finir la guerre plus tôt ».
Il va chercher son fusil, tire l’allemand et le manque.
L’allemand tout surpris regarde sans penser à se cacher, pendant ce temps, le
caporal le tire une 2°" fois et l’allemand tombe. Quelques secondes plus
tard, nous avons aperçu des dos de ses camarades qui le tiraient.
Le mort ou blessé a failli nous coûter cher car nous avons été
arrosés copieusement de torpilles, mais personne de la section n’a été touché.
N’empêche que le caporal a bien regretté son geste.
Un passe-temps avec le brave THOLLET (parisien)
Un jour, (Georges) THOLLET
dit :
« Voyons voir si les fritz nous guettent ? »
Il prend un casque et le montre un peu au-dessus de la tranchée,
presqu’aussitôt ‘flac”, dedans.
Il recommence un peu à côté ‘flac’, manqué ; une troisième fois,
il recommence et ‘flac’ dedans. 2 fois sur 3 à environ 100 mètres, c’était
bien. Alors mon (Georges) THOLLET monte le casque au bout du bâton et
annonce rigodon et interpelle le boche d’en face.
L’autre lui répond :
« T’es de Paname, montre voir ta gueule. Paname, je le connais aussi bien que toi, j’étais garçon de café chez Maxime pendant 2 ans ».
C’était le lendemain que l’Italie avait déclaré la guerre à l’Allemagne. (*)
(Georges) THOLLET lui dit qu’ils perdraient la guerre
et l’autre lui répondit que plus nous serions, plus il y aurait d’honneur pour
eux.
Les jours passèrent assez tranquilles, en ne faisant pas
d’imprudences. La 10ème compagnie au Bois-Brûlé (à 400 mètres, à
notre droite).
A la 10ème compagnie, il y avait très souvent des combats à la
grenade, par endroits, les tranchées étaient à environ une quinzaine de mètres
l’une de l’autre. J’y avais un très bon camarade de la Saône-et-Loire nommé (Joseph) CanNard,
très fort, et qui portait bien son nom car il marchait comme un canard. C’était
un farinier qui travaillait dans un moulin, il fut tué dans la Somme. (**)
Au périscope, je regardais les combats et je pensais souvent à
lui.
Un soir je le retrouve au ravitaillement. Je lui dis :
« Mon pauvre CanNard, vous prenez quelque chose à la
10 »
« Penses-tu, qu’il me
répond, avant d’envoyer leurs grenades, ils nous préviennent. »
« Hein ? »
« Oui, figures-toi que le lendemain de notre arrivée, un
allemand nous prévient :
« Ne tirez pas les gars, les chasseurs ne vous ont rien dit? »
« Non »
« Ici on ne fait pas la guerre, c’est assez de s’entre-tuer quand on ne peut pas faire autrement. Voilà la consigne : une pierre ‘garez-vous, on va vous balancer des grenades’ ; deux pierres ‘attention, nos officiers sont là’ ; trois pierres ‘quartier libre’. Et, tous les matins, il vient nous dire bonjour, nous échangeons cigares, cigarettes et chocolat, et, mieux que cela, avec les chasseurs, cela leur est arrivé de poser les barbelés ensemble ! »
Cela ne m’a étonné qu’à moitié car, quand je suis monté en
ligne, après ma permission, j'avais rencontré 3 chasseurs alpins, je crois du
10ème (***), je
leur avais demandé si çà se bagarrait beaucoup, ils
m’avaient répondu que « Oui ».
Je leur avais demandé leurs pertes, ils m’avaient répondu :
« 5 tués en 6 mois d’occupation de tranchée ».
Nous qui revenions de Verdun en avions vu bien d’autres. Et
c’est par ce caporal allemand qu’ils ont appris qu’ils seraient relevés le soir
par le 43ème territorial (****), et il avait ajouté :
« A ce moment là, si nous voulions, qu'est-ce qu’on vous mettrait ! »
Et c’est bien le 43ème qui les releva, sans recevoir un coup de
fusil. Un fait remarquable, c’était le 23ème d’infanterie bavaroise, nous nous
sommes trouvés 3 fois face à face : à Verdun, en Alsace et dans la Somme.
(*)
: L’Italie a déclaré la guerre à l’Allemangne en mai
1915….Date qui ne correspond pas au récit
(**)
: Joseph CANNARD, 20 ans, soldat au 44ème régiment d’infanterie est
bien de Saône-et-Loire. Mais mort pour la France en avril 1917. Voir
sa fiche.
(***)
: Le 10e bataillon de Chasseurs était en Alsace en avril-mai 1916.
(****)
: le 43ème régiment d’infanterie
territoriale était bien dans le même secteur en juin 1916 que le 44ème
régiment d’infanterie (JMO)
Un soir de ravitaillement où j’ai eu bon nez
La cuisine de ma compagnie se faisait à Metzeral,
dans une maison, il y en restait encore quelques unes
sans trop de dommage ; pour ne pas faire trop de fumée, de manière à ne pas se
faire trop repérer, le feu se faisait à la braise. Je connaissais
particulièrement le cuisinier, il se nommait Caillot,
il avait cantonné à Auxon-Dessus au début de la
guerre et était venu plusieurs fois à Geneuille.
Nous parlions patois et il m’avait pris en affection. Les lignes
allemandes étaient à environ 400 mètres de la cuisine, il y avait une route qui
était prise d’enfilade par les mitrailleuses et, à chaque instant, ils
balayaient la route. La maison du ravitaillement se trouvait au bord de cette
route qu’il fallait traverser à découvert.
Après avoir bu un coup de pinard et de café avec le père Caillot, je lui dis :
« Salut ».
Mais au moment de traverser la route, j’ai eu le pressentiment qu’il
allait se passer quelque chose. Je m’arrête donc au coin de la maison et à
l’instant même ces messieurs se mettent à balayer la route, Aussitôt le père CaIllot sort et m’aperçoit :
« Té l’ait, oh !_iae évu poue » (Tu es là, oh! j'ai eu peur).
Pour une fois, j’avais eu le nez de m’arrêter. Ce fut mon
dernier risque encouru en Alsace car le lendemain j’étais désigné avec un autre
de ma section, pour descendre à Gérardmer, pour suivre des cours de grenadier. (*)
(*)
: Les cours de grenadiers à Gérarmer sont indiqués
dans le JMO,
ce qui nous permet de dater exactement cet épisode, le 6 juin 1916.
À Gérardmer
On peut dater cette formation
les 3 premières semaines de juin 1916
De toute la division, il y avait eu deux hommes de désignés par
compagnie, ou 3.
Nous étions trois de ma compagnie : (Georges Louis)
CHOLLET, Benoît, Guyot et moi. Le
stage dura environ 3 semaines, cela consistait à apprendre la confection des
grenades françaises et allemandes et aussi la manière de s’en servir et de les
lancer.
Où j'ai eu un succès sans le vouloir
Nous faisions un dernier tir de classement avec grenades
réelles. Nous avions 5 grenades à lancer dans une tranchée latérale, à environ
40 mètres. Le tir était commandé par un sous-officier du 35ème régiment
d’infanterie, sous la surveillance d’un lieutenant.
Mon tour arrive :
première grenade
dans la tranchée ; deuxième dans la tranchée ; 3ème tombe au bord
puis roule et éclate dans la tranchée.
A ce moment, le sous-officier me fait remarquer que je ne prends
pas la position réglementaire, je lui fais remarquer qu’elle était quand même
dedans. Il rouspète et moi pour me débarrasser de lui, je balance mes deux
dernières grenades qui, elles aussi, tombent dans la tranchée. j’étais le seul de la division à avoir placé mes 5 grenades
dans la tranchée. Je ne l’avais pas fait exprès.
Résultat :
Quelques jours après, au rapport, j’entends :
« Chevillard
Gaston, matricule 11.929, sorti premier tireur à la grenade de la division, a
droit au port du cor de chasse en or. »
Ce n’était pas perdu…
Juillet 1916
Arrivée du régiment à Gérardmer
Au début du mois de juillet, le régiment quitte l’Alsace et
arrive à Gérardmer (*)
où
nous restons quelques jours dans les casernes du 152ème
d’infanterie.
Nous avons reçu un renfort assez important, en partie des gens
du midi.
(*)
: Le 3ème bataillon arrive à Gérardmer le 19 juillet 1916.
Départ pour l’inconnu
Un beau matin, départ, grande halte vers 10 heures du matin,
reprise de la route vers 15 heures et, dans la nuit, nous nous arrêtons, il y
avait beaucoup de brouillard et nous ne savions toujours pas où nous allions.
Quand le brouillard fut un peu dissipé et que le jour fut levé,
nous nous aperçûmes que nous étions en bordure d’une ligne de chemin de fer à
Bruyères. Ce qui signifiait embarquement. (*)
En effet, quelques instants plus tard, nous avons touché des
vivres : une boule de pain, deux boîtes de sardines et du singe, ainsi que le
vin ; 32 hommes par wagon.
Vers 8 heures du matin, le train démarre, mais dans quelle
direction ? A l’avis de tous :
« Pourvu que nous ne retournions pas à Verdun ! »
Un peu plus tard, nous avons compris que ce n’était pas pour
Verdun, nous avons eu un petit soulagement.
Nous avons roulé toute la journée, toute la nuit, et nous sommes
arrivés dans l’après-midi suivante dans une petite gare, dans la Somme. (**)
Débarquement et 2 heures de pause pour permettre à ceux qui avaient
encore quelque chose à manger de casser la croûte.
Ensuite, départ, nous n’allons pas loin : 5 kilomètres (oui mon
petit). En place de 5 kilomètres, il y en avait au moins 15.
Enfin, assez péniblement, nous arrivons dans un petit village,
il y faisait encore bien chaud et avec la capote et tout le barda, nous étions
bien fatigués et avions soif.
(*)
: Le régiment embarque sur 3 trains à Bruyères le 21 juillet 1916.
(**)
: Ils arrivent en gare de Saleux (Somme), sud-est
d’Amiens.
James fait de la boxe
Les gendarmes avaient une mauvaise corvée à remplir.
Dans ce village, il y avait un café, mais l’entrée était
consignée et gardée par deux gendarmes.
James, un grand gaillard qui
n’avait pas froid aux yeux, se présente pour avoir de la bière, donne ses bidons
pour obtenir de la bière ; un des gendarmes s’interpose, d’un coup de poing James s’en débarrasse, l’autre prend la
place et lui aussi en reçoit un autre et va, lui aussi, au tapis.
Le lieutenant de la compagnie fait appeler James qui avait été arrêté par la
garde, veut lui faire des reproches, mais James,
déchaîné, met le lieutenant knock-out dans son fauteuil.
Arrêt de James et
prévention de conseil de guerre (sur laquelle je reviendrai un peu plus tard).
Une bonne cuite dans une hutte à cochons
Arrivée au cantonnement, la fine équipe avait repéré une hutte à
cochons, bien propre, où il y avait assez de place pour 4 : Chambrot (Marcel Élie DUBOIS), (Georges Louis)
CHOLLET, (Étienne
Eugène) ClÉment et moi
; nous nous y installons.
Ce jour là, un pays de Chambrot rentrait de permission de
Morteau et avait rapporté, de la part des parents de Chambrot, 1 litre de Pernod, ainsi que d’autres victuailles.
Ce jour là, il y avait une revue
d’armes et de détails. Nous nous installons et commençons à déguster le Pernod
ainsi que les victuailles, si bien qu’au moment de la revue il n’y avait plus
personne, tous ronflaient à qui mieux mieux.
Et ce bon (Jean) ROSET
(aspirant), nous avait enfermés et avait dit à l’officier que nous étions de
corvée. A notre réveil, il nous fit croire que nous étions punis et,
finalement, nous dit la vérité (bon ROSET !).
Un drôle de bain pour Chambrot
Dans la section, il y avait aussi un copain à Chambrot nommé Cheval (*), qui était assez taquin, il logeait dans un bâtiment en face de
nous, mais il y avait entre nous un fumier et une fosse à purin.
En fin de soirée, Chambrot,
qui n’était encore pas dessaoulé, entend son copain qui se bagarrait.
« Je vais défendre mon copain »
Et, malgré notre défense, voilà mon Chambrot qui file pour faire partie de la bagarre, il aimait
assez cela.
Oui, mais dans sa ferveur, il oublie la fosse à purin et tombe
dedans. Nous courons, moi et TIÉNOT, pour l’en retirer, mais TIÉNOT lui avait
encore un peu pressé sur les épaules. Il n’était plus habillé en bleu-horizon
mais en brun foncé, et ne sentait pas bon.
Dans ce village, il y avait une mare qui devait servir
d’abreuvoir au bétail, nous y avons conduit Chambrot
pour faire un peu de toilette. Il ne pensa plus à aller défendre son copain.
(*)
: Marc François CHEVAL, 20 ans, est originaire du même pays (Morteau) que
CHAMROT (Élie DUBOIS). Incorporé au 44ème RI en avril 1915, il survrivra à la guerre après être passé par le 37ème
régiment colonial avec lequel il partira en Serbie, puis Roumanie en octobre
1918.
On se rapproche du front
Après quelques jours passés dans ce village, nous avons repris
la route pour aller dans un camp un peu aménagé. Une de ces étapes nous a été
très dure, et toujours avec le même refrain, encore une étape et on arrive,
mais il y en avait toujours au moins encore une après.
Partis depuis les 4 heures du matin, avec simplement le jus au
ventre, la capote, la vareuse, le sac et les musettes qui nous coupaient la
respiration; une poussière étouffante, les croisements de ravitaillement et
d’artillerie qui nous obligeaient à marcher sur les bords de la route, et
toujours le même refrain.
On arrive finalement.
Après avoir lutté pour ne pas caler, nous arrivons dans ce camp
à 11 heures.
(*)
Dès le lendemain, entraînement et formation des groupes de
nettoyeurs de tranchées.
(*)
: Il s’agit du camp n° 8 au sud du Hamel (80) à l’est d’Amians,
arrivée le 27 juillet 1916.
Je me suis laissé rouler
Pour la formation des groupes de nettoyeurs de tranchées ; rapport
à mon tir à la grenade de Gérardmer ; l'officier qui devait commander les
groupes : lieutenant KÜSS. Appelé
par lui, il m’annonce que je passais caporal et que je prendrais le
commandement du 1er groupe de nettoyeurs. Je lui réponds que :
« Non, je ne voulais pas passer caporal ».
Après
avoir un peu insisté, sans résultat, il me dit :
«C’est bon, tu t’arrangeras avec le commandant ».
Effectivement, dans l’après-midi, le commandant DUBIN, officier de réserve, brave
homme, et à qui j'avais déjà eu à faire deux fois au sujet de la vaccination,
me fait appeler. Je me présente correctement :
« Soldat Chevillard ».
Le commandant dubin ?
« Qu'est-ce qu’il me raconte, le lieutenant, tu ne veux pas être
caporal ? »
« Non, mon commandant. »
« Et pour quelle raison ? »
« Parce que j’ai déjà du mal à me conduire, ce n’est pas pour
conduire les autres ».
Le
commandant : « Tu manques de respect à ton lieutenant, est-ce que tu le
prends pour un imbécile ? »
« Pas du tout, mon commandant, loin de là. »
« Puisqu’il te propose, c’est qu’il te sent capable, au fait,
n’es-tu pas sorti premier tireur à la grenade ? »
« Oui, mais cela n’est pas suffisant, je ne veux pas être
caporal, je suis soldat pour défendre mon pays, mais je ne suis pas militaire
».
Le
commandant : « Cela suffit. Écoute, Chevillard,
c’est un refus d’obéissance. »
« Pardon, mon commandant, il n’y a pas refus
d’obéissance. »
« Bien, je vais te répéter 3 fois la question, je te préviens
d’avance que je vais t’avoir : première fois, veux-tu être caporal ? »
« Non, mon commandant. »
« 2ème fois, veux-tu être caporal ? »
« Non, mon commandant. »
« Pour la 3ème
et dernière fois, veux-tu être caporal ? »
« Non, mon commandant. »
« Bien, soldat Chevillard, vous allez prendre le
commandement du 1er groupe de nettoyeurs de tranchées, sans galon.
Cette fois, si tu refuses, ça sera refus d’obéissance. Va ! »
« Mais, avant, écoutes : nous allons bientôt monter en ligne pour l’attaque, tu partiras avec ton groupe de 7 hommes avec la première vague, à l’arrivée de la tranchée boche, tu t’occuperas d’eux. Je ne veux point de prisonniers, vous les tuerez tous, sans exception ; quant aux blessés, tu en feras ce que tu voudras… Si cela te fait plaisir, ne te gênes pas ».
Réponse :
« Ceux qui seront encore debout, passe encore, quant aux blessés, je crois que je ne m’en chargerai pas. Il n’y a pas de gloire à tuer, même un boche, quand il est désarmé, et surtout blessé »
Le
commandant, paternellement :
« Va, mon vieux Chevillard, je te souhaite bonne
chance, et quand tu redescendras, tu accepteras les galons de caporal et je me
charge de te faire passer sous-officier peu de temps après ».
Chose à signaler : presque la totalité de ceux qui étaient
passés caporal à la sortie de Verdun furent nommés sous-officiers, dont le
caporal Roque.
Août 1916
La montée en ligne dans la Somme
Avant tout, je dois dire une chose, car elle a son importance au
3ème bataillon, le mien.
En plus du commandant DUBIN,
il y avait un volontaire, mais pas un jeune, c’était le capitaine (Arthur) Dumas.
Vétéran de la guerre de 1870, il avait passé 60 ans. Parti sans galons, il
était lieutenant en 70 et y avait perdu un oeil. (*)
En 14, il avait suivi un régiment d’infanterie et y fut blessé,
soigné. Il repartit avec un régiment de zouaves, il y fut blessé une deuxième
fois.
Après guérison, il fut cependant incorporé au 44ème
régiment d’infanterie. À l’époque où je l’ai connu, il était capitaine
major-adjoint au commandant Gombain,
au 3ème bataillon.
Partis du camp, nous nous sommes rapprochés des lignes, environ
5 kilomètres.
En passant à Villers-Bretonneux, où il y avait des chasseurs à
pied, je reconnus, parmi eux, Nevers
Léon, qui était de Geneuille (et mort, il y a
quelques années, à Boulot). Il était sous-officier. Je l’interpelle et il finit
par me reconnaître et me dit ceci (il venait de descendre des lignes après y
avoir été attaqué) :
« Sais-tu où tu vas ! »
Je
lui réponds : « Pas en permission ».
Et
me recommande : « Fais attention, ils ne sont pas commodes ».
Je lui dis que nous venions de Verdun et que cela ne pouvait pas
être pire.
(*)
: Le capitaine Arthur Isidore DUMAS était à cette date agé
de 66 ans.
Arthur
DUMAS fait partie de ces soldats hors du commun qui ont eu une carrière et vie
militaire extra-ordinaire, cela vaut la peine de s’y interesser :
Certificat
d’étude primaire - Engagé volontaire à 17 ans aux Zouaves pontificaux pour 2
ans – Blessé contre les Garibaldiens (3/11/1867) - Engagé volontaire à 20 ans en janvier 1870 au
4ème régiment de Chasseurs d’Afrique. En Afrique à partir de février 1870 -
Brigadier - en juillet 1870 – Guerre contre l’Allemagne du 5 août au 1er
septembre 1870 – Blessé à Gravelotte - Prisonnier de guerre à Sedan - Il
s’évade le 15 septembre 1870 et repart en Afrique à partir du 15 octobre Blessé
(jusqu’en août 1881) - Maréchal-des-Logis en novembre 1870 - Chef en mars 1872.
Adjudant
en août 1878 - Retour en France et cours de cavalerie en qualité de
sous-lieutenant d’octobre 1881 à septembre 1882 - Chevalier de la Légion d’Honneur
en 1885 - Sous-lieutenant en juillet 1881 au 13e régiment de Chasseurs
d’Afrique - Lieutenant au 7ème régiment de Chasseurs en juillet 1886 - 2ème
régiment de Spahis en Algérie - Perte d’un œil en août 1887 (explosion inopinée
d’un bâton de dynamite en service commandé) - Sud Oranais – Tunisie – Gabon -
Côte d’Ivoire – Soudan – Maroc.
Demande
sa retraite (à Lille) en janvier 1900 – Part pour le Transvaal (Afrique du sud)
– Guerre des Boers en 1900 contre les Anglais – Bataille de Boshof
- Prisonniers des Anglais – Évasion – Retour en France - Se marie en 1901 -
Veuf début 1914 – Demande à se réengager en août 1914 – Refusé – S’engage dans
l’armée belge – Blessé - Prisonnier – Évasion – Blessé plusierus
fois à la bataille de la Marne (régiment ?) - Arrivée le 17 septembre
1914, capitaine, au 308ème régiment d’infanterie, (JMO) qui
vient de subir d’énormes pertes. Blessé le 28 septembre 1914, ferme du Touvent,
Oise (JMO) - Citation au 308ème régiment
d’infanterie (JMO) –
Officier de la Légion d’Honneur en octobre 1914 - Retour au 308ème régiment
d’infanterie, le 22 novembre 1914 (JMO)
- Quitte le 308ème RI entre juin et septembre 1915 –
Dardanelles ?
Retour
au 44ème régiment d’infanterie – Blessé à Verdun (Bézonvaux février 1916) - Retour au 44ème
régiment d’infanterie (66 ans) et …nous en reparlerons plus loin.
Passage à Cerisy-Gailly
Pause assez longue à Cerisy-Gailly où
Jules Poy était boucher. En cherchant de l’eau, j’étais allé dans son
abattoir, et lui, pendant ce temps-là cherchait des ‘Geneuille’,
tant au 44ème qu’au 60ème qui passait, lui aussi.
Par coïncidence , il s’était justement
adressé à mon caporal (Joseph Marie François
Édouard) PITON et lui avait demandé après moi et (Georges Louis)
CHOLLET.
(*)
A mon retour, j’étais bien déçu, et sûrement lui aussi, car il
n’avait pas oublié le pinard.
Enfin, nous arrivons à côté d’un petit village qui s’appelait
Suzanne où nous nous installons sous la tente.
(*)
: C’est la dernière fois que Gaston CHEVILLARD cite dans ses souvenirs Georges
Louis CHOLLET qui sera déclaré « disparu » quelques jours plus tard
lors de l’attaque du bois de Hem près de Maurepas dans la Somme. Voir
sa fiche de décès. Son corps sera finalement retrouvé et inhumé dans la nécropole de Maurepas.
Une revue de cheveux un peu mouvementée
Un bel après-midi, le 60ème d’infanterie, qui bivouaquait à côté
de nous, décide de passer une revue de cheveux et se forme en carré juste sur
une petite hauteur. Le résultat n’a pas été bien long avant d’arriver. Nous
étions à 5 kilomètres des lignes et les ballons d’observations boches n’ont pas
tardé de les repérer. Un sifflement d’obus et en même temps l’éclatement d’un
88 qui tombe presque au milieu du carré, résultat 16 blessés. (*)
Un deuxième à environ 80 mètres de moi et TIÉNOT, qui nous
étions couchés au premier éclatement.
Résultat : TIÉNOT un
éclat sur la fesse et moi un sur la patte de mon ceinturon, mais il
n’avait plus assez de force et, à part une petite talure, rien de grave.
Il n’en était pas de même pour ce pauvre (Robert) Cheviet qui avait
déjà été touché pendant la relève de Verdun ; un éclat lui avait traversé le
menton et coupé l’artère carotide, il est mort presqu’aussitôt.
Un troisième était tombé à côté de la tente de Charles ZÉdet, adjudant qui avait déguerpi
d’une belle vitesse.
(*)
: Cet épisode tragique est raconté
dans le JMO.
Une petite émotion en se promenant
A 2-300 mètres de notre bivouac, il y avait quatre pièces
d’artillerie lourde de 240, à longue portée, et aussi de gros obusiers anglais
qui tiraient sur Péronne.
TIÉNOT et moi, nous nous étions approchés quand nous découvrons
un petit dépôt d’obus de 75 qui avait sauté et des lamelles de poudre se
trouvaient à côté, nous en ramassons quelques unes et
avisons un 75 avec son étui, nous essayons de le sortir de sa douille en le
tenant chacun d’un côté. Quand tout à coup, sans nous y attendre, une pièce de
240 tire à côté de nous et nous surprit tellement que
nous lâchons l’obus, comme si c’était lui qui avait éclaté. Alors nous avons
compris qu’il valait mieux rester tranquilles, mais
c’est avec un ensemble parfait que nous avions lâché cet obus.
Quand nous regardions partir ces gros obus, car on les voyait
très bien et assez longtemps, nous disions :
« Tiens, les boches sont en train de faire le gros dos »
Et cela nous faisait plaisir.
En route pour la grande bagarre
Le 9 août (1916) au
soir, nous montons en ligne sans sac ni capote. Le premier bataillon était un
peu en avant de nous. En tête de notre bataillon et à cheval, le commandant Gombain et le capitaine adjudant-major (Arthur) Dumas
chantent ‘Malbrough s’en va-t-en
guerre’, mais pas pour longtemps.
À environ 400 mètres en avant de nous, sur la route qui va à Curlu, se trouve une petite côte et un grand rocher, sorte
de carrière qui s’appelait le chapeau de gendarme pour sa forme qui lui
ressemblait assez, la route au pied, et à côté de la route un marais.
Y étaient embouteillés le 133ème régiment d’infanterie qui
descendait des lignes, une colonne d’artillerie coloniale et le 1er bataillon
du 44 qui montait en ligne. Quand tout à coup arrivent deux 210, en plein dans
la colonne. Combien y eut-il de victimes, je n’en sais rien, ce que je sais,
c’est qu’il y a eu 16 chevaux de tués.
Ce fut une drôle de bousculade : chevaux, caissons et canons 75
passèrent sur tout. Et pendant ce temps là nous
marchions toujours dans cette direction, en priant le bon Dieu qu’il n’y en
revienne pas deux autres.
Le commandant et le capitaine Dumas ne chantent plus
En arrivant sur les lieux du carnage, en voici deux autres qui
rappliquent, par une chance inouïe, ils étaient trop courts et s’enfoncèrent
dans les marais, sans éclater. Ce n’était pas notre heure ! Mais ce souvenir
est ineffaçable à la mémoire.
Peu après ce passage, après un tournant de la route, nous
passons devant des batteries de 75 qui déclenchaient un tir de barrage bien
fourni et qui nous faisaient drôlement mal aux oreilles, et puis nous
commencions à entendre les rafales de mitrailleuses et quelques fusées
éclairantes et demandes d’artillerie.
Nous étions à nouveau vraiment à la guerre,
Sur la ligne de combat
Notre emplacement se trouvait bien en avant de Maurepas, sur la
gauche du bois de Hem, à côté d’une voie de tacot régionale.
Nous, les nettoyeurs de tranchées, n’étions pas dans la tranchée
de tir mais un petit peu en arrière à côté d’un ancien poste de commandement
allemand qui servit de poste de secours quelques jours après, mais qui nous
servit pour recevoir pas mal de bombardements de gros noirs, dont un très
copieux l’après-midi du lendemain de notre arrivée.
Ils commencèrent par des fusants 88 et 130 qui, heureusement
éclataient un peu haut, ensuite ce furent les 210 qui remuèrent passablement
l’emplacement.
Où j’ai bien fait de changer de coin
À un moment donné, je me trouvais à côté d’un gars qui n’était
pas tranquille, chaque fois qu’il arrivait un obus un peu près,
il se mettait à trembler, à ne pas pouvoir se contenir, J’ai changé de place
pour ne plus me trouver auprès de lui. J’avais eu une bonne idée car quelques
secondes plus tard il était retourné par un 210.
Je m'étais placé dans une excavation que nous faisions pour nous
protéger contre les fusants.
Une fusée de fusant traversa le dessus et me coupa le pantalon
sur les genoux.
Le bombardement avait duré environ une bonne heure, j'avais un
bon petit copain martiniquais, noir comme de l’encre, qui s’est trouvé enseveli
2 fois de suite, la dernière fois, il n’y avait plus qu’une main qui dépassait,
commotionné, mais sans blessures.
Par contre, une chose incroyable, il faut l’avoir vu pour le
croire : après le bombardement, je vois un type étendu dans un trou d’obus, les
grands yeux ouverts, un peu voilés, et sa veste qui brûlait. Je le croyais
mort, mais tout à coup, je m'aperçois qu’il respirait, je le secoue, il me
regarde et me dit :
« Tu ne peux pas me laisser
dormir ».
Je pense qu’il était devenu un
peu fou.
Mais pas du tout, il n’avait pas entendu le bombardement et ce
n’est que lorsqu'il a constaté le rebouillage des
obus qu’il y a cru. Il avait le sommeil dur ?
Notre première attaque. Un adjudant tué à mes côtés
Le 10
août, vers 16 heures, nous étions dans la parallèle de départ. Les
crapouillots tiraient sur les tranchées boches à flanc d’un revers ainsi que
des 155 ; le tir était assez bien réglé, nous en étions à environ 150 mètres. À
mes côtés, il y avait, à gauche, un adjudant qui était de Besançon, nouvellement
arrivé en renfort, je n’ai pas su son nom ; et à ma droite un nommé ChampanÉ de la Saône-et-Loire.
L’adjudant a été appelé par le commandant qui se trouvait à une
centaine de mètres, il part en courant et revient de même, quelques instants
plus tard, mais juste au moment où il saute dans la tranchée, il reçoit une
balle en plein coeur et tombe, à mes pieds, mort.
Nous lui déboutonnons sa veste pour voir sa blessure : juste un
petit point bleu sur le coeur. (*)
(*)
: Le seul adjudant tué ce jour est Émile TRACOLAT, 22 ans. Voir
sa fiche.
Ma première victime
Quelques secondes après cet événement, je vois surgir de la
tranchée boche, un grand fritz, je le tire et il culbute. Champané me dit :
« L’adjudant est vengé, tu ne l’as pas loupé ».
N’empêche que, lorsque nous avons eu pris la tranchée, je ne
l’ai pas retrouvé.
Quelques minutes plus tard, à 150 mètres sur ma droite, j’aperçois
deux allemands qui venaient se rendre. L’un boîtait
et l’autre avait un bras de cassé. J’en vise un, mais au moment de serrer le
doigt j’ai eu un remords de conscience et j'ai relevé un peu le canon de fusil,
ma balle n’avait pas du passer bien loin car il l’a
saluée en baissant la tête. Quand nous sommes arrivés à la tranchée allemande,
elle était vide, ils avaient décampé.
Nous nous arrêtons un peu plus loin sur le plateau, à 7-800
mètres devant le village de Maurepas, et commençons à creuser une tranchée.
Sur notre droite, il y avait un noyau qui avait résisté et qui
nous prenait d’enfilade, et ce n’était pas le moment de relever la tête. A ma
droite, TIÉNOT, et à ma gauche un autre bon camarade Berthet qui était de l’Ain. (*)
(*)
: Deux soldats BERTHET (Cyrille et Pierre), originaire de l’Ain, sont dans la
liste des morts pour la France au sein du 44ème régiment
d’infanterie. Est-ce l’un d’eux ?
Entrevue avec le lieutenant Froidurot
A la tombée de la nuit, je m’adresse à Berthet, lui demandant si, par hasard, il avait encore à
boire. Bien sûr, je savais bien qu’il était comme moi, et que son bidon était
vide depuis longtemps. Mais il me répond qu’il avait encore de l’alcool de
menthe.
Je lui réponds que j'allais agrandir encore un peu mon trou et
que j'irais me mouiller la langue.
A ce moment, j'entends derrière moi :
« T’as donc soif Lacheville ? »
C’était ce bon et brave lieutenant (Jean Désiré) Froidurot.
Réponse
: « Oh ! oui mon lieutenant, je crois que je boirais
la mer et les bateaux ».
Le
lieutenant : « T’as un quart ? »
Réponse
: « Mon quart, mon fusil et mon masque à gaz me suivent toujours ».
Le
lieutenant : « Passe-moi ton quart ».
Je le regarde, et, à ce moment,
les balles sifflaient encore assez drues.
« Baissez-vous mon
lieutenant. »
« Passes-moi ton quart ».
Je lui tends et, à ma grande stupéfaction, il vide son petit
bidon qui contenait encore un quart de vin et me dit:
« Bois. »
« Après vous, mon lieutenant. »
« Je te dis : bois »
Et moi, bien timidement, je trempe mes lèvres dedans et lui
retends le quart. La réponse ne fut pas longue :
« Est-ce que tu me prends pour un c.. ? »
« Oh ! mon lieutenant. »
« Alors, bois-en la moitié ».
J'étais ému et en avais les larmes aux yeux.
«A Pontarlier, je vous l’avais assez
dit qu’il fallait toujours garder une poire pour sa soif. Tu l’as oublié. Qui
est-ce à côté de toi ? »
« TIÉNOT, un de la 26ème
compagnie de Pontarlier ».
Question
qu’il pose à TIÉNOT :
« Tu viens avec moi
TIÉNOT. »
« Oui, mon
lieutenant. »
« Et l’autre là, qui
est-ce ? »
« Berthet, un autre de la 26ème »
« Bon, tu viens avec moi Berthet »
« Où est-ce qu’on va
? »
« Pas en perme, bien
sûr »
« Oui mon lieutenant »
Berthet : « Jusqu’où est-ce qu’on va ?
»
Réponse: « Jusqu'à ce qu’on les trouve ».
Et nous voilà partis en patrouille sur le plateau où il y avait
de la grande herbe.
Après avoir parcouru environ 200 mètres, un coup de fusil claque
; tout le monde se couche.
Quelques instants après, le lieutenant se lève un peu et claque
un 2ème coup. Le lieutenant me dit :
« Je le vois, passes-moi ton
fusil et des cartouches ».
Il change un peu de place et
tire et me dit :
«Cà y
est ; tu vas aller trouver l’adjudant Maigrot
et lui dire qu’il vienne ici avec un fusil-mitrailleur ».
Je pars et je ramène Maigrot et le fusil-mitrailleur. Le
lieutenant le place et lui dit d’ouvrir l’oeil, et me
dit :
« Je ne t'avais pas demandé de
revenir ».
Je lui fis remarquer que «
c'était plus facile au fusil-mitrailleur pour le retrouver ».
La nuit se passa assez tranquille,
Une mauvaise corvée
Le 11
août, vers 16 heures, l’agent de liaison vient me prévenir que le
lieutenant RuET, qui commandait
le groupe de nettoyeurs de tranchées, me demandait. Je me présente.
Le lieutenant :
« Voilà, Chevillard, la mission n’est pas très
facile, il faut à l’instant même porter une caisse de grenades offensives au 1er
bataillon qui se trouve devant nous, un peu sur la droite. Tu demandes deux
volontaires pour porter la caisse ».
Je fis remarquer au lieutenant qu’il n’y aurait sûrement pas de
volontaires. Le terrain : plat comme une carte, et aucun
obstacle pour se
dissimuler, et, en plein jour, il y avait de grands risques à courir.
Le lieutenant :
« S’il n’y a pas de
volontaires, tu en désigneras deux. Vas et bonne chance ».
J'arrive vers mon groupe, TIÉNOT me fit remarquer que ne n’avais
pas l’air d’être très satisfait.
Je lui réponds qu’il n’y avait guère moyen de l’être, et je
soumets la chose en demandant s’il y avait des volontaires.
Aucune réponse.
Je savais que TIÉNOT viendrait avec moi. Mais depuis notre
montée à Verdun, comme volontaires, nous avions été bien servis et avions juré
de ne plus être volontaires, même pour aller en permission.
Après avoir reposé la question, sans réponse, je désigne TIÉNOT.
Réponse :
« Merci Tonton ! »
Il y
avait le petit martiniquais que j'avais déterré la veille, il s’appelait aussi
Gaston. Il s’avance et me dit ceci :
« Ecoute, Gaston, moi je veux
bien aller avec toi, mais à une condition. »
« Laquelle ? »
« Voilà, je suis noir, et
si les boches me prennent, ils me coupent la tête ; si tu me promets que l’on
ne revient pas
les uns sans les autres, je suis
volontaire ».
Je
lui serre la main et lui dis :
«Tous ou personne ».
Après avoir fumé une cigarette, nous voilà partis à découvert.
Premièrement pas un coup de fusil. C’était presque incroyable, trop beau pour
que cela dure. En effet, cela n’a pas duré et nous avons été copieusement
arrosés de balles ; après bien des plats ventres et des ruses, ne pas se
relever à la même place, nous avons fini par arriver à la tranchée où les
copains se demandaient sur qui les boches tiraient.
Pour le retour, voilà ce que j’avais convenu : partir en
vitesse, au premier coup de fusil se coucher, ramper et repartir en zigzag. Ce
qui nous permit, avec la chance, de rentrer tous les trois.
Je me représente au lieutenant et lui annonce :
« Mission remplie. »
« C’est très bien, Chevillard, je t’ai suivi au périscope,
mais voilà, il y en a une deuxième à porter au 3ème bataillon ».
Je me permis de lui faire remarquer que nous étions 3 groupes et
que les deux hommes qui étaient avec moi étaient volontaires pour la première
caisse, mais que pour la deuxième ?
Le lieutenant :
« Je te comprends, et ce que tu
me dis est un peu logique, mais, si j’en envoie 3 autres, ils vont se faire
tuer, et, vous trois, je suis presque sûr que vous reviendrez. Vas ».
Je vais retrouver mon groupe :
« Eh bien, mon vieux Tonton,
t’en fais une tête ! »
On l’aurait faite à moins ? Nous voilà donc repartis avec la
deuxième caisse, mais cela n’a pas été de même.
Sitôt sortis, les boches nous canardent et je craignais qu’une
balle fasse sauter la caisse de grenades, et pour nous redonner du moral, dans
nos plats ventres, nous nous sommes trouvés plusieurs fois avec des morts
encore sur le terrain, ils étaient du 133èmed'infanterie.
Un spectacle qui nous avait très frappés : 16 autour d’un gros
trou de torpille, dont un que je verrai toujours en position de tireur à
genoux, avec une barre d’acier qui le traversait de part en part.
Enfin, nous finissons par arriver et je suis tombé sur le
lieutenant (Jean Désiré) Froidurot qui était très surpris de nous voir
arriver avec des grenades, me disant qu’il n’en avait pas demandé. Nous avons
soufflé un bon coup et nous avons fait des cigarettes. Et TIÉNOT s’est mis à
chanter la chanson du condamné à mort : ‘Pour la dernière fois donnez-moi
donc une cigarette’.
Après bien des émotions, nous sommes quand même arrivés à notre
point de départ. Quand je me suis présenté au lieutenant, il m’a félicité et
demandé les noms de mes camarades pour nous demander 3 citations.
Une demi-heure après, il était tué d’un éclat d’obus au cou, sur
la colonne vertébrale. (*)
(*)
: Jean-Claude RUET, sous-lieutenant au 44ème régiment d’infanterie,
mort pour la France au bois de Hem le 12 août 1916. Voir
sa fiche.
Complément du 1er jour d’attaque
J’ai oublié de mentionner une chose assez importante : après
quelques minutes après avoir abattu cet allemand, nous sommes passés à
l’attaque. Je faisais partie de la première vague.
J'avais dans mon groupe un gars pas très dégourdi qui me dit :
«Je n’ai rien dans mon machin
».
Je lui demande de quel machin il parlait. Alors il me sort son
pistolet 7,65 enveloppé dans un chiffon blanc. Il s’appelait Cretin. Avant de monter en ligne, après
avoir touché les pistolets, nous les avions essayés sous le commandement d’un
lieutenant et pendant ce tir, il avait manqué de peu de tuer le lieutenant.
Je reviens à la tranchée allemande où nous arrivions à l’instant
où il sortait son pistolet. Dans cette première vague, il y avait un sergent
nommé Girardet, qui était de
Belfort et qui me dit qu’il y avait un gourbi. C’était à moi de m’en occuper.
Je m’approche et au même instant je vois un bras qui sort et qui
lance une grenade. Je crie « Gare ! » et je me couche en vitesse : la grenade
éclate à 3 ou 4 mètres de moi et les éclats me passent au-dessus de la tête.
De suite, je saute à côté de l’entrée du gourbi, le pistolet
d’une main et une grenade de l’autre. A ce moment là,
j’entends « Camarade, camarade » et je me demandais ce qu’il était bon de
faire. Pas question d’entrer, on n’y voyait rien, dans le trou.
Je n’ai pas attendu longtemps, un grand diable sort en baissant
la tête et moi, sans hésiter, je lui mets une balle dans la tête, et il tombe à
mes pieds, j’ai balancé plusieurs grenades et j’ai continué l’attaque.
Par la suite, j’ai toujours pensé que j’avais eu à faire à un
pauvre type devenu fou par le bombardement qu’il avait subi.
Question de ravitaillement
Dans la Somme, ce sont les territoriaux qui devaient nous
apporter le ravitaillement.
Le troisième jour, ils étaient parvenus jusqu’à nous ; pour 3
groupes de nettoyeurs de tranchées, nous avions touché, en tout et pour tout,
une gamelle individuelle de viande et rien à boire, à noter qu’il y faisait
très chaud dans la journée. Le matin, il y avait souvent du brouillard, ce qui
nous permettait de recevoir un peu moins d’obus car il était difficile de
régler les tirs.
Le 11
août au matin, il était si épais que nous avions quitté les tranchées pour
visiter devant nous, Les allemands avaient fait comme nous, nous les entendions
jargonner, il y avait pas mal de morts, en partie du 133ème d'infanterie, ce
qui prouvait qu’ils avaient été contre-attaqués et repoussés.
Je vois encore un jeune sous-lieutenant qui portait des
lorgnons, qui était tombé avec son épée à la main, il avait une petite
moustache blonde (*) ; et
bien d’autres encore, mais, à cet endroit, il n’y avait pas un allemand.
(*)
: Le seul sous-lieutenant tué le 10 août est Antoine Henri PILLARD. Voir
sa fiche.
La soif est une chose bien dure à supporter
Le 12
août, au début de l’après-midi, j’apprends qu’il y avait une
fontaine à Curlu, village que nous avions traversé la
nuit de la montée aux tranchées.
Comme village, il n’y restait que des ruines et il y avait au
moins 5 kilomètres pour y aller. Bien entendu, il était interdit de quitter la
tranchée sans ordre de mission, et il n’était pas question que j’en demande un.
Enfin, je décide de risquer le coup. Tant pis pour le conseil de
guerre, je ramasse une dizaine de bidons et me voilà parti.
Il y avait les gros noirs, les 210, qui tombaient un peu
partout, et pas mal de macchabées des deux sortes, français et allemands. Ils n’étaient
pas beaux, tout noirs et gonflés, prêts à éclater.
En arrivant aux abords de Curlu, il y
en avait beaucoup qui étaient rassemblés, cela ne sentait pas bon, Pris sous
une rafale d’obus, j’ai dû me coucher et j'étais parmi eux, et je faisais des voeux pour qu’il n’y en aie pas un de plus.
La rafale passée, je repars de l’avant à la quête de cette
fameuse fontaine, que je n’ai pas trouvée, et finalement j’ai trouvé une espèce
de mare où il y avait de l’eau et aussi une couche de mousse qui la recouvrait.
Je l’ai écartée avec le fond d’un bidon et j’ai commencé par boire un bon coup,
car j’avais chaud et bien soif. Une fois désaltéré, j’ai fait le plein des
bidons et je suis reparti.
Après avoir fait bien des saluts et des plats ventres, je suis
enfin arrivé à la tranchée, où personne n’avait remarqué mon absence.
À mon arrivée, tous les copains :
« T’as de l’eau ? T’as de l’eau
? »
« Oui ».
Finalement, au moment de l’attaque, il ne m’en restait plus.
Le 12 août 1916. Attaque de Maurepas
Le 44ème régiment
d’infanterie doit attaquer et prendre les tranchées de Celle et du Crabe. Voir la carte
L’attaque devait avoir lieu à 17 heures. Mais avant, je devais
porter une caisse de grenades au 3e bataillon qui se trouvait à environ 300
mètres de mon groupe de nettoyeurs ; toutes les compagnies étaient dans la
tranchée parallèle et il n'y avait que quelques minutes pour me rendre à ma
place.
Pour m’y rendre, il m’aurait fallu trop de temps en suivant la
tranchée qui était pleine de soldats, je décidai donc de prendre le pas
gymnastique par bonds, de temps en temps, lorsque les balles sifflaient trop
près, je sautais dans la tranchée et je recommençais un peu plus loin,
A un certain point, je me trouve auprès de mon bon et brave
caporal ROQUE, qui était passé sergent, et qui s’écrie :
« CHEVILLARD, CHEVILLARD, ne fais pas le ‘coune’
tu as le teimp, tu as le teimp
».
Et
je lui réponds, mi cafardeux, mi souriant :
« Tu n’a pas vu le lièvre qui mangeait
la carotte dans le champ de choux-raves ! »
« CHEVILLARD, je te répète ‘fasse’ pas le ‘coune”
tu as le temps ».
C’était la dernière fois que je devais le revoir, très gentil
garçon de 40 ans, avec une grande moustache brune. Nous nous aimions et
estimions beaucoup.
Enfin, j’arrive sans encombres à mon groupe, où je trouve (Michel) BONJEAN,
celui qui avait fait quelque chose dans son pantalon, à la relève de Verdun. Il
était couché en avant de la tranchée et paraissait avoir un moral bien bas. Je
l’interpelle et lui dis :
« Tu vas voir les fritz, s’ils vont en prendre un bon coup. »
« Oui (qu’il me répond), c’est nous qui
allons en prendre un bon coup, on va tous se faire descendre ».
Il n’avait pas tout les torts.
L’attaque
L'ordre arrive :
« Baïonnette au canon, en avant ! »
Nous étions en ligne de tirailleurs, à environ deux mètres l’un
de l’autre, Nous avons fait environ une centaine de mètres sans un coup de
fusil. La tranchée allemande se trouvait aux abords de Maurepas, c’est-à-dire
aux décombres de Maurepas, car il n’y restait que quelques pans de murs. Et,
tout à coup, les mitrailleuses allemandes commencent par faire du clair dans la
première vague.
À ce moment, ce pauvre (Michel) BONJEAN (*), qui avait le pressentiment de sa fin
proche, se serrait toujours contre moi, j'avais beau
lui dire de s’écarter pour ne pas donner trop de visée aux boches : je
m’écartais de lui, mais je me rapprochais des copains qui étaient à ma droite,
ce qui fait que nous étions cinq d’un paquet, je me suis fâché et je l'ai
renvoyé à sa place.
Tout à coup, je ne le vois plus, il était resté en arrière avec
une balle en plein front.
Les rangs s’éclaircissaient. Il y avait beaucoup de bleu-horizon
sur le terrain, à un moment, je pensais qu’ils se planquaient. Nous nous
faisions décimer par les feux de barrage et par les mitrailleuses que nous
n’apercevions pas. À un moment donné, entre deux bonds en avant, je me trouve
dans un trou d’obus en compagnie de CHAMBROT, DUBOIS de Morteau (**), et d’une
recrue arrivée en renfort quelques jours avant.
Je ne le connaissais pas, il se trouvait entre nous deux, je
m'aperçois qu’il était mort.
Je le dis à CHAMBROT : « Hein ? » qu’il me dit. Il l’interpelle,
ne répondant pas, il l’empoigne des deux mains par la tête, et le lâche
aussitôt, il avait des morceaux de cervelle du copain dans la main.
Il se mit à pleurer et à jurer :
« Ils ont tué mon copain ! »
Il se dresse d’un seul coup, part en avant tout seul en jurant
et pleurant. Je l’appelle, mais en vain, il était fou. Inutile de dire que,
seul debout, il a été le point de mire des boches.
Tout à coup, je le vois tomber. Nous repartions à l’avant pour
un nouveau bond, je m’arrange pour passer près de lui, le croyant mort, Mais
pas du tout, il était bien en vie, il pleurait, jurait tout
les jurons possibles en disant toujours :
« Ils ont tué mon copain ! »
Il est reparti avec nous.
Notre première vague s’éclaircissait de plus en plus, et nous
n’étions plus guère nombreux, et toujours impossible de voir d’où nous venaient
les coups. Le champ de bataille était un grand plateau où il y avait de la
grande herbe, plat comme une carte, où il n’y avait pas moyen de se dissimuler.
(*)
: Michel Joseph Pierre BONJEAN, 20 ans, mort pour la France le 12 août 1916 à
l’est de Curlu, bois de Hem, Somme. Voir
sa fiche.
(**)
: C’est à ce moment du récit que l’on découvre que « CHAMBROT » est
un surnom et qu’il se nomme en réalité Élie DUBOIS, terrassier, 20 ans qui est
bien de Morteau. Il sera prisonnier en avril 1917 durant l’attaque du Chemin
des Dames. Voir
sa fiche.
Mais
pourquoi le surnom de Chambrot ??.
Une découverte
Tout à coup, à environ 60 mètres de moi, je découvre un petit
amoncellement d’herbe, et, qu'est-ce que je vois dessous ? Deux bérets avec le ruban
rouge... C’était les boches. Ils avaient étendu des toiles de tente qu’ils
avaient camouflées avec de l’herbe et installé des mitrailleuses, et nous
avaient causé d’énormes pertes.
Ils ont fait plus vite que moi
Lorsque j’ai aperçu ces deux Allemands, notre bond en avant
était terminé, il n’était pas question pour moi de rester debout pour tirer, je
n’en aurais pas eu le temps, j’attendais donc un nouveau bond en avant pour
tirer. Ce que je fis.
Cette chose que je vais décrire est absolument véridique, sur tout les détails : j’étais bon tireur, et mon fusil portait
juste, j’étais donc certain de tuer mon boche. J’épaule, je prends la ligne de
mire, comme au tir. J’étais sur la deuxième bossette, à un fragment de seconde,
et pan ! c’est moi qui roule. J’ai été très surpris de
ce qui m’arrivait.
Après un certain temps, indéterminé, je reprends toute ma
lucidité, ne sentant pas ma douleur, je me demande ce que je faisais là, et
qu’on allait me prendre pour un lâche. Je vais pour me lever, mais à ce moment,
j’ai bien compris que j’en avais pris une, et qu’il fallait que j’essaie de
faire mon pansement. Il y avait un petit trou d’obus que je venais de passer,
je me traîne dedans, je prends ma pelle-bêche pour tenter d’agrandir le trou,
mais à la 2e pelletée, une balle la traverse, je n’avais plus rien qu’à faire
le mort.
M’étant déséquipé, j’essaie de me renseigner sur l’état de ma
blessure, j’enfile ma main dans mon pantalon en tâtonnant, sans rien sentir,
mais lorsque j’ai retiré cette main, elle était pleine de sang qui coulait au
bout des doigts. Alors, j’ai pensé que j’avais l’artère fémorale coupée et que
je n’avais plus guère à vivre. J’ai pensé à tout ce que je laissais, ce qui me
faisait le plus de peine, c’était de mourir à 20 ans, par un beau ciel clair,
et c’est le ciel clair qui me chagrinait le plus...
Mais, comme je pensais que j’allais quitter ce monde, il fallait
se préparer pour arriver dans l’autre.
Car, malgré la chanson qui dit que Dieu bénit qui meurt pour son
pays, il fallait quand même faire une prière. J’entrepris donc de dire mon
‘acte de contrition” et, tout en le faisant, je pensais aux miens, ceux qui
m’étaient chers.
Quand tout à coup j'arrive à ma grand-mère paternelle et je me
souviens de ce qu’elle m’avait dit à ma dernière permission :
« Gaston, tu ne mourras pas à la guerre, je prie pour toi ».
Et ma prière s’est arrêtée là, car, à ce moment
là, j’ai mesuré le temps passé depuis que j’avais été touché et j’en ai
convenu que je n’avais pas l’artère coupée. Et ma prière s’est terminée par
cette phrase :
« Bon Dieu, c’est pas ton heure ».
J’ai à nouveau essayé de faire mon pansement mais dès que je
bougeais la pelle-bêche, les boches me saluaient.
Un long moment après, j'entends :
« En avant pour la France ».
C’était ce brave lieutenant (Jean
Désiré) FROIDUROT qui avait fait se regrouper en rempart le reste de la
compagnie qui s’élançait sur les boches qui étaient à environ 10 mètres, tous
déséquipés, et qui se rendaient sans résistance.
À cet instant, je me dis :
« C’est bien le moment de déguerpir ».
Je me lève, mais rien à faire pour marcher, je suis donc parti
en me traînant jusqu’à notre point de départ, un petit renvers.
En arrivant au bord du renvers, j’aperçois
les boches prisonniers qui venaient à l’arrière, et je me dis ceci :
« Tu es bien seul ici, s’il leur prenait l’idée de te tuer. Oui, que je me dis, mais j'ai mon pistolet ».
Quelle déception, c’était ma pelle-bêche que je tenais, je l’ai
balancée d’un geste rageur. Ce qui permit à un camarade de section de
m’apercevoir. Il se nommait RABEROLE.
Ayant été blessé à la main, il ne pouvait pas tenir un fusil, et
le lieutenant l’avait laissé dans la tranchée pour s’occuper des prisonniers.
Il vînt à ma rencontre et me dit :
« C’est toi, CHEVILLARD, qu'est-ce que tu as ? »
Réponse
: « J’en ai pris une bonne. »
« Viens, je vais te faire ton pansement ».
Nous
arrivons dans la tranchée, mais quand il vit ma blessure, il me dit :
« On n’est pas bien ici pour faire ton pansement, je vais te mener
au poste de secours ».
J’avais compris pourquoi nous n’étions pas bien. Arrivés au
poste de secours, il va prévenir le major, mais il n’avait pas que moi à
s’occuper. J’ai attendu longtemps, et, pendant ce temps, les prisonniers
allemands arrivaient. Le poste de secours était un ancien poste de commandement
allemand et ils connaissaient bien l’emplacement, et ils ne tarderaient pas à
nous le faire voir. Ils commencèrent à nous arroser avec des 130 fusants, et
d’autres. Il y avait un rassemblement de prisonniers que les observateurs
allemands voyaient très bien. Je commençais à ne pas rigoler.
Tout à coup, un prisonnier s’approche de moi, il était vieux, au
moins 40 ans. Comme les obus éclataient toujours, il me demande si je voulais
qu’il me place dans une espèce de petit gourbi. Je lui fais signe que « oui »
ce qu’il fit de suite, Comme mon pantalon était ouvert, il y avait beaucoup de
sang répandu sur mon ventre et mes cuisses. Je crois qu’il avait pitié de moi,
si jeune, sans moustache, il pensait sûrement à ses enfants, il m’a dit qu’il
en avait.
A ce moment là, je le regardais d’un
sale oeil, il m’offrit une cigarette, je lui ai fait
signe que je n’en voulais pas, il en a pris une pour lui, et devant son
insistance, j’ai fini par en accepter une.
Les obus arrivaient toujours, et il y avait plusieurs Allemands
de tués et des blessés. A un moment donné, RABEROLE, le camarade qui m’avait
amené au poste de secours et qui s’occupait des prisonniers, m’aperçoit, tout
surpris de me voir encore là, et me dit :
«Tu es encore là ? »
Je
lui réponds : « Où veux-tu que je sois ? »
Réponse
: « Je vais trouver le major, qu’il fasse ton pansement ».
Ce
qui fut fait de suite :
«Je vais te faire évacuer par les prisonniers en les ramenant à
l’arrière ».
Le 44ème régiment
d’infanterie a perdu 164 tués, 629 blessés et 105 disparus entre le 8 et le 14
août 1916.
Mon évacuation par les prisonniers allemands
Il en désigne 4 pour porter le brancard.
Celui qui m’avait donné la cigarette était toujours à mes côtés
et il insista pour me porter. Chose qui lui fut accordée par RABEROLE. Pendant
le parcours, nous passions vers ce fameux trou de torpille où il y avait 16
français de tués.
A ce moment, l’allemand, qui décrochait quelques mots de
français, et qui avait voulu me porter, me dit d’un air triste :
« Malheureux, chez nous, pareil
(mauvais la guerre) ».
«Je
luis réponds que c’était la faute de Guillaume.
« Nix, PoincarrÉ ».
J’insiste sur Guillaume et il me répond
toujours :
« Nix, c’est PoincarrÉ »
Et j’en déduis que, de la faute de l’un ou de l’autre, nous en
étions les victimes... Mais, pour moi, c’était bien de la faute à Guillaume.
Pendant le trajet du retour à l’arrière des blessés et des prisonniers,
Raberole en avait la
responsabilité. Et quelques obus fusants et autres, nous accompagnaient, et
parmi les 4 prisonniers qui me portaient, il y en avait un petit à ma tête, et
chaque fois qu’un obus arrivait assez près de nous pour être dangereux, il
s’enfilait sous le brancard, et, bien entendu, j’étais déséquilibré, ce qui me
faisait un peu plus souffrir.
Je le fis remarquer à Raberole
et lui demandai de changer les porteurs.
« Pas celui-là, qu’il en rote un peu ».
Le vieux n’a pas voulu qu’on le change et insista pour continuer
à me porter. Il remplaça donc les deux de derrière et s’adressant à un,
celui-ci lui répond :
« Nix (moi sous-officier)
Ah ! Toi sous-officier ».
Raberole le
met en joue et le sous-officier s’empresse :
« Ya, ya ! »
Il me regardait d’un mauvais oeil ! Ce
qui lui a valu de ne pas être rechangé.
En cours du parcours, je passais à côté d’un bataillon du 35e
d’infanterie où il y avait un fils Debief,
de Bussières. Je demande après lui, et de suite, il arrive et me dit ceci :
« Nous montons ce soir, je vais chercher les galons d’adjudant ».
Il était sergent.
Hélas ! Lui et les galons sont restés sur le champ de bataille,
il fut tué le même soir.
Une rencontre qui me fit grand plaisir
En passant à notre ancien emplacement, avant la montée en ligne,
l’ordonnance du commandant qui ne montait pas en ligne et attendait le passage
des blessés pour avoir des nouvelles de l’attaque, m’aperçut et me voyant plein
de sang, il me demande où j’étais touché et si j’avais soif. Que m’avait-il dit
? « Oh ! oui ! j'ai soif ».
Il partit en courant et revint avec un bidon de vin blanc, il m’en verse un
quart et me demande si j’en voulais encore. :
« Oui ».
Un
deuxième quart m’est servi.
« T'en veux encore ?
« Oui ! »
Un
troisième quart.
« T’en veux encore ? »
« Oui ! »
« Non, qu’il me répondit, tu en as assez !
»
Et nous sommes repartis jusqu'aux charrettes à deux roues, sous
lesquelles on pendait un brancard, qui nous conduisaient aux voitures
ambulances.
À mon arrivée en ce lieu, les prisonniers partaient à l’arrière,
mais le vieux qui m’avait porté, ne s’en allait toujours pas et ne cessait de
me dire bonne chance. Finalement, j’ai compris ce qu’il voulait : il aurait
voulu me serrer la main.
A 10 pas de nous, il y avait deux capitaines et un commandant,
ce qui ne m’a pas empêché de lui tendre la main. Peut-être était-ce lui qui
m'avait blessé ? Face à face, pas de camarade, chacun pour sa peau, mais à ce moment là, nous étions tout deux
victimes d’avoir fait notre devoir et je n’ai pas regretté mon geste, ainsi que
le sien.
L’arrivée à l’hôpital de Cerisy-Gailly
Nous étions quatre dans l’ambulance à notre arrivée à environ
minuit, il y en avait un des quatre qui était mort. L'hôpital était composé de
nombreuses baraques ‘Adrian’ où les majors opéraient jours et nuits. Il y avait
autant de plaintes et de râles que dans un abattoir.
Dès l’arrivée, piqûre antitétanique. L’infirmier qui ne pouvait
pas faire entrer son aiguille :
« Bon Dieu, que t’as la peau dure. »
« Salaud » lui fut-il
répondu ! »
Sur la table d’opération
Assez curieux de ce qui se passait autour de moi, j’aperçois une
boîte en fer blanc dans laquelle il y avait pas mal d’instruments : couteaux,
scies, pinces, etc. Je me demandais ce qu’ils allaient me faire.
Un infirmier me met de la vaseline sur les lèvres et sur le nez,
Je lui demande si c’était pour faire pousser la moustache :
« Non, qu’il me répond, c’est
pour ne pas te brûler »
« Hein ? Me brûler, mais
comment ? »
« T’es trop curieux, tu
vas faire ce que je te dis ? »
A cette époque, il n’y avait pas de masques pour endormir les
gens, simplement un tampon de ouate avec du chloroforme. L’infirmier me dit :
« Tu vas dormir »
Réponse
:
« Mais, je n’ai pas sommeil
! »
« Peu importe, tu vas
dormir quand même. Pour t’endormir vite, tu vas respirer très fort ».
Je réfléchis et je me dis qu’il valait mieux faire ce qu’il me
disait. Je vais chercher mon souffle bien
loin pour respirer, mais aussitôt je suffoque et me débats, et m’assois sur la
table, me débarrassant de l’infirmier, mais pas pour longtemps, aussitôt je
suis saisi par les bras et recouché en vitesse avec le tampon sur le nez.
J’en ai pris un bon coup et pour que je m’endorme plus vite, il
me posait des questions auxquelles je répondais avec un
air pas content. Les dernières
paroles que j’entendis :
« Ca y est ».
J’ai
répondu : « Non, ça n’y est pas ».
Et ils ont commencé de me charcuter, mais cela ne me faisait pas
mal.
Mon réveil après l’opération
Endormi vers 1 heure du matin, je me suis réveillé à 10 heures.
Lorsque j’ai ouvert les yeux, je m'aperçois que j’étais dans une salle et je me
demandais où j'étais. Quand tout à coup un infirmier qui était à côté de moi me
dit :
« Enfin, te voilà réveillé »
Je
lui pose la question : « Où suis-je ? »
Réponse
: «A Cerisy-Gailly »
« Cerisi, Ceris
? Le pays des cerises. ? »
« Non, tu sais bien, tu y es passé la semaine dernière »
Vite, j’ai compris et me suis souvenu. Vite, je tâte si j’avais
encore ma jambe. L’ayant trouvée, rassuré, je m’adresse à l’infirmier et je lui
dis :
« C’est pas le tout, j’ai faim! »
« Tu as faim, mais ce
n’est pas possible, après une
opération comme tu en as eu une, tu veux rire ! »
« Dis-donc, espèce
d’embusqué, toi, tu casses la croûte tous les jours, eh bien moi, il y a 4
jours que je n’ai rien mangé ».
Réponse
: « Moi, je te dis que ce n’est pas possible que tu aies faim ».
Devant
mon obstination, il me dit :
« C’est bon, je vais prévenir
le major ».
Et voici, en effet, un capitaine-major qui vient et qui me dit :
« Qu’est-ce qu’il raconte,
l’infirmier, tu as faim ? »
« Bien sûr que j’ai
faim. »
« Infirmier, prenez-lui sa
température ».
Chose
faite, pas de fièvre.
« Vous pouvez lui donner à
manger »
Ce qu’il fit en m’apportant des haricots rouges. Mais, le soir,
je n’ai pas mangé.
Le premier pansement
J'avais à côté de moi un zouave qui avait été blessé au bras le
même jour que moi. Il avait le lit numéro 12 et moi le numéro 13. Il ne
paraissait pas bien souffrir. Les infirmiers viennent le chercher pour le pansement, à un
moment donné, je l’entends crier et, lorsqu’il est revenu, il était très abattu et tout pâle.
Et ce fut mon tour, j’allais en toute confiance, je me disais :
« Tu as 7 petits trous, ce sera
vite fait ».
J’arrive sur la table d’opération et le major commence à défaire
mon pansement, mais cela fut terrible, insupportable et incompréhensible pour
moi. C'était comme si on m’avait passé une barre de fer rouge dans la cuisse,
j’étais attaché sur la table, une ceinture de cuir me passait sur la poitrine,
j’ai fini par la casser et me suis assis.
A ce moment, le major se mit devant moi pour que je ne voie pas
ma blessure. Je lui disais :
« Qu'est-ce qu’ils m’ont fait ? (et je voulais voir, lui disant
que j’avais bien le droit) ».
Alors,
il me dit :
« Tu veux voir, eh bien regarde ».
Le pansement était à moitié défait, j’avais une plaie large
comme les deux mains. Les chairs repoussaient à travers le pansement et je dis
au major :
« Qu’est-ce qu’ils m’ont
charcuté ».
Le major me répondit :
«Ils t’ont drôlement arrangé.
Ton pansement est en bonne voie, il n’y a pas d’humeur, on ne va pas continuer
».
Quel soulagement pour moi, je ne perdais rien pour attendre.
Le lendemain, j’étais évacué par péniche à Amiens.
Une rencontre dans la péniche
Par des camarades, et aussi ce que j’avais vu, je savais que
nous avions eu beaucoup de tués et blessés la journée du 12 août, à la prise de
Maurepas. Bon nombre de mes camarades avaient été tués, dont TIÉNOT qui était
encore debout lorsque je suis tombé.
Pendant l’attaque, un bon camarade nommé Vignat, qui était de Lyon, et qui venait de prendre une balle
dans un bras et qui partait pour l’arrière me souhaite :
« Bonne chance » et à l’instant même, tombe et
dit :
« Oh ! les salauds, ils viennent de m’en
mettre une autre dans le flanc ».
Le capitaine (Arthur) Dumas, vétéran de 1870, tombe, la cuisse
traversée. L’infirmier nommé Léguier
le pose sur un brancard, quand arrive une rafale de
mitrailleuse le touchant à la tête, il a eu encore la force de dire :
« Je suis heureux, je meurs
pour la France » (*)
L’aspirant (Jean) ROSET, de Lons-le-Saunier, laissé pour mort
sur le terrain : le sang lui sortait par la bouche et les oreilles, et combien
d’autres. A sa descente des lignes, il restait 23 survivants à la 9ème
compagnie.
J’étais donc installé sur un brancard étagé du haut et
j’entendais causer. N’en croyant pas mes oreilles, puisqu'il était mort, il me
semblait reconnaître la voix de TIÉNOT, en dessous de moi, je vois un gars
barbu, la figure encore pleine de sang, avec une culotte d’artilleur et une
espèce de képi de pompier. Je me
dis :
« Ce n’est pas lui, puisqu'il est mort ».
Un instant après, je r’entends la voix de TIÉNOT et je dis tout fort :
« Y a pas, c’est bien sa voix ».
En entendant ma voix, il me regarde et nous nous reconnaissons
en pleurant :
« Moi qui te croyais mort, on a retrouvé les restes de ton équipement, tes musettes de grenades ont sauté et tous ont cru que tu avais sauté avec ».
Il me raconte la fin de l’attaque.
La mort glorieuse de Tolet, le parisien qui jouait du piano à
Verdun. La dernière résistance des boches dont j’ai vu les prisonniers. La mort
de l’un d’eux qui l’avait manqué 3 fois de suite et lui avait traversé deux
fois sa toile de tente, sur l’épaule.
Lui, TIÉNOT, n’avait plus de balles dans
son fusil et, chaque fois qu’il faisait un mouvement, il recevait un coup de
fusil ; quand ils ont du se rendre, il s’était dressé
devant lui en faisant : « Camarade », implorant la pitié, TIÉNOT lui aurait
laissé la vie sauve s’il ne lui avait pas dit qu’il était officier :
« Ah ! Toi officier, c’est donc toi qui est l’auteur de la mort de tous mes camarades. Eh bien ! ‘pan’ tant pis pour toi ».
Très heureux de nous retrouver en vie tous deux, nous avons eu
une pensée pour tous nos camarades tombés sur ce champ de bataille.
Particulièrement pour l’aspirant (Jean) ROSET qui nous aimait bien tous deux et
que nous aimions bien aussi.
TIÉNOT avait reçu une balle dans la main droite, lui coupant
deux doigts et traversé un troisième.
(*)
: Arthur Isidore DUMAS, capitaine et commandant du 3ème bataillon, mort pour la
France le 12 août 1916 au bois de Hem. Il avait 66 ans…
Il
est inhumé à la nécropole nationale de Maurepas, tombe 981. Lire
ici, la citation élogieuse sur le JMO du 44e RI
(**)
: l’aspirant Jean ROSET n’est pas mort ce jour-là.
Blessé très grievement à la poitrine, il survivra et
intégrera le 35ème régiment d’infanterie en 1917. Blessé à nouveau
très grièvement (jambe droite emportée par un obus), il décédera à l’ambulance
de Saint-Clément (54) en mai 1918. Voir
sa fiche.
Arrivée à Amiens
A l’arrivée de la péniche, il y avait un tri, blessés couchés et
blessés debouts. Nous étions donc destinés à être
séparés.
Mais TIÉNOT a dit au major que nous étions cousins. Vu le grand
désir de n’être pas séparés, le major, bon garçon, s’est laissé faire, nous
avons donc été dans le même hôpital complémentaire.
Une grande souffrance partagée
Le lendemain matin de notre arrivée, il fallut aller au
pansement. Il y avait deux majors et infirmiers. Pour TIÉNOT, cela consistait à
lui couper deux doigts et pour moi, à refaire mon pansement. Quand j’y repense,
il me semble avoir encore mal.
Un infirmier humectait le pansement et le major le décollait.
Les chairs étaient déjà repoussées à travers le pansement et comme ce n’était
pas assez mouillé, il arrachait tout, je poussais des hurlements et, comble de
bonheur, l’infirmier laisse couler sa bouteille d’éther où il ne fallait pas,
c’est tout juste si je ne criais pas : « Au
feu ! »
Et pendant ce temps là, ils coupaient les
doigts à TIÉNOT et, malgré sa souffrance, il me criait :
« Souffle, Tonton, souffle ».
Quand
ce fut terminé, les majors s’adressent à lui, lui disent :
« Tu l’aimes donc bien ton cousin. Je ne te faisais pas mal
? »
« Oh si ! mais pas tant qu’à lui ».
Quelques jours après, ce fut la séparation, lui partait assis
pour la Normandie, et moi, je fus destiné à Paris (Courbevoie).
Arrivée à Courbevoie. Hôpital complémentaire, 12 rue de la Montagne
Très bien reçu, affecté dans une belle chambre à 3 lits. De très
gentilles infirmières, protestantes, affables et adroites, de vraies
infirmières.
À mon arrivée, j'étais le benjamin, le plus jeune, premier de la
classe 16 dans l’hôpital. Une fois en place dans mon lit, l'infirmière
m’apporte à manger, ce n’était plus les haricots rouges, mais du rôti de veau,
frites et salade. Il y avait bien longtemps que je n’en avais pas mangé, et je
dis à l’infirmière :
« On mange de la salade ici ? »
« Oui, qu’elle me dit, vous l’aimez ? »
« Oh ! oui. - En voulez-vous encore
? »
Réponse
: « Je n’ose pas ! »
« Je vais vous en chercher encore ».
Après
m'être bien restauré, je me sentais heureux mais...
« Eh bien ! Maintenant, on va faire votre pansement. »
« Oh ! non, mademoiselle, pas
aujourd’hui, ce n’était pas la peine que je me trouve si heureux ! C’est
terrible pour moi les pansements.
« Mais, tranquillisez-vous, je ne veux pas vous faire mal »
Réponse
: « Je connais la chanson ! »
Et, sans plus s’occuper de moi, elle commence à défaire le
pansement.
A un moment donné, je sens un petit picotement et je lui dis :
« Voilà que çà commence. »
Pas
du tout, qu’elle me répond, c’est fini.
« Oui ! oui ! je
connais. »
« Mais, regardez... »
Effectivement,
c’était fini, je n’en croyais pas mes yeux. Je lui dis :
« Pour un rien, je vous embrasserais »
« Eh bien ! allez-y ».
Ce que je fis d’un bon coeur. Elle
s’appelait mademoiselle GUIGUET. Elle était extrêmement gentille et très
adroite. Plus tard, elle maria un amputé d’une jambe.
Je suis resté trois mois dans cet hôpital, et, sortis de l’hôpital,
nous pouvions y venir manger tous les dimanches. De Courbevoie, je suis rentré
au Grand Palais, à Paris, qui était transformé aussi en hôpital, je suivais un
traitement par application de sel de radium 2 heures par jour sur ma blessure.
C’est au Grand Palais que j’ai commencé d’apprendre le métier de
coiffeur. Nous y étions bien soignés et bien traités.
Conseil de réforme
J’ai passé un premier conseil de réforme à Clignancourt.
Proposé pour la réforme, j’en suis sorti « service
armé » affecté au 5ème régiment d’artillerie à Besançon. Ne pouvant faire
le service, après avoir récolté 15 jours de prison pour absence illégale, j’ai
été envoyé au Casino, qui était à cette époque hôpital complémentaire,
Après un traitement d’un mois, et un mois de congé, j’ai repassé
une commission de réforme où j'ai été affecté dans la D.C.A. ; je suis parti à
Rueil, banlieue de Paris, et envoyé en renfort à Lure 15 jours ; ensuite j’ai
été muté dans un groupe de projecteurs à Chèvremont,
à côté de Belfort.
C’est là que l’armistice est venue me
trouver.
Après bien des péripéties, j’ai été démobilisé le 9 avril 1919 :
4 ans de services, jour pour jour.
À force d’avoir canulé un major, j’ai réussi à repasser devant
une commission de réforme à Gray et, malgré une lettre de recommandation, pas
en ma faveur de la part du major, j’ai été classé service auxiliaire pour
blessure de guerre, ce qui me permettait d’être démobilisé avec la classe 1914
: j’avais vu la circulaire sur un journal.
C’est de bon coeur, en voyant ma blessure,
que le commandant major a pris cette décision, sans passer devant la
commission, j’ai donc raccourci mon temps de service militaire de près d’un an.
Ainsi s'est terminée ma campagne 14-18.

![]()
Je désire
contacter le propriétaire du carnet de Gaston CHEVILLARD
Voir
sa fiche matriculaire (3 pages)
Voir
des photos du 44ème régiment d’infanterie
Suivre
sur Twitter la publication en instantané de photos de soldats 14/18
Vers d’autres témoignages
de guerre 14/18