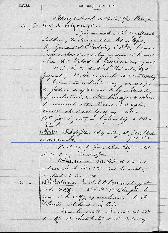Carnet de guerre 14/18 de DECAMPS Louis
Aspirant au 288ème RI
2ème
carnet, partie 1/2, année 1917
Apporter
une précision, une question sur ces carnets
![]()
Prélude
Dans
les pages précédentes, après être arrivé, à 18
ans au 288e RI, Louis monte pour la première fois en tranchées dans le secteur de Reims, le « pays des taupes ». Dans les
pages suivantes, il part pour Verdun, « comme des bœufs à l’abattoir »
Après sa première blessure, il repart secteur
Fay-en-Haye, pour ensuite intégré St Cyr, pour devenir officier. Il réintègre
son régiment qui se trouve dans l’Aisne dans la creute de
Rochefort, « l’antre du Cyclope ».
La bataille de la Malmaison se prépare…
![]()
Avertissement
Le
texte étant particulièrement dense, j’ai créé volontairement des paragraphes et
un sommaire.
Sommaire
très détaillé, car les écrits de Louis sont aussi très détaillés, très imagés.
Tous
les textes de couleur bleue sont des rajouts pour comprendre et expliquer
certains mots, certaines expressions, certaines situations.
La
lecture du carnet en est donc rendu beaucoup plus « digeste » avec
ses ajouts et les possibilités d’internet.
![]()
Sommaire
(n’existe pas dans le carnet)
Ø 1917
ü Retour au régiment,
dans l’Aisne
ü Arrivée dans l’antre
du cyclope
Ø 21 août 1917 : Les crêtes de Rochefort
ü Les anciennes sapes
allemandes, tranchée de la gargousse
ü L’ancien PC
allemand, tranchée de Scutari
ü L’hypothétique
attaque allemande, les consignes aberrantes, le bombardement
ü La sinistre tranchée
de la Gargousse
ü Les grenades
allemandes, l’inconscience du sous-lieutenant MAAS
ü La visite imprévue du
colonel : la boite de sardine
ü Les cours de formation
d’engins, mitrailleuses et canon de 37
Ø 22-23 septembre
1917 : Le coup de main allemand
ü Le drame du poste de commandement
de l’abri Scutari
ü L’imposante
cérémonie funèbre
Ø Début octobre 1917 : la
bataille de la Malmaison
ü La formation au
lance-flamme
ü La destruction de la
saucisse
Ø 18-19 octobre 1917 :
dans l'antre d'Ali Baba et des 40 voleurs
Ø 20 octobre 1917 :
La cacophonie du convoi régimentaire - La lente montée en ligne
Ø 22 octobre 1917 :
La veille de l’attaque - La
montée en ligne
ü Les planqués de l’arrière
: Qu’ils y viennent eux !
ü les abris allemands,
les prisonniers, avoir pitié
ü Le phénomène
psychique de la présence du chef
ü La blessure : les souvenirs
qui assaillent le cerveau
ü Le poste de secours, l’hôpital
1917
20 juillet – 23 octobre 1917
Retour au régiment, dans l’Aisne
Après un séjour de cinq mois à Saint Cyr (stage d'élève aspirant), je rejoins le centre d'instruction divisionnaire de la 67ème division, stationné à Maast-et-Violaine (Aisne) gros bourg constitué par deux villages dont l'un surplombe l'autre en corniche.
Le pays est vallonné riant et boisé.
La vie des troupes de l'arrière du front me reprend avec des altercations de longues heures monotones à flâner dans les rues ou la campagne à la recherche d'une âme féminine en peine ou bien à de longs exercices variés en groupe hétéroclite de poilus, qui d'un jour à l'autre se disperserons dans les unités actives du régiment ou mieux encore à s'égosiller dans de modestes cafés de campagne devant une bonne bouteille de bière fade, de vin blanc ou simplement d'un pot de cidre aigrelet qui incite aux congrues beuveries.
C'est une période de bon repos, de vie saine au grand air agrémentée pour moi d'une douce liaison sentimentale.
Une piqûre douloureuse para-typhoïdique qui me cloue pendant deux jours sur ma litière dans le grenier de mon amie, au milieu de mes hommes, me permet de mesurer ce qu'une sincère affection féminine peut avoir de bon, de tendre, dans de si douloureuses circonstances.
Combien j'étais heureux de la voir paraître au haut de l'échelle, dépassant la trappe de sa tête de jeune et jolie paysanne, qui me cherchait tout de suite du regard, craintive de mes voisins, un peu hésitante lorsqu'ils étaient nombreux et gouailleurs et pourtant quand même si hardie pour venir jusqu'à moi avec un gros bol de tisane, accompagné de bonnes paroles douces à m'émouvoir.
De bons mots qui apaisent la douleur et les malaises de ces piqûres que l'on ne cesse de nous prodiguer selon le bon vouloir des médecins.
Une visite de notre général de division SAVY interrompt brusquement notre douce quiétude en ces lieux, brisant irrémédiablement ma délicieuse idylle, trop belle en ces temps troublés.
« Vous êtes jeunes »
nous dit-il
« Et les régiments ont besoin
de vous, de votre entrain, de votre courage. Votre tour est venu de commander
des hommes au feu. Vous devez vous montrer dignes de vos aînés ».
Deux jours après, il faut quitter Maast-et-Violaine en laissant bien des regrets et en emportant de biens tendres souvenirs. Les adieux faits au petit jour furent touchants.
La division est au repos dans les environs de Soissons et mon régiment cantonné à Muret-et-Croute à 8 kilomètres de Maast.
Je suis affecté à la 19ème compagnie de mon ancien bataillon, avec pour capitaine l'abbé BESSEDE du Gers. La compagnie est installée dans une grande ferme à Neuville-Saint-Jean à 1 kilomètre au sud est d'Hartennes, gros bourg à cheval sur la route de Soissons.
Après une rapide présentation au capitaine et aux officiers, je prends le commandement de la 2ème section. Beaucoup de mes hommes m'ont connu à la 17ème compagnie et plusieurs se dépensent pour m'installer une litière dans un coin de la grange qui nous sert de lieu de repos.
Partout le long des murs ou d'une simple barricade de planche d'étable, un fouillis d'équipements, de sacs et de fusils, d'hommes qui dorment écrivent ou jouent aux cartes dans un clair obscur d'étable.
Pour rejoindre ma place je ne cesse de buter contre des obstacles indistincts, lorsqu'il ne me faut pas enjamber des dormeurs.
J'ai beau me trouver dans mon ancienne famille du front, rouvrir les souvenirs communs qui ont précédé mon départ de Bois-le-Prêtre, écouter attentivement les faits divers ou faits d'armes qui l'ont suivi et notamment l'émission de gaz chlore suivi d'attaque effectuée par les Allemands entre Flirey-Regniéville et Regniéville le jour de pâques 1917, une sorte de gaucherie inexplicable, une émotion indescriptible m'étreignent.
Ce n'est pas que je me trouve trop dépaysé, mais cette nouvelle vie qui s'ouvre pour moi avec la lourde responsabilité d'avoir à mener des hommes au combat, de ménager leurs forces et surtout leur vie, de savoir leur demander au bon moment ou le coup de collier ou le sacrifice de leur être, la nécessité de les aider à oublier leurs misères, ce qu'ils ont laissé au pays, atténuer par les bons mots les petites misères du front et de l'arrière front, me semble pleine de difficultés.
Quelques heures de fraternisation avec les camarades sous-officier de la compagnie suffisent à calmer mes appréhensions, d'autant plus que le chef de popote coupe court à nos propos, en nous invitant à nous réconforter à la popote, si l'on peut appeler ainsi une soupente pleine de toiles d'araignées dans laquelle un cuisinier et un serveur nous ont aménagés sur des billots ou à même le sol une ou plusieurs tables sur lesquelles sont posées des assiettes et des quarts en fer blanc.
Je prends mon repas avec l'adjudant de la compagnie, bon bougre de paysan marbré, le sergent major, comptable dans le civil et le sergent chef de popote, joyeux bon vivant intarissable de paroles.
Rien n'est aussi gai qu'une popote de sous-officiers. (*)
Chacun se met à l'aise et les conversations pas toujours très raffinées mais toujours intéressantes à suivre. On cause de tout ce que l'on a fait, de ce que l'on fera, des femmes surtout.
Les rires fusent à chaque propos gai.
Le menu n'est pas très varié.
A la guerre on n’a pas toujours ce que l'on veut et la viande frigorifiée est souvent difficile à préparer soigneusement. Le sergent bon enfant présente gauchement ses plats, un grand plat de fer blanc qu'il tient à deux mains.
Sur interpellation de chacun, il verse avec un bidon de deux litres, de nombreuses rations de vin.
Assis ou couchés dans
des pauses pittoresques, le repas s'achève sur une large ration de café, arrosé
de la traditionnelle « gnole ».
(*) : Le grade d’aspirant étant
considéré non-officier, Louis mange donc à la popote des sous-officiers.
Notre installation dans cette ferme sera d'ailleurs de courte durée.
Dès demain, la division monte en ligne on ne sait où et l'après-midi doit être entièrement consacrée aux préparatifs de départ.
Pendant que les hommes s'occupent et vers 14 heures, nous décidons entre sous-officiers d'aller faire une petite virée à Hartennes-et-Taux, histoire d'oublier nos préoccupations guerrières ou de découvrir des lieux et des gens très hospitaliers.
Peu de temps après nous déambulons dans les rues du village, épiant de ci de là pour tâcher d'apercevoir derrière les carreaux, une ravissante tête féminine, sur laquelle à la moindre alerte glissent tous nos regards, s'épanouissent nos sourires.
Il en faut bien peu dans certaines circonstances.
Hélas, les bonnes rencontres sont rares dans ce pays si prés du front et il ne nous reste plus après maintes allées venues, que la ressource d'explorer les deux petits cafés du village plus accueillants. Nous y buvons du vin blanc, du vin rouge en compagnies de jeunes ou vieilles « cabarières » pas farouches et surtout très commerçantes. On n'y réfléchit pas trop; on dépense et on boit en se berçant d'illusions. Tant et si bien qu'à la tombée de la nuit, nous rentrons au cantonnement légèrement gais.
La soirée se passe sagement à deviser dans nos granges
Ont se couche ensuite vautrés dans un immonde débris de paille, roulés dans une couverture, aspirant au repos pour mieux supporter les fatigues de la montée en ligne.
20 août 1917
Date
théorique (car non-indiquée sur le carnet), d’après la corrélation avec le JMO
L’arrivée en secteur
Le lendemain matin de très bonne heure, les yeux encore bouffis de sommeil, nous embarquons rapidement sur des camions à la sortie d'Hartennes sur la route de Soissons.
Pendant des heures notre caravane s'échelonne en un long ruban de poussière blanc sale au roulement monotone.
Depuis 10 heures, la chaleur est extrême; on boit souvent et les bidons se vident.
Le moindre arrêt ou à coup dans les villages, est utilisé par les débrouillards pour remplir à la petite épicerie café rurale, les bidons de tout le camion. Si la caravane part à l'improviste, ils trouvent toujours le moyen de monter sur les camions suivants et de rejoindre leurs amis au prochain arrêt.
Je puis dire que nous n'avons pas manqué de vin blanc pendant tout le trajet ; c'est drôle ces pays font peu de vin rouge.
Quelques poilus débarquent des camions, bravant les lois de l'équilibre, au risque de se rompre les os sur la route, lancent des lazzis (*) aux paysans au travail dans les champs, aux villageois curieux.
Ce sont les plus gais de notre bande, à peine reconnaissables sous la couche de poussière qui les couvre, ils chantent, sifflent, distraient toute la compagnie. C'est heureux, car le voyage est long et coupé de cahots, mais ils sont extrêmement remuants. Placé prés de la sortie, je reçois maints frôlements brusques de bidon ou de musettes, de chocs de casques tombés, à chaque ressaut violent du véhicule.
Je le supporte allègrement.
(*) : Plaisanteries
moqueuses
Vers 15 heures, notre camion s'arrête brusquement à la sortie du village de Chassemy. Nous sommes arrivés.
Un officier appartenant à la section automobile suivi des officiers de la compagnie, nous invite à sauter à terre. Déjà des camions précédents les hommes ont surgi s'équipant tant bien que mal sur le bord de la route, le sac et le fusil entre les jambes.
Nous sommes tous plus ou moins couverts de poussière.
On ne distingue plus nos yeux tellement les cils et les sourcils sont couverts d'une épaisse couche compacte agglutinée chez certains.
Le temps de se secouer un peu pour se dégourdir les jambes et on court au rassemblement qui a lieu à quelques centaines de mètres en lisière d'un grand bois, pendant que les camions dans un grand bruit trépidant, rebroussent chemin nous abandonnant à notre triste sort.
Des habitants de Chassemy venus en curieux, nous apprennent que nous sommes à quelques kilomètres de Vailly.
Après un bon quart d'heure d'attente au soleil dans le fossé de la route, nous pénétrons dans le bois, où il nous est ordonné de former les faisceaux, de nous reposer et de manger en attendant la chute du jour.
On se repose donc, on mange, on boit, on dort, on parle surtout par paquets sympathiques dans les buissons. Plus au Nord et pas bien loin, le canon tonne et un roulement puissant se répercute jusqu'à nous.
Des coups sourds partent même à quelques centaines de mètres. Il fait une chaleur intense.
Ces heures que nous passons comme des êtres d'un autre âge, plus près de la nature sauvage, sont vraiment angoissants, malgré une sorte d'inconscience faite de résignation.
Où nous serons ce soir ?
A quoi nous destine-t-on ?
Les officiers ne sont pas plus renseignés que nous.
Cependant vers 18 heures, des hommes partis en reconnaissance vers Chassemy, rapportent qu'un bataillon du 283ème occupé la veille à des travaux dans les tranchées de 1ère ligne du Chemin des dames, garnison des chasseurs de la 66ème division de Chasseurs a dû aider ceux-ci à repousser avec succès une attaque allemande.
Ce bataillon a été effectivement cité à l'ordre de la 66ème division de Chasseurs général BRISSAUD-DESMALLET pour cette affaire avec le motif suivant :
« 6ème bataillon du 283ème RI. bataillon très discipliné et
travailleur, malgré de violents bombardements a travaillé à l'organisation d'un
secteur particulièrement important. A contribué au succès des contre attaques
de la 66ème division dans la nuit du 9 au 10 août 1917 en repoussant une
attaque dirigée sur son front et en infligeant des pertes considérables à
l'ennemi ».
D'ailleurs peu après cette nouvelle, notre chef de bataillon rassemblait les commandants de compagnie et leur disait l'ordre d'opérations indiquant l'itinéraire pour monter aux lignes, région du Chemin des Dames – secteur du Nord-Ouest du ravin d’Ostel.
Nous relevons les Chasseurs et ma compagnie reste en réserve aux crêtes de Rochefort.
A 19 heures 30, comme le jour commence à tomber le bataillon est rassemblé ; les derniers ordres donnés nous nous dirigeons sur Vailly en longeant des haies et des murs par sections à bonnes distances. Nous rentrons dans la zone de tir d'artillerie ennemie ; la guerre commence pour moi.
La traversée de Vailly se fait dans le plus grand silence. Peu de soldats dans les rues, très peu de maisons démolies. Sur une place nous tournons à droite et nous engageons sur la route de Chavonne et d'Ostel.
Le canon tonne sans cesse ; un roulement entretenu secoue le vallon d’Ostel dans lequel nous cheminons bientôt par une nuit très claire.
Les bosquets qui bordent la route prennent des airs mystérieux.
Avec l'imprévu du nouveau secteur, nos imaginations fantasques semblent y craindre une horde d'êtres malfaisants hostiles.
Sur notre droite sur les croupes nord de Chavonne des éclairs partent dans l'obscurité comme des jets de lumière d'un blanc rougeâtre, un intense aboiement interminable des 75 cachés dans les broussailles.
Dans le silence impressionnant qui suit chaque salve on n'entend plus que le bruit métallique des fourreaux de baïonnettes heurtant les crosses de fusil, le froissement des sacs et des musettes sur les capotes, le frottement cadencé des semelles de souliers sur le sol.
De temps à autre s'ajoutent des sifflements sinistres et les éclatements de gros obus allemands qui cherchent nos batteries dans les futaies à moins de cent mètres.
Nous marchions ainsi depuis deux ou trois heures, lorsqu'à un carrefour de chemin, un léger arrêt se produit.
Des guides des bataillons de Chasseurs appellent à voix demi étouffées les numéros de compagnies pour la relève. Ma compagnie fait encore quelques centaines de pas sur la route, puis s'engage sur une croupe raide au travers d'un terrain tourmenté sur laquelle est située la croupe de Rochefort notre nouvelle résidence provisoire en réserve du régiment.
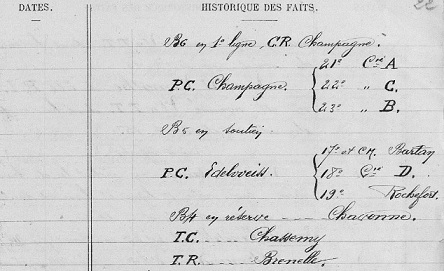
Extrait
du journal du 288e RI du 20 août 1917
On y
lit que la 19e compagnie était bien positionnée à « Rochefort »
Arrivée dans l’antre du cyclope
Il fait nuit, accroché à l'équipement de celui qui me précède, je pénètre par une petite ouverture dans une véritable caverne de brigands très sombre parsemée de lueurs pâlottes qui nous font paraître ces lieux encore pus mystérieux.
Chacun se laisse placer docilement contre une paroi rocheuse et humide et sans ordre se débarrasse de tout son barda.
On s'assied, on se couche et on attend. On allume des bougies et le plafond nous apparaît très haut. Ma section a droit au repos et est chargée de garder le matériel; les autres sections sans avoir le temps de songer à la détente, sont déjà chargées de travaux et de corvées à l'extérieur.
J'essaye de me reconnaître dans cet antre de cyclope, mais je butte sans cesse contre des obstacles et me résigne de peur de tomber dans quelque trou, à songer au repos et au sommeil surtout.
Près de nous une machine à écrire marche sans cesse.
Quelque P.C de grand chef est près de nous. Le tapotement régulier du clavier achève de nous bercer et déjà quelques ronflements sonores échauffent un air lourd de cave humide aux murs moisis. Des hommes agents de liaison sans doute, passent souvent l'ouverture et se dirigent comme des gens très à l'aise dans ce sépulcre, vers des coins mystérieux plus éclairés, une vive lumière épousant des pentes grossièrement taillées dans le roc.
A la pointe du jour, les sections rentrent avec une terne lumière blanche qui nous éblouit. Un véritable capharnaüm emplit notre caverne qui résonne intensément.
Bruits de ferraille, de matériel jeté à terre, de voix sépulcrales.
A côté dans le recoin de la machine à écrire, on prie avec véhémence de modérer le chahut. On apprend ainsi que le poste de commandement du Colonel est derrière une barrière d'énormes pierres.
Avec peine cependant, le bruit s'atténue.
21 août 1917
Date
théorique (car non-indiquée sur le carnet), d’après la corrélation avec le JMO
Les crêUtes de Rochefort
Avec le jour, je puis faire une petite reconnaissance des lieux. Nous sommes dans une carrière de pierre tendre comme on en trouve dans tout le Soissonnais.
A l'ouverture un énorme effondrement de grosses pierres datant de notre attaque d'avril 1917, aurait enseveli, d'après les dires des Chasseurs, quelques douzaines de boches ; c'est à qui expliquerait l'odeur nauséabonde qui se dégage de notre abri.
Un large tour d'horizon sur la vallée et la route d’Ostel que nous surplombons, me fait reconnaître la croupe de Chavonne qui nous cache la vallée de l'Aisne et le canal et au delà l'énorme massif opposé de St Mard et les communes de Presles et Boves – Brenelle.
Nous sommes à contre-pente et il faut faire une cinquantaine de mètres sur la droite de notre crête pour apercevoir les lignes du haut du ravin d’Ostel. Seules les positions de soutien sont visibles, les lignes allemandes étant dans une dépression de terrain, sur le Chemin des dames en avant de l’Ailette. (*)
Cette oisiveté ne me pèse pas longtemps.
Le capitaine me fait appeler et m'entraîne avec ses sous-officiers vers une position de résistance du Chemin des Dames entre l'Epine de Chevrigny et le Panthéon. C'est là que pendant quatre nuits nous devrons faire des travaux défensifs. Nous prenons au travers du chemin toujours à découvert.
Le secteur paraissant très calme pendant ces premières heures de la matinée.
Les tranchées
sont occupées par des poilus des 18ème et 19ème compagnies et par les
Chasseurs. J'ai l'heureuse surprise de retrouver dans une tranchée de soutien,
un de mes anciens camarades de la classe 1916 à Mirepoix, sergent des Chasseurs
(**)
et parti en juillet 1916 pour faire partie d'une équipe de skieurs, de
plusieurs amis Palois ou Tarbais (***), présents au régiment et je regrette
beaucoup de ne pouvoir leur serrer la main.
(*) : Rivière, affluent de l’Aisne
(**) : C’était des hommes du 46e bataillon de Chasseurs
(JMO)
(***) : Habitants de Pau et Tarbes
Fin août 1917
Pendant quatre jours, chaque nuit munis de pelles et de pioches, de fils de fer barbelés, nous complétons l'organisation des éléments ébauchés et chaque soir devant nous, sur nous, ou au loin surtout vers le plateau de Craonne, nous assistons béats à de véritables feu d'artifice plutôt dangereux.
Du côté de Craonne tout particulièrement, il y a des heures ou dans le noir tout s'embrase. Des fusées de toutes couleurs montent en importantes sorties de terre projetées violemment dans les airs. On les sent lutter contre une force qui résiste à leur glissade, des éclairs innombrables d'explosions faibles ou puissantes ; un roulement de tonnerre secoue la terre jusqu'à nous.
Les journées faites de détente et vouées en partie au repos nous pèsent. On ne dort que quelques heures.
Lourdement la guerre pèse sur nos nerfs et dès le réveil on mange et on circule aux abords de l'antre, malgré la présence de « dracheurs » ballons d'observations allemands qui se balancent doucement très haut dans le ciel, au loin vers Laon.
Des croupes de Rochefort, nous allons reconnaître le secteur de première ligne que nous devons occuper demain à la tombée de la nuit.
Nous partons par une matinée de brouillard très opaque et remontons vers un plateau où nous coupons en sautant d'un bord à l'autre les tranchées de la seconde position. Parfois une simple planche branlante faisant office de pont, nous permet de passer plus facilement.
Les boyaux sont surtout très profonds ; certainement plus de deux mètres.
Les anciennes sapes allemandes, tranchee de la gargousse
De temps en temps, une vieille sape (abri enfoncé dans le sol) attire nos regards. On s'y attarde même pour tâcher de la faire parler : cadres vermoulus ou brisés par des éclats d'obus, lambeaux d'étoffe fortement imprégnés d'une boue verdâtre, ciel de bois défoncé on ne saurait dire par quoi !
Ce sont les vestiges de l'occupation allemande d'avant avril 1917, anciens abris de batterie – P.C ou poste de liaison.
Dans bien des cas les rondins qui recoupent ces abris sont à nus par endroits ; ils sont même très vermoulus et mis à mal par les intempéries, les pluies surtout.
Le bois est couvert de champignons, sorte de lèpre blanche spongieuse. La terre tombée sous l'ébranlement des explosifs bouche en partie l'entrée de ces sapes.
Elle n'est même pas tassée et des milliers de sortes de petits godets, petits trous produits par les gouttes d'eau tombées des rondins, sculpte cette masse uniforme de terre. Je me laisse aller à mes réflexions et pense longtemps que des drames obscurs ont du se dérouler là !! ...
A droite en bordure du plateau, notre regard embrasse le ravin de Certaux, vaste dépression désolée qui aboutit au ravin d'Ostel plus large et encore plus désolé sur ses pentes est avec une lignée d'arbres estropiés.
Celle-ci borde un semblant de piste dont on aperçoit des tronçons de traits blancs qui semblent briller au soleil sur cette terre bouleversée et d'un gris sombre. Quelques obus allemands la cherchent ; ils arrivent avec un sifflement brutal qui nous fait courber l'échine. Les explosions encadrent notamment trois arbres isolés, derniers probablement de la lignée, à mi-chemin entre elle et les premières tranchées.
Nous sautons prudemment dans un boyau d'évacuation. Nous ne sommes plus très loin des tranchées de soutien qui courent à flanc de coteau à contre pente.
Bientôt nous débouchons dans l'une d'elle d'où un poilu Chasseur veut bien nous accompagner au poste de commandement de son capitaine. Le secteur est calme à cette heure et nous rejoignons le PC par un dédale de petits éléments de tranchées ou boyaux de quelques mètres.
Contours à droite, contours à gauche et nous voilà arrivés. Un jeune capitaine des Chasseurs nous reçoit très aimablement, s'offrant à nous faire visiter son secteur :
« Ici, nous dit-il, vous
êtes dans la tranchée de Scutari et mon secteur, qui va être le vôtre,
est à cheval sur le boyau du Négus, élément qui mène à la tranchée de
la Gargousse ligne avancée extrême et qui finit au fond du ravin d'Ostel,
desservant le PC du bataillon niché avec un poste de secours au centre Est du
ravin ».
Sous sa protection nous cheminons avec une providentielle quiétude dans tous ces lieux, non sans avoir la chair de poule aux effrayants récits de combats récents, attaques et contre-attaques.
« Nous arrivons »
dit le capitaine
« Dans une période de 24
heures de calme »
Les boches reprenant certainement haleine après les échecs de la veille d'ailleurs suffisamment marqués sur le terrain par un impressionnant spectacle de cadavres allemands fraîchement tués, abandonnés en terrain découvert ou constituant même en certains points, la masse du parapet de la tranchée de la Gargousse, d'où dépasse un bras, une jambe, un soulier.
On voit que la tranchée a été rapidement ébauchée avec n'importe quoi.
De certains points choisis du terrain, nous dominons la ferme de la Rozère, le Chemin des Dames situé à moins de 50 mètres, la vallée de l'Ailette, le fort de La Malmaison et pouvons admirer amèrement tout le panorama de Laon et des villages avancés Monampteuil etc. etc. qui s'étagent comme des nids d'aigle sur les contreforts d'un massif abrupt sur l'Ailette et du fort de La Malmaison jusqu'à Craonne.
De l'ouest à l'est ma section doit rester en soutien dans la tranchée de Scutari à cheval sur le boyau du Négus.
Je me réserve de pouvoir mieux examiner tous ces lieux après la relève et les jours suivants.
Deux alertes d'attaque et voilà mon premier contact au Chemin des Dames. Il y a à peine une heure, en pleine nuit, que je suis installé avec ma section dans la tranchée Scutari où je m'efforce de me reconnaître.
Un adjudant des chasseurs alpins m'a rapidement passé les consignes, mené d'un bout de secteur à l'autre et s'est évanoui avec ses hommes en quelques secondes dans le boyau du Négus en route vers l'arrière.
Par cette nuit très noire, tout me paraît fantastique et avec cela les boches paraissent si nerveux, nous harcèlent sans cesse de rafales d'obus, de tourterelles (petites bombes à ailettes) de tirs de mitrailleuses et de coups de fusils isolés.
Par endroits la tranchée ou les traverses ont disparu écrasées par les obus et ne sont qu'une longue suite de sinuosités dont l'un des parapets en remblai vers les boches est en large déblai de l'autre, avec cependant quelques passages bien abrités. Je m'inquiète plutôt du service de garde placé et des consignes qui m'ont été données dans la journée, que de l'état de mon organisation. Je réfléchis notamment dur les instructions concernant la tranchée de doublement de la 1ère ligne, sur laquelle je dois me porter en cas d'attaque ennemie. Elle est à 50 mètres en avant de nous et immédiatement derrière la tranchée de la Gargousse, première ligne à 150 mètres en avant.
Jeune chef de section et malgré mon expérience de poilu, je prends tout à la lettre tout en exagérant ma responsabilité dans tous les cas possibles et sans penser dans un premier envoi d'être livré à moi-même au milieu de l'algarade, que tout chef imbu de sa responsabilité doit tout d'abord garder son sang froid par incessante maîtrise des nerfs, en adoptant ses actes aux circonstances du moment.
Ne pas s'emballer et voir simplement pour ménager tout le monde en vue du but à atteindre qui est ici un but défensif. Ces premières armes de chef me serviront de lien, très vite.
L’ancien PC allemand, tranchée de scutari
Me laissant encore aller à mes réflexions, je reviens vers mon P.C ancien abri allemand dont l'ouverture fait d'un cadre bloc de ciment armé, s'enfonçant profondément dans la terre, est tournée vers l'ennemi. Il est placé à 2 mètres à peine du croisement de la tranchée de Scutari et du boyau du Négus.
Avant de descendre dans l'antre de protection pour me mettre un peu à l'aise et rédiger le compte-rendu d'installation de la section, destiné au capitaine, je jette un dernier coup d'œil sur le seul élément de tir refait face à l'entrée de l'abri, bien aménagé, abrité des obus par le dos de la croupe en avant et à tâtons, je cherche à reconnaître tous les instruments de surveillance et de répétition des signaux de fusées de la 1ère ligne que l'on m'a particulièrement recommandé.
Pour me rendre compte s'ils sont bien en place en cas d'évènements imprévus ; IVB et revolver lance-fusées barrage, préparés à portée de main.
J'ajoute de nombreuses recommandations au caporal de garde pour l'envoi de signaux instantanés à la moindre alerte. Le secteur nous a été signalé comme très agité tous ces jours-ci, quoiqu'il l'ait toujours été depuis les premières affaires du Chemin des dames.
Ce chemin est situé à environ 200 mètres, c'est notre boyau futur.
Malgré de nombreuses attaques on n'a pas pu y arriver. Les boches essayent naturellement par les leurs, de nous en éloigner ; Ils y mettent même un jour plus d'hommes. Il est vrai qu'ils auraient intérêt à mettre la main sur la tranchée Scutari pour avoir des vues sur le ravin d'Ostel.
Il y a eu tous ces jours là sur les lieux que nous occupons, une série de combats à objectifs limités, derniers soubresauts de notre grande offensive d'avril 1917. La prise et la reprise de la tranchée de la Gargousse dont la possession est toute récente en est un des derniers épisodes.
Pour le moment, 5 heures du matin, tout est calme.
Quelques obus des 2 côtés tirés sans doute par des artilleurs qui s'ennuient; obus qui vont très loin et passent sur nos têtes avec un « vvvzzzzouiiiiiii ... » prolongé, comme une plainte. Nous nous tenons tout de même sur nos gardes, car il est très possible qu'au petit jour, une contre attaque allemande se déclenche au cas où ils ne serraient pas encore résignés.
La première section du sous-lieutenant VALETTE (*) est en première ligne à la Gargousse; c'est elle qui recevra le premier choc; la mienne la soutient en arrière.
En attendant je pourrai prendre mes dispositions de combat.
(*) : Le 28 août 1917 (au
Journal Officiel), le sous-lieutenant VALETTE est nommé sous-lieutenant à titre
définitif.
Vers 6 heures, l'aube s'annonce, et arrive à peine à blanchir un brouillard épais qui nous enveloppe en tourbillonnant, nous empêchant de nous faire une idée du terrain. Devant moi sur 20 mètres, la croupe qui monte en pente douce toute parsemée de petits cratères ou d'une multitude de mottes que le brouillard fait mieux ressortir sur son écran.
En attendant l'attaque problématique prévue par nos prédécesseurs, je décide de visiter l'abri aux 20 marches en ciment armé qui doit me servir de P.C et d'abri de protection pour mes hommes non occupés à la garde ou autres services.
Au bas des marches dans un four noir à peine troué par la lueur pâlotte d'une bougie, je tombe sur une cave d'environ 9m2 occupée d'un bout à l'autre par un large bas flanc garni de dormeurs sur compressés. Inutile dans ce fouillis de chercher une place; je me demande même dans quelles conditions en cas d'attaque tout ce monde pourrait sortir de ce traquenard, car les abris ne sont guère que des nids à prisonniers.
L'escalier donnant sur
la sortie, donne à peine le passage à un homme. Je laisse là mes réflexions et
n'ayant pas autre chose à faire qu'à attendre les évènements, s'il doit y en avoir, je pense à prendre quelque
repos. J'allais m'asseoir sur une des marches de l'escalier pour faire à la
lueur d'une bougie, mon compte rendu d'installation, lorsqu'une dégelée brutale
se sifflements puissants coupés par une série de violente explosions, secouent
l'abri, me rendant conscient de mes premières responsabilités de chef de
section.
L’hypothÉtique attaque allemande, les consignes aberRantes, le bombardement
Ces explosions m'attirent dehors en quelques bonds passant sans ménagement
sur des corps allongés. Dans mon cerveau l'attaque boche se précise déjà. Le
gradé de garde aux signaux, a vu une fusée rouge d'alarme de la 1ère section,
pâlotte dans le brouillard et il a repéré le geste qu'il confirme une deuxième
fois.
Ce n'était pas nécessaire car tout aussitôt une trombe de 75 en nuée
d'abeilles, sans cesse renouvelés passent à nous raser, rapides en un long
sifflement strident de glissade qui semblent vouloir nous percer.
Naturellement l'alerte est donnée à l'abri et l'arrivée apeurée
d'hommes à moitié endormis, arrangeant le désordre de leur tenue sur laquelle
l'équipement est pitoyablement arrimé, serait du comique le plus risible si
notre situation n'était pas aussi tragique.
Pendant dix bonnes minutes, il en sortira par groupes de deux ou trois, fusil à la main, caques de travers, à intervalles variables; c'est dire si les boches auraient eu le temps de nous coiffer et de ramasser ce lot pitoyable d'hommes fatigués de la relève.
Le corps ramassé, ils sortent affolés se faisant d'abord une place contre le parapet de la tranchée pour rejoindre ensuite leurs caporaux qui appelle le numéro d'escouade. Collés au parapet l'œil aux aguets, embrassant le terrain jusqu'à la limite visible du brouillard, attentifs à la moindre motte nous attendons l'évènement.
En quelques minutes chacun retrouve son calme et est prêt à vendre chèrement sa vie.
L'artillerie allemande se met vivement de la partie. Leurs obus s'écrasent avec fracas en projetant d'énormes masses de fumée en avant et en arrière de notre tranchée, heureusement protégée par un dos d'âne.
Pour mes premières armes de chef, je ne suis pas à la fête et mon premier acte est de suivre à la lettre les consignes données.
Mon monde rassemblé, nous nous portons à la file indienne par le boyau Négus dans la tranchée de doublement 50 mètres plus en avant sous un ouragan d'obus qui nous couvrent de terre en nous ensevelissant dans un épais nuage de fumée noire et acre. Rien de plus ridicule que ce transport en avant en pleine action.
Comment se défendre si nous étions surpris dans le boyau par la progression ennemie surgissant en terrain découvert, comme dans toute attaque. C'est nous amener dans la gueule du loup, sans compter les pertes laissées en cours de route.
Rester sur place eût été plus simple, afin de recevoir l'ennemie pour l'arrêter par le feu et la contre attaque ensuite pour lui faire rendre le terrain pris, avant qu'il ait eut le temps de s'organiser et de reprendre haleine ou bien occuper constamment cette tranchée de doublement où l'on a des vues sur notre ligne et sur la ligne allemande pour agir dans les mêmes conditions en cas d'attaque. On ménagerait ainsi les nerfs des hommes et on ne risquerait pas de désorganiser par des pertes et une situation difficile la cohésion nécessaire à une troupe pour agir.
Dans la tranchée l'unité est bien en main et il faut contre-attaquer ce qui est de mon devoir à l'approche des boches. Sur un seul commandement, sur un seul geste, c'est la ruée de tous pour surprendre et désorganiser l'adversaire à qui on n'a pas donné le temps de réfléchir sur sa nouvelle situation, l'assaillant ayant toujours l'avantage moral sur celui qui se défend.
Pourquoi ceux qui donnent de pareilles consignes ne viennent-ils pas se rendre compte des conséquences de leur imagination. Pour exécuter cette consigne, j'ai couru en tête de ma section pour entraîner tout le monde vers cette tranchée de doublement, sous une grêle d'obus qui s'écrasent de tous côtés.
Je suis assez heureux pour voir une partie de mes hommes arriver quelques secondes avant l'explosion en plein boyau, à une dizaine de mètres de ma tranchée, d'un gros obus qui s'écrase avec un long craquement abrutissant. Une tollé de gens qui tombent à mes pieds et d'autres qui s'engagent au dessus du boyau en terrain découvert pour me rejoindre et j'ai un monde dans la tranchée en dehors de deux d'entre eux, commotionnés et à demi-enterrés qui appellent et que je fais secourir rapidement.
Les hommes se collent au parapet d'une tranchée qui est plutôt un fossé sinueux, le fusil braqué, l'œil perçant les demi-ténèbres du brouillard dans une danse de pierres, de fer, de terre et de deux feux-follets furtifs, petits éclairs ne laissant qu'une fumée qui va se dilatant vers le ciel. Nous attendons le boche ; il ne vient pas.
Le tir ennemi s'allonge brusquement semblant tout écraser en arrière sur la deuxième position à mi contre pente que notre regard embrasse largement. Le brouillard s'y épaissit de plus en plus mêlé à la fumée intense et devient un rideau opaque et lourd.
Il n'y a pas de doute, cet allongement de tir précède l'attaque.
« Attention à tous et
courage ! »
36 corps se cramponnent au sol sous l'orage attendant le choc. Il ne vient pas ; c'est une fausse alerte.
Le bombardement devient de moins en moins intense. Le brouillard nous étreint toujours, mais les obus s'éclaircissent. Ils arrivent encore par groupes de quatre comme une trame tissée dans l'air, tirés par quelques centaines de pièces des deux cotés à plus longs intervalles en gliss-gliss-gliss puis le tir décidément s'atténue, perd en intensité, jusqu'à s'éteindre en partie ne laissant qu'à trois ou quatre pièces de ci de là, le soin d'envoyer à quelques secondes d'intervalle et successivement leur pluie ou cascade d'acier.
L'aube achève de blanchir le paysage tout autour de nous presque en blanc de lait, sans que le brouillard arrive à se lever. Par instants, une éclaircie vite bouchée par une nouvelle vague de vapeurs impalpables qui limitent brièvement notre vue. L'alerte est en partie passée. Avant de rejoindre la tranchée de Scutari et l'abri, je tiens à aller me rendre compte des évènements de première ligne à 120 mètres.
Dans le boyau sur ma droite une section de mitrailleuses occupe un abri à bon coffrage neuf, à deux mètres des premières lignes. Trois hommes sont à la mitrailleuse sur le qui-vive embrassant par une large embrasure, tout le terrain en avant à peine distinct dans le brouillard. Dans le boyau, un groupe de grenadiers le protège derrière un pare-éclats organisé défensivement, créneau oursin de barbelés sur le parapet prêt à boucher le passage en avant. Ils ne savent rien de ce qui s'est passé et ils attendent œil et oreilles attentives.
En première ligne, le lieutenant VALETTE a cru à une attaque. Les boches ont d'abord tiré à la mitrailleuse et au « minenverfer » (bombes à ailettes), puis seraient sortis de leur tranchée sans pourtant aborder nos lignes d'où un feu violent de mousqueterie était parti.
En résumé, beaucoup de bruit pour rien. On prend vite tout au tragique et on s'énerve encore plus vite.
Nouveaux dans un secteur encore très agité la veille, le passage de consignes sévères et le récit de la dernière attaque toute chaude marquée par le vue de cadavres fraîchement tués, cela fait travailler les imaginations de gens qui se sentent en plein inconnu terrain, intention de l'ennemi.
Le moindre bruit anormal, une brusque activité d'artillerie ou d'infanterie a suffi pour demander et déclencher les barrages.
Je regarde par dessus le parapet vers les boches et je ne vois que du matériel embrouillé de piquets en bois, en fer ces derniers tirebouchonnés de fils de fer lisse, barbelés, chevalets de frise.
A deux pas un cadavre à bottes d'allemand. Bon, ce n'est pas gai ! Devant moi s'installe une vaste dépression avec L'Ailette que l'on devine loin à droite et la ferme de la Rozère vers une ligne en hauteur à gauche.
Je rejoins ma section et la ramène à la tranchée Scutari par le boyau de Négus qui a légèrement souffert; il est comblé sur un mètre. Quelques hommes vont reprendre leur garde pendant que les autres se préparent à descendre dans l'abri pour se reposer, non sans commenter l'algarade de tout à l'heure.
Lorsque tout à coup une forte explosion isolée ou bombe et un cri aigu provenant des premières lignes, arrivent jusqu'à nous. Le cri est suivi d'une longue plainte déchirante et d'une vive fusillade.
A nouveau des fusées barrage rouges sont promptes à s'élever ; un rouge terne et blafard comme une supplication mourante qui exige d'agir vite. A moins d'une demi minute prés notre barrage se déclenche, sec et serré.
Le cri strident ces 75 hulule en trames épaisses sans cesse renouvelées, passages rapides à quelques secondes d'intervalles, laissant comme d'innombrables lignes vibrantes qui passent sur nos têtes à nous raser. C'est vraiment impressionnant.
Cette fois ci se doit être plus grave. Je suis tenté de suivre une consigne impitoyable ; aller à la tranchée de doublement.
C'est trop idiot !
Et je laisse mes hommes ressortir de l'abri dans la tranchée Scutari.
Au fur et à mesure qu'ils sortent, chacun trouve une place, sous-officiers et caporaux encadrant leurs hommes. Je donne l'ordre de tirer sur l'ennemi s'il apparaît et de se tenir prêt à contre attaquer. Devant nous le barrage boche fait rage, répondant au nôtre. Leurs obus tombent à quelques dizaines de mètres en avant et à cent, cent cinquante mètres en arrière de notre tranchée. Sur la gauche moins protégé par le terrain, quelques uns démantèlent le parapet faisant se serrer quelques poilus vers nous, un peu affolés.
Ils reprennent d'ailleurs vite leur place à nouveau, en possession de leur sang froid, vers les trous encore fumants, résignés à tout.
C'est merveilleux cette résignation de l'homme contre les forces qu'il ne peut pas conjurer, ou contre lesquelles il ne peut lutter à armes égales et qu'il est obligé de subir.
Le geste de fuir sous l'explosion qui vous étreint, vous secoue, est instinctif, involontaire, fait d'un réflexe violent; d'abord le geste de se coucher à plat ventre, rapide y cherchant à ne faire qu'un avant le sol, y rentrer même et l'instinct de conservation étant le plus fort, sortir de ce lieu infernal, fuir vers le coin plus tranquille qui au même moment où on arrive devient aussi infernal.
Il en est aussi partout de même dans le secteur et le voisin n'est pas mieux servi.
Autant rester en place et c'est la résignation de revenir à son poste un peu humilié en son for intérieur mais avec une force de plus, celle de n'avoir plus peur et de le montrer ; une sorte de sursaut de sa personnalité et de l'idée que l'on ne peut rien contre la destinée, contre le sort et contre ceux qui nous ont menés à la guerre, qui nous l'imposent, qui nous y tiennent et qui nous menacent constamment de foudres si nous n'agissons pas ou si nos nerfs ne résistent pas aux horreurs de la guerre, eux qui sont bien à l'abri et pour qui la guerre est un jeu, presque un amusement plein de jouissance.
Pauvres gens qui traînent le poids des années maudites, roulés dans la boue, dans l'eau, sous la pluie, la neige, la mitraille, livrés à mille engins de mort.
Le barrage boche s'allonge. Vont-ils attaquer ?
Je ne le pense pas, car c'est en fait nous qui avons commencé à déclencher le barrage. S'ils avaient attaqué, ils seraient déjà devant nous depuis l'appel de détresse de la première ligne.
Du point où je suis, je découvre en arrière le vallon qui aboutit à Ostel. A 50 mètres, la tranchée de deuxième ligne reçoit les obus de barrage boche. C'est une véritable ligne de fumée qui sort de terre comme soufflée brusquement et qui s'étend en longueur en s'élevant pour ne plus former qu'un lourd rideau dans le quel de nouveaux jets de poudre gris noirs se renouvellent sans cesse en épaississant le précédent, dans un fracas assourdissant et étourdissant.
Cela dure encore une dizaine de minutes pour enfin se terminer par un tir successif par batterie ; un sifflement léger et brutal de quatre obus, quelques coups espacés ensuite auxquels un calme effrayant succède trop brusquement, comme un vide immense, un quelque chose qui nous manque sans transition.
Je me remets encore une fois en première ligne avec deux hommes. Il n'y avait eu rien d'extraordinaire. Les boches avaient fait preuve d'une certaine activité il est vrai mais l'alerte avait été plutôt déclenchée par les cris d'un jeune caporal grièvement blessé par un « minen » allemand tombée en pleine tranchée de tir.
Le blessé est criblé d'éclats.
L'algarade passée, deux hommes essayent de le transporter au poste de commandement de la compagnie où des brancardiers lui donneront les premiers soins. Comme les autres, je lui prodigue quelques consolations. C'est pitié de l'entendre se plaindre.
La sinistre tranchée de la gargousse
Le jour est maintenant complet. Je fais plus ample connaissance avec la tranchée de la Gargousse que je dois occuper d'ailleurs dans quatre jours.
En bien des endroits ce n'est guère qu'un fossé. Des parois dépassent parfois un soulier ou un bras à main livide, collés à une terre gris vert cendre onctueuse. En un point une tête même est à demi visible reposant sur la joue droite coiffée du casque d'acier allemand ; la nuque et le menton sont complètement enfouis dans la terre ; une partie du visage sous le casque laisse entrevoir un œil demi ouvert d'un bleu vitreux terne sans expression, la chair de la joue gauche est à peine d'une teinte plus claire que la terre qui l'enlace.
C'est sinistre.
Nous en avons vu d'autres et sommes trop habitués à ce spectacle et un poilu de la section qui occupe la tranchée renchérit qu'il y a beaucoup de boches morts sur la tranchée et sur la plaine et que les Chasseurs en relevant leurs éléments de tranchée bouleversés en ont étayé les parois avec ceux qui s'y étaient aventurés et qu'une contre-attaque a surpris et tué.
Le chemin des Dames n'est pas loin, 50 mètres à peine. Il y a encore des poteaux télégraphiques qui le limitent. Un large coup d'œil par dessus le parapet me permet de contempler la zone neutre couverte effectivement de nombreux cadavres; paquets affalés ou recroquevillés.
Beaucoup sont pliés en deux la face contre terre. Je reviens au plus vite vers ma section pour rapporter des nouvelles. Du boyau du Négus on me montre le cadavre d'un allemand tué tout contre le créneau de l'abri de mitrailleuse. Le canon de celle ci débouche à quelques centimètres de cette masse informe dont on se garde d'y toucher. Ca ne doit pas sentir bon.
Plié en deux lui aussi une joue contre terre, il a l'air de vouloir saisir le canon de l'engin de mort.
Enfin je retrouve ma section. L'insouciance y est maîtresse.
L'algarade passée, chacun a repris sa place dans l'abri, sur les marches pour ceux qui n'ont pas de place à l'intérieur, ou bien dans la tranchée même enveloppés dans leur couverture. Ils sommeillent déjà fatigués par la nuit de relève.
Quelques uns, un tout petit nombre, mangent un morceau sur le pouce pour tromper la nervosité créée par les alertes ou tout simplement pour s'occuper à quelque chose en attendant de somnoler. Moi avec le jour, je reconnais d'abord mon domaine.
A quelques mètres de l'abri bétonné sur la droite en un point où la tranchée est très évasée et très basse, une botte de soldat allemand attire mon attention; un long tibia sec et lavé par la pluie, à la base duquel dans la botte adhérent des chairs vert-pale onctueuses qui disparaissent avec le pied.
Tout prés sur la plaine un attelage d'artillerie allemande déchiqueté, gît auprès du squelette d'un cheval. Les débris sont déjà anciens, ils datent du début de l'attaque en avril 1917. C'est un convoi d'artillerie ou même une pièce en fuite à la suite de notre avance, qui a du être surprise et détruite.
Sur la gauche la tranchée est par endroits très bouleversée; elle marque bien l'acharnement des chasseurs à s'y installer
Plus en arrière des tombes de troupes de Chasseurs
sont surmontées d'une petite croix de bois. Combien de temps vont-elles rester
là sous l'avalanche d'obus dont nous sommes gratifiés sans cesse. Après la
guerre, il est presque certain que les familles ne les retrouveront pas. Les
croix disparaîtront comme fétus de paille sous le premier obus.
Je passe des journées calmes dans l'abri cimenté. Les boches en avaient fait un vrai repère insoupçonnable.
Après une vingtaine de marches une chambre de 10 m2 environ disposant d'un puis d'aération de 1m de diamètre sur 5 mètres de hauteur, puis défensif qui débouchait sur un terrain environnant avec plate forme de mitrailleuse à peine aménagée pour battre le ravin d’Ostel et les pentes qui y aboutissent souvent.
Je m'installe à ce parfait observatoire auquel on accédait du fond de l'abri par des crampons en fer formant échelle, scellés dans le ciment. Que de mal a du faire sur nos braves troupes d'attaque, la mitrailleuse aussi bien défilée.
Pendant mes heures d'insomnie j'aimais grimper ces échelons de fer et m'installer à l'orifice pour méditer sur la valeur défensive d'un tel ouvrage et sur les drames qu'il a du provoquer.
Au bout de quatre jours mon tour vient de remplacer dans la tranchée de la Gargousse la section du sous-lieutenant VALETTE.
La veille dans l'après-midi, je reconnais en détail tous les éléments de défense de la 1ère ligne ; emplacements de FM (fusil mitrailleur) et parapets pour grenadiers les encadrant.
Mon fusil mitrailleur du centre occupera un vaste emplacement du Petit Poste interdisant à l'ennemi l'utilisation d'un boyau qui nous relie à lui. A sa droite et à sa gauche à 50 mètres d'intervalle, les autres F.M croisant leurs feux devant le front, ne disposent que d'un précaire emplacement grossièrement aménagé sur le parapet même de la tranchée.
De jour, deux sentinelles, une par demi section, gardent tout le secteur, mais la nuit tout le monde veille ou travaille du coucher au point du jour.
Le sous-lieutenant VALETTE me montre un large espace dénudé qui nous sépare des boches, c'est à dire jusqu'au Chemin des Dames, délimité par des poteaux télégraphiques, de nombreux cadavres d'allemands embrassant le sol d'une dernière et lourde étreinte.
Du corps de certains dépasse une petite marmite. Certains sont à portées de notre main, d'autres consolident le parapet de la tranchée et répandent une odeur nauséabonde à laquelle il faudra bien se faire. Leurs amis d'en face ne se sont même pas dérangés de nuit, pour relever leurs pauvres frères d'armes qui pourrissent sous le soleil d'août à quelques mètres de leur réseau.
La relève se fait vers 23 heures et les consignes déjà connues sont vite passées dans la nuit.
Me voilà maître et le grand responsable de 150 à 200 mètres du front. Ma section est à cheval sur le boyau du Négus à son débouché, sur la tranchée 50 mètres à droite, liaison avec le 220ème R.I, le reste à gauche liaison à 20 mètres avec la section du sous-lieutenant NAAS, 18ème compagnie.
Naturellement la première nuit se passe dans une sorte d'inquiétude comme à chaque arrivée dans un secteur nouveau, où l'ombre en avant de nous s'emplit de bruits mystérieux, où chaque heurt, chaque bruissement de la nature, du réseau de fils de fer en particulier, prend des proportions de velléités, de surprises effarantes.
Le regard, les oreilles sont sans cesse tendus vers les mille petits riens qui nous font brusquement sursauter.
Vers une heure du matin surtout, deux heures ou trois heures on n'en peut plus de sommeil. Les paupières deviennent lourdes, se ferment d'elles même et une difficulté quasi-insurmontable leur défend de se soulever et puis brusquement au travers des cils des ombres dansent, des formes s'agitent et l'instinct de défense reprend ses droits.
Les yeux s'ouvrent tous grands, veulent percer la nuit, saisir au vol des silhouettes entrevues, pendant que la main droite serre à l'écraser une grenade citron « foug » prompt à la percuter et à la jeter. Mais partout règne un calme parfait en dehors de quelques voisins qui toussent ou heurtent légèrement la paroi de la tranchée de leur masque ou de leur équipement.
Dans une sorte d'hallucination, les piquets du réseau, les cils même de mes yeux s'étaient transformés en autant d'ennemis menaçants et avaient avec le brusque réveil disparus comme des fantômes.
Ah ! Ces nuits de longue veille qu'elles étaient dures pour mon cerveau de 19 ans.
Les grenades allemandes, l’inconcience du sous-lieutenant MAAS
Toujours au moment de succomber au sommeil, j'en reconnais le pressant besoin par des rondes auprès de mes hommes qu'il fallait souvent secouer peiné de les surprendre et de ne pouvoir permettre un semblant de repos sommeil pris dans une telle position incommode, le corps ne faisant qu'un avec le parvis de terre, les coudes engagés sur le parapet formant appui, la tête enfouie dedans, le nez presque dans la terre ou sur le canon du fusil.
Que de fois mon pauvre fusil-mitrailleur CASTAING et si bon camarade de la classe 1917 ne t'ai-je pas cependant laissé dormir le nez dans ton engin et que de fois toi-même as-tu veillé pour moi !
Des fois, n'y tenant plus et au mépris des consignes, vraiment stupides, ne me suis-je pas affalé quelques minutes pour tomber dans un sommeil de plomb d'où mon pauvre voisin CASTAING avait ordre de me tirer sans ménagement.
Parfois, pour passer le temps et rompre la longueur des heures, nous nous amusons à lancer des grenades allemandes à manches dont la tranchée de la Gargousse, anciennement allemande, est largement pourvue.
On tire sur un cordon par l'intermédiaire d'un bouton de porcelaine ou d'os poli et on jette. A chaque explosion, un bruit de limaille projetée au travers du réseau répond avec un « craou » sourd. Les hommes y prennent goût et la première partie de la nuit se passe dans de courts tintamarres sur lesquels on ferme les yeux.
Tant que les grenades citron « foug » n'entrent pas dans la danse pourquoi arrêter ces divertissements quoi que les grenades allemandes constituassent une bonne réserve offensive.
Pendant quatre jours, la vie de tranchée nous paraîtra monotone quoi que chaque journée et chaque nuit soient marquées d'incidents tragiques et variés. Les « tourterelles » (grosses grenades à ailettes) nous cherchent le jour, tuent ou blessent par ci par là et des obus bouleversent la tranchée que l'on ne relève que la nuit.
L’infanterie allemande est en général très calme et il n'y a chez nous que le sous-lieutenant MAAS de la 18ème qui dans notre secteur la met sur les dents par ses bravades en paroles et par engins. C'est un homme de l'est, 38 ou 29 ans. Il connaît parfaitement l'allemand, aussi ne se prive t il pas d'invectiver les éléments ennemis d'un petit poste placé à 25 mètres de sa ligne.
Il se montre et cela finit par un échange de VB de sa part, de coups de fusils souvent menaçants de la part des boches. Tous les matins et quelquefois l'après midi, il nous empoisonne l'existence dans ce coin du front.
C'est miracle qu'il n'ait pas reçu avant la relève, une balle dans la tête. Cette dernière paraissait mise à prix de l'autre coté du réseau car dès qu'il apparaît au dessus de la tranchée, une balle traîtresse suivie d'un « claoup » strident et d'un jet de terre ou de poussière l'invite à devenir prudent.
Les mots s'échangent gutturaux rageurs et les « tourterelles » nous arrivent en frôlement froufroutés nous obligeant à nous tasser derrière un pare-éclats l'espace d'une minute. Leur arrivée est nettement visible mais à cet instant il eut été trop tard pour s'abriter si le destin les avaient guidées sur nous.
MASS répond par des VB et il me menace de nous rendre le secteur impossible. D'ailleurs, je fais comme lui, je me venge de leurs coups en envoyant quelques obus VB sur le carrefour du boyau franco-allemand où il y a certainement quelqu'un de poste et sur quelques points de la tranchée allemande qui me paraissent bons à battre. Nous sommes à peine à 140 ou 50 mètres du chemin des Dames où se trouve leur tranchée. La distance est bonne.
On ne me répond pas mais MASS continue à recevoir quelques autres balles qui frappent totalement le parapet toujours avec le même « claoup » mais sans le décourager.
Un matin, l'adjudant commandant la section d'engins vient régler dans notre tranchée un tir de canon 37, pour s'amuser sans doute une dizaine de coups sur le carrefour du boyau franco-boche avec la tranchée ennemie et sur la fontaine Ste Berthe située dans un ravin derrière la ferme de la Rozère.
Les petits obus passent vite en nous rasant avec un long sifflement de vipère. Ceux qui vont à la fontaine Ste Berthe marquent leur point de chute par une petite fumée blanche qui s'élève fugace. Des 77 ou des 88 allemands répondent à la petite pièce et cherchent à la faire taire. L'adjudant n'insiste pas et paraît satisfait.
La visite imprévue du colonel : la boite de sardine
Un autre mardi, alors que je venais de placer mon service de jour et que je reposais dans une alvéole de la tranchée rompu et écrasé de sommeil par l'interminable veille de la nuit, le colonel POUGET, commandant la brigade, vient en visite de secteur et me fait éveiller. Il n'y avait pas une heure que le sommeil m'avait terrassé, un sommeil lourd.
L'homme de garde me secoue rudement sans que je puisse arriver à réaliser ce qui arrivait. Les bras, les jambes, le corps même refusaient à obéir à mon cerveau et c'est encore à demi endormi avec les yeux boursouflés et la bouche mauvaise et humide que je me présente à mon chef. L'accueil ne fut guère très cordial chez cet homme qui avait tout de même reposé une bonne partie de la nuit.
Défaillant presque sous la fatigue, l'accent de rudesse de mon général de brigade eût tôt fait de me remettre d'aplomb.
Mais j'avais été mal réveillé et une observation peu juste en ce lieu sur une boite de sardines qui traînait dans la tranchée et sur un coin de tranchée pas suffisamment dégagé à son avis pour donner un passage abrité, attira une réponse un peu désobligeante avec la remarque que les hommes étaient fatigués d'avoir veillé ou travaillé toute la nuit et qu'on ne pouvait leur demander la perfection dans le nettoyage et le relèvement d'une tranchée qui très probablement le soir même sera à nouveau bouleversée.
Il parait que le mot « fatigué » n'est pas français et qu'un homme peut fournir un effort sans limite (surtout pour ces messieurs qui mangent bien, dorment bien).
La conversation ayant ensuite dérivé sur des connaissances communes, le ton des demandes et des réponses devint plus aimable et tout se termina par des congratulations chaleureuses.
Il fallait bien que mon grand chef laisse trace de son passage.
Le soir suivant, un incident qui aurait pu être tragique vint troubler la quiétude de mes responsabilités ordinaires.
Vers minuit, le sous-lieutenant LASSALE de la 18ème compagnie envahit ma tranchée avec sa section pour poser ou renforcer le réseau de fils de fer en avant des lignes. Personne ne m'en avait prévenu.
J'invite donc mes hommes à ne pas s'affoler s'il y a bruit et à ne pas gêner l'opération. J'envoie un sergent et quelques patrouilleurs entre les lignes, 20 mètres en avant du réseau et du sous-lieutenant LASSALE et de ses hommes disposés par petits paquets chargés qui de piquets en fer tirebouchonnés, de fils de fer barbelés ou de chevaux de frise de petite dimension se portant vers les lieux où doit s'exécuter le travail.
Avec le sous-lieutenant LASSALE, nous plaçons les équipes qui se mettent vivement au travail. Il y avait bien cinq bonnes minutes que chaque groupe s'affairait sur son ouvrage lorsqu'un de mes hommes resté dans la tranchée, un solide breton illettré et un peu arriéré venu nous renforcer pour la nuit d'une section de réserve, ayant sans doute mal compris mes instruction, nous jette brusquement coup sur coup ses deux grenades citron « Foug ».
Heureusement, au claquement de percussion de la première grenade, dans un geste instinctif, tous les hommes se sont couchés et les éclats nous ont fustigés avec plus de peur que de mal.
Je saute vivement dans la tranchée et arrive à temps pour arrêter net un prochain lancement sans l'anxiété du mal qu'il a pu faire. Je le semonce sérieusement et remonte sur la tranchée vers les points d'explosion, alors que la moitié de la corvée s'était mise à l'abri.
Les grenades avaient heureusement explosé entre deux groupes de travailleurs et seul un de mes hommes de garde dans la tranchée Chevalier avait eu le casque percé par un éclat de grenade qui lui avait labouré légèrement le cuit chevelu.
Je l'envoie vite au poste de secours d'où il reviendra pansé.
Pour éviter d'autres méprises, je gardais le breton auprès de moi. Ces poilus de la 18ème n'étaient pas très contents, ils nous maudissaient et il y avait de quoi. Le sous-lieutenant LASSALE un jeune de la classe 1916, instituteur dans le civil, les calme, ne prenant pas la chose au tragique puisqu'il n'y avait pas eu de mal chez lui.
Il ne me créera pas d'ailleurs d'histoires.
l’insolent Fantomas
Tous les jours pour nous distraire, un frère « Fantômas » vient nous faire sa petite visite.
C'est un avion allemand d'accompagnement d'infanterie blindé parait-il ? Qui prend un malin plaisir à nous braver matin et soir à peine à 100 mètres de hauteur si ce n'est moins.
Il nous arrive vers les 08h du matin et vers 16h pour faire un petit tour de nonchalante promenade évoluant surtout sur sa première ligne après nous avoir fait une petite visite à toute allure en égrenant parfois une toute petite bande de mitrailleuse, histoire sans doute de nous saluer.
Il est tout naturel que nous perdions notre sang-froid devant toutes ces insolences et sur son passage tout le long de la ligne, la tranchée résonne de coups de fusil et de fusils mitrailleurs, jusqu'aux mitrailleuses des positions de soutien, tranchée de Scutari et autres qui se mettent de la partie et que les obus allemands cherchent aussitôt.
Naturellement, j'essaie de faire un carton et comme mon coin possède un lot important de balles traceuses, j'en use avec prodigalité en pure perte d'ailleurs. Ces balles sont très visibles à une certaine hauteur, elles laissent une sorte de traînée phosphorescente me démontrant surtout qu'il n'est pas très facile d'atteindre un objet pourtant assez massif en mouvement dans l'air.
Cependant « Fantomas » a eu un matin du début de juillet la désagréable émotion d'être descendu par les chasseurs alpins. Quelques balles bien placées ont détérioré sont moteur l'obligeant à s'écraser entre les lignes à l'Épine de Chevigny dans le secteur du 220ème RI.
Son pilote qui serait paraît-il un as « Richtoffer » s'en est sorti sans grand mal devant son salut d'abord à une grande chance ensuite à une fuite effrénée au travers des fils de fer allemands.
La carcasse de son avion est nettement visible à 30 mètres de chez nous. Il est revenu le soir même de sa chute, nous ont dit les chasseurs, pour nous braver à nouveau et démontrer qu'il était un dur à cuire. N'empêche que nous sommes fiers d'admirer comme des touristes, les restes de son avion : ailes presque désenvoilées et enchevêtrement du train d'atterrissage et du moteur.
Souvent, dès la nuit, c'est le rendez-vous de quelques audacieux patrouilleurs qui en ont rapporté tous les souvenirs prenables.
Malgré toute notre bonne volonté et l'enthousiasme que nous mettons à vouloir détruite encore une fois cette cible mouvante, il continuera pendant quelques mois sa promenade et même son petit fond de chemin jusqu'à Vailly, 8 kms à l'intérieur de nos lignes, sans qu'un avion de chasse de chez nous ou des batteries anti-aériennes ne se dérangent pour l'inquiéter.
Il est vrai qu'il volait très bas.
Tout au contraire, le moindre de nos avions apparaissant au dessus de nos lignes était reçu par des « claouf claouf » des obus anti-aériens allemands qui formaient autour d'eux une nuée de boules cotonneuse d'un blanc sale. Le français désigne parait-il par plaisir ce qui se fait chez lui et pourtant on peut bien assurer que comme organisation esprit d'à-propos dans la défense sur toutes ses formes, les boches nous donnent le plus souvent l'exemple.
Ce qui se passait près des lignes n'avait pas trop l'air d'intéresser ceux qui ont les leviers de commandes à l'arrière et pourtant combien ceux de l'avant avaient ils besoin de se sentir soutenus.
Les cours de formation d’engins, mitrailleuses et canon de 37
Le 20 août 1917, je suis désigné avec mon camarade l'aspirant CHAUVIN, du 4ème bataillon, pour suivre le cours d'armée de tous engins d'infanterie, canons 37, mitrailleuses, fusils-mitrailleurs, grenades, etc... au village d'Oulchy-le-Château, très en arrière du front.
Nous faisons la plus grande partie du chemin à pieds par une chaleur torride. Nous commençons par l'étude du canon du 37 mm, j'avoue que cet engin m'intéresse énormément. Je fais connaissance surtout avec son frein hydraulique spécial et avec les divers appareils de tir qui vont m'initier aux mystères du tir direct, indirect et surtout masqué avec son écrêtement, angle de site, dérive.
J'y apprends la correction du tir, coup long, coup court, coup moyen, qui doit être le bon.
Je suis avec profit ce premier cours et passe un bon examen. Dans nos exercices et pour nous démontrer la précision du canon, notre chef pratique n'a pas manqué de nous envoyer par surprise, à peine à deux mètres de notre groupe venu examiner les points de chute, deux obus en vitesse qui font passer dans notre corps à chaque sifflement rapide, un haut-le-corps involontaire.
Cet engin est un véritable bijou d'une précision remarquable.
Avant de passer à l'étude d'une autre spécialité, nous assistons en masse officiers et sous-officiers de tous les cours à un exercice de lancement de grenades OF sur un plateau boisé au nord-ouest d'Oulchy.
Presque en fin d'exercice, au moment où nous assistions à un dernier tir groupé sur le terrain et non abrités, à 30 mètres des explosions, un bouchon allumeur en retour vient blesser grièvement, entre la tempe et l'œil droit, à deux pas de ma place, un lieutenant d'infanterie.
Quelques jours après et dans le but de préparer une future grande attaque, dans le secteur de notre armée, le centre d'instruction est dissous. Je quitte avec regrets Oulchy-le-Château où les journées s'écoulaient calmes et gaies pour rejoindre ma compagnie en ligne.
Je trouve ma section en soutien dans la tranchée de Scutari, coin de l'abri cimenté à cheval sur le boyau du Négus. Je la reprends au sous-lieutenant LISON qui retourne à la 18ème compagnie. Il venait à peine de me passer les dernières consignes près du carrefour Négus-Scutari, lorsqu'un gros obus allemand fuse puissamment sur nos têtes, l'espace peut être d'un dixième de secondes, explosant avec un bruit formidable dans le parados de la tranchée à moins d'un mètre de notre groupe, dans une projection de fumée noire dans laquelle nous disparaissons un instant.
Nous avons embrassé la terre sans mal, mais deux hommes de ma section sont légèrement blessés. Je les accompagne au poste de secours du ravin d'Ostel.
Le soir, je refais connaissance avec « Fantômas ».
A peu près aux mêmes heures matin et soir, il continue à faire le tour du propriétaire égrenant souvent sa série de balles. Au cours d'une de ses mitraillades, un de mes jeunes de la classe 1917 est blessé d'une balle au pied droit dans la tranchée Scutari en ma présence, alors que nous suivions les évolutions de l'avion. Nous sommes à l'abri et en dehors du taracatac de la mitrailleuse de Fantômas, le secteur est très calme. L'homme a poussé un cri qui nous a surpris et sa figure s'est crispée. Il enlève son soulier et montre le tarse traversé de part en part. Le trou d'entrée est à peine visible et la blessure saigne.
Encore un que l'on envie au poste de secours avec la blessure filon.
Tous les huit jours, nous faisons la navette des mêmes lignes, Gargousse, Scutani, devant la Rozère entre l'Épine de Chevrigny et le Panthéon et la carrière creuse de Rochefort sinon les villages de Cey-La-Commune ou Presle-et-Boves plus gais quoi que vides d'habitant. Sous les obus, nous accomplissons sans cesse les mêmes travaux dès la tombée de la nuit, pose de fils de fer barbelés des lignes ou creusement et relèvement de tranchées sur les lignes de soutien fermes de Certaux ou de Gerlaux.
22-23 septembre 1917
Le coup de main allemand
Au début de septembre, le séjour en ligne devient moins fatigant.
La première ligne n'est plus gardée de nuit que par de petits postes à l'effectif d'un petit groupe de grenadiers placés aux débouchés des boyaux.
A la pointe du jour, nous reprenons entièrement les lignes, ce qui nous demande beaucoup de prudence afin de ne pas tomber dans les embuscades de patrouilleurs ennemis venus s'y installer de nuit.
Jamais nous n'eûmes cette surprise mais un soir, pour répondre sans doute à un coup de main du 369ème régiment d'infanterie qui lui avait fait 18 prisonniers en plein midi, l'ennemi, à la faveur d'un envoi massif de gros minennverfer , pénètre en force dans notre tranchée de première ligne entre notre poste de grenadiers placé au débouché du boyau du Négus sur la Gargousse et le premier poste du 220ème régiment d'infanterie.
Selon les consignes, notre petit poste se replie, après avoir lancé des grenades, dans le boyau jusqu'au pare-éclat organisé pour protéger la mitrailleuse installée dans un abri léger d'infanterie.
La tranchée ayant été bouchée d'oursins en fil de fer barbelés vers nous, les « Stosstrup » se rabattent en quelques minutes sur le poste du 220ème RI non sans avoir reconnu un vieil abri creusé par eux et jamais heureusement occupé.
Le groupe du 220ème se défend énergiquement.
Le fusil-mitrailleur tire crosse sous le bras, mais il est abattu, mortellement blessé, d'un formidable coup de grenade à manche à la tête. Le premier pourvoyeur saute sur l'arme, finit le chargeur dans la poitrine de l'Allemand et se replie, blessé lui même, avec son caporal par dessus le parados de la tranchée.
Le coup est manqué pour les Allemands et ils n'insistent pas, abandonnant dans leur retraite, leur camarade tué.
Le calme revenu, la réoccupation de la tranchée s'effectuera assez rapidement et un sergent de chez nous prend possession de la dépouille de l'Allemand que le 220ème revendique et qu'on lui laisse bien volontiers.
Il ne portait aucune indication de régiment ni aucun papier.
Pendant un quart d'heure, tout mon coin est resté dans l'anxiété de l'accrochage qui ne s'est pas heureusement produit l'adversaire ayant été désagréablement impressionné grâce d'abord à la défense des grenadiers puis à celle du 220ème.
Seule ma première demi-section a un peu souffert des engins de tranchée.
Près de 25 gros Minnenvverfers sont tombés sur ses environs et sur la tranchée de doublement qu'elle occupait à la crête topographique devant Scutari. En dehors d'un veilleur, la plupart des hommes dormaient dans des alvéoles pratiquées dans le talus de la tranchée assez loin les uns des autres. Quelques hommes sont contusionnés et à demi enterrés en plein sommeil.
On s'est dépensé avec célérité pour leur porter secours. Certains éléments de tranchée sont à demi nivelés. Ce coup de main allemand étant parti d'un élément d'abri situé en face notre petit poste, sur le Négus, le 220ème nous a reproché de ne pas avoir assez appuyé son groupe attaqué.
(*) : Ce coup de main est relaté dans le JMO, il
date du 22 septembre 1917.
Cliquer sur l’image pour agrandissement
Au jour, nous examinons les lieux.
Les « Stosstrup » ont largement marqué leur passage sur le parapet de la tranchée qui est largement foulé et érodé sur à peine 6 à 10 mètres. Des lambeaux d'étoffe (feldgrau) restés accrochés aux barbelés, sur un passage de 80cm, marquent l'affolement qui devait régner dans le corps franc ennemi précipité.
Pendant deux jours, vers 15h, nous assistons de la tranchée de la Gargousse à des tirs de réglage par 155 sur la tranchée allemande de 1ère ligne épousant le chemin des Dames.
Peu de temps avant le commencement du tir, j'avais reçu l'ordre de reporter tous mes éléments plus à gauche dans la partie de tranchée flanquant tous les éléments évacués en vue d'un autre tir d'artillerie. Un avion d'observation, réglage d'artillerie, ne tarde pas à nous survoler en même temps que les premiers obus 155 se jettent littéralement sur la tranchée ennemie. Par trois et quatre obus dont on entend le départ, nous les prenons visibles à l'œil, une fraction de secondes à 100 mètres du but sur lequel ils s'abattent tel un épervier sur sa proie.
A 60, 100 mètres de nous, sur la droite, le parapet de la tranchée allemande se disloque bruyamment. L'avion s'en revient vers l'arrière pendant que la batterie suspend le tir, revient et le tir recommence pour cesser au bout d'une demie heure, une trentaine d'obus ayant été tirés. Quelques uns ont atteint le but, l'explosion s'étant produite en pleine tranchée d'où sortait une immense gerbe de fumée qui se diluait en une minute.
24 septembre 1917
Le 24 septembre 1917, après une matinée des plus douce, chaude même, c'est à notre tour de recevoir un déluge de feu. Il est vrai que l'on a tout fait pour cela.
La division doit aller au grand repos dès ce soir et le 11ème corps d'armée, 64ème régiment d'infanterie qui nous remplace, a envoyé dans la matinée, une reconnaissance d'officiers et de sous-officiers, pour prendre contact avec nous et embrasser d'un coup d'œil d'ensemble leur nouveau secteur.
Cela ne s'est pas fait sans va-et-vient insolites pour l'ennemi d'autant plus qu'à chaque observatoire ou point dominant l'Ailette, des groupes se sont formés écoutant les explications, recommandations et renseignements des officiers guides tout en admirant au loin la ville de Laon, ses abords et le fort de la Malmaison.
Des yeux bien placés de l'autre coté de la ligne n'ont pas manqué de noter et de signaler des allers et venues anormales qui, grossies par l'imagination, ont pu laisser croire à des préparatifs d'attaque et cela d'autant plus que ceux qui viennent et qui seront appelés à rester là les jours suivants dans une conscience malheureuse, se montrent à mi-corps au dessus du parapet, jumelles en main.
Le drame du poste de commandement de l’abri scutari
L'avant-garde de nos remplaçants est à peine partie que des explosions violentes ébranlent l'air aux quatre coins du secteur et de gros obus passent sur nos têtes comme des trains de marchandises explosant aussi à 300 mètres de nous.
Sans être bien dense, le bombardement paraît vouloir durer et quelques gros obus courts sans doute tombent sur la tranchée Scutari vers le PC du commandant de compagnie.
Peu d'instants après, un homme de la section de réserve vient me prévenir que l'abri du Capitaine est écrasé sur l'une de ses entrées et qu'il y a de nombreuses victimes dont le Capitaine.
Je cours vers l'abri et après bien des difficultés pour traverser deux éléments de la tranchée de Scutari, le premier bouleversé est troué profondément comme s'il y avait eu un fourneau de mine explosé, le deuxième à demi comblé. Au poste de commandement de la compagnie, un spectacle poignant s'offre à mes yeux.
Le capitaine BESSEDE (Prosper) est étendu dans la tranchée, sans vie, visage terreux. On cherche un brancard pour le transporter au poste de secours du bataillon du ravin d'Ostel.
L'obus est tombé sur l'entrée est de l'abri, ensevelissant le sergent observateur et deux poilus qui avaient leur observatoire tout contre écrasant les boiseries et l'escalier de la descente. L'air ayant été chassé très violemment par l'explosion de l'intérieur de l'abri, à moins que ce dernier ne se soit rempli d'oxyde de carbone, l'atmosphère y devint irrespirable et le capitaine n'eut que le temps de sortir au travers des poilus affalés dans les escaliers en demandant place et de l'air, pour s'effondrer sans connaissance à son arrivée à l'air libre.
On ne put pas le ramener à la vie.
Quatre brancardiers et un poilu descendus pour leur porter secours n'ont pas réapparu et gisent au fond. Le sergent NAGUET, un breton descendu à son tour pour apporter son aide, ne dût de conserver la vie sauve qu'au geste d'un camarade qui, le sentant défaillir alors qu'on faisait la chaîne, le ramena vivement et même mal aisément à lui, alors qu'une sorte de malaise le gagnait.
Sans peine, on pût faire disparaître à l'air libre le commencement d'intoxication qui les incommodait. Il ne fallait plus penser qu'à déboucher l'entrée d'air écrasée pour assurer une certaine ventilation de l'abri.
Tant bien que mal, le capitaine BESSEDE, prêtre du Gers dans le civil, et qui disait sa messe si pieusement tous les mations dans cet abri, au milieu des hommes de la section de soutien, est transporté au poste de secours.
Hélas, il n'y avait plus rien à faire et son cadavre, laissé sur un brancard près du PC du bataillon, qui ne portait à sa mort aucune blessure apparente, est mutilé par le feu en fin de journée.
Vers 17h, le bombardement s'acharnait sur le ravin d'Ostel, le dépôt de munitions, grenades, fusées, etc… saute, mettant le feu aux abris PC et PS et alentours. Le cadavre du capitaine abandonné auprès eut tout le bras et l'épaule gauche carbonisé.
Toute la soirée est employée à dégager l'entrée de l'abri Scutari et les disparus restés au fond.
Vers minuit, après une attente un peu anxieuse, le 64 RI nous remplace entre l'Épine de Chevigny et Le Panthéon. Les consignes sont vite passées et dans une légère accalmie, après avoir côtoyé les abris du poste de commandement du bataillon dévastés par l'acharnement des obus, enjambé de grosses racines d'arbres qui constituaient à se consumer rougeoyantes, nous retrouvons la route d'Ostel à Vailly et atteignons après 2 heures et demi de marche, le village de Presles-et-Boves de l'autre côté de l'Aisne.
Nous n'y restons pas longtemps.
La tragédie de l’abri Scutari du capitaine BESSEDE, a
fait 10 morts et 11 blessés (dont 9 morts et 9 blessés par anoxie) :
Les tués sont :
Capitaine
BESSEDE
Prosper, soldat MAUGIN Louis François, soldat BARRERE Jean Arsène, soldat FORGUES Roger, soldat BARBARIN Henri
Pierre, soldat VERIERA Dominique Joseph, sergent RIGAUD Bernari, soldat ZIEGLER Georges
Edmond, soldat LARRIEU Jean, soldat GRANDIERE Alexis Marie Stanislas.
Le capitaine BESSEGE Prosper sera le seul à obtenir une
citation à l’armée, alors que les brancardiers y sont aussi descendus :
Texte de la citation :
« Modèle de bravoure
et de dévouement, au cours d’un bombardement, une de des issus de son abri
ayant été obstruée, s’est sacrifié pour faire sortir par l’autre issue tous les
soldats qui l’accompagnaient. A succombé à l’asphyxie ».
Et les autres ? On les oublie…
Vous pouvez lire le récit du JMO >>> ici
<<< et >>> ici <<<
L’imposante cérémonie funèbre
Un beau matin après 4 heures de marche, nous nous cantonnons à Arcy-Sainte-Restitue gros village chez lieu de canton du département de l'Aisne.
Dès notre arrivée, un dimanche matin, le Colonel fait dire la messe à l'intention du capitaine BESSEDE et de tous les morts du régiment. L'église est pleine de délégations de chefs et d'hommes de la division. Le drapeau avec sa garde d'honneur est prés de l'autel, entouré de tous les fanions de chaque bataillon.
L'abbé DERAMOND, un de mes compatriotes Ariègeois, aumônier de la division, dit la messe entouré de brancardiers, prêtres eux-mêmes qui le servent avec une dignité, une ferveur que je n'ai vu nulle autre part, dans ce pittoresque ensemble de bleu horizon.
Dans l'église, il n'y a pas de place pour tout le monde ; des portes grandes ouvertes la foule des poilus déborde au dehors. Que cette cérémonie est imposante dans cette modeste église de village campagnard et en même temps si empreinte de piété. Partout des visages recueillis, attentifs aux gestes du prêtre et beaucoup égrenant un chapelet ou suivant sur un vieux paroissien les répons pour obtenir à nos morts, à nos vieux camarades d'hier, la grâce et la paix éternelle qui leur est bien due.
Notre pensée se reporte quelques minutes vers eu ; comme beaucoup je vois dans le bas fond du ravin d'Ostel sur une courte pente, un carré de cimetière du front avec la tombe de mon capitaine et de ses poilus couchés dans ce coin entre le 28 juillet et le 25 septembre 1917 et qu'une simple croix de bois grossièrement établie avec inscriptions maladroites, signale aux vivants. (*)
(*) : Plus de 250 tués au 288e
RI, sont recensé entre ces 2 dates ; mais combien n’ont pas eu de
sépultures !
La messe finie, après une sortie recueillie, la vie reprend ses droits.
Sans oublier les morts, cette cérémonie a regroupé de vieux amis de compagnies, de bataillons différents et l'on va vite oublier les misères de la guerre et les évènements tragiques des jours précédents dans les estaminets du village.
Pas très loin de l'église à un carrefour et faisant coin, le café le plus achalandé et le plus accueillant absorbe des groupes compacts qui avec le vin bouché - il n'y en a pas d'autre et les gens du midi ne peuvent pas s'en passer s'ils ont des sous – ou la bière et le cidre pour les moins fortunés, emplit la maisonnée de cris joyeux, d'interpellations gasconnes ou de chansons surtout que le barde du régiment, DUPOUIL, de mon bataillon est tenu sous les acclamations de débiter d'une voix forte où il met tout son cœur, son recueil de chansons de guerre ; toute l'épopée du régiment depuis le début jusqu'au dernier secteur.
Pour nous celle du 288ème à Verdun et celle du Bois-le-Prêtre nous feront revivre des heures poignants, des heures de misères que nous revoyons aujourd'hui en rêve comme des faits d'épopée qui sont pleins d'attraits.
LA CHANSON
DU BOIS LE PRETRE
(Recomposée
à peu prés)
Huit jours
de tranchée
Huit jours
de souffrances
Puis bientôt
voilà la relève
C'est un
officier de Chasseurs à pied
Qui vient
pour nous remplacer
Doucement
dans l'ombre
Sous la
pluie qui tombe
Les petits
Chasseurs viennent chercher leur tombe.
Adieu la
vie; adieu l'amour
Adieu toutes
les femmes
C'est pas fini ;
c'est pour toujours
De cette
guerre infâme
C'est à
votre tour Messieurs les gros
De mourir
dans un boyau
Où l'on est
tous des condamnés
Des pauvres
sacrifiés
(Suivi de deux
ou trois autres couplets)
Des bis, bis, des applaudissements, de demandes de chansons d'autres secteurs s'entrecroisent à ne pouvoir s'entendre. Pour quelques heures on oublie les misères qu'elles contiennent, que nous avons vécues et qu'aujourd'hui nous voulons revivre en pensée dans la détente du repos.
Infanterie douloureuse nous serons toujours des errants; il faut évacuer les lieux pour laisser la place à l'artillerie ou à des services d’État-major.
Début octobre 1917 : la bataille de la Malmaison
Nous nous rapprochons des lignes et établissons définitivement nos pénates en vue de notre préparation offensive au gros bourg de Braine à 8 kilomètres vers l'avant. (le 5 octobre indique le JMO)
Au cours de la marche nous ne cessons de longer sur notre droite et sur la gauche des installations de dépôts de munitions et des H.O.E (hôpitaux de campagne d'évacuation) dont les vastes tentes Bessouneaux longues et larges comme de hautes maisons, sont impressionnantes de majesté et d'alignement.
C'est là peut-être si nous avons de la chance d'être blessés, que nous recevrons les premiers grands soins avant l'évacuation vers l'arrière et plus d'un de ceux qui les admirent doivent faire ce souhait. D'après des renseignements de vastes camps d'aviation de campagne aménagés selon les mêmes principes accaparent plusieurs terrains de la région.
Il y aurait même l'escadrille des cigognes (sans GUYNEMER porté disparu dans le Nord).
Quelque chose de grave se prépare ; un gros outillage guerrier va donc être mis en action. Notre cœur se serre à la pensée que nous allons être les premiers acteurs du drame qui se prépare.
Ceux sur lesquels la responsabilité du succès va peser le plus pour la délivrance et la grandeur du pays.
Braisne devient vite un véritable camp de troupes où il y a de tout : fantassins, artilleurs, même de l'ALGP (artillerie lourde à grande puissance), du génie.
C'est un gros village coquet aux gens accueillants car les masses d'hommes comme ceux-ci dépensent vite leurs maigres ressources à boire et chaque maison est transformée en cabaret.
Si la fille de la maison est belle et gentille, ce qui arrive le plus souvent, la salle-à-manger hâtivement installée ne désemplit pas. C'est ainsi qu'avec quelques camarades sous-officiers, nous devenons des habitués d'une maison accueillante près du passage à niveau ouest où une jeune fille brune, jolie et potelée nous réserve ses sourires et ses amabilités qui ne sont pas commerciales pour l'un d'entre nous. Je me contente d'admirer et d'envier un peu le plus débrouillard de la bande qui a toutes ses faveurs et qui est là comme chez lui.
Il lui a suffit d'un peu d'audace, être entreprenant tout est là.
Heureux ceux qui savent y faire et que les formes n'embarrassent pas.
La formation au lance-flamme
Notre entraînement en vue de l'attaque prochaine se poursuit avec célérité. Les programmes d'instruction très changés débutent par des exercices de culture physique selon un nouvelle méthode curieuse et amusante : de marche à l'indienne, en canard...etc... d'une durée de 45 minutes bien dosée et s'adressant à toutes les parties du corps, de mouvements d'ordre serré avec arme afin d'obtenir la cohésion et de mouvements en ordre dispersé, marche d'approche, formation, d'attaque, infiltration par petits groupes pour finir par des exercices pratiques massifs.
C'est ainsi qu'à trois reprises différentes, près d'Arcy-Sainte-Restitue, sur un plateau, la division fut rassemblée pour répéter comme au théâtre, sur un terrain ayant à peu de choses près les caractéristiques du secteur d'attaque sur l'Ailette. Les différentes phases de l'opération future avec mise en œuvre de tous engins d'infanterie et particulièrement de lance-flammes (appareils Childs, masse cylindrique avec système de projection de liquide de pétrole comme dans l'appareil Vermorel pour sulfatage de vigne).
L'ennemi n'étant que figuré, tout se passait dans les meilleurs conditions et au moment de la mise en œuvre des lance-flammes sur une entrée de creute, tous nos hommes étaient rassemblés pour constater l'effet destructeur et puissant des flammes.
Dès que la fusée placée au bout du tuyau projecteur fusait, le pétrole était projeté par un petit levier pourpre et au contact des étincelles de poudre, s'enflammait portant avec force en longueur et sur une quinzaine de mètres l'affreuse grillade de tout ce qui se trouvait sur son passage, en répandant sur un large rayon une chaleur presque insupportable qui rougissait le visage de l'opérateur et des ses voisins immédiats.
Sur toute la surface du jet enflammé, il ne restait plus qu'une sorte de lande carbonisée. L'outil serait vraiment terrible si l'occasion s'en présentait et s'il arrivait à bon port ce qui me semble difficile sous les obus et sous les balles.
Il faudra que l'homme d'élite qui le porte ait une volonté et un courage surhumain pour approcher l'ennemi avec un engin si lourd.
La destruction de la saucisse
Depuis le 14 octobre 1917, une période de calme succède à une période d'entraînement, de courts exercices se font aux abords immédiats de Braisne. Plusieurs heures sont même consacrées à l'entretien de nos armes et de nos effets.
Le 15, dans l'après midi, alors que je causais avec quelques sous-officiers sur le pas de la porte de notre cantonnement, nous assistâmes au bombardement de la saucisse (ballon d'observation) en position un peu à l'est de Braisne, à un ou deux kilomètres.
Les 105 allemands ou les 150 fusant venaient s'ouvrir bruyamment à quelques dizaines de mètres du ballon en libérant une masse très dense de fumée avec un craouf puissant.
Nous suivîmes cela avec un certain intérêt lorsque brusquement, sur un éclatement trop rapproché, la saucisse oscille un instant, laisse échapper de son enveloppe un fuseau de fumée noire qui va grandissant. Bientôt, la voilà qui s'embrase pendant que les deux observateurs sautent dans le vide.
Quelques secondes d'angoisse, les parachutes s'ouvrent. Ils atterrissent sains et sauf à quelques lieues. La saucisse est tirée au sol avec rapidité, mais bientôt comme une énorme torche que rien ne soutient plus, elle tourne comme un bolide dans un tourbillon de flamme et de fumée. Depuis longtemps les boches la cherchaient. On peut dire qu'ils l'ont bien eue.
Dans quelques jours, une autre la remplacera et plus prudente, saura garder les distance.
Le départ est de plus en plus proche car nos chefs s'occupent maintenant de surexciter notre moral.
Un coup de main réussi par un de mes anciens camarades de la classe 1916, le petit LARRIEU ou LOUSTAU, caporal au 6ème bataillon, habilement relaté dans le journal « Le Matin », est lu et commenté au rapport du 16 octobre.
Au cours d'une présentation du bataillon et d'un prétexte de remise de décorations, le commandant LAGOUBIE, d'une voix ferme et cependant légèrement teintée de tristesse, résume dans un court discours, ce que l'on attend de nous, les obstacles que nous aurons à bousculer ou à franchir pour réussir notre tâche et dans une courte péroraison, exalte l'esprit de sacrifice avec lequel nous devons nous engager pour le triomphe de nos armes en terminant par les cris d'honneur du 5ème bataillon « Vive le 288ème », le tout clôturé par une présentation impeccable des armes.
Le commandant nous salue dans un silence impressionnant où chacun de nous est figé. L'action va commencer.
La période d'instruction en vue de l'attaque qui se prépare est terminée.
18-19 octobre 1917
dans l'antre d'Ali Baba et des 40 voleurs
Le 18 octobre 1917, vers 16h, nous quittons notre cantonnement de Braisne pour aller en ligne occuper les parallèles de départ en vue de l'assaut. Chacun de nous a dans son porte-carte sa copie de plan directeur et son plan d'engagement avec les abris ou creutes à nettoyer, le bataillon marchant derrière le 288ème avec une mission de nettoyage.
C'est avec beaucoup de regrets que nous quittons ce gros chef-lieu de canton de l'Aisne où nous nous étions faits de nombreux amis dans la population. Pour quelques temps, nous allons abandonner ces lieux civilisés où nous trouvions quelque détente pour la zone rouge dévastée, bouleversée, règne de la souffrance et de la mort.
Tout le régiment s'ébranle au son des clairons et des tambours dans un bruit cadencé et bruyant de pieds frappants le sol. Toute la population est dans la rue, touchant des mains, avec des au-revoir attendrissants et des gestes amicaux.
En quelques minutes, nous sommes sur la route de Brenelle. La clique s'est tue et Braisne ne nous apparaît plus que comme un village tassé aux toits gris et rouges. Le 4ème bataillon prend une certaine avance et après la traversée de Brenelle, l'ordre nous parvient de former les faisceaux et d'attendre.
L'arrêt est assez long. Le bruit court comme une traînée de poudre que le bataillon n'ira pas plus loin ce soir. Les faisceaux sont rompus et sous la direction du chef de bataillon, nous nous engouffrons dans les creutes (carrières) de Brenelle, à gauche de la route de Presle-et-Boves en contrebas.
En dehors de l'entrée qui est assez vaste, aucune autre ouverture ne nos apporte du jour.
La carrière comporte plusieurs galeries dans lesquelles nous sommes dispersés, aussi réclame-t-on sans cesse des bougies, celles de l'intendance ne nous suffisant pas, nous en achetons à l'épicerie du village et cela malgré l'ordre de ne pas sortir de nos casernes, étant en stationnement d'alerte.
Un certain nombre de chalets superposés sur trois étages faits de treillages métalliques sur des cadres en bois sont pris d'assaut par les premiers arrivés. Les autres, dont je fais partie, se contentent du sol humide et crayeux de la creute.
Comme toujours dans l'ignorance de notre destinée, et oisifs dans une demie obscurité, on mange ou on sommeille pendant que sur les chalets, à tous les étages et sur le sol, d'innombrables feux-follets marquent la place de joueurs de cartes endiablés ou de conciliabules indistincts.
On se croirait dans l'antre d'Ali Baba et des 40 voleurs.
Nous passons la fin du jour et la nuit sur place résignés comme un troupeau de moutons. On est jeunes et l'on dort malgré l'état d'alerte sur lequel on nous maintient.
Le lendemain, alors que tout le bataillon est rassemblé dans l'unique rue de Brenelle, et au moment du départ, un contre-ordre nous ramène dans la creute où nous passons une nouvelle nuit. Des bruits divers circulent apportés par des corvéables ou des lascars en quête de pinard dans le village.
On parle de l'assassinat du président POINCARRE, d'une attaque remise, d'une révolution à Paris, autant de suppositions qui n'ont aucun fondement mais que chacun se suggère vrai pour en finir avec cette maudite guerre, même aux dépens de pays.
Le départ du lendemain vers 16h apporte un démenti à ces cancans de la roulante (« tout vient des cuisines » : expression du front).
On se dirige vers les lignes, mais avant Presle-et-Boves, à 3 kms de Brenelle, où nous arrivons par un petit sentier à montée rapide, dans le haut d'un profond ravineau (Talweg) dominant la vallée de l'Aisne en un point très garni de creutes.
Nous faisons encore de nouvelles suppositions aussi fantaisistes les unes que les autres.
Comme l'arrêt paraît se prolonger jusqu'à la nuit, je vais à la découverte, sans trop m'éloigner; nous attendons les ordres. Il fait beau et très clair en cette fin de soirée et du haut du massif, je découvre un panorama merveilleux sur le village de Cys-la-Commune, le canal latéral à l'Aisne : l'Aisne et un pont en bois énorme qui le traverse, enfin les pentes de Chavonne, et plus en arrière, tout le massif du chemin des Dames marqué d'innombrables fumées d'éclatements d'obus.
On entend une forte canonnade et en avant de Chavonne, nos batteries de divers calibres sont particulièrement actives. Pour le moment, il y a peu de chavois sur la route qui traverse l'Aisne, un incessant arrivage de poilus par trois ou plus et se tenant par le bras, rompt la monotonie de ce paysage mort.
De notre point d'observation plus haut de 300 mètres sur la vallée, ces groupes sont infiniment petits.
Nous apprenons un peu
plus tard que ces hommes, des artilleurs appartenant à des batteries de 75
bombardées par obus vésicants (ypérite), sont des évacués pour conjonctivite
grave occasionnée par ces gaz et brûlures sur diverses parties du corps. (*)
Il ne cesse d'en passer.
(*) : 12 soldats du 288e RI sont
aussi intoxiqués (JMO)
20 octobre 1917
Le 20 octobre 1917, à la
tombée de la nuit, l'ordre arrive enfin de rejoindre les lignes, les guides de
la division qui y tient garnison devant nous prendre au carrefour de la creute
de Roquefort vers 21h.
La cacophonie du convoi régimentaire
A 19h30, la compagnie descend dans la vallée par un
sentier à peine praticable, couvert de grosses pierres et bordé de buissons qui
empiètent sur le chemin.
A Cys-la-Commune, au fond de la vallée, se fait le rassemblement
du bataillon. Avec la nuit, les difficultés commencent à se présenter. Les
routes à peu près vides d'êtres humains dans la journée s'animent avec
l'obscurité.
De l'avant à l'arrière et de l'arrière à l'avant, commence un
croisement ininterrompu de chariots, hippomobiles, de camions, de camionnettes,
rompant brusquement le silence dans un brouhaha indescriptible dont le bruit
roule sourdement dans la vallée: crissements métalliques de roues adhérant
puissamment au sol, arrivée cadencée des fers des chevaux sur la pierraille,
cependant que le ronflement des moteurs domine par instant et se détache de cette cacophonie. Il
sen suit qu'au débouché de Cys, il faut s'arrêter plusieurs fois d'abord
pour former la colonne de route et puis ensuite pour que cette colonne prenne
sa place dans la vague montante. Ce n'est pas sans vociférations et longues
discussions entre chefs de convoi ou chauffeurs qui prennent pourtant peu garde
de la piétaille.
Le passage du pont sur l'Aisne se fait par section, à 50 mètres de
distance avec agent de liaison dans la nuit.
Le pont passé, vision continuelle dans la pénombre illuminée par à
coups de départs de coups de tonnerre de très longs canons de marine en action
dissimulés dans le talus creusé de la route ou même dans des maisons démolies
de Chavonne. L'éclair à la bouche du canon est si violent à cette courte
distance que l'on en est tout ébloui pour quelques secondes. Des hommes,
silhouettes noires, bougent autour d'eux et il en est aussi dans Chavonne,
village démoli dans lequel d'autres monstres d'acier crachent la mort.
Tout à coup, un convoi d'artillerie hippomobile, canons et caissons qui montent à leurs emplacements de batterie, nous doublent sur la gauche en trombe, pendant qu'un convoi de camion se faufile au milieu de nous sans aucun égard dans la nuit. Chaque voiture veut passer pressée, elles nous coupent, nous coincent, nous arrêtent plusieurs minutes.
On est par deux, par un, on se regroupe, on se perd, on court dans la nuit au risque de se faire écraser et mon rôle de chef de section est bien difficile. Il ne faudrait pas que je perde la tête de ma compagnie ou que j'arrive aux lignes avec la moitié de mon effectif. C'est un fouillis indescriptible où l'on a de la peine à se retrouver.
Heureusement, de nombreux arrêts des sections de tête nous permettent de rejoindre le commandant de compagnie, très embarrassé de cette pagaille à laquelle il ne peut rien. Quelques incidents marquent cette pénible progression que les boches oublient de troubler par obus; s'ils savaient !
A quatre kms des lignes, nous sommes très heureux de ne pas être inquiétés. Pourtant, notre artillerie ne leur a laissé aucun répit; cinq jours que la préparation d'artillerie est commencée sans grande réaction ennemie.
Près du carrefour Vailly-Chavonne-Ostel, un canon de 75 pressé par un camion se renverse sur le coté gauche de la route légèrement en contrebas. Des artilleurs essaient de le tirer de là et jurent après leurs chevaux.
Nous les laissons empêtrés avec leurs ustensiles et cet accident ayant embouteillé un peu la route, nous en profitons pour gagner du champ. Plus loin au carrefour, une voiture a un brancard brisé, d'où un nouvel embouteillage de camions, de caissons, de troupes, d'isolés qui veulent passer, cependant que brusquement et par salves intermittentes, quelques obus boches arrivent se dispersant dans les champs cherchant sans doute le carrefour. Heureusement, les batteries n'insistent pas; quelques tirs de harcèlement.
Pendant cet enchevêtrement de voitures et d'hommes, le soldat BULLY de la 1ère section a le pied gauche écrasé par une voiture à munitions d'infanterie. Les hommes avec leur bardas peinent beaucoup et blasphèment contre les à coups et les arrêts un peu trop longs à leur gré.
Maintenant on démarre sérieusement au pas allongé : « suivez - suivez » crie-t-on. Le carrefour est traversé sans accident. C'est le point le plus délicat étant le plus repérable et le plus visé de la région. Le canon boche veut bien se taire pendant notre passage; c'est heureux.
La lente montée en ligne
Petit à petit le bataillon se reforme, les sections serrent et se mettent en colonne par quatre en courant. Des distances plus grandes sont prises entre sections car dans ce vallon qui aboutit au village d'Ostel, les boches font des tirs de harcèlement; ils nous laissent cependant des moments de répit que l'on met à profit.
Au carrefour d'Ostel et d'un chemin montant aux lignes du Panthéon, nous trouvons un poste de gendarmes; gare maintenant à ceux qui voudront revenir en arrière et fuir la Zone Rouge, les cognes sont là pour les cueillir.
Nous prenons le chemin de gauche du Panthéon. Il paraît bien entretenu; il contourne par la gauche la croupe de la creute de Rochefort. Un agent de liaison du capitaine prévient les chefs de section que le bataillon va faire une longue pause à une centaine de mètres et qu'il faut serrer sur la tête.
Ma section rejoint la 1ère section et s'arrête à hauteur d'un poste de secours, abri profond dans le talus, dont le fond est éclairé par des bougies. Les hommes exténués s'assoient ou se couchent sur le sol contre le talus.
Je reste un instant debout et m'assied sur quelque chose de mou. C'est un mort allongé sur un brancard. Je me relève vite et je reste debout avec l'image indistincte de la forme du mort un instant dans les yeux. Devant nous une crête nous met à l'abri des obus, mais il est défendu de fumer.
Quelle drôle d'impression produit cette masse d'hommes qui attend le long du talus jusqu'à un horizon limité de silhouettes qui se meuvent, des parlottes à voix basses, des hommes inconnus qui longent la colonne remplissant une mission sous cette obscurité claire blafarde.
Les guides sont arrivés ; l'ordre de départ est donné avec les indications de la formation à prendre au débouché du chemin sur le plateau. Le long du chemin un peu avant la crête, nous distinguons des tas volumineux de gros bus, au moins des 280 sinon de 380. Au débouché sur le plateau se produit une légère erreur de direction. Des artilleurs d'un convoi de voitures à munitions, retournant vers l'arrière, nous indiquent le chemin.
A droite de notre route en éclairs de brusques flammes en forme de cône court, sortent de terre avec un claquement sourd et sec; c'est instantané.
Le plateau en est comme secoué, 75, 105, 155 sèment la mort là-bas au loin dans les lignes allemandes. La préparation continue. Chaque décharge à si petite distance et de tous côtés, déclenche en nous des réflexes nerveux; une brusque secousse dans les épaules et dans les jambes.
En nous éloignant de ce lieu tonitruant, le cerveau s'accoutume mieux aux départs. Ce n'est pas tout ce qui nous préoccupe le plus; il s'agit plutôt d'arriver aux lignes sans trop de casse, pendant que l'artillerie allemande est peu active.
Après un court cheminement, qui paraît avoir duré un siècle, nouvel arrêt qui nous paraît long sur ce plateau nu et enfin l'ordre d'occuper une tranchée plus en avant. C'est en tâtonnant que nous y arrivons, ligne noire et profonde dans laquelle nous sautons au risque d'attraper une entorse : certains s'agrippent et se laissent glisser dans le trou où ils roulent dans un bruit de ferraille.
Dans mon élément environ 200 mètres de longueur, nous découvrons quelques abris faits d'une couverture légère de tôle ondulée formant fond sur la tranchée. Nous trouvons à l'intérieur de quoi nous ravitailler en conserves de haricots, presque le cassoulet. C'étaient en fait des dépôts de vivres dissimulés à proximité des lignes pour le ravitaillement futur.
Nous les pillons en partie.
Nous nous couchons les uns contre les autres pour avoir plus chaud; il pleut par instants et l'eau ruisselle le long de la paroi de la tranchée. Pourquoi y prendre garde.
Tâchons plutôt de passer une bonne nuit.
21 octobre 1917
La journée suivant, 21 octobre 1917, pas d'ordre ; nous croupissons dans notre tranchée où nul obus ennemi ne vient nous inquiéter et nous sommes pourtant à 500 mètres des lignes.
Les boches connaissent nos intentions et la 5ème division de la garde à pied nous attendait de pied ferme.
Il faut les décourager ; l'attaque est remise, la parole est toujours aux canons. Dans la nuit cependant changement de situation ; serait-ce pour demain matin ?
Pas du tout, nous appuyons un peu à droite et nous nous installons dans le ravin de Certeau toujours incertains du lendemain.
Je prends possession d'une petite baraque en planches et tôles ondulées à contre-pente dans laquelle se trouve un lit bois et treillage. J'y entasse en même temps toute la 1ère escouade. Un va et vient incessant de poilus d'artillerie ou autres trouble la nuit.
Cela ne nous embarrasserait guère si l'artillerie allemande ne bousculait pas un instant la quiétude de ce lieu. Quelques obus à ypérite surtout, nous frôlent. Cette baraque n'est pas un lieu sûr. J'abandonne mon lit et fait évacuer mon monde pour l'installer dans des trous à contre pente que chacun doit se creuser.
Bien m'en a pris.
Dans le cours de la nuit, un obus de 77 à gaz transperce l'amas de tôles et éclate sur une pièce du lit. Trois de mes hommes qui n'avaient pu résister au besoin de revenir dans la baraque étaient grièvement intoxiqués; l'un d'eux était légèrement blessé.
Les brancardiers les amènent au poste de secours.
22 octobre 1917
La veille de l’attaque
Le jour, beaucoup d'hommes déambulent dans le fond du ravin, malgré des ordres stricts de rester camouflés ; on laisse faire. Je me rapproche d'un emplacement de pièce de 105 camouflé au filet sous lequel des artilleurs préparent une prochaine mise en action.
Toute la batterie a été installée depuis deux jours, sous des camouflages en lisière nord du ravin de Certeau. Elle attend l'heure H moins quelques minutes pour ouvrir le feu. Jusque là elle doit rester muette à peine à 300 mètres des lignes.
Vers 13 heures, les chefs de section confirment l'ordre de se préparer pour 16 heures à aller reconnaître les parallèles de départ.
La mission s'accomplit en deux heures peu inquiétée par l'artillerie allemande.
C'est demain le jour « J ».
Sept jours que notre artillerie de tous calibres du 75 au 380, arrose les positions ennemis du massif de Laon, de Laffaux à Craonne. Une artillerie formidable qui en principe par son œuvre destructrice doit faire place nette aux fantassins qui dans quelques heures vont s'élancer en une ruée vers l'Ailette et vers Laon.
C'est pour demain 23 octobre 1917 aux premières lueurs du jour.
Ce soir à onze heures, nous allons occuper à quelques centaines de mètres, la parallèle de départ.
Dans le calme qui succède à la préparation d'artillerie de la journée, nous avons quitté le ravin de Certaux.
Il est onze heures; je pars le premier avec ma section en colonne par un, les autres sections suivent à petite distance.
Dans la journée sous les obus, nous avons bien reconnu notre itinéraire, vu notre place dans la tranchée qui double celle de Scutari.
Dans la nuit, je n'ai pas beaucoup de peine à la retrouver, sortir du ravin de Certaux par le haut du talweg en s'agrippant à la terre faute de chemin praticable. Une activité fébrile se manifeste sur les pentes qui montent doucement vers les premières lignes et où va se faire la veillée d'armes.
Sans cesse et non sans quelques difficultés, une petite colonne à la file indienne, s'immisce dans des groupes de territoriaux ou d'hommes des bataillons de réserve qui accomplissent une besogne obscure, mais combien glorieuse par l'appui qu'elle doit donner à ceux qui sont appelés à combattre.
Chaque groupe rencontré a une mission bien définie ; ceux-ci ceints d'une lourde écharpe faite de boules de pain ou chargés de musettes pleines à craquer, assurent le ravitaillement en vivres, ceux là de bons vieux territoriaux moins pressés visiblement fatigués, mènent par la main une colonne de petits ânes d'Afrique chargés à crouler de caisses de grenades ou de munitions diverses. Sans cesse il en passe coupant notre colonne malgré nos récriminations. Dans la nuit complice, il doit en être ainsi sur tout l'arrière immédiat du front d'attaque.
Quelle boucherie, si les boches se doutaient un peu de ce travail; chaque obus ferait certainement mouche et leur artillerie est quasi muette.
La montée en ligne
A travers le plateau, c'est un vrai va et vient incessant d'ombres qui passent et se croisent rapides.
Tout est fait de frôlements.
La besogne des ravitaillements se poursuit sans arrêt avec des périodes de silence et de cris assourdis. Leurs groupes sillonnent les pentes des creutes qui dominent le ravin d'Ostel. Malgré l'obscurité on les voit et on les devine à une longue traînée plus opaque que la nuit, qui défile à quelques pas.
On devine aussi les autres aux mille bruits que produisent les grosses chaussures dans un terrain détrempé, au rythme du bois du bât qui va et vient sur la croupe des petits ânes d’Afrique, au battement des anneaux et des courroies du bât, ou au cahotement des caisses sur le bât.
Parfois tout près de nous des hommes s'arrêtent essoufflés, profitant de notre passage pour respirer un peu, ployant sous leur charge de caisses ou autre objet, en s'appuyant sur un bâton ou pliés en deux musettes gonflées et pendantes tirant fortement sur les épaules.
Certains s'assoient dans la boue ou se couchant sur le côté, le haut du corps affalé sur le bras droit.
Nous passons sans un mot, mes hommes ressassant les mêmes idées qui précèdent leur nouvelle montée au calvaire ; idées pénibles du sacrifice de leur être empreintes de résignation et d'acceptation de futures souffrances. De temps en temps ma voix trouble le silence :
« Serrez ! Ne vous laissez
pas couper ! »
Ordres répétés par les agents et les caporaux.
L'un des sergents est en queue ; c'est celui en lequel j'ai le plus confiance. Il doit veiller sur ceux dont le cœur flanche et qui pourraient profiter de la première occasion pour lâcher la section.
C'est quelque chose d'inhumain de forcer de pauvres bougres aux nerfs faibles et pourtant le pays exige le sacrifice de leurs pauvres existences et nul n'a le droit de se dérober.
L'ennemi aurait la besogne facile pour nous submerger s'il n'y avait pas quelques âmes fortes, souvent malgré elles. La guerre est là avec ses misères.
Des politiciens pacifistes qui d'ailleurs, pour inviter à faire tout notre devoir, nous ont bercés et bernés jusqu'au dernier jour de paix.
Ils ont saboté notre machine guerrière, matérielle et morale pour nous pousser ensuite au sacrifice dans l'improvisation qui nous a coûté cher en hommes et en argent. On ne peut guère lutter à forces inégales contre un ennemi fin prêt et dont la machine matérielle et morale surtout, est portée à un haut degré de perfection.
Cette nuit est une sorte de veillée funèbre pour tous les acteurs qui vont participer au grand drame de demain.
Hélas tous n'arriveront pas jusqu'à l'ennemi; beaucoup tomberont en route, impuissants à se défendre contre des engins invisibles et précis. La calme actuel qui précède l'attaque est factice. On dirait que tous les engins de mort des deux parties se ménagent, font des réserves d'énergie pour mieux nous écraser un peu plus tard; comme s'ils voulaient nous faire mieux apprécier les quelques heures qui nous restent à vivre. Pourtant nous apprécions ce répit qui nous permet de rejoindre le parallèle de départ sans pertes.
Dans ce calme en cheminant, une angoisse m'étreint; la crainte que le bombardement ennemi ne reprenne avant que mes hommes soient à l'abri.
A chaque seconde il me semble entendre la masse de feu et de fer qui s'avance en trombe vers nous, imagination heureusement car les boches restent bien sages. Il me tarde d'arriver à cet élément de tranchée d'où je dois sortir au petit jour pour déloger le boche de son trou et le réduire.
Que les canons ennemis s'animent vers nous en ces instants de rude montée et c'est me semble t-il la dislocation de ma section sur ce plateau où tout est noir. Mon itinéraire longe de très nombreux trous d'obus pleins de caisses de grenades, de cartouches et de conserves alimentaires en vrac.
Dans tous les gros trous, des dépôts d'engins de mort ou de la nourriture pour ceux qui survivent. Le ravitaillement est poussé jusqu'aux lignes ; les corvées n'auront pas un grand trajet à faire pour s'approvisionner et c'est tant mieux. Cela nous prouve que l'affaire est bien préparée et que l'on nous soutient bien à l'arrière, arrière immédiat où pourtant des gens sont au paradis comparé à nous. Aussi en vue de cette grosse attaque tout est réglé par une main mystérieuse : mise en place des troupes de choc, préparation d'artillerie et ravitaillement divers.
Enfin nous voici arrivés.
La tranchée m'apparaît comme une masse plus claire que le sol environnant et très allongée dans la nuit ; ses bords sont comme deux livres pâles sur une figure de noir. Je reconnais ses contours et n'éprouve aucune difficulté pour m'installer au point qui m'est réservé. Un à un je place mes hommes face à l'ennemi.
L'appel démontre qu'il y a eu des défaillances ; cinq hommes de la section manquent à l'appel. Ceux sont naturellement ceux sur lesquels j'avais le plus de doutes sauf un, qui très jeune avait toujours fait son devoir. La nuit leur a été propice à la faveur d'un croisement avec des ravitailleurs, ils ont du se camoufler dans quelque trou.
Ceux-là ont ne les retrouvera plus qu'après l'attaque.
23 octobre 1917
L’attente de l’attaque
Il est minuit.
Jusqu'à cinq heures du matin nous avons le temps de nous reposer.
J'invite mes hommes à dormir un peu chacun s'organise disposant la toile de tente sur la tête pour se protéger d'une pluie fine et froide qui ne cesse de tomber depuis quelques instants. Longeant la tranchée, je rejoins le P.C du lieutenant non sans avoir défilé devant deux autres sections déployées à ma droite.
Tous les chefs de section étaient convoqués. J'arrive le premier auprès du lieutenant MENETRIER commandant la compagnie, qui doit nous communiquer les derniers renseignements et les derniers ordres sur l'attaque.
Dès que nous sommes au complet nous rendons l'appel. Pour les manquants, le lieutenant sera sans pitié. Que chacun prenne les noms et que celui qui reviendra de l'attaque les signale à l'autorité supérieure. Le Conseil de Guerre leur est réservé. Il y en a 14 à la 19ème compagnie.
Le lieutenant nous tient presque responsables de ces défaillances. Qu'y pouvons-nous ! La nuit il est bien difficile d'empêcher quelqu'un d'abandonner une colonne qui tient prés de 100 mètres et constamment coupée.
L'attaque doit partir à 5H15.
Après le passage de la première ligne allemande sur laquelle il doit y avoir un arrêt d'une demi-heure, notre rôle consiste en un nettoyage des abris allemands et en particulier de la creute Ste Berthe prés de la fontaine du même nom.
Ma section qui doit coiffer cette dernière dispose d'un appareil lance flammes Z (cylindre de diamètre environ 30cm; hauteur 0,80cm, manche comme un appareil Vermorel pour sulfater les vignes) pour impressionner les défenseurs qui voudront résister, sinon pour griller s'ils ne veulent pas se rendre.
Les derniers conseils reçus et l'heure officielle donnée, je rejoins ma section où plusieurs hommes paraissent endormis, affalés dans la boue ou appuyés au parapet. Il est minuit trente et tout est tranquille. Je me recroqueville tant bien que mal dans un coin de tranchée, les pieds dans l'eau, la toile de tente sur la tête en attendant l'heure fatidique où nous foncerons sur l'ennemi, serré contre trois de mes hommes, nous nous réchauffons mutuellement.
Je sommeille bien quelques instants malgré une inquiétude perpétuelle qui tend mes nerfs par cette veillée d'armes.
Les planquÉs de l’arrière : Qu’ils y viennent eux !
L'imagination qui nous surexcite montre les choses les plus tragiques qu'elles ne sont en réalité.
Et puis il y a encore et toujours le souvenir de ceux qu'on a laissé bien loin à l'intérieur du pays, il y a aussi les évènements qui vont suivre et d'où peut être nous ne reviendrons pas vivants, la responsabilité de 35 hommes, la ruée sous les obus et les balles, la collision avec les boches et c'est la guerre qui est devant nous.
L'attente est la pire des défaitistes ; vision de la mort, le brusque arrêt dans un court râle, de notre pensée, de notre activité. Quelle souffrance morale il faut endurer !
Peu de gens de l'arrière se doutent de cela.
Beaucoup nous diront même au cours de nos permissions, que leurs angoisses pour les leurs qui sont là-haut sont pires. Ceux de l'arrière immédiat des lignes nous disent que ceux qui sont en avant ont moins de risques sous prétexte que l'ennemi évite de bombarder les premières lignes de crainte de toucher les siens. Il y a de quoi rire.
A les entendre tout est réservé à ces pauvres gens de l'arrière immédiat, mais ils se gardent bien de demander à venir relever ceux de l'avant.
Savent-ils seulement ce que c'est que de n'avoir personne devant pour nous protéger et vous assurer un brin de sécurité. Ont-ils réfléchi seulement au courage qu'il faut déployer pour aller chercher l'ennemi dans son trou et pour le réduire coûte que coûte, au couteau s'il le faut, quand il ne faut pas le recevoir baïonnette haute après avoir supporté un écrasant déluge d'obus qui assomme et met dans un état d'hébétude jusqu'à l'apparition impressionnante de l'ennemi qui a pour lui l'avantage de l'assaillant, celui d'avancer coûte que coûte jusqu'à son objectif, ce qui lui donne déjà une force morale extraordinaire ?
Certains ne peuvent réagir aux premières minutes tragiques : ils fuient vers l'arrière ou bien sont incapables du moindre mouvement comme si soudain une paralysie les avaient terrassés et c'est la reddition à l'ennemi, ce qui est pire avec son accompagnement de bassesse, cris ou gestes de supplication, sursaut de l'instinct de conservation qui s'accroche à l'espérance de la miséricorde humaine. Combien qui ont abandonné aussi leur pays à leur triste sort; on ne peut les blâmer.
De loin bien des choses semblent possibles ; devant une bonne table de café, il est toujours facile de résister. Pour un esprit reposé, au milieu de ses aises rien ne paraît impossible; des ennemis il n'en ferait qu'une bouchée.
Pour cet esprit peu en danger, le pauvre bougre qui n'a pas pu résister à l'enfer guerrier est un pleutre, un peureux, un lâche.
C'est facile à dire quand on ne risque rien; il aurait fallu se trouver dans sa situation pour le juger ainsi. Beaucoup de ceux pour lesquels la critique est aisée n'ont jamais fait un pas pour aller remplacer les pauvres bougres qui ont flanché parce que leurs nerfs étaient lâches.
Bien des chefs supérieurs sont durs parce qu’ils ne raisonnent pas et qu'eux sont le plus souvent à l'abri.
Beaucoup de ces gens d'arrière qui critiquent vous disent :
« Moi, si j'étais jeune, ou
si j'avais la santé ! J'ai fait des demandes pour être pris et on m'a refusé
! »
Ou bien
« J’étais indispensable pour des
écritures très compliquées »
Ou autres prétextes ou sinécures qui leur permet de suivre bien à l'aise de loin, les misères et les souffrances de ceux qui n'avaient pas d'appuis, de protection.
Combien de pauvres, récupérés à la santé plus que précaire, maigres, porteurs de tares faisaient nombre dans nos rangs, sans grand bénéfice pour nous, souvent incapables de se servir d'une arme : quatre mois de classe et la boucherie.
Il paraît que c'est suffisant pour faire un soldat.
Aller de l'avant sans tirer un coup de fusil ou bien tirer dans le ciel, voilà tout ce qu'on pouvait demander à ces pauvres bougres.
Petit à petit, la vie de tranchée les instruisaient, par une pratique constante de l'appareil guerrier qui leur montre souvent la négation de ce que l'on enseigne à l'arrière. La réalité est une, et l'imagination des chefs qui n'ont eu souvent aucun contact avec le front, est une autre.
Ici on tire souvent quand on veut sur toute chose qui se déplace devant soi, on apprend vraiment à s'abriter, à utiliser le moindre abri, à faire corps avec la terre et ce qui a été difficile à assimiler à l'instruction, l'expérience nous le donne en peu de temps à nos dépens.
L'homme devient fataliste et ses réflexes quasi automatiques, tout au moins pour la défense.
Qu'il marche et il embrassera pesamment la terre pour un obus qui l'impressionne ou le surprend de son souffle puissant, aux balles de mitrailleuses qui brusquement lui claque aux oreilles à l'étourdir ou font comme une danse de petits diablotins sauter la terre autour de lui en petits jets ; sous ces dernières il sortira vivement des trous pour aller de l'avant en bons énergiques d'où il part comme projeté. Dans une sarabande d'abeilles mortelles et une course folle, il usera tout son souffle jusqu'à tomber épuisé malgré les chutes de ses voisins touchés à mort, roulant dans un bruit de gamelle qui heurte le sol d'un choc sourd accompagné de plaintes.
Sa chute se fera tout d'une masse et il roulera jusqu'au fond d'un trou, le souffle court, comme un paquet de vieilles hardes jetées. Il sent à peine ses jambes qui tremblent après l'effort.
Dans une demi-minute d'hébétement, les yeux gonflés, la figure crispée, il cherche sa respiration et le calme de l'instant d'arrêt. Plaqué à terre, haletant, les yeux fixes, il revient lentement au calme et à la vie, parle enfin à ceux qui l'entourent et qui sont comme lui, tous ensemble, heureux d'en avoir réchappé encore une fois en attendant de recommencer dans quelques instants.
Pendant le court arrêt, ils commentent la marche de la section, la mort de camarades, la blessure filon de quelques autres, l'état des lieux qu'il vient de parcourir, l'aspect de celui vers lequel il va avec les obstacles qu'il faudra surmonter; la position probable des mitrailleuses qui balaient le terrain et tout cela en attendant une accalmie problématique des engins de mort et surtout du déluge de balles qui rasent les lèvres du trou menaçant toute tête qui se lève.
On attend que les mitrailleuses soient occupées ailleurs, car elles se lassent de tirer sur un coin de terre où rien ne bouge plus, allant semer ailleurs sa graine de mort, non sans garder un œil vigilant sur un point qu'elle sait occupé par un ennemi qu'il faut exterminer pour éviter d'être manœuvrée.
Le balai, quand il n'y en a pas plusieurs qui s'entrecroisent sur nos têtes comme une sorte de musique aiguë ou grave allant crescendo en s'éloignant à droite ou à gauche, peut devenir strident lorsqu'il à quelques centimètres au dessus de nous avec un claquement si sec, si puissant que la tête en est ébranlée et toutes les cellules comme disloquées par des trépidations dissymétriques, à croire qu'une sonnette électrique est en action dans un coin de non identifiable de notre crâne.
L'éloignement du délai est mis à profit pour un nouveau bond, vite arrêté par une affolante décharge de mitrailleuse qui vous reprend haletante ; la marche continue avec des intervalles d'arrêts, le tout coupé d'incidents produits par des boches qui se rendent ou par un échange de grenades qui éclatent avec un bruit aigu ou sourd de grosse porcelaine écrasée qui semble insignifiant sous les grosses explosions d'obus et qui cependant sont plus dangereuses avec leur multitude de petits éclats qui se dispersent en rasant le sol sur un grand diamètre.
Le défenseur réduit, lève les bras en implorant pardon et vie sauve ou bien l'assaillant à bout de forces, se terre ou se tient coi et il faut que l'un d'eux crie « grâce ».
Le bombardement
Brusquement vers 1 heure du matin, des lignes ennemies, une série de départs suivis à quelques secondes de souffles puissants et d'explosions retentissantes ébranlent l'air nous faisant sursauter et rompant le cours de nos réflexions. Notre zone s'embrase sous une écrasante masse d'obus qui explosent avec fracas.
De tous côtés il en est de même sur toute la ligne, les boches exécutent un formidable tir de destruction. Ils s'attendent à notre attaque; ils ont compris que le silence de nos canons précède l'instant critique de l'attaque.
Ils déclenchent pour la dissocier une contre préparation formidable. Sous l'avalanche brutale, je vais et viens au milieu de mes hommes prêts à tout événement. L'élément de tranchée occupé par ma section est suffisamment protégé par la contre pente. Il n'en est pas de même plus à gauche du côté des Chasseurs de la 66ème division et sur le 283ème, 30 mètres en avant de nous.
De gros obus de 150 et du 210 arrivent en une charge puissante de bête fauve qui pousse son dernier souffle de vie avec un hurlement monstrueux qui tire de la terre en s'intégrant à elle et en la disloquant comme un cri douloureux d'épouvante, soulevant et précipitant dans les airs des mottes énormes au milieu d'une crasse noirâtre qui tend avec violence mille bras nouveaux vers le ciel, de tous côtés. Un bouleversement diabolique se manifeste et nous trouble intensément malgré le masque dur que je fais. La terre tremble par secousses violentes et paraît se disloquer sous nos pieds, contre nos corps.
Chez nous la terre résiste encore; seuls des vrombissements puissants nous écrasent du poids de l'air déplacé, créant l'angoisse respiration sans grand mal avec la vibration intense produite par de puissantes explosions à nous toucher.
De temps en temps, il semble qu'un cataclysme se rapproche et que le trou d'écrasement de notre parcelle de terre est arrivé. Pas encore pourtant ! Les souffles puissants nous caressent semblant pour l'instant nous ménager pour faire durer notre souffrance ou bien n'arrivent pas jusqu'à nous comme pour nous dire à bientôt; ce sera votre tour la prochaine fois en nous couvrant de terre.
Tous ensembles accroupis tassés contre le parapet, anxieux, mais l'arme haute, nous attendons dans cet enfer l'heure du départ qui sera l'heure de la délivrance. Chaque explosion nous illumine en éclair qui disparaît avec des gestes de folie, composés de mille lueurs fugaces essayant de percer une fumée vague et grise qui s'évanouit un peu moins vite.
Que nous sommes peu de choses.
Quel bonheur que notre crâne n'éclate pas dans ce tonnerre et sous les mille idées tragiques qui surgissent dans notre cerveau, dans la tension nerveuse qui se manifeste et nous contraint un peu plus à chaque explosion rapprochée, qui vous assomme, vous coupe le souffle en vous couvrant d'une masse de terre fine ou de grosses mottes, dans une fumée acre qui remplit la tranchée, crispant la gorge.
Ma pensée se porte constamment sur notre prochaine sortie. Ce tir d'écrasement cessera t-il avant notre départ ?
Il me semble que les mitrailleuses ne sont rien à côté de ces remous fantastiques et de ces bruits furieux. Il nous tarde de partir en avant, de quitter ce lieu d'enfer et ce désir m'étreint sans cesse. Chacun de mes hommes à la même pensée ; puisqu'il le faut, que cette attente cesse au plus vite.
Aller chercher le boche, c'est à dire agir, ne sera rien à côté de cette tornade qui met nos nerfs et nos cerveaux à rude épreuve.
De temps en temps, les artilleurs boches paraissent se fatiguer. La densité des obus à nous destinés, paraît diminuer.
Ramassés, une dizaine dans le recoin d'une pare-éclat ou nous nous croyons à l'abri des explosions, nous sommes serrés les uns contre les autres pour avoir chaud, suspendus par la pensée au barrage. Muets, enveloppés à nouveau dans nos toiles de tente, nous essayons encore de dormir.
Maintenant la nuit s'achève; il est 4H30, l'obscurité s'atténue à peine pour faire place à une grisaille que les explosions d'obus déchirent sans cesse en formidables courants d'air.
Mon désir ne sera pas exaucé, les boches persistent à entretenir le barrage. La traversée va être pénible et dangereuse sinon tragique. Je parcours la tranchée pour donner mes derniers ordres; tous les hommes prennent leur place d'assaut, prêts au sacrifice, l'oreille tendue dans l'éventualité de la fin du barrage allemand.
L'heure H approche et il est à peine 5 heures lorsque les artilleurs qui jusque là étaient restés muets, déclenchant brusquement et avec un ensemble parfais, une canonnade extraordinaire.
Les obus de nos pièces passent en masse sur nous en hululements graves ou aigus ou dans un sifflement perçant de toile qui se déchire, avec plus haut dans l'air un véritable sillage d'express ou de train de marchandises qui se suivent à peu de minutes d'intervalle.
Derrière nous, l'orient s'embrase et s'illumine comme à la seconde ou le soleil paraît à l'horizon, dans lequel une multitude de larges éclairs entretenus jouent à paraître ou à disparaître des dixième de secondes en une furie indescriptible; un jeu d'échec ou les proies s'auréolent en longueur et en profondeur, empruntant en une multitude de couleurs un ciel gris et sale.
Cet embrasement de l'horizon français, s'est fait comme par enchantement. Une véritable ligne de feux en fureur faites de points clairs qui trouent une aube terne s'entremêlent, s'enchevêtre ou se juxtaposent brusquement surgis et entretenus, dominant un véritable feu d'artifice merveilleux. A quelques mètres en plein champ, couverts par une toile de camouflage, des 75 muets depuis de longs jours, aboient crachant la mort et l'épouvante. Leur coup de départ nous arrive avec l'éclair de la bouche du canon comme le claquement d'un fouet énorme et puissant suivi à la même seconde d'un sifflement strident. Les crapouillots, mortiers de 58 et jusqu'au 240 installés dans un élément de tranchée à droite à peu prés à notre hauteur, s'échauffent à lancer le plus d'obus possibles.
Le départ est sourd « paououc – paououc - paououc » et l'obus projeté donne l'impression de donner une grosse résistance à l'air.
Dans les lignes allemandes le tonnerre gronde et s'amplifie de minute en minute.
Une tornade épouvantable de fer et de feu d'un sinistre indescriptible par sa masse de fumées entre lassées, ravage des hectares de terre balayant et secouant le plateau du Chemin des Dames et vallée de l'Ailette comme une région maudite.
Je remarque avec mes poilus que si nous n'étions que de simples spectateurs, ce feu d'artifice nous émerveillerait, nous transporterait d'enthousiasme. L'un deux fait même la réflexion que beaucoup paieraient très chers notre place, pour voir un pareil tableau, assister à un tel spectacle, à une aussi belle illumination dépassant tout ce que l'on peut imaginer en féeries de couleurs sur un ciel gris qui blanchit du rouge violacé ou orange au jaune clair en passant par le gris bleu de rouille. On ne peut pas faire plus beau et plus saisissant.
Notre situation nous engage à moins d'enthousiasme.
C'est pour nous le prélude d'une drôle de fête qui va commencer et notre imagination ne dépasse pas les horreurs que cette féerie va nous coûter de vies humaines et d'héroïsme dans quelques instants.
L’attaque
5H15 c'est l'heure H, il faut sortir.
Des coups de sifflets retentissent. Le long de la tranchée les mots « EN AVANT » courent de bouche en bouche comme une traînée de poudre et nous fouette en surprise.
La minute est impressionnante, le cerveau reçoit et transmet au corps en une seconde une secousse qui nous jette en terrain découvert, enregistre une image fantastique de destruction de l'ennemi, le besoin de lui sauter à la gorge vite pour le rendre inoffensif. Tout cela résonne en une seconde, toutes nos peurs d'êtres humains, imbus de l'esprit de conservation, vaincues. On hésite un peu après le premier choc au départ, puis l'hésitation disparaît devant la nécessité d'agir.
Grimpé sur le talus de la tranchée, je raisonne en deux mots quelques hésitants sur lesquels d'ailleurs je n'avais déjà qu'une confiance relative, à faire comme les camarades. Tout le monde hors de la tranchée c'est la ruée vers le barrage et les boches la baïonnette haute.
Au milieu de l'ouragan d'obus du barrage ennemi, la minute est poignante ; il ne faut pas réfléchir. S'engager dans cette zone infernale, c'est mépriser sa peur. Braver ces explosions infernales et cette ferraille qui cingle, c'est vraiment défier la mort ou plutôt préférer à la honte de la fuite, le coup mortel qu'infailliblement on doit recevoir.
Dans bien des âmes, la crainte des conséquences d'un recul, d'une mise à l'abri frauduleuse, des responsabilités du chef est plus forte que la peur. On la surmonte parce qu'il faut en passer par là, qu'il n'y a pas d'autre issue. Après tout il en reviendra toujours quelques uns et l'on peut être de ceux-là. De gré ou de force il faut y aller, le plus souvent à contrecœur, mais c'est la loi des pauvres bougres de l'avant.
Huit jours que la préparation d'artillerie écrase les lignes adverses.
En principe après un pareil pilonnage l'ennemi doit être anéanti. Ma section disparaît dans la fumée du barrage ennemi. Devant nous une demi-section de la 1ère section court vers un élément du boyau.
Au moment où ils y arrivent, un obus déboule en trombe, scalpe un porteur de lance flammes, réduisant en miettes le haut de son appareil « Child ». Le liquide se répand sur le sol sans s'enflammer. Deux autres poilus sont aussi blessés et l'un deux touché grièvement au dessus du coude gauche, roule à mes pieds. Je l'aide à se relever et poursuis ma route sous une nouvelle dégelée d'obus en allongeant plus vivement le pas, en enjambant pour pénétrer dans le boyau, le lance flammes mort.
A peine ai-je sauté qu'un nouvel obus tombe dans un trou boueux plein d'eau à deux pas de ma section en colonne par un dans le boyau, nous faisant plus de peur que de mal. Ses éclats lourdement imprégnés d'une boue grasse, ne vont pas loin et nous cinglent comme d'énormes bourdons.
La pluie nous est propice, en détrempant le terrain et en le transformant en lac de boue, rend les obus plus inoffensifs. Nous éprouvons plus de difficultés à courir dans cette fange argileuse. Un nouvel obus de petite dimension du 77 que je vois nettement arriver au sol sur le rebord du boyau, n'éclate pas, glisse sur le rebord pour rebondir sur l'épaule de l'homme qui me précède et qui pousse un hurlement de douleur et d'épouvante au choc.
L'obus tombe à nos pieds avec un bruit sourd sans éclater; un frisson glacé m'a couru le long de l'échine. L'homme touché est sérieusement contusionné; il souffre. Je l'envoie au poste de secours.
Nous venons de l'échapper belle.
Nous abordons la tranchée allemande nivelée que le 283ème a largement dépassée.
Ce barrage s'intensifie sur le lieu que nous traversons et une trombe d'obus s'abat sur notre droite sur le groupe de liaison du commandant de compagnie, tuant le sergent observateur SAUVAGE (*) auquel un obus avait arraché le bras droit, blessant grièvement le lieutenant MENETRIER (**), commandant la compagnie : gras du mollet gauche traversé de part en part par un gros éclat et commotionné sérieusement ainsi que deux poilus et l'adjudant de la compagnie qui reste plus d'un quart d'heure hébété et sans voix.
Le lieutenant VALETTE prend le commandement de la compagnie.
Nous courons sous l'avalanche de fer et de feu, accueillant sans y prêter trop d'attention, des prisonniers allemands aux galons blancs de la garde, déjà coiffés par les compagnies d'attaques du 283 ème RI ou des Chasseurs qui ont progressé rapidement en laissant des morts et des blessés sur le terrain que nous abandonnons nous aussi à leur triste sort pour notre mission.
En passant, les prisonniers lèvent les bras et crient « camarades, pardon monsieur » avec des airs horrifiés.
Depuis le début de l'attaque l'infanterie allemande n'a pas trop manifesté sa présence; seul le barrage nous a fait beaucoup de mal. De ci de là, nos sections ont quelques pertes à déplorer. Une heure après le départ de l'attaque, l'artillerie allemande se tait; elle paraît déménager, se retirer. C'est donc que l'attaque marche bien pour nous.
Seuls quelques obus très dispersés et produisant en explosant une petite fumée café au lait (obus à gaz) nous cherchent.
Arrêtés sur la ligne de crête du Chemin des Dames selon l'horaire prévu, nous découvrons toutes les pentes descendant vers l'Ailette sur PARGNY FILAIN et jusqu'à VAUXAILLON.
A côté de nous, les Chasseurs de la 66ème division du général BRISSAUD DESMAILLET progressent à gauche et l'on découvre leurs petites colonnes ou petits groupes allant de l'avant, apparaissant et disparaissant dans les divers replis de terrain ou éléments de boyau.
Vers le fort de Malmaison, je distingue à la jumelle des groupes tous petits qui le débordent.
L'enthousiasme chez nous est à son comble malgré l'instant critique. L'infanterie allemande s'est réveillée, l'alerte a été donnée. Les premières positions coiffées et l'effet de surprise passé, les mitrailleuses entrent dans la danse.
Celle de la ferme de la Rozère et surtout du village de Monampteuil, véritable nid d'aigle de l'autre côté de l'Ailette sur notre flanc droit, nous gène beaucoup, nous faisant quelques pertes. Les balles claquent cependant assez haut.
(*) : SAUVAGE Fritz, sergent, mort pour la France le 23
octobre 1917 à Ostel (Aisne), tué à l’ennemi. Il était né le 22 octobre 1885 à
Houga (Gers). Pas de sépulture militaire connue.
(**) : Le lieutenant MENETRIER Auguste, de Dinard
(Ille-et-Vilaine) sera soigné à l’hôpital de Rennes jusqu’à la fin de la
guerre. Il mourra le 12 février 1919 à Dinard (Ille-et-Vilaine) de suite de
maladie. Il était né à Dinard-Saint-Enogat (ancien nom de Dinard) le 11 juillet
1880. Il sera déclaré mort pour la France. Il est noté « lieutenant du 288e RI, provenant de la
territoriale » (JMO du 288e RI du 20/02/18)
Consulter sa fiche matriculaire ici et ici
Extrait du JMO du 288e RI, journée du 24 novembre
1917
les abris allemands, les prisonniers, avoir pitiÉ
Après la demi heure prévue dans le bilan d'attaque sur la deuxième tranchée allemande entièrement bouleversée et même en beaucoup d'endroits absolument nivelée et abandonnée par les Fritz, nous reprenons la progression.
Notre arrivée sur la portion de résistance ennemie se fait sans coup férir. Par endroits elle est aussi nivelée que la première. De deux abris que nous coiffons sortent trois allemands qui demandent grâce.
Les abris sont à moitié comblés et pour arriver jusqu'à nous, les prisonniers remontent une pente raide de terre meuble qui recouvre les escaliers sur au moins 60 cm d'épaisseur, en s'agrippant malaisément à cette terre qui se dérobe sous leurs genoux et leurs mains; une terre réduite en poussière tombée de toutes les parties de l'abri d'où elle a glissé comme on passe le grain dans un crible pendant tout le bombardement jusqu'au fond de l'abri, couvrant les marches d'accès de l'escalier de 30 à 60 cm d'épaisseur.
Des capotes « felgrau », des fusils, des équipements maintenus par de longues pointes sont visibles le long des parties hautes de l'abri. Les boches enfin sortis de leur trou, véritables pantins apeurés, supplient agenouillés sur cette terre qu'ils franchissent difficilement. Une lueur d'hésitation se lit dans leurs yeux; la peur de la balle meurtrière et des coups. Ils portent les pattes blanches de la garde.
Nous les invitons à se joindre à un autre groupe de prisonniers qui fuient vers notre arrière à toutes jambes.
Les deux abris paraissant vides d'êtres humains, nous jetons trois jetons deux grenades incendiaires pour plus de sûreté ; surtout pour éviter d'être pris par derrière. Une énorme fumée blanche sort en grandes bouffées de l'intérieur des trous, le phosphore par larges flammèches doit achever l'œuvre de destruction, pendant que nous conduisons la progression.
Sur notre gauche à une vingtaine de mètres, un abri en superstructure laisse voir des rondins énormes verticaux, déchiquetés par les obus.
Sous nos yeux le reste de mitrailleurs qui l'occupaient s'est rendu à des éléments du 283ème.
Ils se sont presque prosternés devant nos poilus. On leur montre la route de l'arrière et ils fuient sans demander leur reste.
Quelle force de volonté ont-ils du devoir pour rester dans cette cage cylindrique formée de gros rondins, plantés en quinconce sur trois rangs, qui se démantelaient et se disloquaient lentement à chaque arrivée de gros obus dont l'explosion soufflait la terre masquée.
Le terrain tout autour est défoncé, bouleversé et en maints endroits montre des trous de plus de trois mètres de diamètre sur un 1,50 ou 2m de profondeur. Les rondins, gros d'au moins 30 cm de diamètre, profondément enfoncés dans le sol, sont déchaussés et lamentables.
Ici, notre grosse artillerie a fait du bon travail.
Trois cadavres sont encore dans l'abri, un blessé agonise de blessures qui ne sont pas d'aujourd'hui. Des morts du 283ème de chez nous, jonchent le sol, tantôt groupés, tantôt dispersés. Il y en a un qui est partagé en plusieurs tronçons, la jambe gauche presque en entier est à peine séparée du corps et forme bouillie dans sa partie supérieure avec le drap bleu du pantalon.
Devant nous, un groupe important du 283ème s'empare d'un élément de tranchée ou essayent de résister une quinzaine d'allemands. Un blessé par balle qui passe auprès de nous, nous apprend qu'un gradé allemand tout jeune aspirant ou sous-lieutenant, a menacé le capitaine LUCIANI du 283ème et que celui-ci l'a abattu d'un coup de revolver; les autres n'ont plus offerts de résistance.
D'un bond, ils se sont précipités aux pieds du capitaine et les premiers hommes arrivés se sont agrippés à sa capote en implorant clémence. Maintenant ils fuient déséquipés, grotesques, accompagnés par un seul poilu et passent prés de nous. Ils portent les pattes blanches des soldats de la garde.
Ils mettent une hâte compréhensible à mettre du large entre eux et les démons qui viennent de les déloger de leurs trous. Leurs yeux effarés expriment une telle terreur, une telle angoisse, leur visage est si livide, si terreux, si crispé, qu'une pitié nous envahit malgré la vision de nos morts, de tant de camarades qui viennent de jalonner notre chemin de croix et malgré la haine qui est en nous contre cet ennemi qui nous a déversé tout à l'heure des tonnes d'acier impitoyables.
Cette pitié nous fait ménager ces hommes qui quelques instants auparavant semaient la mort dans nos rangs. L'un d'eux qui parlait très bien le français, prétend que son unité est restée trois semaines en position de ligne.
Dans l'abri passé, les deux mitrailleuses « maxim » gisent sur le sol, deux petits monstres trapus et mastoc avec leur réservoir d'eau pour refroidir le canon et leur affût massif comme un traîneau. Leurs canons nous menacent toujours, maintenant inoffensifs pendant que les servants, indemnes fuient dans nos lignes, loin déjà sans doute, relevant à chaque rencontre de français, des bras qui implorent grâce, lâches et veules, mais déjà plus calmes et certainement avec la joie au cœur d'en avoir enfin fini de cette guerre.
Leur fuite ne sera pas trop gênée par leurs propres obus.
Depuis huit heures, les artilleurs d'en face font trêve, probablement pour sauver leurs pièces menacées par notre avance. Les mailles du filet que constituaient le barrage puissant de l'aube, se sont largement desserrées et chaque joint marqué par les soubresauts des explosions est maintenant nettement marqué.
Les obus qui tombent à quelques mètres, nous donnent plus de répit; ils sont plus lents à nous chercher comme si les pièces qui nous les envoient étaient lasses. Ceux qui tombent plus prés, plus rapides, semblent venus simplement pour nous rappeler qu'il faut encore veiller au grain et compter sur un ennemi qui n'est pas encore vaincu.
Mais celui-ci aurait-il peur ? Est-ce le commencement de la sagesse ?
Il ne nous envoie plus les gros noirs qui s'écrasaient le matin à peu de distance l'un de l'autre. Son gros barrage bravade est-il tombé parce qu'il escompte notre succès ?
Jusque là cette menace ne l'avait guère touché. Et puis ne compte t-il pas sur les régiments d'élite de sa 5ème division de la garde à pied qui aurait fait paraît-il la relève la veille au soir et qui est donc une troupe fraîche; plus fraîche que nous qui avons passé trois jours dans ce secteur d'enfer. La relève a du être dure sous notre formidable préparation.
Les éléments de la garde épargnés par notre feu roulant, n'ont pu atteindre complètement leurs premières lignes. Ils sont restés dans les ravins de Pargny-Filain et de l’Ailette où ils ont essuyé de grosses pertes.
Les survivants se sont tapis dans de profonds trous d'obus et dans les abris très nombreux de la contre pente, dans les creutes (carrières) véritables cavernes à l'épreuve des plus gros obus. Cette dispersion de bonnes troupes va aider notre victoire; elle va permettre une cueillette d'hommes de guerre constituant l'élite de l’Armée Impériale allemande.
Cette récolte ne se fera pas sans beaucoup de casse.
Nous avons eu beaucoup de tués et de blessés.
Le sous-lieutenant commandant la 4ème section est tué par un petit obus à gaz qui le cloue au sol. (*)
En deux heures nous avons à peine avancé d'un kilomètre par petits bonds sur les pentes qui descendent vers l’Ailette et qui sont sans cesse balayés par les mitrailleuses de Monampteuil, véritable nid d'aigle sur les pentes abruptes de l'autre côté de l'Ailette.
Des lisières de Pargny-Filain même à quelques centaines de mètres devant nous les moulins à café de la mort tournent affolés. A plusieurs reprises et au moment où devant nous le terrain paraît nettoyé, une mitrailleuse surgit et nous fusille à bout portant ; il faut engager une lutte sans merci. On hésite, on flotte, on manœuvre pour s'en rapprocher par bonds rapides et courts.
Entre nos hommes et eux, il faut que l'un des groupes meure ou se rende, la guerre le veut aussi.
(*) : LAMARQUE Léon, sous-lieutenant, mort pour la France le 23 octobre
1917 au chemin des Dames, tué à l’ennemi. Il était né à Fleurance (Gers) le 30
octobre 1882. Il est inhumé à la nécropole de Soupir (Aisne), tombe N° 1147.
L’attaquant et le dÉfenseur
Chez l'assaillant l'action est l'impulsion puissante d'une énergie qui veut accomplir sa mission sans folle témérité et chez le défenseur l'activité est réduite, l'action est bridée par la menace d'un danger plus grand. Le défenseur appréhende toujours le pire sous les bombardements qu'il a du subir, il est moins entrain et déjà sous l'empire d'une certaine terreur.
L'assaillant qu'il sait décidé à le réduire, le pousse à esquisser un geste de défense d'abord, ou à échapper à l'étreinte, à prévoir éventuellement un chemin de fuite s'il est débordé, à penser sans cesse à une retraite précipitée avant que l'assaillant ne l'ait débordé, toutes choses qu'il n'appréhenderait pas s'il était de sans froid, c'est à dire s'il n'avait pas déjà subi l'assaut de moyens matériels puissants contre lesquels il ne peut rien.
Le défenseur à neuf fois sur dix le dessous. Il se fait tuer sur place en se défendant, ce qui est mieux que se faire tuer en fuyant, ou bien il se rend avec toutes les humiliations que comporte cette éventualité.
Chez l'assaillant l'énergie, la volonté de détruire décuple ses forces. Rapidement il est capable d'amorcer une manœuvre.
De loin quelques VB bien placés font taire les mitrailleuses qu'il est possible de dénicher ou les font tirer en l'air. Le temps mis à profit on avance de tous côtés si l'on peut, car il faut agir vite et coiffer l'engin de mort avant qu'il ne puisse faire son œuvre malfaisante.
Les tireurs le servent de toutes leurs forces morales et physiques mais ils sont occupés en tous sens, distraits quelques fois de leur mission de flanquement en particulier. Ils ne nous gênent guère que par quelques rafales qui passent légèrement haut, suffisant un instant à nous plaquer au sol. Vautrés dans la terre après une courte course extra rapide, on en surgit tel des diables à ressort, tantôt tirant, tantôt courant en jalonnant notre route de camarades qui s'écroulent avec un cri, un appel au secours ou sans un mot, simplement dans une chute sourde accompagnée d'un bruit sonore et métallique du bidon, de la gamelle heurtant le sol.
Souvent le corps roule et se ramasse sur lui-même en une seconde, entraîné par l'élan de la course. Il se tasse dans une dernière convulsion de tout l'être.
Ainsi des camarades ne sont plus; d'autres touchés à mort, amorcent en vain un mouvement de relève, comme pour s'accrocher à quelque chose, le râle court, dans un besoin de respirer qui est presque un spasme, puis retombent convulsivement avec un tel regard de détresse où le dernier souffle de vie se concentre, regard inexprimable qui parle et vous crie :
« Sauvez-moi, pour mes parents, ma femme, mes enfants, pour moi ».
Oh ! Que ces regards de mourants agrippés à la vie comme en une ultime seconde, sont expressifs !
Dans la profondeur de leurs prunelles, s'amasse toute la lumière violente, indéfinissable et l'image de tant de souvenirs venus en foule pour disparaître pour l'éternité.
La mitrailleuse boche
Bientôt on la touche presque cette mitrailleuse maudite; elle est à portée de la main 30 à 50 mètres, mais elle tire encore rageusement alors que le 283ème aurait dû la coiffer protégé sur ses flancs par celles de Monampteuil et de Pargny-Filain, peut être même de la Rozère, point extrême de l'attaque où la 17ème doit avoir du fil à retordre avec les creutes qu'elle doit nettoyer au lance-flammes.
Elles mêlent leurs voix aiguës à la sienne. La terre autour de nous frémit et tressaute comme un sirop qui bout ; les balles frappent le sol en cadence et chacune provoque son jet de terre. Des claquements bruyants et secs endolorissent le tympan et nous secouent de la tête aux pieds. Coûte que coûte il faut l'avoir, la détruire comme une bête malfaisante et la poignée d'hommes qui reste encore debout sous l'impulsion du sous-lieutenant VALETTE et de moi-même, tapis dans les trous, jetons comme une volée de pierres, une dégelée de grenades O.F qui explosent avec un bruit formidable d'averse en grosses gouttes qui sifflent en tous sens, fustigeant l'air avec une plainte sinistre.
Arc-boutés à la parois du trou d'obus, la décharge à peine passée, nous bondissons comme un seul homme « en avant – en avant ! » vers la mitrailleuse. Les servants sous l'avalanche des explosions ont du baisser la tête, car la mitrailleuse s'est tue quelques secondes pour reprendre son « claouc claouc claouc ... » formidable tout prés, mais elle est mal réglée et le tireur s'affole.
Il nous ajuste fébrilement.
Un homme de ma section tombe et ce sera tout le mal qu'il nous fera.
Une balle a bout portant le cloue sur la pièce; ses camarades deux beaux boches ont déjà levé les bras et suppliants, peureux, affolés, incapables de réaction de défense, fuient vers l'intérieur de nos lignes où ils seront accueillis et canalisés vers l'arrière. Dans son trou le tireur allemand affalé sur la mitrailleuse, une seule main crispée sur une des poignées, râle doucement.
Dans le fond du trou un autre boche blessé au ventre par un éclat de grenade se plaint lamentablement, ses yeux implorent le clémence, hagard, grands ouverts, de beaux yeux bleus comme sortis des orbites, sont d'une mobilité extrême, surveillant les moindres faits et gestes de nos hommes. On s'occupe peu de lui.
Nous sommes six dans le trou tassés avec ces boches et l'avance doit continuer. Il a fallu prés d'une demi-heure d'efforts pour réduire la mitrailleuse et la rendre muette et il y en a d'autres dissimulées sur le terrain et qu'il faut aussi museler.
Des rafales de balles passent un peu hautes. Il n'y a guère maintenant que les mitrailleuses de la Rozère qui balaient les pentes sur lesquelles nous sommes. Ce sont toujours elles qui menacent les moindres groupes de nos poilus qui bondissent en avant.
Qui plus est c'est presque dans notre dos qu'elles tirent, cette partie du secteur restant passive et ne servant que de pivot à l'attaque. Après notre effort de tout à l'heure, notre arrêt sera long; il faut souffler et lasser l'ennemi. Pendant ce temps le tireur boche achève de mourir, l'autre reçoit un pansement de l'un de mes hommes et un peu d'eau de vie. Il essaie de parler, on lui parle, nous ne comprenons pas. Cependant je remarque que ses yeux toute crainte disparue et par gestes, il semble dire qu'il est satisfait. Par instants il ferme les yeux et gémit doucement. Dans combien de temps le retirera-t-on de là. Les brancardiers ont assez à faire avec les nôtres et quand nous serons partis, qui viendra le chercher ici ?
La mitrailleuse de la Rozère qui ne cessait de nous harceler est occupée ailleurs depuis au moins 10 minutes et d'un trou plus à droite, le lieutenant m'invite à me préparer à bondir. Il faut arriver coûte que coûte à la creute Ste Berthe qui doit être fortement occupée et qui constitue notre objectif final.
Justement sur la droite des éléments du 283ème ont déclenché une fusillade qui doit marquer le départ d'une contre attaque allemande, mais nous ne voyons rien. C'est le moment de profiter de l'inattention des mitrailleuses du secteur sur notre point pour essayer de remplir notre mission. Nous sortons et parcourons d'un seul trait prés de 200 mètres. Nous nous arrêtons à bout de souffle et sous une dégelé de balles qui par bonheur ne nous font pas de mal.
La poignée d'hommes, une vingtaine, ce qui reste de la 2ème section de 66 hommes, a disparu dans les trous par petits groupes compacts. Pour leur malheur depuis le début de l'attaque, les hommes ont une tendance à se grouper dans le trou du chef.
On a beau les raisonner, leur dire qu'une troupe en petits groupes dilués est moins vulnérable, impossible de les maintenir par deux ou trois à quelques mètres d'intervalle, afin d'offrir à l'ennemi une ligne de tirailleurs presque invulnérables, en tout cas difficiles à détruire.
Le phénomène psychique de la présence du chef
Chaque groupe trouverait facilement un abri lors des arrêts dans les innombrables trous d'obus qui parsèment le champ de bataille et que les tirailleurs ennemis seraient bien en peine de battre tous à la fois.
Autour du chef un phénomène psychique fait que l'homme croit se sentir moins en danger ; le geste de serrer sur lui est instinctif.
Par sa responsabilité, le chef marque sa volonté d'agir et cette volonté lui donne une force, un pouvoir d'attraction extraordinaire qui en impose. Dans l'action c'est le seul moment où il n'est pas discuté et où toutes les énergies se tendent vers lui, obéissante à la parole et au geste. Cette énergie, cette impression de force et de tout braver, semble lui donner un air invulnérable qui rassemble les hommes autour de lui, dans la course en avant comme dans son trou.
Ainsi ce groupe compact autour du chef est-il une cible sûre qui sollicitera tous les engins de mort du secteur. Il sera sans cesse l'objet de représailles et laissera à chaque sortie, après chaque bond des hommes sur le sol, tués ou blessés. Seule une discipline rigoureuse du rang obtenue à l'instruction, aurait pu y porter remède, mais le soldat pourrait y être trop réfractaire.
Quelques instants plus tard, mon groupe et moi-même devions être victimes de ce manque de discipline de rang. Par bonds rapides notre progression se poursuit vers la creute de la fontaine Ste Berthe sans trop d'accrocs et avec la seule menace de quelques salves de mitrailleuses lointaines qui nous importunent malgré tout avec leurs claquements sinistres.
Il était prés de midi; nous allions atteindre notre objectif lorsque tout à coup à peine à 80 mètres, des têtes allemandes en calot émergent du sol et disparaissent dans une sorte de remue ménage fébrile. Avec une précipitation extraordinaire, le canon d'une mitrailleuse lourde avec son réservoir massif, est dirigé vers nous dans un brouhaha de cris.
Avant qu'un mouvement de défense ou d'attaque ait pu être annoncé par une rafale puissant, la mitrailleuse nous cloue au sol.
Avec mon commandant de compagnie, j'annonce oralement une manœuvre. Trois VB les derniers, encadrent l'engin mais sont un peu longs. Dès l'explosion aux « fluigs fluigs » retentissants nous sortons de nos trous pour charger. Le mouvement à peine esquissé et alors nous avons parcouru une dizaine de mètres, la mitrailleuse se remet à moudre des balles.
Instinctivement un regroupement se fait sous les claquements stridents.
La blessure : les souvenirs qui assaillent le cerveau
J'ai à peine le temps de crier « halte ! » en me laissant tomber de tout mon poids dans le premier trou d'obus, qu'un coup violent me broie l'épaule gauche que je serre de toutes mes forces avec ma main droite, lorsque trois poilus de la section me tombent littéralement dessus comme de lourds paquets qui me bousculent et me calent sans douceur au fond du trou (deuxième blessure 23 octobre 1917 peu après midi).
D'autres encore sautent sur nous et j'en suis tout abasourdi.
Je me dégage tant bien que mal d'eux.
Les trois premiers sont touchés durement. CARREE (*) mon fusil-mitrailleur a la tête traversée par une balle. Sur sa tête d'où son casque est tombé, sort une masse assez volumineuse de matière cérébrale à filets rouges. En quelques secondes, il y en a presque comme la moitié du poing. Le visage contre le sol, mon pauvre CARREE râle par saccade pendant que se son nez coule un filet de sang qui arrive par à coup ; un autre poilu est touché au ventre et le troisième à une balle dans la poitrine.
Il ne se plaint pas.
(*) : CARREE Pierre René Victor, 21 ans, 2e classe au 288e
RI, mort pour la France au chemin des Dames (Aisne), le 23 octobre 1917, tué à
l'ennemi.
Il était né à Saint Christophe-sur-Avre (Eure), le 12 février
1896. Il n'a pas de sépulture militaire connue.
Sur la fiche, le lieu exact est indiqué "Ostel" mais
il a été barré…
D'abord hagards comme stupéfaits de ce qui leur arrive, du choc ressenti, de ce déchirement intérieur qu'est cette brusque et violente pénétration dans la chair. Ils ont été comme saisis d'un arrêt brusque de leur activité ; l'angoisse d'un attentat à leur vie.
Cependant qu'une réaction se produit en éclair, l'appel de la vie, le besoin de se cramponner à l'espérance, de maîtriser le mal qui nous atteint.
Un flot de souvenirs assaillent le cerveau, serrent l'estomac en une contraction d'espoir et aussi de doute, mais en tout cas avec le moindre souffle de vie, la vision d'un futur reposant, rempli de douceurs, d'une tendre sollicitude de la part de ceux qui soignent et de ceux qui ne vivent le drame que de loin et qui ont une réelle reconnaissance pour ceux qui souffrent physiquement et moralement pour le pays.
Mon sang coule le long du bras coupant ma main de filets roses qui se divisent en ruisselets entre mes doigts.
Le bras se fait lourd, une sorte de paralysie le gagne accentué tout prés de la clavicule par une douleur lancinante comme un poids douloureux en suspens dans la chair avec par moments comme des aiguillettes qui me torturent la plaie, le tout cependant supportable au milieu des incessantes pensées qui m'assaillent et me font presque oublier le mal.
Les poilus indemnes s'affairent auprès des blessés.
L'un d'eux a déchiré ma capote et mes vêtements, mettant à nu l'entrée et la sortie de la balle. Le trou d'entrée est très petit, simplement marqué sur le gras du bras prés de l'épaule par un petit bourrelet violacé d'où s'écoule doucement un filet de sang qui court sur le biceps en s'étalant sur les rondeurs antérieures de l'avant bras vers le poignet.
En quelques minutes mon pansement individuel est placé et il ne me reste plus qu'à penser au départ vers le poste de secours au moment le plus favorable. Autour des autres blessés d'autres valides s'empressent. La poitrine de l'un est vite découverte et l'abdomen de l'autre s'étale au grand air sans pudeur.
Pauvres camarades de combat, quelle souffrance est la vôtre !
Que ma blessure est peu de chose à côté de la leur. Auront-ils au moins le bonheur d'en réchapper. Ils me regardent avec des yeux calmes et cependant suppliants, implorant un secours et je ne puis leur donner que quelques consolations; l'espoir qu'un brancardier les sortira bientôt de ces mauvais lieux.
Les morts
Nous ne recevons
plus d'obus; par intervalles des rafales de deux mitrailleuses dont les balles
claquent bruyamment en éclair, déterminant sur les nerfs une sorte de brusque
débâcle faite de tressaillements accentués aux jambes avec crispation des
muscles du visage. Sait-on ce qu'un blessé pense lorsqu'il voit sa retraite
coupée ?
L'éden, le paradis
bien loin et des chemins dangereusement battus, cernés des pires obstacles, des
pièges que nous tend la mort. Mon pauvre fusil mitrailleur a cessé de râler ;
il ne bouge plus.
Sa tête qui tout à
l'heure était secouée de tressaillements par suite du sang qui coulait par à
coups du nez et de la bouche, est maintenant immobile, rigide. Les traits sont
figés, les yeux vitreux. Le sang s'écoule du nez vers la bouche toujours rouge
sur fond noir violacé de sang coagulé, tapissant la face interne de la narine.
Il sort avec une sorte de glou, glou, diminuant sans cesse de densité. Déjà, personne ne s'occupe plus de lui.
Que faire ! Il était condamné. Maintenant que la vie a fui, il n'est plus qu'une masse inerte au milieu des vivants qui n'en sont pas plus impressionnés.
Quand le relèvera-t-on pour lui donner une sépulture ?
Ah ! Ces pauvres morts du front.
A peine tombés on les abandonne à leur sort. Avant de les prendre à jamais, la mort leur laisse souvent quelques minutes de répit ou la vie semble se concentrer au cerveau. La tête réagit par secousses et paraît indépendante du corps, masse déjà inerte, elle se débat en tous sens comme pour se relever en efforts surhumains. Quelques fois le corps est encore traversé de frissons qui agitent jusqu'aux pieds comme si un courant alternatif passait.
Les vibrations très vives d'abord vont diminuant pour s'éteindre et faire place à une immobilité impressionnante.
Il faut sortir d'ici.
Dans ce trou d'obus, au milieu des vivants qui vont m'abandonner pour poursuivre leur mission destructrice, avec les mort et les blessés qui se plaignent doucement et auxquels d'ailleurs je ne puis être d'aucun secours. Ma situation est plutôt tragique. Je me demande non sans appréhensions comment sortir d'ici.
Dès que je mets le nez hors du trou, une bordée de balles m'interdit une longue observation.
Devant notre front d'arrêt qui n'est pas loin de celui qu'on doit atteindre, les croupes de Monampteuil aux nids de mitrailleuses innombrables, les croupes qui s'étagent devant la ville de Laon impressionnent comme une terre inconnue que l'on va découvrir et dont le peu d'animation qui y règne étonne et appelle la défiance, car on le sait habitée par une faune dangereuse qui se terre.
Le calme de ces abords n'est que factice. Les mouches qui par instants les quittent pour se précipiter vers nous et tourbillonner avec grand bruit sec, à souffle rapide et élégant, nous invitent à la prudence.
Au delà de ces croupes qui crachent le feu sur le plateau presque à l'horizon, la ville de Laon semble solliciter sa délivrance, sa cathédrale finement élancée au dessus d'un gros patté de maisons nous appelle.
Elle voudrait redevenir française, cette bonne ville et cela se devine à l'aspect las de ses maisons, à la tristesse qui semble se dégager de sa masse largement étalée à portée de fusil. Toute cette bonne terre française sollicite nos efforts, nous encourage à persévérer, à nous approcher de sa belle ville, à la couvrir de notre protection.
Hélas ! Laon restera encore longtemps allemande.
Pour l'instant, assez de considérations oiseuses.
Pensons plutôt à sortir d'une situation tragique et le plus vite possible. Le lieutenant VALETTE m'y engage d'ailleurs vivement et c'est d'une impulsion soudaine, comme irréfléchie que je précipite hors du trou, non sans avoir touché la main de tous les braves que je quitte et des deux blessés auxquels je souhaite une prompte délivrance par les brancardiers. Ils sont pansés. Pour le reste qu'y ferai-je ?
Mes forces sont déjà réduites par la fièvre qui me gagne et je ne puis songer à les emporter sur mon dos. Mon premier devoir sera de les signaler aux premiers brancardiers que je rencontrerai sur ma route.
J'ai passé le commandement de la section à un sergent. Un de mes hommes, MARGAIL, me voyant tout tremblant de fièvre n'a pas voulu m'abandonner. Je venais de me jeter dans un vaste trou d'obus, déjà occupé, que mon brave MARGAIL s'y jetait à son tour. Toutes mes exhortations pour le faire rester furent vaines. Il tient à m'accompagner au poste de secours.
Moi à l'abri il reviendra ensuite en ligne. J'eus beau lui monter les dangers qu'il allait courir à l'aller et au retour sur le terrain battu par les mitrailleuses, il ne voulut rien entendre.
Avant peu je serai de retour en ligne, me dit-il.
La blessure filon
Dans le trou d'obus que nous occupons, dépression énorme, il y a des hommes du 283ème, blessés du matin et qui ne savent pas s'en aller vers l'arrière. L'un d'eux présente derrière l'oreille gauche, une énorme verrue, gros caillot de sang allongé, d'un rouge brun teinté par plaque de rouge vermeil.
Il est hébété, ne répond pas à mes questions, semble atteint d'amnésie.
Il ne fait même pas un effort pour essayer de comprendre ce que je lui dis. La blessure au rochet l'a rendu malencontreusement idiot. D'autres pauvres hommes, blessés aussi moins sérieusement aux bras et aux jambes, très capables de joindre un poste de secours, hésitent à se lancer en terrain découvert.
En imagination ils voient le paradis de l'arrière, la fuite vers le poste de secours, les premiers soins, la fiche de blessé accrochée à la poitrine, le transport en auto sanitaire d'ambulance avec les formalités qui y sont attachées et enfin l'échouement à l'ambulance d'évacuation où le calvaire doit se terminer, le transport par train sanitaire vers un des hôpitaux de l'intérieur où l'on est douillettement et confortablement installés, entourés de soins dévoués.
Ils pensent à tout cela ces pauvres bougres qui ne savent pas s'en aller. Ils voudraient bien franchir cette zone de mort, mais à tout instant des rafales de mitrailleuses leur rappellent qu'il faut encore gagner leur quiétude future et malgré le beau mirage, ils ne peuvent se décider à braver une dernière fois les engins de mort.
Je les engage à me suivre après un échange d'impressions sur l'attaque du matin et sur les circonstances de nos blessures. Quelques uns prétendent qu'ils ont la blessure filon et parlent des joies qui les attendent, mais lorsque je les invite à partir, une sorte de terreur paraît les saisir.
Leurs yeux deviennent vagues, ils rentrent en eux-mêmes et ne répondent pas ou bien ils insinuent que la nuit leur sera propice.
A deux pas, l'abri blockhaus en superstructure que nous avons dépassé le matin au cours de notre progression, paraît tragique et impressionnant dans son abandon avec ses rondins verticaux déchiquetés où d'innombrables filins pendent lamentablement ou bien jaillissent d'un large trou profond, œuvre de nos obus.
Tout autour la terre paraît lugubre et désolée avec les énormes trous qui encerclent l'abri ou qui le touchent non sans avoir déchaussé lamentablement les rondins verticaux criblés d'éclats; ces derniers ont d'ailleurs fait éclater le bois. Vision apocalyptique en ce lieu sinistre témoin d'égorgements pénibles. Un cataclysme semble s'être produit en cet endroit.
Sa vue m'emplit le cœur d'effroi, une angoisse me saisit même à la vue de cette maison d'enfer que les nombreux cadavres allemands et français avaient comme enjeu. Ils gisent corps et membres brisés, déchiquetés avec leurs chairs d'un violet blafard, posés sur de larges flaques de sang dont la terre est sursaturée à tel point que certaines forment un large caillot gélatineux en relief.
Il suffit de lever la tête pour voir tout cela et je comprends l'hésitation de mes voisins.
Après une dernière exhortation à quitter ce lieu tragique ou l'odeur fade du sang, de la poudre et du gaz ypérite en suspense dans l'air, vous saisissent à la gorge et malgré la sorte de torpeur qui me gagne et qui fait que mes membres et ma tête paraissent exagérément lourds, d'un bond je suis hors du trou suivi de mon fidèle MARGAIL qui ne veut pas me quitter.
Quelques mètres sont à peine parcourus que des balles claquent de tous côtés.
Ma tête y est secouée comme un prunier lors de la récolte des fruits. Les claquements stridents des balles font vibrer mes oreilles ainsi qu'une peau de tambour et avec une telle violence que ma tête semble remplie de vibrations puissantes et rapides; tout frémit en moi. Hébété le souffle court, la respiration incertaine, sentant à peine mes jambes qui tremblent, je fuis comme une bête traquée qu'une balle risque à chaque dixième de seconde de coucher au sol pour l'éternité.
A Dieu vat ! Je n'ai qu'un seul but, arriver au poste de secours, advienne que pourra, en route si une balle folle m'est destinée.
Presque inconscient sous l'averse infernale, le bras gauche collé au corps, je ne pense qu'à courir pour me sauver, finir le plus tôt possible de ce lieu. Rien ne peut m'arrêter. J'arrive à bout de forces et de souffle sur la contre pente où au moins je suis à l'abri des balles et presque sauvé, en tout cas dans une sécurité relative.
Poursuivant ma route sans regarder en arrière, j'utilise tantôt des éléments de tranchée ou de boyau restés intacts, tantôt en terrain découvert. Plusieurs boyaux sont bouchés par des morts des premières heures de l'attaque.
L'un d'eux notamment tombé sur les genoux a le haut du corps courbé en avant, le visage collé à la terre et pris à la boue gluante. Quelques agents de liaison sans doute, peut-être quelque blessé qui se retirait car il allait vers l'arrière.
Un fort belle homme à puissante carrure. Son corps bouche toute la largeur du boyau. Pour passer, je ne puis l'enjamber. Je passe sur son dos en me soutenant de la main droite.
Je marche comme un automate, la figure crispée, les yeux troubles, la fièvre aux tempes.
Bientôt, je n'en puis plus et le brave MARGAIL doit me soutenir. Mes jambes flageolent, mes yeux voient trouble. Il faut s'arrêter.
Au creux de l'estomac, une angoisse subite me saisit, un malaise indéfinissable comme la vie qui s'enfuit et je n'y vois plus. Quelque chose me remonte à la gorge comme si j'avais fait une mauvaise digestion. Une torpeur douloureuse m'envahit, la gêne gastrique monte à mon cerveau qui s'engourdit brusquement. Ma tête devient lourde et un voile gagne mes yeux.
Je me sens défaillir.
Le malaise n'a duré que quelques secondes.
Je sens qu'une douce chaleur me gagne mais ma figure est baignée d'une sueur froide que le poilu s'emploie à essuyer. Une explosion formidable avec arrosage de terre et de gravats achève de me faire reprendre les esprits par un mouvement de protection réflexe. Maintenant un état délicieux m'a saisi, mais je me sens courbaturé et incapable de faire un pas.
Il faut pourtant encore faire un effort.
Laissant sur ma gauche le boyau d'évacuation, sans le perdre de vue, car il est mon guide vers le poste de secours. Tout à coup l'arrivée de quelques 150 me rappelle à plus de prudence. Leur sifflement rapide et cinglant me plaque au sol.
Malgré ma blessure et la torpeur qui m'envahit, je saute d'un bond dans le boyau large et profond où je me relève couvert de terre. D'autres très gros obus fusent puissamment dans le ciel et s'écrasent avec un bruit formidable à 50 mètres le long d'une ligne d'arbres dans un jet de fumée noire intense.
La paix renaît un instant, j'en profite pour retrouver le chemin de la plaine où mon itinéraire est plus praticable et moins sinueux.
Une pluie fine se met justement à tomber, elle rend ma marche encore plus pénible, plus lourde. Plus je vais vers la quiétude, plus la vision de ce qui m'attend à l'arrière se précise dans mon cerveau. Je vais vers le repos, vers la détente et les joies.
La vue au dessus d'une énorme masse de terre d'un petit drapeau blanc à croix rouge, chasse ces rêves qui bientôt seront une réalité.
Le régiment a perdu près de 200 hommes au cours de cette
journée.
Fin octobre-novembre 1917
Le poste de secours, l’hopital
Me voilà arrivé sans m'en douter au poste de secours.
J'embrasse un instant le lieu qui en forme le cadre, l'inspecte et finit par découvrir l'entrée de la tanière où l'on va me donner les premiers soins. C'est un abri léger d'infanterie situé à 1 km des lignes auquel il est relié par le boyau d'évacuation plus large et plus profond que les autres.
Le médecin de bataillon à deux galons (lieutenant), se précipite à l'entrée pour recevoir le nouvel arrivant dessinant sa jeune silhouette sur le fond obscur de l'abri.
En quelques secondes, mon épaule gauche est à nue.
Dans le haut et sur le gras du bras, apparaît un petit trou violacé d'où s'écoule un petit filet de sang rouge vermeil qui fait contraste avec le bourrelet de chair violette. Tout autour et sur une large surface de chair s'étale un barbouillage rouge terre, incrusté dans la chair.
Un lavage sommaire à l'alcool, un peu de poudre blanche (de l'iode parait-il) sur l'entrée et la sortie de la balle et me voilà en un clin d'œil l'épaule enveloppée d'un pansement délicatement posé.
A peine rhabillé une petite fiche rouge d'évacuation est accrochée à un de mes boutons de capote, accompagné de souhaits de bonne chance pour le reste du voyage. Encore une bonne poignée de main et en route pour des lieux plus sûrs.
Quelques obus passent encore en force sur nos têtes comme d'énormes bourdons, un peu poussifs, à bout de souffle pour s'écraser à 60 ou 80 mètres avec un bruit formidable. MARGAIL me quitte pour retourner aux lignes et c'est sur une bonne embrassade que je quitte mon si dévoué poilu.
Quelques groupes de prisonniers effarés, ahuris plutôt, se collent à la terre ou disparaissent dans des éléments de boyau ou de tranchée sous la menace de nouveaux obus.
Des fantassins de chez nous ont de la peine à les faire sortir.
Après le dernier pansement, je me sens mieux et malgré la lourdeur de mon bras et la fièvre qui me tient, je marche vite.
Encore un 130 autrichien (obus) qui me salue à quelques mètres en avant. J'esquisse un plat ventre involontairement et prends ensuite le pas de course en longeant le trou d'obus d'où la terre fume. Je fonce droit devant moi; ce sera d'ailleurs le dernier obus menaçant ma route.
Tantôt courant, tantôt allongeant simplement le pas, je coupe une batterie d'artillerie en position à droite et à gauche de mon chemin. D'abris légers sort à demi camouflée la gueule de canons de 75. Ceux-ci sont pour l'instant muets, mais les servants s'occupent tout autour et il n'y a personne au dehors sans doute préparent-ils le prochain tir en attendant des renseignements sur l'avance de l'infanterie et de nouvelles données de tir.
De ci de là sur le bord du chemin, des stocks de munitions d'artillerie en vrac ou en tas bien alignées.
Je quitte enfin le plateau, pour m'engager dans un chemin creux où je retrouve bientôt l'abri poste de secours, prés duquel quelques jours avant, montant pour l'attaque, je m'étais assis sur un mort. J'apprends que c'est un poste de relais de blessés.
J'en profite pour m'y reposer.
Il faut descendre plusieurs marches à 45° pour atteindre la salle de soins. Mon pansement n'ayant pas besoin d'être refait, on me donne à boire une petite ration d'eau de vie pour me remonter le moral et me redonner des forces.
Je repars bientôt sans vouloir attendre la voiture automobile sanitaire qui doit venir dans un instant enlever les premiers arrivés. Tant que je peux marcher il vaut mieux sortir de la zone dangereuse le plus tôt possible.
Au carrefour de mon chemin avec la route d'Ostel près de la creute Rochefort, un gendarme monte la garde pour arrêter les déserteurs de combat sans doute.
Des obus ont cherché le carrefour car sur la route de nombreux petits trous d'obus composent un damier. Le tablier de la route doit être bien solide, les trous sont peu profonds et uniformément arrondis, plus allongés du côté opposé à l'arrivée.
Au carrefour des routes d'Ostel – Vailly et Chavonne, derrière un camouflage largement troué, je découvre des cadavres de chevaux et deux corps d'artilleurs déchiquetés, les effets comme tiraillés, en désordre et en lambeaux.
On dirait qu'ils ont été lapidés. Le tout baigne dans une boue compacte.
Voici le village de Chavonne sur la gauche.
Les canons de marine, énormes et longs que nous avions déjà reconnus le soir de la relève aux servants à bérets à pompon rouge. De temps en temps, ils font entendre leur grosse voix qui me surprend.
Voici le pont sur l'Aisne, très grossie par les dernières pluies, le passage sur le canal et enfin l'arrivée à Cys-la-Commune où dès l'entrée du village, j'ai l'agréable surprise d'être reçu gentiment par un de mes compatriotes le caporal-fourrier PUJOL de la CHR (compagnie hors rang) du 283ème R.I.
Je lui raconte en quelques mots, mon odyssée de la journée pendant qu'il m'entraîne vers la cuisine roulante de sa compagnie où un bon quart de jus très chaud me remet d'aplomb de la longue marche que je viens d'effectuer.
Je le quitte bientôt pour le poste d'évacuation de Cys-la-Commune où après un examen sommaire de la blessure on me fait monter dans une auto, ambulance d'évacuation à côté du chauffeur.
En moins d'une minute, la voiture est au grand complet prête à partir. Nous parcourons pendant un court moment la belle vallée de l'Aisne très encaissée à cet endroit.
De l'autre côté, je reconnais la creute de Chavonne et les hauteurs de Vailly.
A Presles-et-Boves en plein village nous prenons à gauche, coupons un large massif montagneux où sur l'autre versant nous retraversons Brenelle et Braine villages dans lesquels une multitude de poilus des régiments du Nord et de l'Ouest, font presque la haie à la voiture s'informant si le fort de Malmaison est pris.
Sur une haute maison bordant la place, un large pavillon blanc indique en grosses marques cercles noirs « Coopérative division Cauvin ».
Braine dépassé et 3 km plus loin, l'ambulance d'évacuation de Courcelles nous accueille.
Le vaste Bessonneau (tente) dans lequel je pénètre est déjà plein de blessés légers et un brouhaha indescriptible emplit la vaste tente. Une odeur d'iodoforme, de cuir et de sueur forte, flotte dans l'air. On se dirait dans l'enceinte d'un cirque au milieu de gens attendant une représentation, si le va et vient des brancards chargés d'une précieuse vie humaine, la figure tirée, ne nous ramenaient à d'autres réalités.
En fournées, de nouveaux blessés pénètrent sous la tente au fur et à mesure des arrivées des autos ambulances amenant de plusieurs points de la ligne d'attaque leur misérable et pitoyable cargaison.
Avant peu, j'ai l'impression qu'il n'y aura pas de place pour tout le monde, malgré la diligence que mettent de nombreux toubibs pour faire les piqûres antitétaniques, afin de libérer les premiers arrivés et on les dirige sur d'autres tentes où ils trouveront un lit de repos. Des gradés infirmiers, des médecins auxiliaires essayent de nous canaliser vers différents emplacements de piqûres.
Pendant de longs moments il faut suivre la foule qui s'écoule lentement toujours debout, il n'y a d'ailleurs pas de siège.
Au début je me sens assez fort pour résister à la fatigue, à la combattre occasionnée par les émotions de la matinée, la longue marche vers les lieux où l'on soigne, mais au fur et à mesure que l'échauffement de l'action me fuit, une fièvre me gagne, une lassitude avec défaillances inexplicables me gagne, ma blessure bat à coups redoublés, un voile coupe mes yeux t un douloureux malaise étreint mon estomac.
La vie s'en va, je ne vois plus mes camarades, tout se dérobe autour de moi.
Combien de temps suis je resté ainsi…
Quelques minutes je pense et je reviens à moi dans une tente couché dans un bon lit, mais encore brisé par mon évanouissement, le corps moite et je sens qu'un bien être me gagne doucement. Des médecins m'entourent, ils causent entre eux et je les entends à peine. Ma blessure est mise à radiographiée dans le minimum de temps.
Rien de grave, entend-je dire. L'épaule gauche est traversée et l'os n'est pas touché. Replacé dans un lit et bien au chaud, je reprends tout mon équilibre nerveux en attendant les évènements.
Dans la nuit, transporté dans un train sanitaire stationné à quelques mètres, j'échoue le lendemain soir prés de Montdidier à l' H.O.E du village d' Hargicourt où je retrouve mon commandant de compagnie et beaucoup de camarades de régiment blessés plus ou moins grièvement. Mon voisin de lit est l'aspirant JOUET du 218ème RI de ma division, fils de médecin commandant à Paris, bon camarade.
Rétablis nous faisons de longues promenades vers Montdidier.
Dès mon arrivée on me radiographie à nouveau. Ma blessure nécessite six agrafes dans le dos.
Pendant deux jours, j'ai une forte fièvre.
Enfin tout s'arrange pour le mieux et le bras en écharpe je puis sortir dans le village tous les matins.
La visite du médecin terminée, on se précipite aux nouvelles et apprenons un beau matin une attaque anglaise sur Cambrai par « tanks » nouvel engin de guerre au succès étonnant mais pas exploité.
Mon frère, Maréchal des Logis au 10ème Dragons, en secteur région de Montdidier, vient me voir.
Cela me fait du bien.
L'odeur d'iodoforme et de pharmacie qui emplit la baraque l'indispose. Nous allons faire une longue promenade au dehors.
Des bruits d'attaque allemande sont envisagés pour le printemps. L'État-major français constitue des réserves pour devancer l'attaque ou pour se défendre. Les Anglais étendent leur secteur jusque vers Roye. De nombreux trains de troupes à la casquette plate kaki infanterie et artillerie, défilent devant notre H.O.E. (h
On parle de l'évacuation de cette dernière plus en arrière. Les convalescents sont envoyés au repos chez eux, j'en suis avec un mois de congé. Les autres sont dirigés sur Beauvais et les villes avoisinantes.
Décembre 1917
Le 20 décembre 1917, après un mois de convalescence passé au pays, je rejoignais le dépôt divisionnaire de la 67ème D.I en station provisoire à Ville-en-Tardenois (Marne), gros village dans lequel j'avais déjà fait un court séjour en début de 1916.
J'y retrouvais de vieilles connaissances en particulier d'aimables jeunes filles qui me font oublier les doux souvenirs du congé ainsi que les futurs dangers.
La popote des sous-officiers de la 24ème compagnie où je viens d'être affecté est des plus joyeuse.
La fille de notre hôtesse, gentille à souhait.
Quoique logés dans des baraques à gauche de la route de Romigny, au milieu d'un cloaque boueux sans nom par ces temps rigoureux de neige et de dégel qui nous font patauger jusqu'à mi-jambe, la vie est belle. Les alentours des baraques grouillent de poilus dès que le soleil veut bien donner de ses rayons par une température sibérienne. Les baraques regorgent de monde.
Dès que la neige tombe on se regroupe autour de braseros fumeux. Dans notre bout de baraque très compartimentée, les sous-officiers comptables de la 24ème et moi-même s'entassent dans un petit réduit où nos couchettes superposées en bois et treillage, laisse à peine un petit passage sur l'extérieur. La porte ferme mal, mes pieds la touchent presque et le matin les bourrasques de neige viennent me recouvrir en partie d'un gel blanchâtre.
Heureusement qu'à l'aube à peine naissant un des agents de liaison employé de bureau, ne manque pas tous les matins d'allumer un tout petit poêle venu d'en ne sais où. Je secoue ma petite couche de neige et ma couverture supérieur s'élève avec le jour et la chaleur une légère vapeur d'eau. Cela n'a aucune importance.
Le jus bu, il faut se lever, affronter les rigueurs de la température extérieure pour faire sa toilette et présider aux diverses corvées ou exercices au dehors. Bien souvent la glace qui marque le chemin comme un miroir, cause des chutes plus ou moins graves.
Le temps de chien dure une dizaine de jours.
![]()
Je
désire contacter le propriétaire du carnet de Louis DECAMPS
Voir des photos sur mon site de groupe de soldats du 288e RI
Vers d’autres témoignages
de guerre 14/18