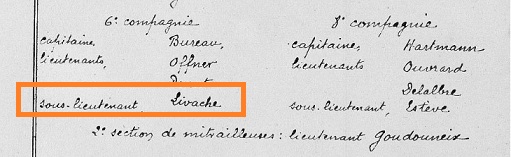Souvenirs de la bataille de Rossignol de Georges LIVACHE
Sous-lieutenant
au 3e colonial
Mise
à jour : novembre. 2014

Sous-lieutenant Georges LIVACHE
![]()
Préambule
Jacques, septembre 2014 :
« Je viens de consulter votre site sur la guerre 14-18. Je vous envoie
ci-joint un chapitre des mémoires de mon père qui avait été laissé pour mort
sur le champ de bataille de Rossignol. Il était alors sous-lieutenant. Son nom
était Georges Livache.
En fait il n'était que blessé et il revenu dans sa famille après la
guerre. Militaire, il a continué dans l'infanterie coloniale où il a terminé la
dernière guerre (39-45) comme général de brigade.
![]()
Le 2 août, la mobilisation
était déclarée.
A cette date tous les
élèves ont été promus sous-lieutenants et ont rallié sans délai le régiment
auquel ils étaient affectés. C'est dans ces conditions que je me suis rendu à Rochefort.
Dans cette ville, je
suis resté six jours au 3°
Colonial. Nous avons eu un gros travail pour mettre le régiment sur pied
de guerre.

Georges LIVACHE fait partie de la 6e
compagnie du 2e bataillon, comme l’indique le journal
du régiment.
Le 7 août
Le 7 août, nous avons quitté la
garnison.
Le bataillon auquel
j'appartenais était le premier à partir.
Nous avons parcouru la
courte distance qui sépare la caserne de Joinville à la gare, encadrés
par une foule enthousiaste qui nous acclamait et nous jetait des fleurs. Nous
avions l'impression d'être pris pour des héros. Après un voyage de 48 heures,
nous avons débarqué près de Bar-le-Duc et nous avons progressé en
direction du Nord, par des routes parallèles à la Meuse ou situées dans la
vallée de cette rivière que nous avons traversée à Vilosnes le 15 août.
Les étapes étaient
longues et pénibles car il faisait très chaud. Les hommes souffraient beaucoup
de la température avec leurs vêtements de drap et un sac lourdement chargé.
Nous avons eu plusieurs décès par coup de chaleur.
Nous n'étions pas très
renseignés sur les événements. Nous avions seulement appris que les Anglais
s'étaient joints à nous et avaient envoyé un corps expéditionnaire en France,
qu'un détachement français avait pénétré en Alsace pendant que les Russes
avaient envahi une partie de la Prusse Orientale. Nous savions aussi que nous
appartenions à l'armée de Langle de Carry, provisoirement en réserve.
Mais nous ne voyions
pas encore les Allemands et il nous tardait de nous mesurer à eux car, de
l'avis de tous, la guerre devait être de très courte durée. Nous n'avons pas tardé
à voir nos désirs exaucés.
Le 21 août
Dans la région d'Avioth,
nous avons commencé à entendre le canon. Nous avons changé plusieurs fois de
cantonnement, sous une pluie battante et le soir, nous pénétrâmes au village de
Limes en Belgique.
Il était bondé de
troupes.
Nous y avons cantonné
et c'est avec beaucoup de mal que, dans l'obscurité, nous avons pu trouver une
petite chambre pour les quatre officiers de la compagnie. Pour ne pas être
repérés par les avions ennemis, toute lumière était interdite. Après avoir très
mal mangé dans la journée, nous avons dû nous contenter pour dîner de quelques
rares conserves.
Le Capitaine, très
optimiste, déclara :
"Nous
nous rattraperons demain".
Las, le lendemain il
était tué avant le premier repas !
Le 22 août
Nous avons quitté Limes
à l'aube.
On nous a communiqué
l'ordre suivant :
"Le
Corps Colonial cantonnera ce soir à Neufchâteau"
(C’était à une vingtaine de kilomètres)
"L’ennemi
sera attaqué partout où on le rencontrera".
Tout le monde était joyeux.
Le temps était beau.
Les Belges qui nous
regardaient passer nous faisaient des signes amicaux et surtout, nous allions
enfin voir les Allemands. De plus, nous savions que Neufchâteau était
une localité importante. Nous pourrions donc y cantonner dans de bonnes
conditions.
Vers 8 heures, nous avons de
nouveau entendu le canon et un avion ennemi nous a survolés. Une heure plus
tard, en traversant le village de Saint-Vincent, nous avons reçu les
premiers obus.
Nous avons quitté les
routes pour nous engager dans les bois et nous sommes arrivés près d'une petite
rivière affluant de la Meuse, la Semois. Au bruit de la canonnade s'était joint
celui de la fusillade.
Mon Capitaine avait
reçu la mission de marcher sur le village de Rossignol, situé à quelques
kilomètres de là. Un pont enjambait la rivière.
Mon Capitaine me donna
l'ordre de le traverser et de déployer ma section en tirailleurs sur l'autre
rive, face à la localité que nous avions pour objectif. Ce mouvement n'était
pas terminé que nous recevions une grêle de balles venant de l'arrière.
Au premier moment nous
avons cru à une méprise. Mais à la jumelle je ne tardais pas à reconnaître, par
son casque à pointe, un officier allemand.
Plus tard j'ai appris
ce qui s'était passé. La division qui était à notre droite avait progressé
moins vite que nous. Les Allemands qui marchaient à sa rencontre trouvant le
vide ont continué leur manœuvre en avant et nous ont dépassés. Nous ayant
aperçus, ils ont pu ouvrir le feu, nous prenant à la fois par notre arrière et
par le flanc droit. J'ai fait face à la direction d'où venaient les coups de
feu et j'ai riposté tout en faisant abriter mes hommes derrière le talus d'une
route en remblai.
Mon capitaine a
approuvé mes dispositions et m'a dit :
"Je
continue ma marche sur Rossignol avec le restant de la compagnie.
Rejoignez-moi
dès que vous pourrez...".
Je ne l'ai jamais revu !
Les feux d'artillerie
et d'infanterie devenaient de plus en plus violents.
Un régiment
d'artillerie qui se trouvait en colonne sur la route de Rossignol a été
pris à partie par les canons ennemis et a subi de lourdes pertes sans même
pouvoir se mettre en batterie et répondre au feu par le feu.
C'est là qu'a trouvé
la mort le lieutenant Psichari,
petit-fils de Renan et écrivain apprécié.(*)
Le pont sur la Semois
était particulièrement visé et une section de mitrailleurs qui était venue s'y
installer a été rapidement détruite. Les Allemands qui étaient à notre gauche
étaient de plus en plus menaçants.
Près de l'emplacement
de ma section étaient arrivés des éléments du 2° Colonial. Un capitaine est
venu me trouver pour me dire :
« Notre situation devient intenable,
puisque nous avons l'ordre de marcher sur Rossignol, prenons la direction de ce
village. »
« Vous êtes isolés de votre compagnie, je vous
prends sous mon commandement ».
Lui non plus je ne l'ai pas revu. Il a été tué.
Le terrain à parcourir
était constitué par des prairies séparées par des clôtures de fil de fer et de
petits fossés servant à l'écoulement des eaux. C'est en franchissant l'une de
ces clôtures que j'ai été grièvement blessé.
Par chance, je suis
tombé dans l'un de ces petits fossés où j'étais à l'abri des balles qui
passaient à quelques centimètres au-dessus de moi. Je perdais mon sang en
abondance. L'eau du fossé en était toute rougie.
Lorsque j'ai été
blessé, j'ai refusé d'être transporté à un poste de secours. Il ne fallait
distraire personne de la ligne de feu.
Il était environ une
heure de l'après-midi et le combat a continué jusqu'au crépuscule. Les
tirailleurs allemands ont alors progressé dans la direction de l'endroit où je
me trouvais, au milieu d'autres blessés.
M'ayant aperçu, ils se
sont dirigés vers moi. Il avait été dit que les Allemands achevaient les
blessés.
Ils ne m'ont fait
aucun mal. Ils m'ont seulement pris mon revolver, c'était normal.
La nuit étant tombée, le champ de bataille
est devenu lugubre.
Quelques coups de feu
éclataient encore, mais on entendait surtout les lamentations, les cris des
blessés qui réclamaient du secours et presque tous "à boire".
Les hommes tombés dans
mon voisinage ont appris, je n'ai jamais su expliquer comment, qu'il y avait un
officier blessé et se tournaient vers moi pour me demander des conseils.
Il m'était bien
difficile de leur en donner. J'étais très affaibli, ayant perdu beaucoup de
sang et à plusieurs reprises je m'étais évanoui.
Dans la nuit, un
soldat colonial assez légèrement blessé est passé près de moi et m'a tiré hors
du fossé où dans l'eau froide je grelottais. Il m'a traîné jusqu'au talus de la
route où plusieurs blessés gisaient déjà. L'un d'eux, un artilleur gravement
atteint au ventre, souffrait horriblement et suppliait qu'on l'achevât.
Il est mort dans la
nuit.
(*) : Ernest SPICHARI, lieutenant au 2e
régiment colonial, mort pour la France à Rossignol, tué à l’ennemi. Il était né
à Paris, le 27 septembre 1883.
Durant la journée du 22 août 1914, le journal du régiment (JMO)
indique la perte de 2025 tués, blessés ou disparus. Georges LIVACHE fait parti
de ces disparus.
Le JMO a été arrêté le 21 août. Il fut repris le 8 septembre. C’est
donc à la date du 8 sept. que les journées des 22/08 au 07/09 furent écrites,
avec les renseignements et témoignages qui permirent de reconstituer ces journée sanglantes.
23 août
A l'aube du 23 août,
des unités de cavalerie allemande sont apparues sur la route. Les blessés qui
m'entouraient étaient très inquiets. Je leur ai conseillé de rester immobiles
et de faire le mort.
Ce petit stratagème a
réussi pendant quelques temps mais, par la suite, un escadron de dragons mit
pied à terre et les cavaliers eurent vite fait de constater que nous étions
seulement blessés.
Dans la bagarre,
j'avais perdu mon képi et je portais un bonnet de police, coiffure qui était
celle des Belges.
Un officier allemand
m'ayant aperçu m'a demandé :
"Sind sie Belgium ?", (êtes vous Belge ?)
J'ai répondu :
"Nein, ich bin Franzose", (non, je suis Français).
Il a ajouté :
"Sind sie verwendet ?", (êtes vous blessé ?).
Pour toute réponse,
j'ai soulevé le manteau dont on m'avait recouvert et il a vu ma blessure à l'aine
avec le pansement individuel mal ajusté. Il s'est éloigné et quelques instants
après survenait un autre officier. Je me demandais ce qu'il allait se passer
mais j'ai été rassuré lorsqu'il a prononcé le mot "Doktor".
En effet, il a refait
mon pansement et m'a indiqué le chemin du "Lazaret",
"hôpital" en allemand.
Après son départ, j'ai
décidé d'essayer de rejoindre le poste de secours avec ceux qui pouvaient
encore faire quelques pas.
Personnellement, étant
dans l'impossibilité de marcher, j'ai été traîné plutôt que porté par deux
braves soldats moins handicapés que leurs camarades. La distance à parcourir
n'était pas longue mais, clopin-clopant, nous avons mis très longtemps pour
arriver à l'emplacement du soi-disant poste de secours.
En fait, c'était
seulement un endroit où l'on avait rassemblé de nombreux blessés français, mais
il n'y avait personne pour les soigner. Les Allemands avaient seulement posté
des sentinelles pour surveiller et tirer sur ceux qui auraient tenté de
s'échapper.
Cependant, tard dans
la soirée, des brancardiers français sont venus du village de Rossignol
pour nous transporter dans un petit manoir qui avait été transformé en
ambulance de campagne. Il y avait des blessés partout, dans les bâtiments, dans
les cours, dans les jardins.
Les médecins, peu
nombreux, étaient débordés. Ils pratiquaient les amputations en plein-air, sur
une pelouse.
Grâce à la
complaisance d'un médecin, j'ai été placé dans une petite chambre. Elle était
pour une seule personne avec un lit unique occupé par deux amputés. Les autres
blessés, au nombre de sept ou huit, étaient comme moi, allongés sur le
plancher. De temps en temps, passait une patrouille allemande.
Un sous-officier nous
menaçait d'un revolver et nous devions montrer notre blessure pour prouver que
sa gravité ne nous permettait pas de nous échapper.
Pour toute
consolation, nous avions des jeunes filles belges du village qui,
volontairement, s'étaient jointes au personnel sanitaire français totalement
insuffisant en nombre. Mais elles n'étaient pas infirmières, manquaient de
pansements et de médicaments. Elles devaient se contenter de nous apporter de
l'eau, quelques provisions et... leur sourire quand les Allemands ne les
voyaient pas.
Je suis resté deux ou trois jours
dans cette ambulance puis, on nous a embarqués dans des camions pour nous
conduire à la gare la plus proche, Marbehan.
Là, stationnait un
train sanitaire déjà rempli de blessés allemands. On nous a placés dans des
wagons de marchandises et, en route pour l'Allemagne !
Nous avons alors pris
définitivement conscience que nous étions "prisonniers", situation
qu'aucun d'entre nous n'avait envisagée lorsqu'il avait quitté sa garnison, les
jeunes officiers moins que les autres.
![]()
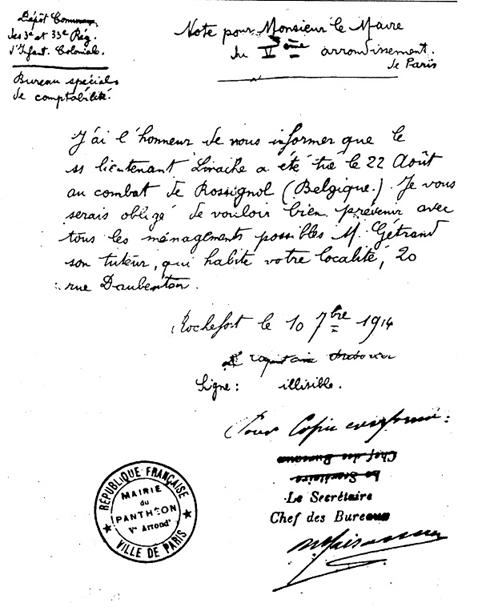
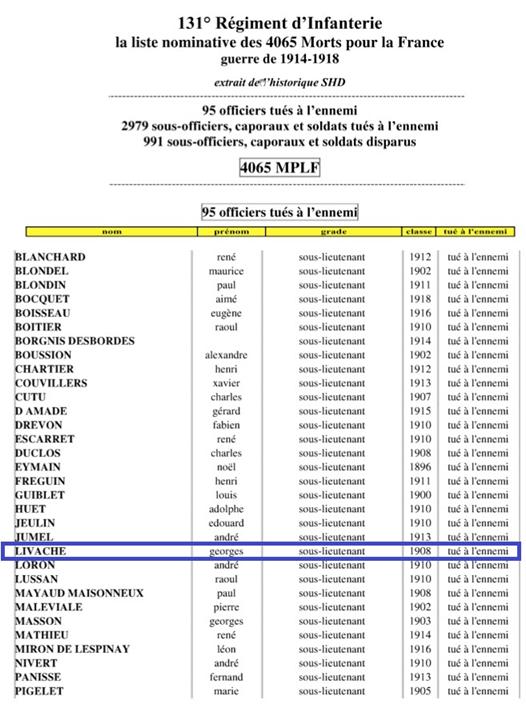
![]()
Je
désire contacter le propriétaire des souvenirs de Georges LIVACHE
Vers d’autres témoignages
de guerre 14/18