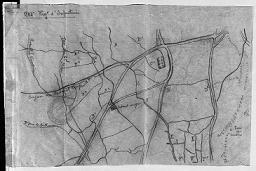Carnets de guerre du sergent-fourrier Alexandre ROBERT
du 204e régiment d’infanterie - Année 1915
Mise
à jour : octobre 2014

Alexandre ROBERT en septembre 1915
![]()
Sommaire
Le sommaire ne fait pas
partie du carnet, il a été rajouté volontairement pour une meilleure navigation
Janvier 1915 : Aisne, Crouy, l’attaque allemande, la débâcle
Mai 1915 : Artois, combat d’Angres, Bully, Aix-Noulette
Juillet 1915 : Artois, le fusillé pour l’exemple
Fin 1915 : Artois, les tranchées, la boue
![]()
ICI COMMENCE LE SECOND CARNET INTITULé :
« Du 1e
janvier1915 au 21 juin 1916 »
![]()
Janvier 1915 : Aisne, Crouy, l’attaque allemande, la débâcle
1er janvier 1915
Un jour pour nous bien monotone. Chacun est pris par le cafard de se trouver en ce jour loin des siens, et la perspective de les revoir est si lointaine !
Le 2 janvier
Nous allons à la cote 132 à Crouy relever le 276ème. Il est entendu qu’à la prochaine relève nous ne reviendrons pas à Mercin, mais que nous irons à Vauxbuin.
Le 3 janvier
Nous constatons que beaucoup de travail a été fait dans les tranchées durant notre séjour à Mercin. Les sapes et boyaux qui avaient souffert du bombardement ont été réparés puis de grands abris ont été faits dans la tranchée de 1ère ligne par le 276ème. Des ordres sont donnés pour continuer le travail commencé avec toute la diligence possible.
Il parvient à mes oreilles
qu’une nouvelle attaque est demandée par le lieutenant-colonel Auroux et il insiste tout
particulièrement pour qu’elle ait lieu très prochainement, avant que nous quittions le secteur. Le
commandant CHALET n’en a pas
l’air très partisan.
Il pleut.
Les travaux se poursuivent sans incident notable jusqu’au 7 janvier.
L’ordre arrive d’évacuer les têtes de sape et de faire mettre les
hommes à couvert dans la tranchée de façon qu’ils soient parés des éclats qui
pourraient revenir sur nos lignes, car notre artillerie va effectuer un tir de
réglage qui doit commencer à 7 heures 50.
En effet toutes nos pièces commencent à tirer, depuis le 75 qui est
tout près de nous jusqu’aux grosses pièces qui se trouvent sur les crêtes qui
bornent l’horizon au sud.
En fait de tir de réglage, c’est bien un bombardement en règle.
L’artillerie est magnifique de précision. Nous voyons tous les coups tomber au
beau milieu des tranchées boches. Néanmoins dans toute cette journée où les
pièces n’arrêtent pas de tirer, 2 gros obus de 155 tombent en plein sur les
tranchées de 1ère ligne de ma compagnie, sans aucun mal heureusement.
Le 8 janvier
Le bombardement recommence dès le matin.
Les Allemands ripostent peu. L’attaque est déclenchée sur notre gauche, dans le secteur du 5ème bataillon. Ce sont les Marocains et les Chasseurs qui attaquent. Ils prennent de suite 2 ou 3 lignes de tranchées et organisent aussitôt la position, tandis que les sapes sont poussées activement pour établir la communication.
Le 9 janvier se passe sans changement.
Les Allemands, des hauteurs de Perrière, bombardent les positions que nous avons prises, et nous bombardons leurs 2èmes lignes, ainsi que les tranchées qui se trouvent en face de nous.
Les hommes commencent à être fatigués.
Le 10 janvier
Le bombardement reprend, encore plus violent.
Le 276ème monte dans les tranchées et prend place sous les abris. C’est lui qui doit attaquer, et nous devons rester dans les tranchées. On avait donné l’ordre de porter tout le 204 dans les tranchées de 2ème ligne à 50 mètres environ en arrière pour faire la place au 276ème et il devait reprendre la 1ère ligne dès que l’attaque serait partie. Mais cet ordre n’est pas exécuté.
En effet, tous les obus allemands tombent sur cette partie de nos tranchées. Les hommes se tassent dans la 1ère ligne et sous les abris pour faire de la place au 276ème.
À 2 heures, heure fixée pour l’attaque, l’artillerie allonge son
tir et le 276 sort des tranchées. C’est une attaque admirable. À peine quelques
hommes sont-ils blessés avant d’arriver aux tranchées boches dont ils prennent
possession.
Tous les hommes du 204 sont aux créneaux, prêts à toute éventualité. Les batteries boches placées en haut de Perrière nous bombardent et nous voyons très bien les coups partir. Plusieurs fois on signale l’emplacement de ces batteries.
Pendant l’attaque, alors que
j’étais allé porter un ordre, j’attendis que le 276 soit parti pour revenir vers
le commandant, car il encombrait les boyaux. D’autre part, je me sentais plus
en sécurité dans les tranchées de 1ère ligne qu’à l’arrière.
C’est à ce moment que je vis l’un de nos officiers, le sous-lieutenant Viault, de Saint-Florentin, qui commandait la 4ème section, donner l’exemple de l’attitude la plus déplorable. Il s’était blotti dans un trou et se faisait le plus petit possible dans le fond de la tranchée. Il disait aux sergents qui se trouvaient à proximité :
« Faites bien
attention que tous les veilleurs soient aux créneaux. »
Il n’était plus qu’une loque humaine.
Le capitaine Noël, lui, était à son poste.
Les travaux de sape sont poussés très activement pour relier les tranchées conquises avec les nôtres, de façon que nous n’ayons pas à passer par-dessus le parapet.
Vers le soir, la communication est établie vers la 1ère section de
la 21ème. Les tranchées conquises ne sont plus qu’un chaos sans nom. Des
cadavres et du sang partout. Les hommes s’organisent comme ils peuvent, mais
ils sont couchés dans une boue gluante rougie par le sang. C’est un affreux
tableau.
Quelques prisonniers ont été ramenés ainsi qu’une mitrailleuse.
Le soir, j’apprends qu’un peloton de Marocains, qui était parti à
l’attaque le 8 et s’était avancé trop loin et s’était trouvé cerné et dont on
n’avait plus aucune nouvelle, est sorti des tranchées en entendant sonner la
charge et s’est mis à attaquer. Je ne sais si quelques-uns d’entre eux sont
revenus.
On dit aussi que les Marocains ne font aucun prisonnier suivant l’ordre qui leur a été donné par leurs officiers ; cet ordre, je l’ai moi-même entendu donner ; et on dit aussi qu’ils coupent les têtes de tous les Allemands qu’ils trouvent.
À la tombée de la nuit, les boches contre-attaquent ; ils
s’avancent par les boyaux en jetant des grenades. J’entends raconter que
certains ont revêtu des manteaux de Marocains et qu’ils s’avancent jusqu’à
bonne portée en criant :
« Camarades ! »
Beaucoup d’hommes du 276ème, à la faveur de la nuit, se sauvent par-dessus le parapet et rentrent dans nos lignes sous prétexte de venir chercher des munitions, des outils ou autre chose. Comme ils deviennent nombreux, il faut les empêcher de revenir, car ceux qui restent ne pourraient plus résister.
Leurs fusils sont bouchés par la boue et, dans la nuit noire, il se produit de tragiques et regrettables méprises. Nous leur envoyons, par des corvées, des munitions et des outils.
Je constate qu’ils sont bien démoralisés.
Du génie est arrivé pour aider à la mise en état de défense de la position conquise. Mais le terrain absolument détrempé ne favorise pas les travaux et les matériaux ne sont transportés qu’avec la plus grande difficulté. Nous avions distribué tous les outils et le 276 en réclamait encore.
Je trouve 3 ou 4 pioches qui restaient et les remets à Haury qui les porte en avant. Il n’est pas revenu. J’apprends par la suite qu’il a été blessé d’une balle dans la cuisse et qu’il est dans la tranchée allemande.
Les brancardiers ne suffisent
pas à évacuer les blessés. Il est d’ailleurs presque impossible de passer dans
les boyaux avec un brancard. Tout est bouleversé et les projectiles de toutes
sortes tombent sans arrêt. Je vais à la 24ème compagnie qui est à la droite de
la 21ème pour transmettre un ordre qui doit passer dans toutes les compagnies.
Les boyaux sont presque déserts ; je ne trouve aucun gradé.
À la fin, je finis par trouver le sergent-major Maréchal, l’ancien fourrier qu’on me dit être dans une guitoune que l’on m’indique.
Je n’oublierai jamais le sinistre tableau : une guitoune à moitié éboulée par les obus, 3 ou 4 moribonds qui râlaient, 5 ou 6 autres blessés entassés dans les coins et Maréchal, seul indemne, qui établissait la liste des tués et blessés à la lueur vacillante d’une bougie.
Toute la nuit, je cours ainsi de côté et d’autre. J’ai l’occasion
d’engueuler des brancardiers du 276 qui étaient cachés dans une guitoune du
chemin creux, alors que de nombreux blessés gisaient sur le terrain.
Les brancardiers du 204 ont été magnifiques de dévouement.
Le 11 janvier
Le bombardement qui n’a pas arrêté une minute depuis le 7 continue. Poulet, le sergent-major qui la veille au matin était descendu à Crouy, était resté dans notre guitoune à côté du commandant et n’avait pas osé remonter. C’est effrayant ce qui tombait et je me demande comment j’ai pu passer au travers sans être blessé.
Il est vrai que la veille je l’ai échappé belle. Un shrapnel m’a bousculé et m’a projeté dans les cabinets des officiers. J’ai eu une belle émotion. Quand je suis revenu, les autres fourriers m’ont dit avoir vu et le commandant lui-même a fait cette réflexion :
« Robert, que je viens d’envoyer, doit être blessé. »
Un gros bouleau avait été coupé net à 2 mètres du sol et barrait tout le chemin ; j’ai été obligé de me frayer un passage à travers les branches. Car il n’y avait guère que moi qui passais là pour aller communiquer à ma compagnie. Les hommes étaient extrêmement fatigués.
Depuis le 2 au soir, nous sommes dans les tranchées, les hommes n’ont presque pas de sommeil, car jour et nuit il faut travailler et être sur le qui-vive, ils n’ont pris presque aucune nourriture depuis le 7, car les cuisiniers ne leur portent la soupe que quand ils croient voir une accalmie ; d’ailleurs beaucoup n’ont pas le cœur d’y goûter.
Dollinger, qui montait la soupe dans la journée du 10, a eu son récipient crevé par un éclat d’obus et ne put arriver jusqu’à son escouade.
En allant communiquer les
ordres, je vois les hommes affalés dans la tranchée et somnolant. Ils ont tous
des yeux de fièvre et les pommettes des joues saillantes et rouges. Mais dès le
plus petit incident, une fusillade qui se déclenche par exemple, ils se
dressent tous comme mus par un ressort et, automatiquement, se mettent aux
créneaux.
Le commandant fait un rapport disant que ses hommes sont exténués et il insiste pour que son bataillon soit relevé. Dans toute cette affaire, le commandant CHALET, qui n’était pas partisan de l’attaque, a l’air d’avoir été laissé à l’écart. Je ne sais si je me trompe, mais beaucoup d’ordres ne passent pas par lui et sont transmis directement du colonel Auroux.
Enfin il obtient gain de cause
et l’ordre de la relève arrive dans l’après-midi.
Nous devons aller à Villeneuve, de l’autre côté de l’Aisne, et nous sommes relevés par les chasseurs alpins. Leurs officiers viennent reconnaître les tranchées et nous les conduisons à nos compagnies respectives.
Le soir, à la nuit, nous allons chercher les compagnies alpines
dans le bas de Crouy. Dans la nuit extrêmement opaque, il se produit une
pagaille indescriptible ; les hommes qui ne suivaient pas avaient vite fait de
perdre leur chemin et la compagnie qui remplaçait la 24ème a été au moins 2
heures pour trouver son emplacement.
La pluie tombe toujours. Nous partons.
Mais le commandant reste à son poste de combat, je ne sais pour quelle raison. Nous allons cantonner à Villeneuve. Pour la liaison, nous trouvons une maison hospitalière ; nous avons un lit, des matelas et des draps. Je couche avec Chauvot sur un matelas étendu par terre, et c’est avec délices que je me glisse entre les draps. Il y a longtemps que pareille chose ne m’est arrivée.
Je dors d’un sommeil de plomb.
Le 12 janvier
Le 12 janvier dans la matinée, nous assistons, de Villeneuve-Saint-Germain, à une violente bataille qui se livre sur les pentes de Crouy, de l’autre côté de l’Aisne.
L’artillerie fait rage, nous voyons distinctement les éclatements des projectiles. Les officiers suivent à la jumelle les phases de la bataille. Nous voyons des bataillons français gravir les pentes puis les redescendre. Des bruits contradictoires circulent. Le commandant CHALET nous rejoint. Il apprend aux officiers que tout ne va pas tout seul.
Dans la soirée, nous recevons l’ordre de partir. Où allons-nous ?
Nul ne le sait.
En arrivant à Soissons nous
attendons très longtemps avant de repasser le pont des Anglais.
Finalement, le Colonel Auroux
vient trouver le commandant CHALET.
Il est très énervé. Il veut aller faire une reconnaissance au château
Saint-Paul, Q.G. de la Brigade ; il craint qu’elle ne soit prisonnière. Il
demande une section et il prend la tête avec le commandant et la liaison.
Après la traversée du pont, nous trouvons une foule de soldats de tous les régiments qu’une étroite surveillance empêchait de passer le pont.
Le colonel Auroux en attrape plusieurs, les traite de lâches, leur parle de conseil de guerre, leur dit qu’ils seront fusillés, etc., mais ils sont trop nombreux. Il reprend la route de Saint-Paul en marchant à une allure désordonnée. Nous avons vite fait de semer la section qui nous suivait et comme elle n’avait aucune mission précise, je ne sais ce qu’elle devient dans la nuit.
Le colonel Auroux a absolument l’air d’un fou.
Je soupçonne, comme c’est lui qui a réclamé avec insistance cette attaque et qu’il en est l’âme, qu’il est écrasé par le poids des responsabilités en voyant la façon dont tourne cette affaire.
Le commandant CHALET lui donne des conseils de prudence qu’il ne veut pas entendre. C’est un homme absolument désemparé. Nous arrivons enfin au château de Saint-Paul sans encombre. La brigade est là, et nous trouvons qui ?
L’adjudant Bouchet et sa section avec le drapeau du régiment.
Nous restons longtemps dans une salle du château où le commandant CHALET a une petite altercation avec un officier d’état-major ; il rend l’état-major responsable de ce qui arrive.
Au bout d’un certain temps, nous revenons vers notre bataillon ; le matin arrive.
Le 13 janvier
Le bataillon est amené au faubourg et au château de Saint-Médard où il se met à l’abri. Défense de se montrer dehors ; nous n’avons rien à manger.
Dans la journée, nous voyons des troupes d’autres régiments qui traversent la plaine. Le canon fait rage. Des obus fauchent une escouade de la 21ème qui était abritée des vues par un mur.
Des ordres sont donnés ; nous devons marcher le soir. Nous sentons que cela va mal.
À la tombée de la nuit, nous partons et passons vers les magasins
généraux, où nous devions rester tout d’abord, car l’ordre avait été donné de
faire une ligne de défense coupant la plaine du château de Saint-Paul à
la Verrerie. Les compagnies restent échelonnées sur la route de Terny,
à proximité de la Verrerie.
Nous montons avec le commandant jusqu’à la maison de Gisèle, où se trouve le poste de commandement du colonel. Sur la route, c’est une effroyable pagaille.
Dans la nuit, des troupes de tous les régiments sont mélangées sans
savoir où elles vont ni ce qu’elles font. C’est un désordre indescriptible. Si
les Allemands bombardaient la route de Terny, quelle boucherie cela
ferait ! Le commandant entre parler au Colonel.
Pendant ce temps, en causant avec les cyclistes, nous apprenons que le 5ème bataillon qui n’avait pas été relevé a été chassé de ses positions ; les Allemands ont attaqué en force et nous avons perdu non seulement ce que nous avions pris mais même nos anciennes positions.
Le commandant, en sortant de
chez le colonel, donne l’ordre aux compagnies de retourner à Saint-Médard
où elles étaient. Je crois comprendre que l’on voulait contre-attaquer sur les positions du 5ème bataillon, mais vu
les conditions c’est presque impossible. Nous redescendons la route et
communiquons l’ordre aux compagnies. Il y a toujours la même pagaille et la
route est absolument encombrée.
Nous rentrons à Saint-Médard et reprenons nos emplacements.
Naturellement nous ne pouvons allumer aucune lumière qui se voie du dehors sous
peine d’être bombardés. Les hommes se couchent comme ils peuvent où ils
trouvent de la place.
La liaison, nous nous couchons dans une petite cuisine où nous nous
entassons les uns sur les autres. Nous tâchons tout de même de nous reposer un
peu.
Le 14 janvier
À minuit environ, je suis réveillé en sursaut par une voix qui
crie :
« CHALET ! CHALET ! »
C’est le colonel Auroux.
Toute la liaison saute sur pied ; nous sentons qu’il y a quelque chose de grave. Nous entendons alors le lieutenant-colonel dire au commandant CHALET qu’il faut immédiatement passer le pont. Il est venu en auto le prévenir avant d’aller à la brigade.
Alerte aussitôt ; je cours réveiller la compagnie, et 5 minutes après tout le monde était dans la rue. Le commandant se fraye un chemin à coups de trique et prend la tête du bataillon, qui passe le 1er le pont des Anglais.
Nous traversons Soissons et attendons les ordres à la sortie, sur la route de Paris. Ils arrivent au bout d’un certain temps et nous partons pour Missy-aux-Bois.
Au bout de 2 poses, le
commandant envoie en avant le capitaine Noël
et les fourriers pour faire le cantonnement. Avec son cheval, le capitaine a
vite fait de nous semer. Mais au bout d’un certain temps un cycliste, Chabin, nous rattrape et nous dit
d’attendre le bataillon, que nous n’allons plus à Missy ; il file en
avant pour communiquer l’ordre au capitaine Noël.
Nous marchons toute la nuit et arrivons à Ploisy à 6 heures du matin le
14 janvier.
Nous faisons les cantonnements
au galop ; nous connaissions déjà le pays pour y avoir séjourné un jour au mois
de septembre. Une violente altercation se produit entre le commandant CHALET et le capitaine Chauvet de la 24ème.
Ce dernier a l’air très exalté, un peu fou. Il crie pour les cantonnements.
Le commandant CHALET, qui ne perd pas son sang-froid, tâche de le calmer et lui reproche d’avoir amené sa compagnie en retard de Saint Médard à Soissons.
Chauvet lui répond qu’il ne se sauve pas et qu’il est arrivé jusqu’à Soissons l’arme sur l’épaule. En réalité, une section n’avait pas suivi et, dans la nuit, il s’était perdu. Je crois même que ses 3 autres sections étaient arrivées avant lui au bataillon.
Dans la journée, nous sommes ravitaillés et nous recevons encore
des caisses provenant de dons qui sont distribués dans les compagnies. Toute la
journée est employée ainsi.
Le 15 janvier
Nous avons été prévenus la veille au soir que nous devons partir dans la matinée pour Berzy-le-Sec. Sur la route, nous voyons beaucoup de gens qui se sauvent, qui fuient les horreurs de la guerre et de l’invasion. Nous ne savons si nous devons ajouter foi à leurs récits, car beaucoup tendent à généraliser ; nous ne savons rien de la situation ; c’est dire que les bruits les plus fantaisistes ont libre cours.
Je n’y prête guère d’attention ; j’en ai déjà tellement entendu.
Par un temps plutôt incertain, nous nous mettons en route pour Berzy-le-Sec. L’étape n’est pas très longue.
Nous y arrivons de bonne heure. Nous avons de bons cantonnements.
2 heures après notre arrivée, le capitaine Chauvet s’en allait dans une ambulance automobile ; il était
évacué pour maladie.
Les journées des 16 et 17 janvier sont employées à se nettoyer et remettre un peu en état. Le moral n’est pas brillant. Après ce que nous venons de vivre, cela n’a rien d’étonnant.
Le Maréchal des Logis Riboux est adjoint au commandant et vient à la liaison.
Le 18 janvier
Le lieutenant-colonel passe en revue le régiment.
Nous devons retourner à Soissons le soir même. Nous nous mettons en route assez tard de façon à ne pas nous faire bombarder sur la route. Nous relevons un régiment d’active. Ma compagnie est dans le faubourg Saint-Christophe. En somme, le bataillon garde depuis le château de Saint-Crépin jusqu’à Maison-Rouge, sur la route de Mercin. La 21ème a un petit poste au bord de l’Aisne au pont de Pasly.
Les journées des 19,20, 21 et 22 janvier sont employées à organiser la défense de la position. Des tranchées sont creusées, des créneaux faits dans les murs, des cheminements établis dans les jardins etc.
Le 19, le petit poste du pont de Pasly est surpris par les boches, il y a 3 blessés. Tous ont pu être ramenés et le petit poste a été amélioré pour éviter toute surprise à l’avenir.
Le 23 janvier
Nous sommes relevés le soir par le 5ème bataillon. Nous allons dans la journée reconnaître les cantonnements. Ma compagnie est à la Montagne de Paris, la 23e est à Vauxbuin. Le commandant est dans une villa près de la 21ème compagnie.
Comme il mange avec les officiers de la 21ème, il la garde toujours près de lui. La relève a lieu sans incident. Les cantonnements ne sont pas fameux et tous les hommes préfèrent les tranchées de 1ère ligne à Soissons quand tout est calme bien entendu. Là, ils sont propriétaires des maisons, de coquettes villas qui maintenant sont saccagées mais qui offrent tout de même un peu de confort.
Nous faisons notre cuisine chez une personne qui est évacuée des régions envahies. Elle a un enfant qu’elle soigne au petit bonheur et qu’elle laisse pleurer tandis qu’elle-même se fait faire la cour par les soldats.
C’est déplorable de constater les mœurs qui ont cours depuis la guerre. Des jeunes-filles, des femmes doivent être évacuées par les autorités pour enrayer la propagation des maladies vénériennes. Partout on rencontre l’esprit de lucre et la débauche.
Beaucoup de personnes se mettent commerçants et débitent surtout du vin et de l’alcool qu’ils vendent aux soldats hors de prix.
Le 28 janvier
Nous allons à Soissons relever le 5ème bataillon. Aucun incident ne se produit durant la relève. Un état d’esprit déplorable règne à la liaison.
La longueur de cette guerre tend les nerfs à l’excès.
Février 1915 : Soissons
Le 2 février
Le commandant envoie les fourriers reconnaître le cantonnement à Saconin où nous devons aller à la prochaine relève qui ne se fait que le 5.
Le 5 février
La relève a lieu et nous allons à Saconin comme il était prévu. Tout le monde se case après les discussions comme il y en a toujours à chaque changement de résidence.
Comme je me trouvais vers les officiers qui étaient à table en train de manger, j’entends cette appréciation sur les soldats du commandant CHALET qui aime bien généralement pousser les affirmations jusqu’à l’excès :
« Les troupiers, ce sont des individus sales, fainéants,
voleurs, menteurs, paillards et qui doivent être menés à coups de trique ; et
il n’y a aucune exception. »
Quoiqu’il y ait du vrai dans tout cela, je trouve cependant que le commandant CHALET a trop tendance à généraliser. Il y en a d’ailleurs beaucoup qui subissent l’influence du milieu.
Le 6 février
Comme quelques officiers n’étaient pas logés, nous allons à la recherche de lits pour eux.
C’est M. Buizard, le docteur, qui commence à se
plaindre. Il avait choisi sa chambre et je l’avais donnée au capitaine Noël, la chambre étant meilleure. Je ne
fais en cela que suivre les règlements, mais ce Monsieur s’est trouvé froissé. Il
vient donc avec nous pour chercher des chambres, et je dois dire que dans
beaucoup de maisons il fut grossier avec
les habitants.
Parce que c’est la guerre et qu’ils ont quelques galons, il y a des
gens qui, partout où ils se trouvent, se croient tous les droits. Après la
tournée du pays, au cours de laquelle nous ne dénichâmes naturellement aucun
lit, M. Buizard me dit bien
aimablement « que je ne retombe jamais dans ses pattes ».
J’allai le trouver ensuite pour lui demander des explications. Résultat
: tout s’arrange ; je ne dois pas tenir compte de ses paroles, me dit-il.
Le 8 février
Je vais faire une balade à cheval avec Riboux, le Maréchal des Logis adjoint ; nous allons jusqu’à Missy-aux-Bois
et revenons par un temps splendide.
Les officiers vont à la chasse, exercice qui est absolument défendu et sévèrement réprimé pour les simples poilus. Il est vrai que les règlements ne sont pas les mêmes pour les hommes que pour les officiers. Ceux-ci se considèrent comme les maîtres et doivent avoir tous les droits.
Le Lieutenant Dutemple tue un lièvre.
Le 9 février
Il fait un vent froid.
Les compagnies vont à l’exercice et le reste de la relève se passe ainsi tranquillement. Je ne vais pas à l’exercice et reste au cantonnement avec toute la liaison, ou bien je fais quelques petites promenades à cheval, à bicyclette et même à pied. Un jour, un avion atterrit tout près du village ; il est porteur d’ordres pour l’artillerie de 75 qui se trouve tout près.
Assez souvent, des avions survolent le village et ils sont quelquefois canonnés par les boches.
Le 12 février
La relève a lieu et nous retournons à Soissons. Ma compagnie reprend son emplacement dans le faubourg Saint-Christophe et, pour aller communiquer de l’hôtel Barral où nous sommes avec le commandant, je traverse tous les petits jardins à travers lesquels un chemin plus ou moins praticable a été créé à travers les murs et les clôtures.
Les Allemands bombardent fortement ce coin des côtes de Pasly de l’autre côté de l’Aisne où ils ont des vues.
À chaque fois que je passe, en me dissimulant cependant le plus possible, je suis salué par quelques shrapnels. Quelquefois cependant, je m’attarde derrière un mur à cueillir les premières violettes qui font leur apparition. Un civil qui était demeuré avec sa femme dans sa maison à l’entrée du faubourg fut blessé mortellement.
Le 17 février
2 compagnies sont relevées par celles qui étaient cantonnées dans l’église.
Le 18 février
Le général Grandmaison est venu en auto et, accompagné du lieutenant-colonel Collon qui a pris le commandement du régiment et du commandant CHALET, va visiter le secteur.
Mais il se fait trop voir une fois hors des maisons et l’artillerie ennemie envoie une rafale de shrapnels.
Le général est blessé mortellement et ramené à l’hôtel Barral. Tout le monde se précipite ; le lieutenant-colonel a eu un moment d’émotion et il ne revient qu’un certain temps après, tout seul ; il s’adresse à moi-même en entrant dans la cour et fait dire « qu’on ne le cherche pas ».
Ce fut aussitôt dans l’hôtel un va-et-vient inusité. Des officiers, des parents du général arrivent en auto ; mais il n’y a rien à faire ; il expire dans la soirée. (*)
Sa femme est arrivée et passe la nuit à l’hôtel avec des parents.
Dans la soirée, notre artillerie bombarde les positions ennemies.
(*) : Louis Loyzeau
de Grandmaison a été blessé mortellement, il était le commandant de la
53e division d’infanterie.
Le 19 février
Le corps du général Grandmaison est emmené en automobile ; nous lui rendons les honneurs.
La relève a lieu le soir et nous allons à Vauxbuin où nous cantonnons. La 21ème est logée à l’entrée du village, près de le Montagne de Paris. Elle trouve place tout entière dans une maison abandonnée par les civils.
Rien de saillant durant notre
séjour. On parle beaucoup des infirmières de l’ambulance de Vauxbuin.
Nous recevons quelques obus sans mal.
Le 25 février
L’adjudant de bataillon et les fourriers du 292ème viennent pour reconnaître le cantonnement ; ils nous trouvent à la liaison pour les leur faire voir. Nous étions logés dans une maison abandonnée dans une petite ruelle à 50 mètres de la 21ème compagnie.
Au moment où ils arrivent, nous avions une grande note à copier, et nous insistâmes pour qu’ils attendent quelques minutes de façon que nous puissions communiquer la note en leur faisant voir les cantonnements.
Alors Chauvot, l’adjudant de bataillon, nous laisse à notre copie et sort avec l’adjudant du 292ème et les fourriers pour leur faire voir ou plutôt leur donner une idée de l’ensemble des cantonnements.
10 minutes après, alors que nous avions fini de copier la note, une
rafale d’obus s’abat tout près de nous et nous apprenons qu’il y a des tués et
des blessés. Nous sortons vivement.
2 obus étaient tombés juste sur un petit rassemblement devant la porte de la 21ème.
L’adjudant Méhaux de la 21ème était tué d’un éclat dans la tête (*), l’adjudant de bataillon du 292ème tué aussi d’un éclat qui lui avait sorti le cœur de la poitrine et il y avait encore 6 blessés dont Chauvot, qui avait été atteint aux jambes ; une jeune-fille avait été également blessée.
Si nous n’avions pas copié la note en question, nous devions nous trouver, tous les fourriers rassemblés, à l’endroit où ces obus sont tombés.
(*) : Méhaux
Hippolyte Jean, adjudant au 204e RI, mort pour la France à Vauxbuin le 26
février 1915, tué à l’ennemi. Il était né à Paris, le 17 août 1874.
Le 26 février
Nous allons avec le capitaine Noël à Parcy-et-Tigny et la 22ème à Hartennes pour faire les cantonnements. Nous sommes à bicyclette et le capitaine Noël à cheval.
Comme les chemins sont affreusement mauvais, il part en avant et, quand nous arrivons, il a reconnu tous les cantonnements. La 21ème est logée dans la grande ferme.
Le 27 février
Le Médecin-major Buizard essaie encore de recommencer sa comédie pour sa chambre ; je lui offre, ironiquement, de changer avec la mienne, et finalement il garde celle qui lui avait été assignée.
L’après-midi, je vais avec la promenade des chevaux.
Je monte, avec une simple couverture, un cheval du fourgon de bataillon, et il ne me sentait pas trop solide. Pour comble, nous rencontrons en route un convoi de camions automobiles sur une route très peu large ; les chevaux prennent peur et quelques-uns, dont le mien, montent sur le talus du chemin qui surplombe les champs y attenant d’une hauteur d’environ 2 mètres.
Mon cheval fait 2 tours sur lui-même, les pieds réunis sur ce talus, puis finalement prend son élan et saute dans le champ. Je le laisse faire, me bornant à le soutenir, aimant mieux risquer un saut périlleux dans la terre meuble que d’être projeté sous les roues d’un camion.
Mais je me révèle bon écuyer et ce saut me semble, après, la chose la plus simple du monde.
Mars 1915 : Aisne
Le 2 mars
On annonce pour le lendemain la visite du général Maunoury commandant la 6ème armée. Aussitôt, on fait tout nettoyer et tout ranger et des ordres sont donnés en conséquence.
Le 3 mars
Le général vient dans l’après-midi ; il arrive en automobile. Il fait son tour dans les compagnies et, naturellement, fait quelques observations, notamment au sujet des cheveux et de la barbe, qui sont le principal souci des chefs militaires. Nous continuons à vivre la vie de caserne dans toute son horreur.
J’ai, pour ma part, beaucoup
moins à en souffrir que si j’étais dans la compagnie, et cependant cela me
pèse. Je ne peux comprendre même comment des hommes âgés acceptent si
docilement cette servitude militaire que l’on pourrait bien éviter.
Il est à remarquer qu’ils sont beaucoup plus astreints que dans les tranchées et d’ailleurs le plus grand nombre préfèrent la vie des tranchées avec tous ses dangers à cette vie de caserne que nous menons ici, où l’on ne peut faire un pas sans se heurter à des sentinelles qui ont des consignes formelles.
Il paraît que c’est cela qu’on appelle la discipline. Résultat : chacun se tire le plus qu’il peut ; au lieu de suivre les chemins, on s’en va à travers champs ; ceux qui attrapent de la prison, que les chefs dispensent largement, disent que « c’est un manque de chance ».
Le 6 mars
Nous partons à bicyclette faire le cantonnement au Plessier-Huleu, toujours avec le capitaine Noël qui nous laisse encore en route. Quand le cantonnement fut fait, je déjeunai dans un débit du village avec le capitaine et le cycliste Constant nous rejoint. Ma compagnie est logée dans la grande ferme ; il y a des lits en trop et nous trouvons le moyen d’avoir chacun le nôtre.
Je couche avec Benne, le Maréchal des Logis adjoint, et on éprouve une certaine satisfaction à coucher déshabillé et dans des draps. Il y a longtemps que pareille aubaine ne nous était arrivée.
Le 7 mars
Il fait froid et la neige tombe ; les hommes sont gelés dans les greniers.
La vie de caserne reprend ; les compagnies font des marches, des tirs, puis les médecins commencent la vaccination contre la fièvre typhoïde ; on doit nous faire 3 piqûres.
Le 11 mars
Le régiment fait une petite manœuvre : comme thème, la contre-attaque, entre Le Plessier et Baslieux où est cantonné le 5ème bataillon et l’état-major du régiment.
Le 12 mars
Ma compagnie va au tir ; il fait un brouillard froid.
Le samedi
13 mars
Dans la matinée, le régiment fait des évolutions, puis défile devant le colonel, et nous rentrons au village au son des clairons et tambours. Il fait un temps superbe, une vraie journée de printemps.
Le dimanche 14 mars
Nous avons repos et, les hommes ayant toute liberté de circuler, tout le village est envahi par une foule de soldats. Beaucoup en profitent pour boire plus que de raison. Ce ne sont pas les bistros qui manquent. Dans la plupart des maisons, on vend du vin, et beaucoup d’habitants préfèrent faire ce commerce plutôt que de cultiver leurs champs.
Cela leur rapporte davantage.
Nous nous faisons photographier (*) dans le jardin de la maison où nous avons établi notre popote et nous passons la journée à tirer des épreuves dans la cave.
(*) : Dommage que la photo ne nous soit pas parvenue…
Le lundi 15 mars
Le Lieutenant Dutemple de ma compagnie ayant obtenu une permission pour se marier, ou plutôt pour régulariser sa situation, part à Paris.
Le mardi 16 mars
C’est le tour du capitaine Noël, qui a obtenu une permission par dépêche ministérielle.
Il fait l’étonné et dit ne pas savoir ce que cela signifie. J’apprends des choses précises sur la conduite de nos officiers et celle de la fermière chez qui ils sont logés. Le fermier, un homme très sérieux d’après les gens du village, est artilleur sur le front ; sa femme, qui a tout l’air d’une hystérique, se console avec qui elle peut.
Le capitaine Dauphin de la 24ème est aussi toujours dans cette ferme où il se passe des scènes d’orgies qui ne peuvent même pas être racontées.
Quel exemple pour les deux charmants enfants de la fermière qui voient tout ce qui se passe !
Le 23 mars
Les fourriers partent à 7 heures 30 pour faire les cantonnements à Billy et à Venizel. Nous faisons la grand’halte à Septmonts. Avant de descendre dans le village, nous avons sous les yeux un magnifique panorama.
Le temps est beau et il fait même chaud. Le 5ème bataillon va prendre les tranchées à Venizel où il y a une tête de pont. Le 6ème reste à Billy.
Quand le bataillon arrive,
j’ai encore des difficultés avec les lits d’officiers. Ceux-ci ne sont jamais
contents, et en particulier le Médecin-major Buizard. Finalement ils sont bien obligés de prendre ceux
qui sont disponibles. Quand ils sont chez eux, je doute que la plupart d’entre
eux soient aussi difficiles.
Pendant ce temps, les hommes s’installent dans des granges et des caves où il n’y a pas de paille, ou bien s’il y en a elle est remplie de poux et de vermine. Je déniche un jeu de jacquet dans une maison abandonnée et je m’empresse de l’apporter à la liaison.
Dès l’arrivée du bataillon, un officier explique au commandant que
la fermière du Plessier-Huleu avait, au départ, réclamé 3000 Kgr. de
paille qui soi-disant ne lui avaient pas été payés. Le commandant fait aussitôt
une note pour le Lieutenant Bernard,
officier des détails, pour qu’il veuille bien payer ce qui était réclamé.
J’apprends aussi qu’au départ le Lieutenant Viault n’avait pas manqué de faire ses adieux à la fermière, et cela dans un petit coin du bâtiment, alors que la compagnie partait.
Le soir, nous attendons les voitures une bonne partie de la nuit et
je ne vais me coucher qu’à 4 heures ½. Nous sommes bien installés et pour toute
la liaison nous avons des paillasses.
À 6 heures ½, le Lieutenant Nault,
l’ordonnance du commandant, vient nous faire lever pour avoir un cachet pour le
commandant qui est indisposé. Il fait beau temps. Comme avant de partir du
Plessier il y avait eu des scènes de désordre, des hommes ayant bu plus que
de raison, le commandant fait consigner tous les débits et leur défend de
vendre du vin.
Dans ce village, comme partout où nous passons, il y a des jeunes-filles et des femmes très accueillantes. Quelle influence cette maudite guerre aura sur les mœurs ! C’est à désespérer.
Nous sommes submergés par la paperasse et les notes de toutes sortes.
Le 31 mars
Il tombe de la neige le matin.
Le soir, nous allons à Venizel relever le 5ème bataillon.
Le commandant loge dans une petite villa à l’entrée du village et nous en face chez une dame où nous sommes très, très bien. La dame nous parle toujours de son ambulance qu’elle avait mise à la disposition de l’autorité militaire. C’est une très bonne personne, elle mange avec nous, ce qui nous oblige à être un peu plus civilisés qu’à notre habitude.
Nous couchons sur des sommiers et des matelas.
Avril 1915 : Aisne
Le 1er avril
Il a gelé dans la nuit et au matin tout est couvert de givre, mais le soleil se montre et dans la journée il fait un temps magnifique. Nous finissons de nous installer et allons reconnaître le village et l’emplacement des compagnies. Le village a bien souffert et il ne reste guère que des ruines. Je ne crois pas qu’il y ait une seule maison qui soit intacte. Les cuves de la raffinerie de pétrole ont été éventrées par les obus et on peut se procurer du pétrole dans des trous ou dans le fond des boyaux. La nappe reste au-dessus du niveau de l’eau.
Quatre fusils de chasse sont au P.C. du commandant, passés en consigne par le 5ème bataillon, et il y a des munitions, des cartouches à chevrotines.
Ces fusils pourraient avoir leur utilité en cas d’attaque des boches ou bien ils pourraient servir la nuit, alors que l’on entend des patrouilles invisibles. Mais ils sont destinés à rester au P.C. du commandant.
Dans l’après-midi, nous apprenons qu’un Taube serait tombé tout
près d’Ambrief où se trouve une compagnie du 6ème bataillon (la 23ème)
ainsi que la clique qui fait l’école.
À 10 heures du soir, il y a un exercice d’alerte qui était prévu
d’avance. C’est simplement pour s’assurer que les compagnies connaissent bien
l’emplacement qu’elles doivent prendre en cas d’attaque de l’ennemi.
Le 2 avril
Au matin, nous apprenons que l’adjudant GErardin (*), de la 24ème compagnie, a été tué dans la nuit par une balle française.
Je vais avec Macard, le fourrier, visiter le secteur, et en passant dans la 24ème on nous raconte avec tous les détails comment s’est produite la fatale méprise. Nous faisons ensuite tout le tour des tranchées de notre secteur, allons voir le pont qui est à moitié démoli, la raffinerie de pétrole qui est saccagée comme toutes les autres maisons du village.
Dans un coin, sous un petit hangar, des radeaux faits de fûts à pétrole sont rangés. Je doute fort qu’ils servent un jour pour le passage de l’Aisne.
Le secteur est très calme ; à
peine quelques shrapnels de temps en temps et notre artillerie tire beaucoup plus
que l’artillerie boche. Quand nos canons crachent, nous montons dans le grenier
d’un moulin abandonné au centre du village et de là, sans être vu, on découvre
toute la vallée et les pentes de l’autre côté de l’Aisne.
De cet observatoire, on peut juger si nos artilleurs font mouche ou s’ils gaspillent leurs munitions inutilement. Nous nous rendons compte que tous les champs sont cultivés du côté des boches, même ceux qui sont tout à fait à proximité des lignes.
(*) : GERARDIN Émile Jules, adjudant au 204e RI, mort pour
la France à Vénizel (Aisne), le 2e avril 1915, tué à l’ennemi. Il était né le 5
décembre 1882 à La Neuville-Garnier (Oise)
Le 8 avril
La relève a lieu ; nous retournons à Billy-sur-Aisne et sommes remplacés par le 5ème bataillon. Nous partons dans la journée pour faire les cantonnements qui sont changés 2 fois.
Finalement, ma compagnie est logée dans le bas du village, dans 2 ou 3 maisons où les hommes sont bien installés.
Le 9 avril
Le commandant Fabiani fait irruption dans « nos appartements », qui sont les mêmes que durant le 1er séjour. Il nous trouve en train de jouer, les uns aux cartes, les autres au jacket, etc. Cela n’a pas l’air de lui plaire, surtout aussi que nous ne nous dérangeons même pas.
Il dit :
« Qu’est-ce que c’est
que ce tripot, ce bastringue ? »
Finalement il sort et nous continuons notre partie.
Le 10 avril
Le commandant Fabiani revient chez nous, je ne sais pour quelle raison, et nous trouve encore en train de jouer.
Il nous fait une nouvelle scène et il me choisit pour accompagner à Venizel, l’aumônier et le pasteur. Les deux ministres du culte sont venus faire un petit tour ; ils distribuent quelques menus cadeaux à ceux qui viennent les entretenir et ils veulent aller voir le Colonel qui est à Venizel.
Je les conduis par les boyaux et les chemins détournés, car en plein jour il est impossible de passer sur la route. Cavin, le fourrier de la 22ème, est nommé adjudant de bataillon en remplacement de Chauvot. Jusqu’ici c’était Riboux qui en faisait les fonctions.
Le 11 avril
Il fait toujours un temps superbe.
Le lieutenant-colonel Collon vient visiter notre cantonnement ; il fait un petit tour dans le jardin où il cueille des fleurs. Puis il demande des explications à CAVIN au sujet de la distribution du vin.
Soi-disant, les compagnies ne doivent pas avoir de récipients pouvant contenir tout le vin qui leur revient et la distribution devrait être faite en 2 fois.
Le soir-même, une note paraît à ce sujet. Naturellement, cela ne
change en rien la manière de faire.
Les caporaux d’ordinaire, de même que nous qui faisons la distribution, préfèrent prendre d’un coup ce qui leur revient et être débarrassés ensuite.
Le colonel trouve aussi anormal que les fourriers soient à la liaison et qu’ils mangent en popote. Le commandant CHALET s’explique avec lui à ce sujet et rien n’est changé.
J’apprends qu’une pièce de 75 placée dans une grotte au sud-est de Billy et dont nous avions admiré la position a été atteinte par des éclats d’un obus qui est tombé juste devant l’entrée de la grotte. Elle ne devait cependant pas être facile à repérer. C’est peut-être le simple hasard.
Le 15 avril
On annonce que des officiers étrangers doivent venir dans le secteur. Les hommes ne doivent pas sortir et doivent rester dans des caves qui ont été reconnues. Il doit y avoir 2 heures de bombardement de notre part.
Finalement, on ne voit pas d’officiers étrangers et le bombardement n’a pas lieu. Comme l’heure était passée, Cavin jouait au jacquet avec le cycliste Brigandat sur le perron.
À ce moment, le colonel passe
sur la place et l’aperçoit. Il lui inflige 2 jours d’arrêt de rigueur. Tous les
jours, nous fournissons des corvées pour le génie. Elles travaillent à
l’établissement de la 2ème ligne de défense : pose de fils de fer, creusage des
tranchées etc.
Dans la journée, un clairon est de garde sur la place du village ; dès qu’il aperçoit un avion, il donne un coup de langue et tout le monde doit disparaître.
Le 21 avril
Nous devons aller cantonner au Plessier-Huleu. Au moment où nous allions nous mettre en route pour aller faire les cantonnements, un contre-ordre arrive et nous devons nous rendre au Grand-Rozoy. Nous faisons la grand’halte au-dessus de Septmonts, où en passant nous avons rencontré le maréchal des logis d’artillerie qui dirigeait les crapouillots, le « vieux brigand », comme on l’appelle.
Il est maintenant dans une batterie de 155.
Tout en cassant la croûte sur
la pente de la colline, nous jouissions d’un coup d’œil magnifique. Le village
se trouve comme dans le fond d’un cirque et, tout autour, de très hautes
collines le surplombent. Il y a beaucoup de bois sur les pentes et les crêtes
et le printemps, en dépit des heures tragiques que nous traversons, met son
renouveau sur toute la campagne.
Nous arrivons dans l’après-midi au Grand-Rozoy
et nous faisons aussitôt les cantonnements. Il y a des lits en quantité et nous
nous en réservons. La liaison va être bien éparpillée, un peu aux quatre coins
du village, mais tant pis.
J’attends ma compagnie jusqu’au matin.
Elle n’arrive qu’au petit jour.
Je passe la nuit sous un hangar de la ferme dans le bas du village. Il faisait
un froid de loup et le matin il y avait une gelée blanche.
Le 22 avril
La journée est consacrée à l’installation. Le village est assez plaisant et les gens sont aimables.
Le 23 avril
Nous fêtons la Saint-Georges en compagnie du sergent-major Poulet et de la liaison de la 21ème. Nous sommes tous très bien reçus chez un assez fort propriétaire qui vend du vin ainsi que du lait, dont je fais une cure. J’en bois 2 litres tous les jours.
Il y a dans cette maison 2 jeunes-filles, assez libres d’allure quoique sérieuses.
Le fourrier Macard avait choisi sa chambre dans cette maison, mais il en fut délogé, toujours par le Major Buizard qui a encore voulu voir tous les lits du pays le lendemain de son arrivée.
Seulement cette fois il avait raison ; son cycliste Dubosc était arrivé avant le bataillon pour faire le cantonnement et il nous avait dit qu’il avait une chambre pour les deux médecins. Naturellement, nous ne nous étions plus occupés de lui.
Mais sa chambre était tout juste un taudis, alors que tous les fourriers et d’autres sous-officiers étaient bien couchés. Il choisit une autre chambre et ce fut le sous-lieutenant de Lauzun de ma compagnie qui prit la place de Macard.
Les officiers voulaient nous
empêcher d’aller dans cette maison, car certains d’entre eux ayant agi en
goujats envers les jeunes-filles et les habitants, ils étaient plutôt mal
reçus. Ils ont été jusqu’à menacer le patron de le faire arrêter sous prétexte qu’il
y avait chez lui des effets militaires.
Naturellement, comme des troupes avaient été cantonnées très longtemps chez eux, il y avait des vieux effets jetés par les soldats. Moi qui allais très souvent dans cette maison, je n’ai jamais rien remarqué d’autre.
Tout ce que je sais, c’est que je trouvais lait, vin et œufs chez eux et que nous étions tous très bien reçus. Malgré les menaces directes ou indirectes, la consigne etc., nous ne cessâmes d’y aller, et j’y fis quelques bons dîners, notamment le jour de la Saint-Fernand, la fête du sergent-major.
Ce jour-là, nous étions installés dans la grange et nous fîmes le baptême d’un veau nouveau-né.
Viard, le brancardier, nous prit plusieurs fois en photographie.
Le 24 avril
Tout le régiment alla à une manœuvre.
Dans l’après-midi, une musique d’un régiment territorial vint pour
répéter avec les cliques des régiments de la division. Je remarque même que le
chef de cette musique dont on me dit le nom est un tout jeune homme et que sa
place serait mieux dans les tranchées.
Tout l’après-midi et la journée du lendemain sont pris pour la préparation de la revue qui doit avoir lieu le 26.
Le 26 avril
La revue est passée par le président de la république et le ministre de la guerre qui arrivent en auto. Il fait un temps superbe.
Tandis que les compagnies se placent, le commandant CHALET, devant tout le bataillon, traite un peu cavalièrement le lieutenant Café, commandant la 23ème compagnie. Il y a une remise de décorations, puis défilé au son de la musique, et le lendemain nous voyons sur les journaux que M. Poincaré est allé sur le front où il a passé en revue une division de réserve et qu’il a pu admirer l’élan et l’entrain des troupes.
Le 30 avril
Le quartier général de la division revient à Oulchy.
Il se fait de grands mouvements de troupe ; nous apprenons que le 231ème et le 246ème sont relevés par des territoriaux. Tout cela ne nous dit rien de bon. En ce moment où des bruits d’offensive circulent, nous préférerions être dans les tranchées et tenir un secteur.
Enfin, nous tâchons de profiter le plus possible du temps que nous passons au repos.
Certains, suivant cette thèse, trouvent des compagnes d’occasion. Ici, comme partout ailleurs, la guerre a bien fait relâcher les mœurs.
Une dame de Parcy-et-Tigny, mariée et mère de famille, vient même jusqu’au Grand-Rosoy pour voir des officiers. En compagnie du capitaine Dauphin et du commandant CHALET, elle va cueillir le muguet dans les bois environnants.
La 24ème compagnie possédait un petit cheval qui servait pour aller chercher l’ordinaire, faire quelques corvées etc. Comme il était paru un ordre que les compagnies devaient se débarrasser de leurs voitures et attelages, ce fut cette dame qui hérita du cheval.
Mai 1915 : Artois, combat d’Angres, Bully, Aix-Noulette
Le 3 mai
Une visite de santé est prescrite et le commandant avait dit qu’il y assisterait.
Quand j’y vais, je vois que ce n’est qu’une simple exhibition et je ne la passe pas. Je ne veux pas servir de spectacle à des officiers plus ou moins sadiques. Personne ne me dit rien, mais un homme de la 22ème compagnie qui n’avait pas voulu la passer pour la même raison que moi a été puni de 8 jours de prison.
Le 6 mai arrive un ordre de changement de cantonnement. Nous devons aller remplacer le 216ème à Villemontoire. Nous partons avec tout le campement. Des ordres complémentaires doivent nous parvenir en route.
Mais arrivés à Hartennes où est le peloton des élèves sous-officiers, nous recevons un contrordre et nous retournons au Grand-Rozoy.
Le 7 mai
Le colonel nous passe une revue de départ.
Il trouve très drôle que chaque homme n’ait pas les piquets de tente sur son sac. Il devrait cependant déjà s’être rendu compte que ces piquets sont très pratiques pour allumer du feu et que les hommes qui sont déjà chargés excessivement ne se soucient guère d’emporter des ustensiles dont ils ne se servent jamais.
À 11 heures ½ dans la nuit, l’ordre arrive de se tenir prêt à
partir à 6 heures du matin.
Le 8 mai
à 3 heures ½, arrivent les ordres de détail, ce qui fait que nous ne dormons guère.
Nous quittons le Grand-Rozoy à 7 heures et en partant je regrette le temps relativement bon que j’y ai passé ; je n’y ai pas eu beaucoup le cafard et c’est appréciable.
Nous passons par Le Plessier en musique, puis Billy-sur-Ourcq, Chouy.
Le sac est lourd, les musettes aussi, car nous nous sommes munis de tout ce que nous pouvons emporter. Nous ne savons pas où nous allons et ne voulons pas être pris au dépourvu. Nous faisons la grand’halte le long de la Savière, sous les arbres.
Nous devons aller cantonner à Faverolles. On s’attend à embarquer cette nuit.
Je pars avec le campement à 12 heures ½, sous les ordres du capitaine Poitevin qui est maintenant capitaine-adjudant-major.
Nous faisons les cantonnements au petit bonheur, car le capitaine ne peut même pas faire une répartition équitable. Nous sommes très bien reçus par les habitants et nous trouvons même 2 ou 3 lits pour la liaison.
Gresle, le fourrier de la 24ème, fait la connaissance d’une dame, à côté d’où nous faisons notre popote. Elle est de son pays où il est instituteur. Elle a une belle chambre qu’elle ne donne jamais pour les officiers et qu’elle lui offre. Je couche avec lui au 1er étage ; un officier de ma compagnie couchait au-dessous dans une chambre qui ne valait pas la nôtre.
Le 9 mai
Le rassemblement des compagnies se fait à 5 heures. On doit se tenir prêt à partir, les faisceaux sont formés et les sacs bouclés ; mais ce n’est qu’à 11 heures ½ que nous recevons l’ordre de départ qui a lieu à 12 heures.
Nous traversons le village de Dampleux, puis nous nous engageons dans la forêt de Villers-Cotterêts.
Arrivés à la sortie, nous faisons une longue halte où nous prenons notre repas. On aperçoit la ville dans le fond de la vallée. Le temps est magnifique et, de l’orée du bois où nous sommes, nous embrassons un splendide panorama.
À 4
heures du soir, nous nous mettons en route.
Comme nous approchons de la ville, la clique se fait entendre et nous défilons l’arme sur l’épaule.
Nous entrons dans la gare en défilé, mais il y a contrordre ; après avoir traversé un grand nombre de voies, nous venons nous ranger dans la rue devant la gare où nous mettons sac à terre et attendons.
Notre arrivée avait amené une foule de curieux. Des employés plus ou moins militarisés, des militaires élégants, de fringants officiers, des automobilistes passent et repassent.
Beaucoup d’entre eux ont des femmes à leur bras, légitimes ou non, c’est la même chose. Certains donnent la main à des enfants. De voir cette vie, ce mouvement, nous donne à tous le cafard.
Et bientôt des lazzis, des propos plus ou moins accueillants se croisent de tous côtés. Le terme d’embusqué court sur toutes les lèvres, et la rue devient moins mouvementée.
Au bout d’une assez longue
attente, nous entrons dans la gare et embarquons. De « confortables » wagons à
bestiaux non aménagés et sans paille nous attendent.
Nous nous y entassons tant bien que mal, plus mal que bien. Nous avons touché des vivres d’embarquement : ½ boule de pain, du singe. Le train chargé de toutes les voitures, chevaux etc. du bataillon démarre à 8 heures 16.
Après avoir fumé un cigare, je m’installe pour essayer de dormir. Je m’enroule dans ma couverture et mon capuchon et me recroqueville sur le plancher du wagon, dans l’entrelacement formé par les jambes et les corps de mes camarades.
Les ressorts manquent un peu de souplesse et les chaos nous bousculent quelquefois. Je ne tarde pas néanmoins à m’endormir du sommeil du juste et je ne me réveille qu’après avoir passé Amiens.
Le 10 mai
Au matin, le train roule toujours et nous ne savons aucunement où nous allons.
A Frévent, il y a un arrêt d’une demi-heure environ. Houbard, un homme de ma compagnie, voit sa mère et ses sœurs qui sont du pays.
Il a juste le temps de les embrasser et c’est avec des larmes dans les yeux qu’il remonte dans le wagon. Plusieurs trains de blessés passent à côté de nous. Nous apprenons par eux qu’une forte action est engagée dans l’Artois et que nous avons avancé.
Le 20ème corps serait de ce côté, mais je ne puis avoir de renseignement précis en ce qui concerne le 37ème où est Marcel. La majeure partie des blessés que nous apercevons n’ont reçu que des blessures légères. Les langues vont bon train et les tuyaux les plus fantaisistes circulent.
Nous quittons bientôt Frévent et nous dirigeons sur Saint-Pol où nous débarquons vers les 9 heures du matin.
Il fait un temps superbe.
Nous partons de la gare en musique et le bataillon fait la grand’halte-repas à la sortie de la ville dans un pré contigu à la route. Je me rends compte qu’il y a de grands mouvements de troupes.
Plusieurs régiments passent en colonne ou dans des camions automobiles. Il y a une circulation intense d’autos, d’aéros etc. La gare de Saint-Pol est encombrée de locomotives sous pression.
Nous apercevons deux trains blindés qui sont garés sur les voies et les longs canons tendent leur cou au-dessus des wagons. Des locomotives et des wagons blindés circulent sur les voies et nous voyons passer encore 2 trains de prisonniers boches et 3 trains de blessés.
Les fourriers partent en avant du bataillon à 11 heures pour aller faire le campement à Ternas où nous passons la nuit. Nous nous montons une tente et nous tenons prêts à partir.
Voir >>> ici <<< sur mon site la description de la bataille d’Artois en mai 1915
Le mardi 11 mai
Nous nous levons à 5 heures et attendons les ordres.
Nous n’avons toujours guère de nouvelles de l’action qui se passe non loin de nous. Nous passons encore la journée et la nuit à Ternas. Les cantonnements ne sont pas fameux, et sales. Les maisons sont bâties en torchis et à moitié éboulées.
Le mercredi 12 mai
Nous quittons Ternas à 5 heures du matin.
Nous passons par Averdoingt, puis nous arrivons tout près de Tincques.
Avant d’entrer dans le village, le bataillon fait une pause et le commandant CHALET nous envoie en avant faire le cantonnement. Comme nous ne devons rester que peu de temps dans le village et que nous devons partir au 1er signal, il nous donne l’ordre de faire les cantonnements de façon à ce que chaque compagnie soit groupée.
Il fait sur la carte le partage du cantonnement : une compagnie de chaque côté d’un croisement de rues. Je trouve suffisamment de place pour ma compagnie et les officiers.
Le village, comme dans toute
la région du Nord, n’est pas bien gai, et beaucoup de maisons sont bâties sans
pierres. Nous prenons vite l’habitude du pays et nous buvons des « bistoules »,
du café avec de l’alcool, et des chopes de bière, qui est bonne et bon marché.
C’est une petite bière légère qui coule bien et sans faire de mal.
Nous sommes installés, si l’on peut dire, dans la maison d’un notaire où couche le commandant, et nous n’avons qu’une espèce de grange à notre disposition.
Pour ma part, je me fais un lit dans une écurie à côté où je ne serai pas trop mal.
La route d’Arras passe tout à côté et il y a un trafic intense. Camions, autos de toutes sortes. Nous voyons passer le général Joffre dans son auto spéciale munie de chaque côté d’une barre de fer recourbée destinée à couper ou soulever par-dessus la voiture les obstacles qui pourraient se trouver sur la route (par exemple un câble qui serait tendu d’un côté à l’autre).
De nombreux avions sillonnent le ciel.
Le jeudi 13 mai
La journée s’annonce pluvieuse.
Nous n’avons toujours guère de nouvelles des opérations en cours. Des trains de blessés venant d’Aubigny se dirigent vers l’arrière.
Les gens, cependant aisés, chez lesquels nous sommes, nous regardent d’un mauvais œil ; ils ne voulaient pas que nous restions chez eux. Cependant nous ne les gênons guère. C’est le commandant qui a insisté que nous restions là pour être auprès de lui.
La cour, fermée par une grille sur la rue, est envahie par l’herbe sur les côtés et il y a quelques arbres sous lesquels nous nous étions mis à l’ombre dans l’après-midi de la veille. Aujourd’hui on ne la cherche guère.
Pour comble de malheur, Macard trouve le moyen de casser après déjeuner une boule de verre qui émergeait d’un massif de fleurs et de verdure au milieu de la cour. Mais nous devons partir à 2 heures de l’après-midi et nous ne nous attirons aucune récrimination.
Au moment où le bataillon est
rassemblé, un convoi de 1200 prisonniers, suivant les dires, passe sur la route
d’Arras. Le capitaine Poitevin
qui a attendu pour les voir rejoint le
bataillon sur son Boussaâda qui le fait passer où il le veut bien et à l’allure
qui lui fait plaisir. Le capitaine reçoit du commandant quelques remarques
ironiques.
Il tombe une petite pluie fine.
Nous passons par Villers-Brûlin, Mingoval, Villers-Châtel,
où nous voyons dans un champ près de la route après le village au moins 250
croix de bois alignées. Ce sont des hommes décédés à l’ambulance qui est
installée dans le village.
En arrivant à Cambligneul, le prochain village où nous
cantonnons, j’apprends qu’Henri Martin
de Roffey est enterré là depuis une quinzaine.
Il était ordonnance d’un lieutenant et c’est en lui portant la soupe
dans les tranchées, avant l’attaque, qu’il a été frappé par une balle. Je tiens
ces renseignements d’un chasseur du 17ème qui était son camarade.
Le village est rempli de troupes, principalement des chasseurs et de
l’infanterie alpine et c’est avec beaucoup de peine que nous arrivons à caser
le bataillon. Quoique les cantonnements soient déplorables, les hommes seront
cependant mieux qu’au-dehors sous la pluie qui ne cesse de tomber.
Après avoir mangé et bu du lait que nous nous procurons dans la maison
où nous sommes installés et où est le commandant, je vais me coucher tout au
haut d’un tas d’avoine en gerbes, sous les tuiles, avec un de mes camarades et,
la fatigue aidant, je passe une bonne nuit.
Heureusement que nous n’avons pas de cauchemars durant notre sommeil et
que nous ne changeons pas de place, sans quoi nous aurions couru le risque de
dégringoler d’une belle hauteur sur l’aire de la grange et tous les instruments
aratoires (*) qui y sont remisés.
(*) : Qui servent au travail de la terre
Le vendredi 14 mai
Le vaguemestre nous rejoint dans la matinée et fait la distribution de
lettres. Pour ma part, j’en ai 3 de Jeanne qui étaient en retard.
La pluie continue à tomber.
Dans la journée, nous avons quelques détails au sujet de notre
offensive qui a très bien réussi. Carency est pris ou entouré et sur le
point de se rendre. Nous avons pris également la Chapelle de
Notre-Dame-de-Lorette.
Un curé, dans les rues du village, est transporté d’enthousiasme et, s’adressant à des poilus du 59ème chasseurs je crois, s’écrie :
« Ah ! Les voilà les braves qui ont pris d’assaut les
tranchées boches, qui ont pris Carency ! C’est bien cela, mes enfants !
etc… »
Le fait est que ce sont des régiments ou bataillons qui ont participé à l’attaque et qui sont remplacés.
Nous montons sur une petite éminence derrière le village et de là on nous fait voir la Chapelle de Notre-Dame-de-Lorette et l’emplacement approximatif des points principaux. Le canon tonne au loin ; une « saucisse » est non loin de nous, suspendue en l’air, et surveille l’horizon. L’après-midi, la pluie recommence.
Le commandant nous avertit qu’il faut nous attendre à partir le lendemain matin.
Le samedi 15 mai, combat d’Angres
Nous recevons l’ordre de départ
pour 6 heures ½.
Les couvertures qui avaient été mises dans les voitures de réquisition sont reprises. Chaque homme emporte tout son paquetage, le régiment allant s’engager, nous en aurons peut-être besoin. Nous devons nous rendre à Aix-Noulette, en réserve de la 43ème division qui attaque.
Nous voilà en pays minier ; nous passons les crêtes avec prudence, les compagnies échelonnées, et arrivons un peu en arrière d’Aix-Noulette où nous prenons nos dispositions pour être à l’abri des obus. Nous devons nous tenir dans un ravin, le long et en arrière d’une ligne de chemin de fer de la compagnie de Béthune.
Mais à peine étions nous
arrivés qu’un ordre arrive de nous porter en avant pour nous mettre à
disposition du général de Bouillon
qui commande le secteur d’Angres.
Le commandant CHALET fait la moue en disant que le général de Bouillon est un général de cavalerie et qu’il n’aime pas beaucoup être à sa disposition. Il n’en augure rien de bon.
Nous nous remettons en marche
et traversons Noulette qui a été bien atteint par les obus. Un grand
nombre de maisons sont éventrées et les ruines jonchent les rues.
Un instant, le bataillon se trouve bloqué par d’autres régiments qui se déplacent. Nous sommes obligés d’attendre quelques instants.
Durant cette pause, des poilus du 1er chasseurs nous donnent des détails sur l’offensive et les positions. Nous avons avancé sur Notre-Dame-de-Lorette, mais pour l’instant nous sommes arrêtés.
Le bataillon reprend sa route dès que le passage est dégagé et s’arrête après avoir passé la dernière maison du village, au beau milieu de la route et en pleine vue. Une saucisse boche n’est pas loin de nous et peut facilement nous repérer, par le temps clair qu’il fait.
Nous restons au minimum 2
heures en cet endroit et toutes les cartouches des voitures de compagnie et du
caisson de munitions sont distribuées aux hommes. On sent, par intuition, que
ça va chauffer.
Nous profitons de l’attente pour nous restaurer. L’ordre arrive d’aller nous placer dans les tranchées du 143ème près de Bully-Grenay à la fosse Calonne pour attaquer.
L’artillerie doit faire une préparation de 13 heures à 15 heures.
Le commandant CHALET, arguant qu’il ne connaît pas du tout le secteur, réclame des guides pour conduire ses compagnies. Nous traversons Bully-Grenay où quelques poilus de ma compagnie qui sont du pays voient leurs femmes et leurs enfants. Ils ne peuvent même pas s’arrêter et leurs familles les accompagnent un bout de chemin.
Bully-Grenay est un pays de mineurs assez étendu et l’air très avenant.
Les canons tonnent au loin
sans arrêt.
Enfin, à une certaine distance de Bully-Grenay, nous nous engageons dans les boyaux avec les 21ème et 22ème compagnies. Les 23ème et 24ème avaient pris un boyau avant l’entrée de Bully. Elles doivent être en réserve.
Quand nous arrivons au P.C. du chef de bataillon, l’artillerie a déjà fini sa préparation ; son feu n’est pas très intensif ; et les 21ème et 22ème compagnies arrivent difficilement par des boyaux encombrés à leurs tranchées de départ.
Le commandant CHALET se rend compte immédiatement de
la situation ; de plus, il aperçoit devant nos lignes les fils de fer boches
qui sont presque intacts. Il ne veut pas assumer la responsabilité d’une telle
affaire et rend compte au lieutenant-colonel Collon
et au général de Bouillon de la
situation. Le colonel est de son avis et il demande tout au moins un tir
intensif de l’artillerie avant l’attaque.
Le général renvoie l’ordre de marcher quoi qu’il arrive.
Pendant ces pourparlers, les compagnies ont réussi à gagner leur emplacement. L’artillerie ennemie arrose copieusement nos tranchées.
Je porte au lieutenant POMMIER l’ordre d’attaquer et ce n’est
qu’au prix des plus grandes difficultés que je parviens à passer. Les tranchées
et boyaux sont déjà encombrés de morts et de blessés.
En passant dans la 22ème qui devait suivre le mouvement de la 21ème, je communique l’ordre au lieutenant de Blanger que je trouve en tête de sa compagnie, un fusil baïonnette au canon à la main. Je communique aussitôt l’ordre au lieutenant POMMIER, qui commence immédiatement son mouvement, tandis que je retourne au commandant.
Arrivé en tête de la 22ème, le
caporal-fourrier de cette compagnie, qui voyait partir la 21ème, crie que l’on
arrête, que son commandant de compagnie n’est pas là et qu’ils ne veulent pas
marcher sans lui.
Comme, à mon passage, je l’avais vu prêt à partir, je lui crie aussitôt que son commandant de compagnie est déjà parti en avant, ce qui est la vérité.
Enfin, il n’y eut pas d’ensemble et l’on s’y reprit à 3 fois pour s’élancer. Il est vrai que tout le monde se rend compte que c’est une course à la mort, sans plus.
Enfin toute la 21ème et 2 sections de la 22ème
s’élancent, officiers en tête, mais ils n’allèrent pas loin.
Ils furent aussitôt pris sous un feu d’enfer des mitrailleuses et quelques Allemands sortirent eux aussi de leurs tranchées pour mieux tirer.
Dès lors, c’est la confusion.
Alors que les premiers, dont le lieutenant POMMIER, le lieutenant de Lauzun, l’adjudant Boucher et quelques hommes en avant de la 21ème arrivent jusqu’à des entonnoirs occupés par nos chasseurs, croyant être sur les tranchées allemandes, les hommes valides se replient et reviennent aux créneaux.
Mais beaucoup d’hommes restaient sur le terrain.
Tout ceci se passait en
quelques secondes et je me trouvais encore dans la tranchée occupée par la
22ème. C’est alors qu’il y eut un instant de panique dans la 22ème.
Quelques-uns criaient :
« Voilà les gaz ! »
Et cherchaient à s’enfuir en passant par-dessus les blessés qui obstruaient le boyau. Je me vis contraint de faire le coup de poing pour tâcher d’enrayer la ruée ; les hommes laissaient leurs armes pour fuir et échapper au danger imaginaire, comme j’eus vite fait de m’en rendre compte.
Finalement, on parvint à convaincre une bonne partie des hommes que le danger des gaz n’existait pas et qu’il leur fallait, au lieu de fuir, rester aux créneaux pour parer à toute velléité d’attaque de l’ennemi et je pus enfin rejoindre le commandant à son poste où je lui rendis compte de ce qui s’était passé.
En allant porter l’ordre d’attaque, j’entendis le sergent Roy de ma compagnie, dit Coco, d’Auxerre, tenir le propos suivant au lieutenant Dutemple :
« Je veux bien marcher, mais je veux marcher avec tous
les autres. »
« Je ne veux pas qu’il y en ait qui restent dans la
tranchée alors que je me ferai casser la gueule. »
« Je resterai pour faire sortir tous les hommes de
la section et partirai le dernier. »
Le lieutenant Dutemple l’approuva.
Dès qu’il fut possible, on établit le bilan des pertes qui sont fortes.
En allant communiquer à ma compagnie, je suis obligé d’enjamber les morts et les mourants.
Quel horrible spectacle !
Les brancardiers ne peuvent suffire et ne peuvent passer dans les boyaux et l’artillerie ennemie bombarde furieusement.
Je trouve abattu dans la tranchée un de mes bons camarades, Charles, agent de liaison de la compagnie, avec qui j’avais passé de bons moments au Grand-Rosoy.
Il est grièvement blessé et a été frappé par un obus en même temps que Vatant et un autre qui a été tué sur le coup. Tous 3 sont enchevêtrés les uns dans les autres.
Dès que Charles m’aperçoit, il me dit :
« Mon vieux Robert, le bol est rincé ! » (*)
C’était un Parisien, ce qui explique son langage imagé.
Comme je m’empressais pour lui porter secours, il me demanda seulement de lui allonger une jambe qui le faisait horriblement souffrir. Je fais mon possible, mais aussitôt Vatant (**), qui était blessé à la cuisse et était tombé en partie sur lui, se met à crier. Il m’est impossible de remuer ces deux grands corps pantelants tout seul et je prends le parti d’aller chercher les brancardiers.
Je cherchais à réconforter ces
deux blessés, tâchant de sourire et de plaisanter un peu pour chasser le
spectre de la mort qui planait au-dessus d’eux.
Mais les larmes malgré moi me sortaient des yeux et ma gorge se serrait.
Non, me dit Charles, je suis bien foutu, et il me serra la main en me disant adieu.
J’envoyai aussitôt Mermet et Casimir, deux brancardiers de ses bons camarades, qui transportèrent les deux blessés au poste de secours. Il y avait une cinquantaine de tués et blessés à ma compagnie. (***)
À la tombée de la nuit, les 21 et 22 quittent
le champ de carnage et vont loger à l’école de Bully-Grenay. Les 23 et
24ème restent toute la nuit en réserve dans les tranchées de seconde ligne où
elles ont également eu des pertes par le bombardement.
Le lieutenant de Blanger (****), commandant la 22ème, avait été tué tout près du réseau de fil de fer ennemi et l’on ne put avoir son corps. Le lieutenant de Lauzun de la 21ème, était blessé à la tête.
(*) : CHARLES Marcel est mort de suite de ses blessure à
l’hôpital temporaire n° 52 boulevard Gambetta à Calais (62). Il était né à
Auxerre le 22 novembre 1887.
(**) : Le caporal VATANT Paul Zéphirin mourra le 7 octobre
1915 à l’hôpital du Mans (Sarthe), par blessure de guerre. Mais s’agit-il des
suite de la blessure du 15 mai ?
(***) : Le JMO du régiment précise que le régiment a eu
comme pertes 109 hommes tués, blessés ou disparus.
(****) : DE BLANGER Louis Victor aura une citation. Elle
figure dans le JMO (8 juin) :
« À la suite de l’attaque du 15 mai dernier sont cités à
l’ordre de l’armée :
Le Lt DEBLANGEY, Louis, Victor du 204e RI :
« Venu récemment de la cavalerie, commandant d’une
compagnie qu’il a enlevée brillamment pour se porter à l’assaut des tranchées
ennemi. Tuer en arrivant au bord de la tranchée qu’il allait occuper. »
Les soldats Gaudin
Octave et le caporal TERRAZ Adolphe sont également cités à l’ordre de l’armée,
le même jour.
Le dimanche 16 mai
Nous partons le matin, les fourriers, avec le commandant, reconnaître le secteur pour une nouvelle attaque qui doit être faite le lendemain par les 23ème et 24ème compagnies. Nous faisons au moins 15 kilomètres dans les boyaux avec le sac sur le dos, et il fait chaud.
Durant la nuit, on a déjà remis un peu d’ordre dans le chaos des tranchées bouleversées. Nous trouvons dans le secteur des territoriaux de l’active. Pour l’instant, le calme est revenu.
L’attaque d’hier n’aurait été
qu’une diversion pour tâcher de dégager un point sérieusement menacé sur Notre-Dame-de-Lorette,
dont nous voyons les croupes à quelque distance. Il faut espérer que l’attaque
qui doit avoir lieu demain sera préparée plus sérieusement.
Nous rentrons à Bully bien fatigués et mourants de faim.
Dans l’après-midi, les Allemands bombardent la ville et leurs
avions viennent faire des reconnaissances. Il est interdit de se faire voir
dans les rues.
Le soir, une violente canonnade et fusillade se font entendre du
côté de N.D. de Lorette et continuent toute la nuit. De ce côté, le ciel
est continuellement embrasé par les fusées lumineuses.
Au matin, nous apprenons que les Allemands auraient contrattaqué
sans résultat pour eux et que nous leur aurions au contraire pris une tranchée.
Mais ces bruits sont-ils l’expression de la vérité ? Et d’où viennent-ils ?
Le lundi 17 mai
La pluie se met à tomber.
Dans l’après-midi, les hommes désignés pour faire partie de
l’équipe des grenadiers vont s’exercer au lancement de la grenade. Nous
attendons des ordres qui ne viennent pas.
On ne parle plus de l’attaque projetée. Les journées du 18 et du 19 sont passées dans l’attente d’ordres qui ne viennent pas.
Le jeudi 20 mai
La 21ème compagnie monte aux tranchées.
Le vendredi 21 mai
2 autres compagnies et l’E.M. (*) du bataillon vont relever les compagnies qui étaient en 1ère ligne. Nous couchons au poste 6, à 8 dans un petit abri où il y avait de la place pour 4.
Pendant la nuit, 400 travailleurs, sous la conduite du génie, creusent une tranchée de départ en avant de notre ligne. Ils travaillent en sape volante et l’opération est menée rondement ; chaque travailleur ayant 2 mètres à creuser se dépêche de faire un trou dans lequel il sera un peu à l’abri, car les Allemands arrosent le terrain de temps à autre.
Au matin, notre ligne se trouve donc modifiée et un élément de
tranchée qui était quelque peu isolé se trouve relié au front principal.
(*) : État-major
Le samedi 22 mai
Nous redescendons au poste 5 où était le colonel et qui est le P.C. du secteur. Il est d’ailleurs bien placé et de là on a des vues sur l’ensemble de nos positions et sur celles de l’ennemi.
C’est le commandant CHALET qui prend le commandement de la ligne de combat.
Dans la matinée, il me donne l’ordre de trouver 3 sous-lieutenants,
commandant les groupes de canons de 58, pour leur communiquer l’ordre de se
rendre à 2 heures de l’après-midi au général de brigade à Bully.
Il ne connaît même pas les noms, sauf celui d’un aspirant. Tous les renseignements qu’il me donne, c’est que tous 3 doivent être quelque part dans le secteur.
Je pars à leur recherche.
Les artilleurs que je trouve
aux emplacements des batteries me disent qu’au moins l’un d’entre eux doit être
à Grenay où il est allé déjeuner. Bien que j’aie déjà fait beaucoup de
chemin pour aller de l’une à l’autre des 3 batteries, j’entreprends le voyage
de Grenay.
Encore quelques kilomètres de boyaux à parcourir sous un soleil brûlant.
Arrivé à la route qui mène à Grenay après avoir dépassé le puits de mine, je la longe, et à un moment donné j’entends un sifflement qui me fait pressentir instinctivement qu’une marmite va tomber non loin de moi.
J’ai juste le temps de sauter dans le fossé de la route qui a été approfondi en boyau, et je suis aussitôt couvert de terre. Les éclats tombent de tous côtés et d’autres obus continuent d’arriver. Je presse le pas pour sortir de la zone dangereuse, car je crois que le but visé, ce sont des batteries qui sont non loin de moi sur ma droite.
Je suis d’ailleurs tout près de Grenay.
Je rencontre quelques
officiers d’artillerie à qui je demande des renseignements et qui ne peuvent
m’en donner. Finalement, à côté de la maison d’école, sur laquelle un obus
venait de s’abattre, il se trouve qu’un Sous-lieutenant à qui je m’adresse est
précisément l’un de ceux que je cherchais.
Il déménageait de la maison où il venait de déjeuner, car elle n’était plus hospitalière. Il m’apprend que son collègue qui était avec lui vient d’être tué par la dernière marmite ; le 3ème a été blessé 2 jours auparavant.
Dès lors, ma mission est remplie et je retourne au P.C. du commandant en passant par Bully où je casse la croûte, car il est 2 heures de l’après-midi et je n’ai rien mangé depuis la veille au soir.
Nous n’avons pas de place pour
nous coucher, et je m’installe avec Polbeau,
le fourrier de la 22ème, dans un trou creusé dans la paroi du boyau. En nous
entassant un peu, nous arrivons à nous caser tous les deux, mais nos pieds
arrivent au beau milieu du boyau et comme il passe quelqu’un à chaque instant
qui ne rate jamais de nous mettre les pieds dessus, nous avons une fichue
position pour dormir.
Mais nous ne goûtons pas très longtemps les délices du confort de notre trou, car on nous appelle pour porter des ordres à nos compagnies.
Je conduis ensuite un lieutenant du génie qui amène une corvée aux entonnoirs avec des échelles pour l’attaque.
Je venais de m’installer pour
la 3ème fois dans mon sac de couchage quand, à 11 heures 30, se déchaîne une violente canonnade et fusillade.
Les balles sifflent au-dessus de nos têtes, des obus éclatent de tous côtés.
Notre artillerie répond quand on lui eut fait des signaux « 2 fusées rouges ».
Le commandant CHALET fait preuve d’un grand calme, il est rassuré par le fait que les Allemands tirent des coups de fusil, c’est qu’ils n’attaquent pas.
Ils ont simplement vu ou entendu les travailleurs qui sont nombreux en avant de nos lignes et ils ont cru eux-mêmes à une attaque de notre part. Cette alerte dure deux grandes heures.
Quand c’est un peu calmé, nous
allons dans les compagnies voir s’il n’y a pas de pertes et tâcher de savoir si
c’est une de nos compagnies qui a demandé le secours de l’artillerie.
Mais personne de chez nous n’a envoyé de fusées. Il n’y a qu’un seul blessé à la 21ème compagnie. Nous passons le reste de la nuit dans notre trou.
Le dimanche 23 mai
J’accompagne dans la matinée le commandant CHALET qui parcourt tout le secteur et le reconnaît minutieusement.
Il fait beau temps.
Avec l’aide de 2 mineurs de la 23ème compagnie, nous commençons un abri-caverne pour la liaison, car en cas de bombardement nous n’avons aucun refuge. Nous nous relayons chacun notre tour et le travail avance vite. Quelques-uns d’entre nous pourront déjà coucher ce soir dans cette guitoune.
Un violent bombardement se
déclenche sur N.D. de Lorette en face de nous et, à un moment donné,
nous voyons distinctement des groupes de soldats descendre les pentes au milieu
des explosions et de la fumée. Mais les groupes se fondent et disparaissent
bientôt dans la fournaise.
D’où nous nous trouvons, il nous est impossible de nous rendre compte de la situation.
Après le dîner, qui nous est apporté par les cyclistes de Bully,
je vais communiquer à ma compagnie et quand je reviens je vois toutes les
places prises dans l’abri, dont une par Gresle,
le fourrier de la 24ème, qui n’y avait pas travaillé. Comme je ne veux pas
coucher dans notre trou de la veille où Polbeau
n’a pas trop de place pour lui, je prends le parti de m’installer au beau
milieu d’une tranchée où il ne passe presque personne.
Il fait beau et j’aurai un lit de ciel magnifique.
Le lundi 24 mai
Le lundi 24 mai au matin, le commandant CHALET, qui faisait un petit tour, me voit couché dans le boyau et rebrousse chemin pour ne pas me déranger. J’ai très bien dormi toute la nuit.
Nous continuons à travailler à notre abri.
Le bruit se confirme que nous serons relevés ce soir.
Après la soupe, nous allons faire le cantonnement aux corons d’Aix,
tout près de Bully. Ils sont occupés par le 158ème qui part ce soir et
dont nous prenons la place.
Nous allons manger à Bully après avoir fait le cantonnement, puis nous retournons aux tranchées. Nous redescendons avec le commandant et au débouché du boyau d’Aix nous attendons nos compagnies. La 21ème n’arrive qu’à 2 heures ½ du matin et, après l’avoir placée, je peux enfin aller me reposer.
Il est près de 4 heures du matin.
Le mardi 25 mai
Nous sommes réveillés de bon matin dans le grenier où nous couchons par un violent bombardement. Tout juste si j’ai pu dormir 2 heures.
Les canons font un vacarme effroyable ; c’est à devenir fou. Il y a beaucoup de batteries tout autour de nous, les 75 en avant des corons, des 120 et d’autres pièces de gros calibre un peu en arrière.
Il doit faire bon aux tranchées !
Les Allemands ripostent, mais surtout en avant des corons sur les tranchées et sur la ligne des batteries.
À midi, le 158 revient, prend des outils de parc et monte aux
tranchées. Nous recevons l’ordre de le suivre. Le bataillon se met en marche
vers les 2 heures 30.
Nous prenons le boyau de Bully, mais bientôt nous sommes arrêtés par le 158ème qui est devant nous. Nous attendons dans les boyaux qui sont encombrés.
Des blessés descendent, des Marocains surtout, puis des prisonniers conduits par des Marocains.
Ensuite 2 compagnies du 68ème
passent devant nous pour aller renforcer la 1ère ligne. Nous nous rangeons
comme nous pouvons contre la paroi des boyaux pour les laisser passer. Des
bruits contradictoires circulent.
La brigade marocaine aurait attaqué, mais après être parvenue dans la 1ère ligne allemande s’est vue dans l’obligation de se replier. Beaucoup auraient été tués dans les boyaux pris d’enfilade par des mitrailleuses ennemies.
À la tombée de la nuit, nous revenons aux corons d’Aix dans
nos cantonnements. Le 158ème descend également. Soi-disant, un des prisonniers
que nous avons vus et qui aurait fait mine de s’écarter un peu pour satisfaire
un besoin aurait été tué par les Marocains qui les conduisaient.
Le mercredi 26 mai
Je me lève après avoir fait une bonne nuit ; nous n’avons pas été dérangés.
Nous étions vers les 9 heures tous en train de faire notre toilette dans la cour qui séparait de la rue la maison où nous sommes cantonnés, quand tout à coup une marmite nous tombe presque dessus.
Elle a éclaté sur la poutre de la maison voisine, à environ 2 mètres du pignon contre lequel nous sommes. Une cheminée, des tuiles, des pierres, des morceaux de bois de la charpente s’abattent sur nous, tandis qu’un nuage de fumée nous enveloppe et que le fracas de l’explosion retentit.
Le 1er moment de désarroi
passé, nous nous comptons, nous appelons ; personne de blessé sérieusement ;
c’est un hasard miraculeux. Pautrat,
le caporal-clairon, a bien reçu une tuile dans le côté et un autre soldat a
reçu quelques briques sur les reins, mais ce n’est rien.
Cette marmite avait quand même fait une victime : une vieille femme qui passait à ce moment dans la rue. Nous la rentrons dans la maison où nous logeons et allons chercher un médecin ; mais bien qu’elle n’ait aucune blessure sérieuse apparente, il n’y a rien à faire.
Cette scène m’impressionne beaucoup.
Dans la cuisine, le cycliste Simonnet qui fait notre popote avait
reçu tout le plafond sur le dos, et il était navré qu’une belle épaule de
mouton qu’il s’apprêtait à mettre au four après avoir mis tous ses soins pour
la préparer soit presqu’enterrée sous les gravats.
Bah ! Cela servira de poivre, lui disons-nous pour le consoler.
Des officiers du 158ème qui mangeaient aussi dans cette maison s’étaient précipités dans la cave et ne mettaient plus le nez dehors, bien que, raisonnablement, ils ne soient pas mieux garantis qu’ailleurs, moins même, car la cave n’était pas du tout solide et l’entrée n’était formée que par l’escalier de bois qui montait au 1er juste en face de la porte.
Mais la peur ne se raisonne pas.
Peut-être 5 minutes après
cette 1ère marmite, une autre suivit, mais un peu plus loin, à 100 mètres
environ, du côté des batteries de 120. Elle tombe dans un champ.
Nous apprenons bientôt que cette dernière a encore fait une victime : un zouave qui était dans la maison démolie par la 1ère marmite rejoignait en courant son camp à quelques centaines de mètres. Il courait bien au-devant du danger, car il se trouva en plein dans l’explosion, et l’on ne put arriver à retrouver de son corps que quelques débris.
Les 3 dames qui se trouvaient dans la maison éventrée n’eurent même pas une égratignure. C’est une vraie chance.
Le reste de la journée, les
Allemands continuent à envoyer régulièrement des obus de gros calibre sur les
batteries, mais ils nous passaient tous au-dessus de la tête.
Le jeudi 27 mai
L’ordre arrive à 4 heures de l’après-midi que tout le bataillon monte aux tranchées. Comme il y a quelque chose de pas très clair, le commandant envoie le lieutenant POMMIER en bicyclette à la division, qui est à Aix-Noulette, je crois pour demander des ordres de détail.
Il nous rejoint dans le boyau d’Aix, alors que le bataillon a déjà commencé son mouvement. 2 compagnies seulement doivent monter pour travailler et doivent emporter des outils de parc. Nous restons donc aux corons et c’est la 23ème et la 24ème qui doivent marcher.
Elles rentrent à 3 heures 1/2 du matin, et les hommes
font un vacarme du diable en remettant les outils dans notre cour. Ils ont
toute la nuit réfectionné des tranchées.
Le vendredi 28 mai
Il fait encore assez beau temps. Nous ne connaissons toujours rien de la situation, mais nous avons l’intuition que nous ne devons pas avancer très vite.
Quelques marmites tombent, dans le courant de la journée, aux environs de nos cantonnements. Aix-Noulette surtout est très bombardé.
À 5 heures du soir, les 21ème et 22ème montent faire des travaux.
Elles rentrent à 3 heures du matin environ, rapportant un nombre considérable
de fusils qui ont été ramassés dans les tranchées.
Le samedi 29 mai
Le 225ème devait attaquer à 2 heures ½ du matin. Les hommes étaient prêts dans les tranchées quand, 5 minutes avant l’heure fixée, ce sont les Allemands qui attaquent.
Naturellement ils sont bien reçus. C’est ce qui explique la violente canonnade et fusillade que nous avons entendue, et les compagnies au travail sont rentrées de ce fait plus tôt.
Dans l’après-midi, l’ordre arrive d’aller occuper les tranchées de
1ère ligne, la 24ème à droite, de la rue de Bordeaux à la rue de Pau,
la 23ème à gauche, jusqu’au boulevard Maudhui.
Le commandant me fait partir en avant et me charge de reconnaître le secteur pour trouver un P.C. pour lui. Il n’y en a pas d’autre que le poste 8 qui n’est pas fameux et guère bien placé. C’est là qu’il se trouvait le 15 mai pour l’attaque que nous avons faite.
En faisant ma tournée, je me
rends compte que nos positions sont exactement les mêmes que le 15 mai. Toutes
les attaques qui ont eu lieu depuis cette date n’ont donc pas abouti et les
tranchées qui ont été prises ont dû être relâchées.
Nous quittons les corons
d’Aix à 8 heures 40 du soir.
La relève n’est pas terminée avant 1 heure du matin. Ma compagnie est
en réserve à la tranchée d’Algérie à quelques centaines de mètres de la
1ère ligne et la 22ème, également en réserve, prend position derrière un talus
aménagé à mi-chemin de la ligne de feu et de ma compagnie.
Je couche avec Cavin au
poste téléphonique où nous sommes dans une saleté repoussante.
Le dimanche 30 mai
Je vais chercher à 4 heures à ma compagnie le rapport de la nuit, qui ne mentionne rien de spécial. Il fait un temps incertain. Toute la matinée, l’ennemi nous arrose avec des shrapnels et des bombes. Notre coin est spécialement visé et nous sommes pris d’enfilade sur notre gauche, de Calonne. Nous n’entendons plus les balles qui toute la nuit viennent tout près de nous frapper dans le parapet, toujours à la même place.
Le lundi 31 mai
Le lundi 31 mai, pendant que les officiers de ma compagnie déjeunent au P.C. du commandant, avec qui ils font popote, je m’aperçois que l’ennemi tire sur la tranchée d’Algérie où est la 21ème. Je vois quelques obus tomber au beau milieu de la tranchée qui se trouve en contrebas d’où nous sommes, dans une ondulation du terrain.
Comme le bombardement ne dure pas, je vais aussitôt me rendre compte si les obus ont fait des dégâts.
Il n’y a que le sergent Stanislas qui est blessé au pied, mais légèrement.
Les officiers du 170ème viennent reconnaître le secteur.
Le soir, nous recevons l’ordre de relève ; l’endroit où nous allons
cantonner n’est pas mentionné, et nous ne le connaissons que le soir, quand le
général de brigade commandant la 109ème brigade qui doit être reformée eut
donné ses ordres. Les fourriers partent de Bully à 21 heures avec le T.C. pour Haillicourt
où nous allons cantonner. Je suis horriblement fatigué et fais une bonne partie
de la route sur la flèche du caisson de munitions.
Chacun de nous trouve ainsi à se caser sur une voiture ou sur l’autre.
Nous arrivons à Haillicourt
vers les 2 heures du matin. C’est le
lieutenant Bernard qui est chargé
de la répartition du cantonnement, et il ne s’en acquitte guère bien, car il
nous laisse nous débrouiller.
À cette heure indue, nous avons beaucoup de difficultés pour réveiller les habitants qui, cela se conçoit, nous reçoivent mal quand nous leur demandons s’ils ont de la place pour loger des officiers ou de la troupe.
Enfin, tant bien que mal, nous arrivons à loger nos compagnies, et comme le soleil est levé avant qu’elles soient arrivées, nous remplissons notre mission.
J’ai trouvé un bon coin pour la liaison en cherchant pour ma compagnie, car comme nous sommes un petit nombre et que nous mangeons à part, nous pouvons loger dans des endroits où l’on ne peut mettre une escouade. Nous achetons de la paille pour nous coucher dans une chambre à four.
Juin 1915 : Artois, plateau de Lorette, Carency, l’attaque de l’éperon de Notre-Dame-de-Lorette, Cabaret Rouge
Le 1er juin vers 6 heures, le régiment arrive, le 1er bataillon en avant avec musique en tête.
Cela me produit un effet déplorable de voir tout ce tam-tam et par derrière les hommes éreintés de fatigue ayant laissé quelques jours auparavant un grand nombre de leurs camarades sur le champ de bataille et marchant un peu à la débandade.
Nous allons ensuite nous reposer un peu et dans la journée le ravitaillement nous amène de la paille. Tous les hommes sont fourbus et l’on n’en voit guère traîner dans les rues durant la matinée.
Après avoir fait un somme, je
vais faire un tour dans le patelin qui a l’air bien ravitaillé. C’est un pays
de mineurs. Beaucoup travaillent aux fosses de Bruay qui est tout
proche. Le village est entouré de jardins qui paraissent bien soignés et très
fertiles. Il y a beaucoup de verdure.
Comme dans tous les pays de mineurs, les débits sont nombreux et l’on y boit beaucoup d’une bonne bière légère.
Mercredi 2 juin
Le mercredi 2 juin, nous entendons une violente canonnade dans le lointain. Il fait toute la journée un beau temps et très chaud. Nous installons une table dans le jardin de la maison où nous sommes et nous mangeons et écrivons en plein air sous un merisier en fleurs.
Les gens sont très aimables et la dame tient son intérieur avec une propreté méticuleuse. Elle travaille sans arrêt du matin au soir. Naturellement, comme ils sont très gentils pour nous, toute la famille est nourrie en partie par notre popote.
Par contre, nous avons des légumes, de la salade dans le jardin, que l’on ne nous fait pas payer. Comme les Tambours et Clairons n’ont pas bien joué la veille en entrant dans le pays, et pour cause vu leur fatigue, le colonel les fait aller à l’école.
La vie continue ainsi, assez
monotone quoiqu’assez agréable, jusqu’au
9 juin.
Comme il y a de la très bonne bière et à bon marché dans le pays, on ne s’en prive pas. On boit aussi des « bistoules » et il y a encore de l’eau-de-vie partout ; principalement du genièvre, schiedam, qui est excellent.
Mercredi 9 juin
Le mercredi 9 juin, nous recevons l’ordre à 16 heures moins le ¼ de partir immédiatement.
Le départ a lieu à 16 heures. Nous allons au Grand-Servins,
distant d’une douzaine de kilomètres. Nous passons par Ruitz, Maisnil,
Hermin et Fresnicourt. Au cours de la marche, il tombe une petite
averse.
A la dernière pose, nous partons en avant de la colonne pour faire le cantonnement. D’après les ordres du colonel, c’est le 5ème bataillon qui doit rester à Grand-Servins et le 6ème doit aller à Gouy, à peu de distance de ce dernier village.
Nous repartons en avant, mais la colonne nous a rejoints et il nous faut accélérer notre marche. Le pays est rempli de troupes et c’est avec les plus grandes difficultés que nous arrivons à loger nos compagnies au petit bonheur.
Il n’y a pas d’eau dans le village, rien qu’une mare d’eau noire, boueuse, sale. Toutes les rues, les cantonnements sont dans un état de malpropreté repoussante. Il est tellement passé de troupes depuis quelque temps ici, et des unités qui ne restaient qu’un jour ou deux, qu’il n’y a rien d’étonnant à cela.
Il est aussi très difficile de se ravitailler.
Jusqu’à minuit, je cours de porte en porte à la recherche d’une
pièce pour les officiers. Il m’est impossible de rien trouver.
Le Lieutenant POMMIER, commandant ma compagnie, décide de coucher dans l’église, et il m’envoie chercher la clé qui doit être détenue par l’aumônier. On fait des difficultés et finalement on refuse de me la donner. La dame chez qui logeait l’aumônier criait au scandale de vouloir mettre coucher des hommes dans l’église.
Je rends réponse à mon lieutenant qui, voyant cette mauvaise volonté, force la porte avec l’aide des autres officiers de la compagnie.
« Le Bon Dieu ne m’en voudra pas », dit-il
Et il s’installe
sur des bancs rapprochés l’un de l’autre qui lui font une couchette.
Mais à 6 heures ½ le lendemain ils sont obligés de déménager pour la messe.
Le Lieutenant Viault revient alors dans la ferme coucher avec ses hommes. Je couche dans un petit coin de grenier près d’une fenêtre avec Pilhol, et pour y arriver, il faut faire des miracles d’acrobaties. Nous avons juste la place pour nous coucher, le reste du grenier est plein de trous.
Jeudi 10 juin
Le jeudi 10 juin, le temps est lourd.
Les commandants des 23ème et 24ème compagnies vont reconnaître le secteur pour une attaque qui est en perspective. Le colonel fait un rapport duquel il résulte que les tranchées sont pour ainsi dire inexistantes et n’offrent aucun abri aux troupes. Il y a de nombreux travaux à exécuter et à faire ensevelir les cadavres qui sont en avant et dans nos lignes.
Il est probable que tout cela ne sera pas fait avant l’attaque qui doit avoir lieu le 12.
Vendredi 11 juin
Le vendredi 11 juin, quelques obus arrivent de notre côté. C’est
tout un événement et les brancardiers divisionnaires qui sont toujours à
l’arrière parlent de bombardement et des dangers qu’ils courent.
À les entendre, ils seraient plus exposés que nous. Il a plu la nuit dernière et le temps est encore incertain. Dreyfus, un cuisinier de ma compagnie, se casse un pied et est évacué.
Tous les hommes l’envient et s’en souhaitent autant ; le moral est bien bas, ce qui n’a rien d’étonnant après ce que nous avons passé dernièrement. Ce que tous les hommes redoutent, c’est d’aller se faire tuer bêtement, sans aucun résultat comme à Bully-Grenay.
L’Adjudant Boucher va avec 20 hommes de la
compagnie faire des trous, des abris pour la compagnie en prévision de
l’attaque. Les tranchées sont occupées par le 20ème chasseurs.
Boucher revient démoralisé complètement par ce qu’il a vu. Les troupes font de plus en plus preuve d’un très mauvais état d’esprit et les hommes des 23ème et 24ème se donnent le mot pour ne pas marcher le lendemain.
Le Français est ainsi fait, et cependant, si l’attaque est bien préparée, surtout par l’artillerie, si les mitrailleuses ennemies ne se mettent pas en action quand les premiers sortiront des tranchées, pas un ne restera en arrière.
Ceux qui grognent le plus seront même probablement ceux qui auront le plus de cran.
Samedi 12 juin
Le samedi 12 juin de très matin, nous sommes réveillés par le bruit de grosses marmites qui tombent sur Bouvigny. L’une d’elles vient éclater tout près de Gouy-Servins.
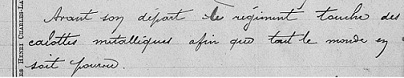
Extrait du journal du régiment du 12 juin 1915…
À 15 heures 45, nous recevons l’ordre de départ pour aller relever
le 21ème chasseurs.
Le rassemblement se fait immédiatement, en ¼ d’heure, et les compagnies vont au bureau du colonel où se fait une distribution de grenades, fusées, sacs à terre, etc. Les sacs des hommes sont laissés vers les voitures du train de combat dans un pré attenant au village.
Nous nous mettons en route vers les 9 heures, la 23ème en tête.
Nous avions fait à peine 50 mètres derrière le commandant que nous entendons le
lieutenant Mathey qui vient dire
à son commandant de compagnie, le lieutenant Café
:
« Les hommes ont dû s’entendre, ils ne veulent pas marcher.
»
Le commandant CHALET, qui est 2 ou 3 pas en avant de nous, à cheval, a certainement entendu, mais il ne bronche pas. Seulement, il ralentit l’allure ; il ne tourne même pas la tête et ne veut pas paraître se rendre compte de ce qui se passe.
Le Lieutenant Café retourne en arrière et, comme si de rien n’était, il crie :
« En avant par 4 ! »
Et met sa
compagnie en route.
Je me rends compte qu’à ce moment il eût suffi d’un petit incident, d’un rien, pour que tout le bataillon se mutine. Grâce au calme du commandant et du lieutenant Café, de regrettables incidents ont été certainement évités.
Nous passons à la Maison
Forestière, dans le bois de Bouvigny où est la division, les postes
de secours, etc. Au passage, nous voyons une très belle installation, des abris
bien conditionnés, un petit Decauville pour le transport de l’eau, des
matériaux et des blessés qui sont d’ici emmenés en auto.
Nous prenons ensuite le boyau qui court sur le bord du plateau de Lorette.
Il fait nuit et nous n’y voyons goutte.
Les guides du 21ème chasseurs
qui nous ont pris à la maison Forestière ne s’y reconnaissent pas
eux-mêmes dans le dédale des boyaux et tranchées. Nous passons en faisant mille
détours à travers des ravins. Des odeurs de cadavres nous arrivent par instants
; c’est une infection, et par endroits nous avons la sensation que nous
marchons sur des corps.
Bien que j’aie le cœur bien accroché, à un certain moment j’ai des nausées ; mais ce malaise est vite passé, car je n’ai pas le loisir d’être malade dans de telles conditions.
En tournant dans les boyaux au
milieu de l’obscurité, nous entendons la fusillade qui part un peu de tous
côtés, et des fusées lumineuses trouent la nuit tout autour de nous.
Vision sinistre, et nous ne nous rendons même pas compte de quel côté se trouve l’ennemi ; il semble qu’il fasse un demi-cercle autour de nous ; et nous avançons toujours. Enfin nous arrivons au P.C. du chef de bataillon et la relève se fait.
Ma compagnie est en réserve
tout près.
Nous n’avons comme abri que la pente du ravin sur laquelle nous nous trouvons. Nous ne connaissons pas du tout le secteur, mais nous avons l’impression qu’une vallée très profonde se trouve derrière nous. Il y a à peine ½ heure que nous sommes arrivés quand tout à coup une vive fusillade se déclenche.
L’ennemi aurait-il aperçu le mouvement de relève qui n’est pas terminé ?
Les balles claquent au-dessus de nous, puis le canon entre en danse, mais tous les obus éclatent soit devant nous, sur les tranchées, soit principalement derrière dans le ravin, au fond de la vallée. C’est un beau spectacle que j’admire en dépit de la situation critique et qui se grave dans ma mémoire.
Spectacle grandiose, terrifiant et mystérieux ! Les grosses marmites qui passent au-dessus de nous avec de lugubres sifflements éclatent bien au-dessous de nous dans la vallée qui paraît très profonde, elles descendent à pic et, l’espace d’une seconde, elles emplissent la nuit de la lueur des explosions à la faveur desquelles nous voyons dans le fond une grande forme blanche se dessiner.
J’ai l’impression d’être suspendu dans le vide et d’avoir au-dessous de moi un féérique décor d’opéra illuminé par des éclairs.
Enfin, la relève terminée, les chasseurs nous laissent la place. Le
commandant se loge dans une « guitoune » qui est son P.C., et nous nous
entassons à côté dans un abri à munitions recouvert de 20 centimètres de terre.
Il y a là-dedans des milliers de grenades de toutes sortes, dont des grenades à
gaz asphyxiantes, des fusées etc.
Le lieutenant Vigreux, des mitrailleuses, et le lieutenant POMMIER, commandant ma compagnie qui est en réserve le long du parapet, viennent aussi chercher un refuge auprès de nous. Nous sommes entassés les uns sur les autres au-dessus des explosifs ; nous sommes à 12 et notre abri n’a pas plus de 3 mètres de long sur 1 mètre 20 de large.
Dès que l’un de nous veut remuer un bras ou une jambe ankylosée, tous les autres sont obligés de se déranger.
Il nous est donc impossible de dormir.
Petit à petit, un calme relatif renaît et l’artillerie ennemie ne tire que par intervalles, mais la fusillade ne cesse guère ; elle a seulement moins d’intensité.
Dimanche 13 juin : l’attaque de l’éperon de Notre-Dame-de-Lorette
Le dimanche 13 juin, le jour vient lentement et nous découvre petit à petit un spectacle de désolation inimaginable. Au fur et à mesure que les voiles de la nuit se dissipent, nous voyons les squelettes des maisons se dessiner dans le fond de la vallée. Ce sont d’abord les ruines de l’église qui émergent du brouillard vaporeux, puis un fantastique chaos de pans de murs et de toits effondrés nous apparaît.
C’est Ablain-Saint-Nazaire.
Nous sommes à 400 mètres au Nord-est, sur la crête qui domine toute la vallée, le dernier des fameux éperons du plateau de Lorette. (*)
Les maisons du village sont absolument anéanties ; les toits sont rentrés dans les caves ; plus de rues ; de l’église, il ne reste qu’un pan de mur blanc tout troué d’obus qui se dresse vers le ciel ; le cimetière n’est plus qu’un amas de débris. Toute la vallée n’est qu’un chaos semblable, les trous de marmites se touchent.
Plus loin, Carency, et tout à fait dans le fond, Saint-Eloi avec ses deux grandes tours croulantes qui ont l’air de deux bras implorant le ciel.
Nous nous familiarisons avec
le secteur.
Sur tout le plateau de Lorette, pas un coin intact.
La terre est éventrée, déchiquetée, des cadavres sont à moitié enterrés, du matériel de toute sorte, des équipements, des sacs traînent partout ; tout est brisé, haché, une odeur infecte traîne sur l’ensemble et un essaim de mouches bourdonne autour de nous. Dans la journée, le bombardement n’arrête guère et nous avons déjà beaucoup de blessés. Heureusement, la plupart des grosses marmites tombent dans le fond du ravin où elles ne font que déchiqueter la terre. Des gerbes de fumée montent à une très grande hauteur et obscurcissent le ciel.
Nos batteries tirent aussi sans discontinuer.
Des ordres pour l’attaque sont donnés aux commandants de compagnies par le commandant. L’attaque doit se déclencher à 18 heures 50.
Le bataillon a 2 compagnies en ligne qui vont se placer dans la tranchée de départ, où les hommes sont entassés faute de place, et les unités enchevêtrées.
A l’heure prescrite, après une
préparation intensive de notre artillerie, les Clairons sonnent la charge.
Les premiers hommes qui sortent sont aussitôt accueillis par une grêle de balles. La 24ème a bien avancé un peu, mais elle est obligée de se replier, n’étant pas soutenue à droite par le 5ème bataillon et à gauche par la 23ème qui a des difficultés pour sortir, étant gênée par les Chasseurs qui la refoulent dans la tranchée. C’est manqué.
Les canons ennemis arrosent copieusement tout le terrain et les nôtres répondent.
A un certain moment, la débandade se met dans les rangs de la 23ème et les hommes cherchent à fuir (**). Mais ils sont arrêtés dans les boyaux par le commandant qui ne laisse passer que les blessés qui sont, hélas, nombreux déjà ainsi que les tués.
La nuit arrive, mais le bombardement n’arrête pas, nous causant de fortes pertes. Nous apprenons que le 360ème qui a fait une attaque en même temps que nous à notre droite n’a pas davantage réussi. Nous passons encore la nuit sur le qui-vive sans dormir.
(*) : Les cinq éperons, de sinistre mémoire, sont :
l'Éperon Mathis, le Grand Éperon, l'Éperon des Arabes, l'Éperon de la Blanche
Voie et l'Éperon de Souchez qui domine, à pic, la sortie à l’est
d'Ablain-Saint-Nazaire
(**) : D’après les dires d’Alexandre ROBERT, ce serait
certainement à la suite de cet épisode que le soldat VERAIN Paul sera fusillé, le 4 juillet
Le régiment perd le 13 juin : 145 hommes tués, blessés et
disparus. Le colonel estime, comme ses chefs de corps, que le 204e RI n’est pas
en état de reprendre une offensive. « Les
hommes sont dans un état de dépression morale qui leur enlève pour le moment
leur capacité offensive »
À 9h30, le chef d’état-major de la division donne l’ordre
d’attaquer pour le lendemain…..
Le lundi 14 juin
Nous passons la journée en nous mettant autant que possible à l’abri du
bombardement.
Nous apprenons qu’en haut lieu on n’est pas content du 204ème. (*)
Cependant, la position que nous avons attaqué la veille l’avait été
plusieurs fois par d’autres régiments, notamment par les Chasseurs que nous
avons remplacés.
Les Allemands sont établis sur les pentes descendantes de l’éperon, et
au-dessous d’un talus qui leur forme un abri naturel. Notre artillerie ne peut
les atteindre, et ils fauchent avec leurs mitrailleuses toute la pente
descendante, tandis que leur artillerie bouleverse nos tranchées à la crête.
Nous ne sommes pas avec notre division et il est probable que l’on aime
mieux nous sacrifier à la place d’un régiment de la division.
L’ordre arrive de faire une nouvelle attaque le soir même et sans
préparation d’artillerie, par surprise. Le colonel et le commandant font des
difficultés et finalement ils ne cachent pas l’état d’esprit des hommes qui
commencent à en avoir assez de faire des attaques dans de telles conditions.
Le moral des troupes est en effet bien bas. Il faut faire l’attaque
quand même, « au petit bonheur ».
Notre artillerie tire toute la journée et l’artillerie allemande
répond. On est assourdi par le bruit des canons. L’attaque doit avoir lieu à 7
heures du soir.
Une demi-heure avant, tout se tait.
Le calme est complet, le calme qui présage la tempête.
A l’heure prescrite, les compagnies sortent des tranchées et sont
aussitôt criblées de balles ; les obus également ne tardent pas à arriver. La
24ème, favorisée par le terrain qui forme une légère dépression dans laquelle
elle est un peu à l’abri des balles, avance d’une trentaine de mètres et se
terre aussitôt.
Un certain flottement s’est produit dans la 23ème, mais sur l’ordre du
commandant, elle repart et se met sur la ligne de la 24ème.
Le colonel Collon
était pour cette attaque monté au P.C. du chef de bataillon, peut-être pour
faire montre d’exemple et pour empêcher, par son autorité, toute « pagaye » qui
pourrait se produire. Il examine tous les blessés qui descendent par le boyau
et ne les laisse aller au poste de secours que s’ils sont réellement blessés.
Quelques-uns qui descendaient pour se garer sont renvoyés sans douceur à leur place. Les travaux commencent aussitôt la tombée de la nuit. Des sacs de terre sont passés toute la nuit aux hommes qui sont en avant, et à la pointe du jour la nouvelle tranchée est terminée.
« Nous avons progressé »,
comme disent toujours nos communiqués.
Cependant, il ne faut pas être un très grand stratège pour se rendre compte qu’on aurait pu prendre la même avance par le moyen de sapes, et cela avec infiniment moins de pertes. Nous avons près de 500 hommes hors de combat dans le régiment. (**)
Le 5ème bataillon surtout a beaucoup souffert par le bombardement.
(*) : C’est exact, les raisons sont indiquées dans le JMO
(**) : Le régiment perd le 14 juin : 151 hommes tués,
blessés et disparus pour l’attaque des tranchées de l’éperon de
Notre-Dame-de-Lorette. Ils ont gagné 30 mètres de terrain…(journal du régiment)
Le mardi 15 juin
Nous devons être relevés le soir, et c’est avec satisfaction que nous espérons enfin quitter ce lieu d’enfer.
La journée est assez calme en comparaison des journées précédentes, il fait beau temps.
Les ordres de relève ont dû être mal donnés ou mal compris : la nuit se passe sans que nous voyions arriver ceux qui doivent nous remplacer.
Le mercredi 16 juin
Le jour arrive, le commandant est hors de lui et il prend des dispositions.
Il ne laisse qu’une compagnie en ligne pour que la relève se fasse plus vite et soit moins visible et il envoie un cycliste à Ablain trouver le colonel du 237ème qui prend aussitôt ses dispositions pour nous relever.
Le 5ème bataillon est parti à la pointe du jour.
Dès que la relève commence, nous partons en avant avec le
commandant et nous passons devant les compagnies qui sont dans les boyaux.
Comme il fait maintenant grand jour (nous ne partons qu’à 6 heures ½), nous nous attendons à être canonnés. Nous arrivons cependant sans encombre à Gouy, en dépit du bombardement qui a repris. Nous reprenons nos anciens cantonnements où nous tâchons de prendre un repos bien gagné.
Depuis 3 jours et 4 nuits, les hommes n’ont pu dormir ni prendre un instant de repos, et les nerfs sont surexcités.
À 6 heures de l’après-midi, nous recevons l’ordre de nous préparer
à partir immédiatement pour Villers-au-Bois où se rend la 55ème division
que nous avons réintégrée. Mais le contrordre arrive presqu’aussitôt. Nous
devons rester à Gouy en cantonnement d’alerte.
Nous passons une nuit tranquille qui détend un peu les nerfs.
Le jeudi 17 juin
J’étais encore couché sur les perches de mon bout de grenier quand j’entends appeler pour un départ immédiat. Je me lève aussitôt et vais copier l’ordre.
Nous partons à 8 heures ¼ pour le point indiqué la veille : Villers-au-Bois qui est situé à 4 kilomètres. Le régiment fait halte dans les bois près du village où nous sommes à l’abri des vues ; nous déjeunons et attendons.
Le beau temps continue ; il fait même chaud.
Les événements se déroulent favorablement, d’après les renseignements qui nous parviennent. C’est dur, mais nous avançons. Est-ce bien exact ?
Nous montons des tentes ou des guitounes en feuillage pour passer la nuit. A quelque distance au-dessus de nous, il y a un campement d’artilleurs.
Toute la nuit, nous entendons la canonnade et la fusillade.
Le vendredi 18 juin
Le commandant part à 2 heures du matin et il ne rentre qu’à 7 heures. Il est allé, je crois, reconnaître le secteur que nous allons occuper.
La nuit nous a semblé fraîche sous nos toiles de tente.
Le samedi 19
Vers les 11 heures du matin, le bois où nous nous trouvons et où il y a beaucoup d’autres troupes de toutes armes est bombardé. Mais ce n’est pas un tir précis sur un point.
Tout le bois est arrosé.
Le dernier obus fait une dizaine de victimes (*), parmi lesquelles le lieutenant Friedrich qui commande la 22ème compagnie. Il se produit une panique.
Ce sont d’abord des artilleurs et des hommes du génie qui passent vers nous en fuyant, puis des hommes de chez nous suivent le mouvement que le commandant a beaucoup de peine à enrayer.
Comme il commandait à la sentinelle qui était près du T.C. (**) de tirer sur les fuyards et que celui-ci ne se pressait pas, il lui prend le fusil des mains et tire en l’air.
Les hommes se sauvaient justement en terrain découvert et étaient en pleine vue. Finalement, tout rentre dans l’ordre et le bombardement s’arrête.
Dans l’après-midi, nous nous écartons quelque peu et nous allons
dans des bois proches situés au-dessus de Camblain-l’Abbé.
(*) : Le bombardement fait 12 victimes dont 2 morts :
FRIDERICH Auguste, lieutenant, mort pour la France près de
Villers-au-Bois (62), le 19 juin 1915, tué à l’ennemi. Il était né à Metz, le
22 mai 1879. Il est inhumé au cimetière militaire d’Ablain-Saint-Nazaire (62),
Nécropole Notre-Dame-de-Lorette, tombe n° 16377.
FRISON Julien Henri, soldat, mort pour la France près de
Villers-au-Bois (62), le 19 juin 1915, tué à l’ennemi. Il était né à Germaine
(02). Il est inhumé au cimetière militaire d’Ablain-Saint-Nazaire (62),
Nécropole Notre-Dame-de-Lorette, tombe n° 16360.
(**) : Train de combat
Le dimanche 20 juin
Dans la nuit, à 1 heure du matin, le commandant est appelé pour aller faire une reconnaissance du secteur où nous allons nous rendre le soir.
À son retour, il envoie chercher les commandants de compagnie pour
leur donner personnellement des instructions. Nous partons pour les tranchées à
8 heures 30 du soir. Nous devons nous rendre au Cabaret Rouge. Il y a
une longueur interminable de boyaux qui sont obstrués en beaucoup d’endroits, et nous ne pouvons arriver à nous
reconnaître, la nuit, dans ce dédale de tranchées.
La 21ème compagnie se perd.
Croquis de situation du
Cabaret Rouge. JMO du 204e RI.
Cliquez sur l’image
pour agrandissement
Le lundi 21 juin
Nous arrivons enfin un peu avant la pointe du jour et nous prenons nos
positions.
Le commandant va se loger dans un trou sous le talus de la route de
Béthune, en face du fameux Cabaret Rouge qui n’est plus qu’un amas de
pierres de briques et de morceaux de bois de charpente.
Nous cherchons à nous loger dans la cave qui n’est pas encore complètement
éboulée, mais la place est déjà prise ; il n’y en a que 2 ou 3 qui peuvent
trouver place, presqu’à ciel ouvert. Finalement, je trouve dans l’obscurité un
trou dans la paroi du boyau juste au point où il descend la pente du talus de
la route.
En tâtonnant, sur le parapet en face de mon trou, je sens quelque chose
de flasque qui me cause une invincible répulsion. Je m’accroupis dans mon trou
et essaye de me reposer. Mais bientôt le jour arrive et je découvre un
spectacle horrible. En face de moi, le corps flasque que j’avais touché
quelques heures auparavant, c’est un cadavre étendu de tout son long sur le
bord du boyau et prêt à tomber au fond. Il y en a d’autres de tous côtés et ils
sont également très nombreux devant nos lignes.
Plusieurs attaques ont déjà dû se briser devant les tranchées ennemies.
Les corps sont couchés dans toutes les positions et certains sont déjà
décomposés, d’autres sont à moitié enterrés après avoir été déchiquetés par les
obus. Une odeur épouvantable se dégage de ce charnier.
C’est effrayant !
Nous sommes en face des positions que nous avions sur les pentes de Lorette.
Souchez est devant nous, un peu à notre gauche, et juste en face est la cote
119 qui nous domine.
Croquis de situation de
la position du 204e RI.
Cliquez sur l’image
pour agrandissement
Le commandant revient établir son P.C. dans une excavation sous le
talus de la route de Béthune, à 200 mètres en arrière de ce que fut le Cabaret
Rouge dont le nom sinistre est bien approprié. La liaison se place dans un
abri ouvert du côté de l’ennemi et couvert tout juste d’une plaque de tôle au
beau milieu de la route.
Au petit bonheur !
Comme les ouvertures provoquent des courants d’air, nous bouchons celle qui est du côté de l’ennemi. Un petit 77 entrerait chez nous comme chez lui. Presque tous les arbres de la route ont été fauchés par les obus.
Il fait très chaud ; la canonnade est ininterrompue ; nous ne pouvons consolider notre guitoune, car nous serions en pleine vue.
A la nuit seulement, nous mettons un peu de terre dessus, ce qui
d’ailleurs ne nous préserverait guère si un obus tombait sur notre toit, mais
cela peut toujours nous garantir des éclats.
Au cours de la journée, le régiment déclare 2 hommes tués et 8
blessés.
Le mardi 22 juin
Nous nous sommes un peu reposés durant la nuit.
On dort en dépit des obus qui éclatent non loin de nous, des coups de fusil et des camarades qui sont couchés sur nous, ce qui fait qu’à chaque instant l’un de nous qui a un bras ou une jambe ankylosé est obligé de changer de position et de déranger un ou deux camarades.
Une attaque combinée des zouaves du 36ème, à notre droite, qui ont relevé les Chasseurs et se sont laissé prendre dans la nuit un bout de tranchée, et la 18ème du 204 à notre gauche, qui a pour mission de jeter bas le barrage de sacs qui la sépare des boches et de remonter le boyau devant la 21ème à coups de grenades, cette attaque doit se faire dans la journée.
Elle a lieu à 5 heures et elle réussit.
Mais les Allemands veulent contrattaquer. En face de la 21ème, ils sortent de leurs tranchées et, suivant le parapet, ils prennent la direction du 36ème. Ils ne sont pas loin et ils sont fauchés par le feu de la section placée dans la parallèle d’avant qui les prend de flanc. Cette parallèle était à peine visible pour les Allemands et ils ne devaient pas la croire occupée.
Leur contre-attaque est donc bien « loupée », mais malheureusement nous avons aussi des pertes : le sergent Crécy, Morange tués par des balles en pleine tête (*), ce qui prouve bien qu’ils n’hésitaient pas à regarder par-dessus le parapet pour viser l’ennemi.
Et voilà des hommes qui n’ont même pas été cités, alors qu’il y a tant de citations distribuées à des gens qui n’ont rien fait.
Pour aller communiquer à ma
compagnie, je longeais le talus de la route et, arrivé à la 1ère ligne où était
la 23ème, je traversais toute cette compagnie pour aller trouver le lieutenant
de la 21ème.
Il me semblait que c’était le chemin le moins dangereux, car un boyau qui partait du commandant à ma compagnie en passant sur la crête et où le commandant voulait me faire passer était effroyablement bombardé.
Toutes les nuits, les corvées le rétablissaient, mais il était presque aussitôt démoli par les obus, et je me trouvais dans la nécessité de sauter à découvert par-dessus les éboulements. C’est dans ce boyau qu’un obus à shrapnel vide de 77 vint tomber à 2 mètres de moi, tandis que les éclats et les balles couvraient un certain espace tout autour de moi.
Mais je n’ai rien ; je reprends mon élan interrompu une seconde et veux ramasser l’obus, mais il est brûlant. Je ne m’attarde pas, car d’autres projectiles tombent tout autour de moi, et ce n’est que 2 jours après, alors qu’il me semblait que le bombardement était moins intense, que je repassai par ce boyau pour ramasser mon obus que je voulais conserver.
Comme il n’y avait guère que moi qui fréquentais ce boulevard à l’endroit où il traversait la crête, je le trouvai toujours à la place où je l’avais laissé.
Au cours de la journée, le régiment déclare 11 hommes tués et 26
blessés.
(*) : CRéCY Gaston Eugène, sergent, mort pour la France à Souchez
(62), le 22 juin 1915, tué à l’ennemi. Il était né à Corbeil, le 23 octobre
1887. Il est inhumé à Neuville-Saint-Vaast, nécropole La Targette, tombe n°
2168.
MORANGE Antoine, soldat, mort pour la France à Souchez
(62), le 22 juin 1915, tué à l’ennemi. Il était né à Volvic (63), le 16 mars
1878. Avant d’intégrer le 204e RI, il venait du 37e régiment d’infanterie
territoriale. Pas de sépulture militaire connue.
Le mercredi 23 juin
Nous sommes très bombardés ; la nuit a déjà été très agitée.
Les tranchées et les boyaux n’existent plus. De grosses marmites tombent un peu partout et non loin de notre cahute qui se remplit petit à petit de terre.
Nous avons quelques tués et beaucoup de blessés.
On annonce officiellement la
relève pour ce soir et tout le monde a hâte de quitter ce lieu maudit. L’odeur
des cadavres qui sont devant les lignes de la 21ème devient insupportable et
les obus dispersent les lambeaux des corps en décomposition. Un essaim de
mouches bourdonne partout.
Une marmite est tombée à côté de l’entrée de la guitoune du lieutenant POMMIER et a blessé le sous-lieutenant Bonaventure et les agents de liaison. Massé est le seul qui reste.
Le temps s’assombrit vers 5 heures du soir. Le commandant envoie
les cyclistes et Pautrat, le
caporal-clairon, pour servir de guides aux compagnies montantes.
Elles arrivent vers les 11 heures, les 1ères.
Mais le peloton qui doit relever la 21ème compagnie ne vient pas. Pautrat s’est trompé de boyau et ensuite, quand il a voulu retourner sur ses pas pour prendre la bonne voie, il s’est trouvé coincé par les autres compagnies et a dû attendre la fin de leur défilé.
Le commandant m’envoie à la 21ème pour le prévenir dès que la relève commencerait.
À 2 heures du matin, rien de nouveau, si ce n’est le jour qui
vient.
Le Lieutenant POMMIER me dit d’aller voir jusqu’au commandant si je puis avoir des renseignements. Je ne trouve plus personne. Le commandant et toute la liaison sont partis.
J’en rends compte à mon commandant de compagnie et, comme il me disait de rester avec lui, je discute un peu. Comme une section est déjà relevée par une autre compagnie, qu’elle n’a plus rien à faire dans les boyaux et que les hommes peuvent se faire tuer inutilement par les obus et que d’autre part il va faire bientôt grand jour, ce qui rendra la relève difficile et dangereuse, j’obtiens d’emmener cette section.
Nous partons aussitôt et,
arrivés à la route, nous trouvons Pautrat
avec le peloton qui doit relever la 21ème. Après explication avec l’officier
qui est à la tête et qui n’avait plus confiance en son guide, nous le laissons
passer et, à la tête de la section, je file ensuite bon train jusqu’à ce que
nous soyons quelque peu hors de la zone dangereuse.
Je suis à bout de forces quand nous arrivons au bivouac de Villers-au-Bois.
Le jeudi 24 juin
Nous quittons le bivouac vers les 7 heures ½ du matin. C’est dire que nous ne pouvons-nous reposer, et depuis mon arrivée je n’ai eu que le temps de casser une croûte et de préparer mes affaires.
Nous nous rendons à Béthonsart où nous devons faire le cantonnement. Le régiment doit nous suivre à ½ heure. Nous n’avons donc guère de temps.
Arrivés à Béthonsart,
il y a confusion ; nous attendons des ordres et finalement nous devons nous
rendre à Villers-Brûlin.
Pendant ce temps, le régiment nous a rattrapés. Avec le capitaine-adjudant-major Poitevin qui brouille tout, nous faisons le cantonnement, tandis que le régiment fait la grand’halte à l’entrée du village. Nous trouvons des chambres pour quelques officiers et le bataillon bivouaque dans un pré.
Nous sommes fourbus et prenons un peu de repos. Gresle s’aperçoit que son pantalon est tout rempli de poux.
Du 25 au 27 juin
Le vendredi 25, nous nous reposons toute la journée, nous en avions vraiment besoin.
Dans l’après-midi, il fait un orage, et pour ne pas être inondés sous notre tente nous devons faire des rigoles tout autour.
Le samedi 26, nous recevons du renfort qui arrive du dépôt ; les
compagnies étaient bien réduites, depuis quelque temps, leur effectif avait
beaucoup diminué par suite des pertes subies.
Le dimanche 27 juin, le commandant va reconnaître le nouveau
secteur que nous devons occuper au poste α (alpha) situé à la cote 123, sur la droite du Cabaret
Rouge.
Dans l’après-midi, nous faisons une partie de football qui est interrompue par la pluie et au cours de laquelle je reçois de Brigandat un coup de pied dans la jambe.
Le lundi 28 juin
Il fait un épais brouillard.
Dans la matinée, nous faisons nos préparatifs de départ pour l’après-midi. Nous quittons Villers-Brûlin à 13 heures.
Nous traversons Cambligneul, Camblain-l’Abbé, villages pleins de troupes, et par la route d’Arras gagnons le Bois des Alleux où nous faisons une halte et mangeons la soupe.
Le T.C. doit stationner en cet endroit et nous y laissons nos sacs, dont nous détachons les couvertures et toile de tente.
À la tombée de la nuit, nous nous acheminons vers les tranchées.
Nous passons aux « 31 abris », un long talus où sont installées de nombreuses batteries, 75 et Rimailho. Là se trouve également un parc du génie où les compagnies se munissent d’outils et de sacs à terre, qui sont maintenant les armes principales du fantassin.
Nous nous engageons alors dans
des boyaux interminables dans lesquels nous pataugeons dans la boue.
Nous prenons d’abord le boyau de Béthune, puis le boyau C, où nous sommes salués par des shrapnels. Les guides du 231ème qui nous conduisent se reconnaissent difficilement.
Carte du 231e RI, qui
permet de distingue le boyau de Béthune.
Cliquez sur l’image
pour agrandissement
De temps à autre, on nous crie à l’arrière que la file ne suit pas, alors le commandant s’arrête ou ralentit le pas.
Enfin, après diverses
péripéties, nous arrivons au poste de commandement. Les compagnies se rendent
sur leurs emplacements respectifs, conduites par des guides des compagnies que
nous relevons.
Le bombardement continue et le commandant CHALET n’est pas rassuré sous la pluie des marmites qui tombent sur la guitoune qui n’a rien de luxueuse. C’est un simple passage sous la route ou plutôt le chemin des Pylônes qui va à Souchez, et du côté de l’ennemi le boyau désaffecté est simplement fermé par des sacs de terre.
Comme le bombardement redouble, le commandant du 231ème qui dit que la lumière filtre à travers les sacs et est vue par l’ennemi souffle la bougie, ce qui ne fait pas l’affaire du commandant CHALET qui « veut y voir clair » et parle de se faire faire un autre P.C.
Les fourriers du 231ème nous donnent une frayeur en nous déclarant qu’il est impossible de communiquer de jour avec la 1ère ligne où sont les 21ème et 22ème compagnies.
Les agents de liaison doivent
nous faire reconnaître le chemin, et le commandant du 231 les envoie avec nous,
mais ils nous laissent en panne dès que nous sommes devant le passage
souterrain au-dessous de la route.
Ils nous disent n’y être jamais allés, que toutes les communications se faisaient par téléphone, quand la ligne n’était pas coupée, auquel cas ils attendaient qu’elle soit rétablie. Ils nous expliquent vaguement qu’au bout de ce souterrain il y a un boyau qui conduit directement aux 1ères lignes, mais qu’il faut être prudent, car en un endroit l’ennemi n’est séparé de nous que par un barrage de sacs de terre.
Voyant qu’ils étaient tous
deux terrifiés à la pensée seulement de traverser le souterrain, je prends le
parti d’aller reconnaître seul avec Polbeau
de la 22ème compagnie l’emplacement des compagnies. Nos 2 compagnies étant en
avant, nous ne tomberons pas chez les Allemands sans les rencontrer. Nous
suivons un petit boyau très peu profond et éboulé en maints endroits et nous nous
guidons sur la ligne téléphonique que nous suivons à tâtons.
Nous arrivons bientôt à la tranchée de 1ère ligne où je trouve la 21ème.
Alors que je leur demande des
renseignements pour connaître l’endroit du P.C. du lieutenant, Polbeau part de son côté à la 22ème qui
est sur la droite. Les hommes sont anxieux et, en regardant par-dessus le
parapet, à la lueur du jour naissant, je vois des ombres se mouvoir à quelque
distance de nous, que je ne crois pas supérieure à 30 ou 40 mètres. Pour moi,
cela ne fait pas de doute, ce sont des boches qui réfectionnent leur réseau de
fil de fer.
A un certain moment même où ils se groupent, je crois à une attaque.
Mais un sergent me dit qu’on leur a défendu de tirer, que du génie doit travailler devant nos lignes. Devant l’horrible incertitude, je n’ose consommer l’irréparable et dire aux hommes de tirer, alors qu’ils me demandent conseil, et je vais aussi vite que me le permettent l’obscurité et ma parfaite ignorance du secteur prévenir le lieutenant POMMIER.
Je le trouve avec le
commandant de compagnie du 231ème qui lui passait des consignes et qui
m’affirme avec une belle audace qu’en effet ce doit être des travailleurs du
génie qui sont devant nos lignes.
J’ai beau expliquer la situation et émettre un doute, ni l’un ni l’autre n’a la conscience de se déranger et de se rendre sur le terrain.
Je reviens donc au commandant
et en passant j’examine encore un bon moment.
Mes doutes se changent en certitude, et je recommande aux hommes en face de ce point d’être prêts à toute éventualité ; ils se rendent compte d’ailleurs de la gravité de la situation, et même l’un d’eux tira un coup de fusil sur un Allemand qu’il avait nettement distingué, disait-il.
Le jour vient et le temps que je vienne rendre compte au commandant de ce qui s’était passé, toutes les ombres s’étaient évanouies.
Le mardi 29 juin
Le mardi 29 juin, de très bon matin, nous apprenons que durant la relève d’hier soir la 23ème compagnie qui est en réserve sur la route de Béthune a eu de fortes pertes par le bombardement.
Les 3 compagnies qui sont en avant n’ont eu que quelques blessés. Je vais plusieurs fois communiquer à la 21ème compagnie. Les fourriers du 231ème n’avaient pas tout à fait tort et en passant dans le boyau dans lequel en certains endroits il y a 20 centimètres d’eau et de boue, je suis en pleine vue et à chacune de mes allées et venues je suis salué par quelques shrapnels.
Je fais donc vite en me garant
le plus possible dans les coins abrités. Je me rends compte du terrain ; nous
sommes placés immédiatement à la droite de notre position du Cabaret Rouge,
et dans le secteur de la 21ème notre tranchée forme un angle droit où un boyau
a été barré par un mur de sacs de terre.
Les Allemands en ont fait autant à 7 ou 8 mètres, et de là ils nous envoient des grenades. Les hommes de garde à cet endroit font leur possible pour leur répondre et leur envoient des pétards à clous. En voyant le terrain, il est évident que c’étaient bien des ennemis qui, à la faveur de la nuit, perfectionnaient les défenses accessoires en avant de leur tranchée.
Un simple feu de salve de notre part aurait fait du travail
et en aurait empêché de l’autre côté de nos lignes. Rien ne sert d’épiloguer,
mais je ne puis cependant m’empêcher de songer à l’incurie de certains de nos
chefs et à leur coupable inaction. Ceux-là ne sont pas à leur place qui
acceptent les honneurs et avantages de leur grade sans en assumer tous les
devoirs et la responsabilité.
En parcourant les tranchées et boyaux, je vois toute l’horreur du champ
de bataille.
Des cadavres, des débris humains partout pêle-mêle avec du matériel de
toutes sortes ; sur le terrain, dans les trous d’obus, les parapets sont faits de morts entassés ;
la tranchée de la 21ème, sur un certain point, a été comblée en partie par des
cadavres ; on ne peut creuser et le fond du boyau se craquelle, se boursouffle
sous l’action des gaz qui se dégagent des corps en décomposition.
Une odeur infecte plane sur tout le secteur et un essaim de mouches,
des grosses mouches noires ou violettes, bourdonne autour de nous et, quand
nous mangeons, les mouches viennent se poser sur notre pain. Elles sont si
nombreuses que l’on ne peut s’en défendre.
À minuit, l’ennemi attaque sur la 21ème et le 289 à
notre droite qui se laisse prendre un petit poste au boyau international.
Un commandant du 289ème est tué. La 22ème doit se replier légèrement
pour être en liaison avec le 289ème.
Le caporal Rodier qui, à
la suite de l’attaque, regardait avec vigilance par-dessus le parapet, est tué
net d’une balle en pleine tête et il tombe comme une masse à mes pieds sans
même pousser un cri. J’étais allé communiquer et j’avais trouvé le lieutenant
dans la tranchée auprès d’un blessé que l’on emmenait sur un brancard.
Comme tout danger semblait passé et que le jour commençait à poindre,
je venais de dire à Rodier de ne
pas s’exposer inutilement ; le lieutenant lui-même lui avait dit d’être prudent
; mais soit bravade ou forfanterie devant son chef, il continuait de veiller
quand le pauvre garçon fut frappé mortellement. (*)
Dans cette journée, nous eûmes beaucoup de pertes par le bombardement. (**)
Le commandant se fait faire un P.C. en un endroit qu’il a choisi non
loin de celui où il est dans le boyau C.
(*) :
RODIER Jean, caporal,
mort pour la France le 30 juin 1915, tranchée sud de Souchez (62), tué à
l’ennemi. Il était né à Saint-Victor (63), le 12 janvier 1878. Il n’a pas de
sépulture militaire connu.
(**) : Au cours de la journée, le régiment déclare 7 hommes
tués, 19 blessés et 1 disparu.
Mercredi 30 juin
Le mercredi 30 juin, dans la journée, la 22ème fait un prisonnier qui,
probablement durant l’attaque de la nuit, s’est blotti dans un trou d’obus tout
près de nos lignes ; il s’est rendu dans notre tranchée et les hommes ont eu un
moment de grande surprise en le voyant surgir au-dessus du parapet. Il était
légèrement blessé.
Le bombardement n’arrête pas et les obus de toutes les batteries de
l’ennemi semblent converger sur notre guitoune où nous sommes entassés avec le
commandant et le capitaine Poitevin
qui, lui, n’en sort pas et dort toute la journée et toute la nuit.
Polbeau, qui s’était blotti dans une cagna tout à côté avec Filhol reçoit une commotion, un obus
étant tombé juste en face l’entrée de son trou. Il vient vers nous ; il est
sourd et a les yeux hagards ; il a l’air un peu fou.
Assis à l’entrée de notre abri, Cavin
reçoit un sac de terre sur la tête, tandis que le commandant, quelques minutes
après, reçoit un mince éclat au cou. La situation est vraiment périlleuse et
nous sommes dans un véritable enfer.
La nuit, les Allemands renouvellent leur attaque de
la veille, mais elle est facilement repoussée. La 22ème, dont les hommes ont
trouvé dans leur secteur des dépôts de grenades allemandes, essaient leur
efficacité sur l’ennemi.
Ils tirent la ficelle et les lancent aussitôt ; mais ils s’aperçoivent
bientôt qu’elles n’éclatent pas et qu’aussitôt il en vient une de leur côté qui
éclate en route très souvent.
Dès lors, ils les lancent avec moins de précipitation, de façon
qu’elles ne puissent leur être retournées. Ils sont heureux de pouvoir envoyer
leurs propres munitions aux Allemands et ils reconnaissent que leurs grenades
sont vraiment plus pratiques que les nôtres.
Juillet
1915 : Artois, l’exécution, la permission
Le jeudi 1er juillet
Le bombardement continue de jour et de nuit, et les compagnies qui ont
des travaux à faire ont beaucoup de difficultés pour les exécuter et elles
subissent des pertes. Un obus frappe dans la journée le parapet juste devant
notre abri et met à jour un cadavre.
Un autre tombe sur le trou où se réfugiait Pautrat, enterre son fusil, ses affaires et crève son
clairon. Heureusement qu’il n’était pas dedans à ce moment.
Nous espérons la relève, mais ce ne sera que pour demain.
Au cours de la journée, le régiment déclare 4 hommes tués et 3
blessés.
Le vendredi 2 juillet
La relève a lieu par le 246 suivant l’ordre donné.
Le commandant arrive de bonne heure et prend les consignes du secteur. Nous attendons nos compagnies correspondantes à l’entrée du passage souterrain pour les conduire à leurs emplacements. Les obus pleuvent de temps à autre. Nous partons ensuite avec le commandant.
Comme le bombardement devenait plus intense, il se met à l’abri dans son nouveau P.C. qui n’est pas terminé. Comme il n’y a pas de place pour tous, nous restons dans le boyau et dans l’entrée. Quelques-uns d’entre nous grognent un peu et voudraient partir de suite de ce lieu où nous ne nous sentons guère en sécurité.
Des corvées du génie qui
apportent du matériel montent le boyau. Nous partons enfin à vive allure.
A la route de Béthune, comme j’allais sortir du souterrain, un homme se jette sur moi dans l’obscurité en criant : Attention ! Au même instant, j’entends un sifflement aigu, puis aussitôt une formidable explosion : une marmite vient de tomber à très courte distance.
Le commandant est sorti du souterrain, je suis le mouvement et je butte dans le boyau sur 2 cadavres étendus dans le passage ; je ne me rends pas bien compte dans la nuit, mais le temps que je fasse un saut pour passer par-dessus, il me semble voir du sang.
Quelle horreur !
Nous passons tous ainsi
par-dessus ces 2 malheureux qui ont été descendus des 1ères lignes par les
brancardiers. L’un d’eux doit être de ma compagnie, il a été tué durant la
relève.
Comme les marmites continuent d’arriver, le commandant marche à toute la vitesse dont il est capable jusqu’à ce que l’on soit à une certaine distance.
Au cours de la journée, le régiment déclare 3 hommes tués et 10
blessés.
Le samedi 3 juillet
Nous
arrivons le matin à Mingoval où nous avons fait le cantonnement dans la
nuit.
Je
suis éreinté et je couche dans une écurie où je dors d’un sommeil de plomb.
Le dimanche 4
Le
réveil a lieu à 2 heures 30 suivant
les ordres reçus dans la journée d’hier.
Le régiment va avoir la pénible tâche
d’exécuter Vérain, de la 23ème compagnie, un pauvre diable sans famille
dont le crime a été de quitter sa compagnie avant de monter aux tranchées. On l’a choisi pour faire un
exemple que l’on croit nécessaire à la suite des
incidents qui se sont produits avant que nous montions à Lorette.
Le
lieu de l’exécution est fixé près de Béthonsart.
Tout
d’abord, devant le régiment rassemblé dans un pré, on procède à la dégradation
de 4 hommes qui sont condamnés à des peines variables.
Puis
c’est le tour de Vérain. Quand il
entre dans le pré, encadré par un piquet baïonnette au canon, qui par un hasard
cruel se trouve justement être de la compagnie à laquelle il a appartenu qui
est de jour, il fixe le commandant CHALET d’un regard qui n’a plus rien
d’humain, il le fixe ainsi jusqu’à son arrivée au centre du carré formé par le
régiment.
Le commandant a l’air gêné.
Le greffier lit l’acte
d’accusation et la condamnation.
Le condamné veut alors parler, mais le colonel lui impose silence et donne l’ordre de lui bander les yeux et de l’attacher au poteau d’exécution. Mais dans un sursaut d’énergie il offre la plus grande résistance et ne veut pas se laisser mettre à genoux et bander les yeux.
Le colonel envoie quelques hommes en renfort et il est finalement maîtrisé. Scène pénible et écœurante. Un jeune soldat de la 21ème s’évanouit. Le peloton d’exécution, composé des plus anciens soldats et gradés, se place en face du condamné ; une salve ; le coup de grâce tiré par une main tremblante ; c’est fini.
Maintenant, au son des
tambours et clairons, tout le régiment défile devant le corps et nous rentrons
au cantonnement.
Tous les hommes sont silencieux ; un nuage de tristesse s’appesantit sur tout le régiment durant le retour. Tous ces hommes qui depuis quelques mois ont vu des scènes atroces de carnage sont profondément et péniblement impressionnés par cette exécution où, au nom de la patrie, ils viennent de jouer le rôle de bourreau. Cette impression est-elle salutaire ?
Peut-être, sur certains individus.
Nous passons ensuite la
journée à nous nettoyer et mettre nos affaires en ordre.
Le mardi 6 juillet
Nous devons remonter ce soir aux tranchées.
L’ordre arrive vers midi. Et nous distribuons tout le vin que le T.R. (*) nous a amené. Comme il y a une distribution d’arriéré, il y en a environ 2 litres par homme.
Cette fois, nous allons aux tranchées de 2ème ligne ; les sacs sont laissés à Mingoval. Nous passons au bois des Alleux ; il fait un beau temps avec beaucoup de vent.
Nous arrivons de bonne heure à la parallèle Dalila où nous trouvons de bons abris, dans lesquels nous nous sentons en sécurité. La liaison loge dans le même abri que le commandant et nous nous installons du mieux possible.
(*) : Train régimentaire : Voir >>>
ici <<<
Le samedi 10 juillet
Nous devons être relevés.
Nous avons passé une bonne période, calme et tranquille en comparaison de nos derniers séjours aux tranchées. J’ai exploré un peu le secteur qui était avant le 9 mai occupé par l’ennemi.
Je suis frappé de la quantité de sacs de terre dont usaient les Allemands. Ces sacs étaient fabriqués avec toutes sortes de tissus, depuis la toile jusqu’à du calicot, de l’étoffe même légère, doublée ou triplée, avec laquelle on confectionne des corsages. Toutes ces étoffes devaient provenir de nos filatures du Nord.
Je rencontre un soldat du bataillon qui cherchait dans ces murs de sacs et prenait de petits échantillons. Il était dessinateur de son métier et me dit avoir travaillé à faire les dessins de certaines de ces étoffes, qu’il me désigne en me nommant les filatures d’où elles proviennent.
Durant cette période, nous
apprenons la bonne nouvelle inespérée de l’établissement de permissions de 8
jours qui seront accordées à tour de rôle en commençant par les plus anciens au
front. Elles seront accordées dans la proportion de 4% de l’effectif, ce qui
représente environ 1 homme par compagnie et par jour.
Le commandant CHALET n’est pas partisan de ces permissions, disant que les hommes qui maintenant sont séparés depuis longtemps de leur famille seront repris par elle et y penseront davantage au retour. Nous sommes relevés de bonne heure par le 276ème et nous nous rendons jusqu’au bois des Alleux, sur la route d’Arras, où nos voitures doivent venir nous prendre.
Nous devons en effet être emmenés jusqu’à Chelers par des camions automobiles.
Le dimanche 11 juillet
Nous partons en auto à 5 heures et nous arrivons de bonne heure à Chelers où nous nous installons pour le repas. Les cantonnements ne sont pas bien brillants, car comme dans toute cette région du Nord les maisons, bâties en terre et en bois pour la majeure partie ne sont guère solides et ont déjà beaucoup souffert, depuis si longtemps qu’il y a de la troupe dans le pays.
Pour la liaison, nous avons trouvé une maison neuve attenante à une ferme où nous disposons de 2 pièces pour manger et nous coucher. Nous sommes très bien installés et les habitants ont l’air très complaisant.
Le soir même, partent les premiers permissionnaires. Ils quittent Chelers
à 11 heures pour aller en
détachement prendre le train à la gare de Savy.
Cavin part à la 21ème.
Le commandant CHALET part également et est remplacé par le capitaine Poitevin.
Le lundi 12 juillet
Je
remplace l’adjudant de bataillon et ne partirai qu’à son retour.
Le mardi 13 juillet
Nous avons une prise d’armes pour la remise de la croix de la Légion au
capitaine Noël du 5ème bataillon.
Le régiment est rassemblé dans un pré tout près du village, où le
colonel le passe en revue. La liaison évite (*) d’y aller ;
nous entendons de notre cantonnement la musique qui joue la Marseillaise, puis
fait défiler le régiment.
Le drapeau a été sorti pour la circonstance.
Le soir, il y a une retraite dans les rues du
village. Je fais mes efforts pour faire partir Nault, l’ordonnance du commandant CHALET, de façon qu’il soit
rentré en même temps que le commandant, mais le colonel, ayant appris qu’il
était ordonnance, l’avait reculé et ne veut pas revenir sur sa décision.
(*) : Les soldats du groupe de liaison ont-ils
volontairement pas assisté à la cérémonie ?
Le mercredi 14 juillet
Tout un programme avait été élaboré pour fêter dignement ce jour : Champagne d’honneur chez le colonel où le plus ancien sous-officier de chaque compagnie devait assister ; fête sportive : courses à pied, à bicyclette, sauts ; musique etc.
Mais des ordres arrivent et nous partons à 4 heures du matin pour Camblain-l’Abbé. Dans tous les villages que nous traversons, nous défilons au son de la musique nouvellement formée et dont le répertoire n’est pas encore très varié.
A Villers-Châtel, nous
croisons le 231ème qui, en voyant la musique lance toutes sortes de quolibets.
Ils en ont une également nouvellement formée, ce dont, comme d’ailleurs tous les poilus, ils ne voient pas la nécessité pour monter aux tranchées. Des saillies ironiques partent comme des fusées, ce qui a pour effet de mettre le lieutenant-colonel Collon en fureur. Les réflexions des hommes se tournent à son désavantage et il ne peut plus rien dire.
2 compagnies montent de suite
aux tranchées de réserve aux Muguets où est le P.C. du général.
Nous restons avec le capitaine Poitevin, faisant fonction de chef de bataillon, et les 2 autres compagnies dont la 21ème, à Camblain-l’Abbé.
Vers le soir, nous recevons l’ordre de monter en réserve près des autres compagnies. La pluie se met à tomber à verse et quand nous arrivons aux 31 abris où nous prenons les boyaux qui sont transformés en cours d’eau où nous avons de l’eau aux genoux en certains endroits, nous sommes trempés jusqu’aux os.
Ma compagnie doit rester dans un boyau où les hommes tâchent de se mettre à l’abri dans des trous, et je reviens près du capitaine.
Par un hasard inespéré, nous trouvons 2 bottes de paille abandonnées par des hommes qui devaient en avoir « marre », et une espèce de petit appentis adossé au talus du chemin. Nous nous y installons ; nous serons tout de même moins mouillés que dehors.
Les canons tonnent dur. On dit qu’ils envoient des obus à gaz asphyxiant.
Une attaque doit avoir lieu,
mais au moment voulu, 8 heures du soir
je crois, les hommes ne sortent pas des tranchées. Avec un temps pareil, cela
n’a rien d’étonnant ; il n’y a rien à faire. Ce n’est partout qu’une
bouillabaisse dans laquelle les hommes s’enlisent.
J’entends au P.C. que l’on rédige un rapport comme quoi les unités n’ont pu avancer. Quelques blessés du 289ème descendent des 1ères lignes. Le bombardement devient moins intense et vers minuit nous nous couchons.
Bien que trempé et grelottant, je parviens tout de même à dormir un peu.
Le 15 juillet
Le 15 juillet, à 6 heures du matin, nous redescendons à Camblain avec les 2 compagnies qui étaient montées hier soir et dont les emplacements sont pris par les 2 autres compagnies du bataillon.
Le soir, celles-ci sont remplacées par le 5ème bataillon, car nous
devons partir en 1ère ligne le 17 au soir. Je m’aperçois de plus en plus de la nullité du capitaine Poitevin qui brouille tout et ne
peut jamais prendre une décision ferme.
Le dernier qui parle a toujours raison avec lui. Heureusement qu’il n’est commandant du bataillon que pour une dizaine de jours, car je n’aurais pas du tout confiance en lui en cas d’événements graves.
Le 17 juillet
Nous montons à la nuit aux tranchées de 1ère ligne. Nous avons encore appuyé sur la droite d’où nous étions la dernière fois, si bien que nous avons tenu successivement toute la ligne depuis Lorette. Le P.C. du commandant de bataillon est à la tranchée des Pylônes ; il y a 2 compagnies en 1ère ligne, une en soutien à la tranchée des Pylônes et la 4ème à la route de Béthune.
Les compagnies font des travaux pour améliorer le secteur. Les canons boches ne crachent pas trop.
Le 20 juillet
Le 20 juillet, bien que Cavin ne doive rentrer que dans 2 jours, je pars en permission.
Je descends dans l’après-midi au bois des Alleux pour déposer mes affaires au T.C. et me préparer et le soir, après avoir vu le lieutenant Bernard qui doit passer la revue des permissionnaires, j’emmène le détachement à la gare d’Aubigny. C’est le cœur léger que nous partons.
Quelle joie à la pensée de revoir notre famille !
Nous prenons le train à 2 heures du matin.
Quand le jour se lève, nous
pouvons enfin contempler des paysages qui ne sont pas bouleversés par la pioche
des travailleurs ou les explosions des obus. Les yeux habitués aux tranchées se
reposent maintenant sur les champs cultivés, sur les jardins fleuris,
s’attardent autour de riantes villas ou de modestes chaumières qui respirent le
calme et la tranquillité.
Seul un G.V.C. (*), de place en place, choque le regard.
Mais nous approchons de Paris. Comme ce sont les premiers jours que l’on voit des permissionnaires du front, notre train est acclamé ; des femmes, des jeunes-filles accourent aux passages à niveau pour nous voir passer ; un G.V.C. nous présente les armes. Dans les wagons, c’est un enthousiasme indescriptible.
Nous passons par la grande ceinture avec une lenteur ponctuée de nombreux arrêts.
A Laroche où il fait presque jour quand nous arrivons, nous déjeunons. J’avais l’estomac dans les talons.
J’arrive enfin à Tonnerre où je débarque et prends aussitôt la route de Tronchoy. Jeanne vient me rejoindre le lendemain et nous rentrons à Paris où je m’offre le luxe d’une crise d’entérite.
(*) : G.V.C. : Gardes des Voies de Communications.
Postes généralement tenus par les plus anciens : la réserve de l’armée
territoriale.
Durant la permission d’Alexandre, une dégradation militaire de 2
soldats est effectuée devant tout le régiment, le 28 juillet à Camblain-l’Abbé
(62).
Août 1915 : Artois
Le 1er août
Ma permission de 8 jours est expirée et je reprends le train à la gare du Nord. C’est avec le cafard que je quitte Paris.
Nous arrivons en gare d’Aubigny à 4 heures ½ le matin du 2 août.
Nous nous rendons au bois des Alleux, où se trouve le T.C.
Le bataillon devant être relevé le soir même, je ne monte pas aux tranchées. Je ne m’en sens d’ailleurs pas la force, n’étant pas remis de mon indisposition.
En attendant le bataillon, je tâche de me reposer dans la guitoune à Riboux et au cuisinier. Le bataillon arrive le soir. Tous mes camarades et même le capitaine et le Médecin-major jettent les hauts cris en m’apercevant et disent que j’ai maigri et que j’ai une mine affreuse. Il est vrai que j’ai encore de la fièvre. Ils me blaguent au sujet de ma permission.
Nous recevons une grosse averse et nous partons pour Camblain-l’Abbé.
Le mardi 3 août, nous nous installons à la ferme derrière l’église et la vie de la liaison reprend pour moi.
Combien je préfèrerais être chez moi !
Le mercredi 4 août, le général de division de Laporte passe une revue.
Le jeudi 5, c’est le tour du général Fayolle, commandant le 37ème corps d’armée.
Le dimanche 8 août, la musique joue devant le Q.G., puis ensuite près de l’ambulance.
La vie continue, monotone, dans ce village morne, sale, plein de troupes, où nous sommes dévorés par les mouches et où l’eau est à une si grande profondeur que très souvent on s’en passe.
Le lundi 9 août, nous faisons une marche de manœuvre d’une dizaine de kilomètres et à 10 heures le bataillon se trouve rassemblé à l’entrée du village où a lieu une remise de décorations.
Le mardi 10 août, nous montons aux tranchées de 1ère ligne.
Le 5ème bataillon est en 2ème ligne. Le lieutenant-colonel étant en permission, c’est le commandant CHALET qui prend le commandement du régiment, et le capitaine Poitevin est commandant du bataillon.
Durant toute cette période, nous avons du beau temps ; le secteur est calme.
À ma compagnie, qui est en 1ère ligne, nous avons un tué, Pottier, le 11 août. Il est tué par un obus de 77, derrière un bouclier où il guettait. (* )
Le vin que l’on nous
distribue, comme d’ailleurs celui que nous achetons, est affreusement mauvais.
J’ai la diarrhée, probablement la suite de ma crise d’entérite.
(*) : POTTIER Louis
Le samedi 14 août, nous sommes relevés par le 231ème. Nous allons à Chelers où nous arrivons le 15 au matin. Nous reprenons nos anciens emplacements.
Durant les 8 jours que nous
passons au repos, nous sommes à peu près tranquilles, à part les paperasses qui
abondent et dont la plupart sont complètement inutiles. J’ai des maux d’estomac
et je suis un petit régime ; ma diarrhée ne se passe pas malgré tout le bismuth
et l’opium que je prends.
Des exercices de lancement de grenades ont lieu, dirigées par le lieutenant Dutemple, et au cours desquels survient un accident le samedi 21 août.
A la 21ème, nous avons 3 blessés.
On nous distribue des nouveaux casques qui nous paraissent bien lourds, mais qui nous protègeront peut-être des petits éclats d’obus. (*)
(*) : Il est grand temps ! Nous verrons qu’Alexandre
devra la vie à ce casque ; le 25 septembre de
la même année.
Le dimanche 22 août, nous partons à 9 heures du matin pour les tranchées de 2ème ligne. Le capitaine adjudant-major Poitevin qui n’est pas du tout cavalier monte sur des tonneaux pour enfourcher son cheval, mais celui-ci s’écarte au bon moment et le capitaine tombe gentiment assis à côté de son cheval.
Il ne se fait aucun mal et ce n’est qu’une occasion de rire un peu.
Nous arrivons à Camblain
à midi 10.
La dernière étape a été un peu longue ; nous avons marché une heure 10 sans arrêt. Le médecin auxiliaire Toupet fait remarquer au capitaine Poitevin qui conduisait le bataillon qu’il y a quelques traînards pour cette raison.
Mais le commandant CHALET parle de la « trique » ; qu’il n’y a que cela pour faire marcher les hommes. Nous mangeons à Camblain ; mon déjeuner se compose de pain et de lait que j’ai pu trouver dans le village. Nous nous remettons en route à 14 heures.
Le commandant CHALET est parti en avant par la route d’Arras et l’escouade de liaison suit la 24ème compagnie qui marche en tête. Il fait chaud et nous faisons un grand nombre de détours inutiles.
Nous trouvons le commandant à l’entrée du boyau 123 et nous arrivons sans encombre à la parallèle Dalila.
Durant la nuit, nous entendons la séance habituelle sur Souchez ; fusillade, grenades et quelques obus.
Le lundi 23 août, tout est calme.
Seuls quelques coups de canon rompent la monotonie. Les compagnies fournissent beaucoup de corvées, une centaine d’hommes environ par compagnie, dont la plupart sont employés au transport du matériel pour la 1ère ligne.
Le mardi 24, nous allons sur le terrain au crépuscule chercher des obus de 75 pour avoir des bagues. Celles du 77 allemand sont encastrées dans l’obus et très difficiles à retirer, d’autant plus que nous n’avons que des pioches pour outils. Aussi nous préférons les 75.
Nous en trouvons beaucoup à proximité d’une ancienne tranchée allemande.
Le mercredi 25, je travaille à faire des coupe-papier ; nous nous installons dans une tranchée abandonnée où nous ne sommes pas dérangés. Il fait toujours un temps splendide.
Dans la nuit, un violent bombardement se déclenche ; le feu est intense sur les 1ères lignes.
Petit à petit, tout redevient calme.
Le jeudi 26 août, nous sommes relevés par le 231ème.
Les fourriers partent à 2 heures du soir avant les compagnies pour faire le cantonnement à Camblain-l’Abbé.
En arrivant, nous le trouvons tout fait par Macard et le commandant de la 23ème compagnie qui avaient reçu des ordres du commandant, leur compagnie étant restée dans ce village pendant que nous étions aux tranchées de 2ème ligne.
Le vendredi 27 août, nous nous installons de notre mieux dans notre cantonnement.
Nous faisons notre popote chez un bistrot au coin de la route de Cambligneul et nous couchons à la grande ferme où est le commandant. Les débits sont règlementés par le haut commandement, l’alcool est prohibé, mais on en trouve tout de même quelquefois.
Des marchands improvisés vendent du vin, de l’épicerie etc. à des prix fabuleux, et certains font des fortunes au détriment du soldat qui est forcé de payer le prix demandé ou de se passer de ce dont il a besoin. Jusqu’à la relève, nous faisons de petits exercices qui sont plutôt ennuyeux que fatigants.
Nous avons assez beau temps, sauf le jeudi où il pleut.
Septembre 1915 : Artois, la folle attaque vers Souchez, des Français détroussent les cadavres français
Le vendredi 3 septembre
Nous relevons le 289ème en 1ère ligne. La 21ème et la 24ème sont aux tranchées avancées au-dessus du ravin de Souchez.
Juste le jour de relève, l’officier des détails distribue de la toile pour faire des fanions blanc et rouge que, comme de juste, on n’a pas le temps de faire confectionner dans les compagnies.
De grands travaux sont en cours. On parle et, plus que cela, on sent une attaque prochaine. Il pleut et les boyaux sont pleins de boue dans laquelle on enfonce jusqu’au mollet.
Le samedi 4 septembre
De vives actions d’artillerie ont lieu qui se continuent toute la nuit. Il ne fait pas bon se montrer par-dessus le parapet. Les premières lignes ennemies sont accrochées au flanc du ravin au-dessous de nous, mais nous sommes dominés par la crête en face de nous qui s’élève jusqu’à La Folie, qui est la cote 140.
Les Allemands ont beaucoup d’artillerie de ce côté et dans la direction de Givenchy.
Le dimanche 5 septembre
Le soleil fait sa réapparition.
Je me mets alors en devoir de me décrotter, ce qui me prend au moins 2 heures. Ma capote, bandes molletières etc., n’étaient plus qu’un bloc de boue argileuse qui ne se détachait pas facilement. Le Colonel donne des ordres pour faire monter le 2ème jour de vivres de réserve qui était resté à la voiture de compagnie.
Cela n’augure rien de bon.
Le général Schmitz qui commande la brigade vient
visiter les tranchées.
C’est la 1ère fois que nous le voyons si près des lignes. Comme il est très gros, il doit avoir de la difficulté à passer dans certains boyaux. Comme il était dans la tranchée de la 21ème, un petit 77 tombe à quelque distance de lui ; ce fut tout un événement, et sur ce, il écourta sa visite. Le commandant CHALET était heureux de lui faire voir les points particulièrement dangereux.
Le lundi 6
La brigade téléphone qu’une attaque s’est déclenchée sur notre gauche, c’est-à-dire Souchez. On entend la fusillade et les coups de grenades ; l’artillerie fait montre d’une grande activité.
Dans notre secteur, elle détruit quelques petits ouvrages allemands.
C’est aujourd’hui l’anniversaire de la bataille de Barcy. Que de chemin parcouru depuis !
Quelle vie nous avons menée depuis un an, et nous en sommes toujours au même point. Il est pénible de penser à ces choses, de songer aux nombreux camarades que nous avons laissés sur les champs de bataille, et que leur sacrifice n’ait pas eu de résultat tangible.
Enfin, nous espérons que ce que l’on prépare amènera une décision.
Le mardi 7 septembre
L’artillerie continue à être très active.
Il me semble que l’attaque que l’on prépare sera sérieuse ; une série de notes sont communiquées à ce sujet ; on creuse des parallèles aux boyaux, des abris etc. ; des munitions sont entassées dans les secteurs, des vivres de réserve également.
Cette fois, les compagnies confectionnent les fameux fanions qui doivent être emportés avec les vagues d’assaut et délimiter notre progression. De cette façon, les artilleurs ne nous tireront peut-être pas dessus.
Nous sommes relevés le soir par le 231ème, sans aucun incident.
Le mercredi 8 septembre
Nous arrivons vers les 5 heures ½ à Chelers et en passant à travers champs nous faisons une belle récolte de champignons dans les pâturages qui avoisinent le village.
Ils nous semblent d’une saveur exquise à notre déjeuner ; l’intendance n’a pas l’habitude de nous en fournir de pareils.
Le jeudi 9 septembre, et jusqu’au mardi 14
Le bataillon fait des exercices divers ; exercices d’attaque surtout, de signalisation etc. Tout se passe admirablement comme de juste. Le commandant avait choisi un terrain se rapprochant, par sa configuration, de celui sur lequel nous opérerons probablement d’ici peu. Nous prenons plusieurs fois la même crête dans des assauts irrésistibles…
Seulement, nous ne trouvons pas de fils de fer devant nous, pas de tranchées, pas de boyaux. Aucune balle, aucun obus ne nous arrête, et il n’y a pas de corps à corps avec les boches.
Durant toute cette période, nous n’avons qu’un seul jour de pluie, le jeudi.
Le mercredi 15 septembre
Nous quittons Chelers à 8 heures 30 du matin ; nous déjeunons à Camblain ; puis nous montons aux tranchées où nous relevons en 2ème ligne le 289ème. Le P.C. du commandant est au point Z et la 21ème reste aux 31 abris. Il fait un temps magnifique.
Le jeudi 16 septembre
Je vais communiquer à ma compagnie qui est à une assez grande distance d’où nous sommes.
Comme je suis seul et qu’il fait beau et que je ne suis pas trop pressé, je flâne en curieux, et je me rends compte des travaux faits ou en cours dans le secteur : je vois de nombreux travaux de terrassement, des emplacements de batteries, des réseaux de fils de fer jetés devant les tranchées qui serviraient en cas de repli, des casemates à mitrailleuses etc.
Puis, en avant du bois de Berthonval,
je fais le tour d’un réduit organisé pour tenir en toute extrémité. Il a une
forme carrée avec des tranchées de tir disposées tout autour de telle façon que
tous les abords de ce centre de résistance soient battus par le feu de
l’infanterie et des mitrailleuses.
De quelque côté que l’on se tourne, on a un magnifique champ de tir. Un triple réseau de fil de fer barbelé entoure ce réduit dans lequel sont ménagés des abris profonds et solides pour les hommes ; ½ section peut tenir place dans chaque abri. Il y a aussi des abris à munitions et à vivres. Ce réduit est dénommé « ouvrage de Berthonval ».
Tous ces travaux ont été faits par des territoriaux et comme ils se trouvent à une assez grande distance des premières lignes, ils ont été bien exécutés, avec tout le soin voulu.
Je me rends compte qu’au cas
où la prochaine offensive ne réussirait pas pour une cause ou pour une autre,
nous aurions à l’arrière de fortes positions toutes préparées où nous pourrions
nous replier et contenir l’ennemi. En arrivant vers les batteries, tout près
des 31 abris, je peux voir que les artilleurs eux-aussi ont fait du travail.
Des soutes à munitions sont creusées dans les parois du boyau et toutes sont remplies d’obus. Il y en a des quantités incroyables. 2 pièces de 270 sont installées dans le talus dit des 31 abris ; tout près il y a des monceaux d’obus. Je me représente la puissance d’explosion d’un tel engin.
Ils tirent sur La Folie.
Justement, depuis le matin, nos
75 n’arrêtent pas de bombarder les lignes allemandes, et en chemin, sur la
lisière du bois de Berthonval, je voyais chaque batterie tirer.
L’ennemi ne répond guère, mais vers le soir, au crépuscule, alors que je rentrais en compagnie des cyclistes qui avaient été chercher notre soupe, ils se mettent tout d’un coup à bombarder violemment notre 1ère ligne sur une étendue minime, mais juste dans notre secteur.
Du point Z où nous arrivons, on ne voit plus qu’un rideau d’une épaisse fumée au milieu de laquelle on aperçoit les éclairs des éclatements. Nous craignons une attaque qui ne se produit pas et, par la suite, quand ce fut un peu calmé, nous apprenons que nous avons 4 blessés pendant ces ¾ d’heure d’intense bombardement.
Le vendredi 17
On demande dans les compagnies le nom d’un caporal pour une décoration à décerner, une décoration anglaise je crois.
Le caporal Bédé est désigné à la 21ème, il avait été choisi par le commandant du bataillon. Mais comme il faut aller jusqu’aux 31 abris pour avoir les renseignements demandés, et que la proposition doit être présentée au colonel à une heure fixée, un autre est choisi à sa place dans une autre compagnie.
Voilà donc à quoi tient la gloire !
Le samedi 18 septembre
Nous
sommes relevés par le 231ème et nous redescendons à Camblain-l’Abbé. Les
deux artilleries sont très actives pendant la relève, mais nous n’avons
heureusement pas de pertes.
Le mercredi 22
Le général de division de
Laporte nous passe en revue dans le pré devant le Q.G., puis il nous
fait un speech vibrant :
« Il faut avoir
du cœur au ventre, et c’est nous, la 55ème division, qui aurons l’honneur
d’ouvrir les portes au 33ème C.A. L’artillerie et les munitions sont en
abondance, et les plus beaux espoirs sont permis. »
Puis le général Schmitz
qui commande la brigade veut, après le départ du général de Laporte, faire aussi un petit laïus
; mais il ne fait que répéter quelques paroles qu’il vient d’entendre et il
détruit tout le bel effet produit par les belles paroles du général de
division.
Le jeudi 23
on nous distribue toute la journée du matériel et des projectiles : des
fanions, sacs à terre, outils, carrés de toile blanche pour épingler sur le dos
des hommes de façon à bien marquer la progression durant l’attaque, des
grenades, etc. etc.
Le soir, nous allons relever un bataillon du 231ème
en 1ère ligne. Il a fait de l’orage dans la journée. Les boyaux sont remplis
d’eau et de boue. À l’entrée du bois de Berthonval, nous passons dans
l’eau jusqu’aux cuisses.
Le cycliste Simonnet de
la 23ème qui était cuisinier et qui est remplacé par Charon de la 21ème a ses souliers de repos et, pour la 1ère
fois qu’il monte aux tranchées, il me fait vraiment pitié.
N’ayant pas de clous, il ne peut se tenir debout et s’allonge plusieurs
fois dans la boue. Pour comble de malheur, il fait une nuit très obscure, et de
temps à autre l’un de nous met un pied dans un puisard.
Enfin nous arrivons à la tranchée des Pylônes où est le P.C. du
chef de bataillon. Nous couchons à 3 dans un petit coin de l’entrée où nous ne pouvons
même pas nous allonger.
Je prends les mesures : notre chambre à coucher a exactement 1 mètre 40
de long sur 1 mètre 20 de large, et encore toutes nos affaires, armes et
équipements, sont dedans.
Le vendredi 24 septembre
En nous levant, nous constatons dans quel état lamentable nous sommes. Tout mouillés et couverts de boue. Je n’ai cependant, pour ma part, pas eu trop froid, durant les quelques heures où nous avons pu nous reposer, et j’ai dormi un peu.
Je me demande comment nous pouvons résister à ce régime. Et nous ne pouvons même pas changer de linge et d’effets. Ce serait d’ailleurs complètement inutile ; il y a tellement de boue dans les boyaux qu’à la 1ère sortie on serait mouillé et crotté de même. Toute la journée, le bombardement est continu et violent.
Il y a de quoi devenir fou.
Nous n’avons malgré tout pas beaucoup de pertes.
Le samedi 25 septembre
C’est le jour fixé pour l’attaque.
Le 5ème bataillon doit partir en avant à 12 heures. Un peu avant cette heure, nous nous portons à la parallèle de départ, le colonel et le commandant CHALET en tête, puis la liaison et le 6ème bataillon qui, dès le départ du 5ème bataillon, doit prendre sa place et le soutenir.
À ce moment, toutes les batteries françaises et boches doivent tirer à la fois. C’est un fracas épouvantable et la fumée âcre nous prend à la gorge.
L’ennemi fait un tir de
barrage très violent, le boyau que nous prenons est démoli et comblé en
plusieurs endroits ; des morts et des blessés l’encombrent ; on passe
par-dessus ; il faut arriver à tout prix et vite en 1ère ligne, être à la
parallèle de départ au moment fixé.
À un moment donné, dans le fracas et la fumée qui nous entoure, il me semble, le temps d’un éclair, voir arriver un objet sur ma tête, que je baisse instinctivement.
Au même instant, je reçois un choc violent, comme un coup de massue, sur mon casque qui me fait l’impression de rentrer dans ma tête, et le coup m’assoit presque par terre. Je pousse un cri sourd, comme le « han » des travailleurs qui font un effort, et reprenant aussitôt mes sens, je continue ma route.
Mon casque a été crevé (*) et je n’ai qu’une toute petite égratignure. Mais il était temps ! Ce doit être une simple illusion qui m’a fait voir l’éclat d’obus alors qu’il venait me frapper, et c’est probablement seulement le choc qui m’a fait baisser la tête. J’ai cependant bien eu l’impression que si je n’avais pas baissé la tête en avant, il venait me frapper en pleine figure. Quelles émotions se succèdent en quelques instants !
Enfin nous arrivons à la
parallèle de départ. En attendant le départ de la 1ère vague d’assaut, les
compagnies du 6ème se rangent dans les boyaux et dans une parallèle un peu en
arrière de la 1ère, la parallèle Billard. C’est là qu’est la 21ème.
Pour aller communiquer, je suis obligé de passer sur le dos des poilus de toute une compagnie qui sont dans le boyau très étroit en cet endroit. En face de nous, de l’autre côté du ravin de Souchez, sur la pente qui monte à La Folie, c’est un chaos indescriptible. Les tranchées allemandes doivent être complètement bouleversées et le bombardement continue, toujours aussi intense.
Nous nous faisons le plus
petit possible contre la paroi du boyau.
Mais le moment de l’attaque est arrivé. Nous devions suivre le mouvement du 246ème à notre gauche et du 289ème à notre droite, mais ces 2 régiments n’avancent pas facilement. Les compagnies du 5ème bataillon se font hacher par les mitrailleuses boches placées sur la pente descendante du ravin de Souchez, là où les lignes ennemies font un saillant où notre artillerie ne peut les atteindre.
Les hommes ne peuvent parvenir jusqu’aux tranchées allemandes ; ils tombent par tas dès qu’ils franchissent le parapet. L’action est arrêtée, mais le bombardement continue.
Le soir, nous revenons à la tranchée de soutien aux Pylônes.
La 21ème compagnie a perdu, par le bombardement dans la parallèle Billard : 11 tués et 37 blessés. Beaucoup avaient été d’ailleurs chercher un refuge, car ce coin était vraiment intenable, et si tous les hommes étaient restés à leur poste, il y aurait eu davantage de pertes pour rien.
(*) : Heureusement que le casque a remplacé le képi mi-août
de la même année !
Au cours de la journée, le régiment déclare 93 hommes tués, 191
blessés, 15 disparus.
Le dimanche 26 septembre
Le commandement a dû se rendre compte qu’il est impossible de progresser en avant de nous tant que la gauche ne se sera pas avancée.
Sur notre droite, nous sommes accrochés aux pentes qui conduisent à La Folie. L’attaque doit avoir lieu aujourd’hui à la même heure qu’hier, 12 heures.
Le 204 ne doit sortir que quand la gauche sera avancée et sur ordre. Nous nous portons au même point que la veille, mais les compagnies ne sont pas aussi pressées, et l’une d’elles reste dans les abris de la tranchée des Pylônes où le colonel a aussi son P.C.
Un terrible bombardement a
lieu avant l’heure fixée, mais l’attaque ne donne aucun résultat. Nous restons
sur nos positions, et à 5 heures du soir même attaque et même résultat négatif.
Et le bombardement continue, toujours aussi intensif. C’est épouvantable. Nous passons la nuit dans la boue et sous la pluie. Les hommes sont exténués et abrutis ; ils dorment assis dans la boue, le dos à la paroi de la tranchée, tandis que l’eau ne cesse de leur tomber dessus.
Nous trouvons un trou à côté du P.C. du
commandant où nous nous entassons à 6 les uns sur les autres ; nous mangeons du
« singe » qui nous semble bon, et nous trouvons même le moyen de dormir,
entassés comme nous le sommes.
Notre trou est juste de la taille d’une niche à chien.
Au cours de la journée, le régiment déclare 5 hommes tués, 12
blessés.
Le lundi 27 septembre
À midi, l’attaque est reprise sur notre gauche par la 77ème division, du côté de Souchez. Nous voyons les hommes monter l’arme à la bretelle le long des pentes de la cote 119 et, tout près de la crête, ils sautent dans une tranchée qui court le long du sommet.
Le commandant CHALET fait dire qu’en dépit des consignes reçues l’on se tienne prêt à se porter en avant, au cas où les chasseurs qui sont entre nous et la 77ème division avanceraient.
Mais ils n’arrivent pas à
gagner du terrain. Nous sommes tous au-dessus du parapet pour regarder la
progression de l’attaque. L’artillerie ennemie ralentit son bombardement de
notre côté. Tout son feu se concentre sur les 2èmes lignes pour empêcher
l’avance des réserves.
En face de nous, les crêtes paraissent évacuées par l’ennemi, mais au-dessous de nous, où l’artillerie ne peut les atteindre, les Allemands sont toujours terrés. Ils tirent même des coups de fusil sur les nôtres qui continuent de grimper le long de la cote 119.
À un moment donné, nous
apercevons des hommes qui se faufilent dans le boyau international pour
remonter la crête en face de nous. Nous sautons aussitôt sur nos fusils et
tirons dans le boyau. Tout mouvement disparaît bientôt.
La pluie a cessé ; nous espérons que le beau temps va enfin continuer.
Le soir, nous sommes relevés par le 231ème.
Nous allons à la route de Béthune. La pluie a recommencé et nous pataugeons. Les fourriers partent un peu en avant pour loger la compagnie dans les abris qui sont aménagés sous la route de Béthune.
Au moment où nous allons partir, nous communiquons une note disant qu’il faut garder le contact avec l’ennemi qui doit se replier sur d’autres positions.
A la route de Béthune,
nous trouvons la plus grande partie des abris occupés par d’autres troupes,
mitrailleurs, crapouillots, dragons, etc., et quand ma compagnie arrive, j’ai
toutes les peines du monde pour la loger.
Cela provoque du désordre ; il faut tempêter, expulser presque de force les hommes qui avaient pris possession des abris sans ordre. Puis les corvées de soupe des bataillons de 1ère ligne passent dans le boyau à ce même moment, ce qui provoque un embouteillage et des altercations.
Enfin, vers une heure du matin, toute la compagnie est placée dans les
abris. J’ai même placé une section un peu à l’écart, sans aucun ordre ; tant
pis.
Je suis trempé et couvert de boue, car l’eau n’a pas cessé de tomber durant tout ce temps. Je vais me coucher dans notre abri qui est rempli d’ordures de toutes sortes : boîtes de conserve vides, morceaux de pain, boue, paille à moitié pourrie, un vrai fumier.
Ce qu’il doit y en avoir des poux là-dedans !
Enfin, nous n’avons pas le choix et au moins nous sommes à l’abri.
Le mardi 28 septembre
Je me réveille vers les 6 heures ½, après avoir passé une nuit affreuse. Je suis transi de froid.
La pluie a cessé et un soleil timide se montre.
Vers les 8 heures, nous apercevons de la route où nous sommes
montés la poussée des nôtres qui continuent à progresser et qui ont élargi leur
action. Un grand nombre d’hommes, dont beaucoup d’artilleurs et de
territoriaux, sont montés sur le terrain pour regarder.
Mais bientôt les boches nous envoient des grosses marmites, et dès le premier sifflement tout le monde disparaît dans les boyaux et les abris.
Vers midi, le général Schmitz
qui commande la brigade monte au talus des zouaves, exactement à 200
mètres d’où nous nous trouvions la veille, mais dans le fond du ravin. L’ennemi
a donc enfin lâché pied sous la menace de l’encerclement.
Il a opéré son repli à la faveur de la nuit.
Peu après, tout notre
bataillon suit par le boyau 123. La pluie recommence à tomber.
Quel temps détestable ! Après avoir traversé notre 1ère ligne à l’endroit où nous étions la veille, nous descendons le ravin aussi vite que possible dans le boyau à peine ébauché, le prolongement du 123.
L’artillerie ennemie bat maintenant sans discontinuer cette pente du ravin et, avec leurs obusiers, ils tâchent d’atteindre le fond même de la dépression de terrain.
Nous arrivons cependant sans encombre sur l’autre pente, appelée le talus
des zouaves, où nous sommes relativement en sécurité et où les hommes
s’occupent aussitôt à se creuser des trous.
Fait extraordinaire : il n’y a aucun blessé au bataillon durant ce
trajet périlleux. Mais dans l’ébauche de boyau, nous avons trouvé un homme
coupé net en deux à la hauteur de la poitrine. Je n’ai vu que le haut du corps
sanguinolent ; le reste, où est-il ? Il est probable que ces débris, comme tant
d’autres, ont été enterrés dans la terre et la boue du boyau en passant
par-dessus.
Quelques morts et blessés barraient la route et nous sommes obligés de
les ranger pour pouvoir continuer. Mais nous ne pouvons nous attarder, car tout
le bataillon est derrière nous et il serait criminel de faire attendre les
hommes dans cette dangereuse position.
Sur le terrain, dans l’herbe, nous voyons aussi de nombreux cadavres de
ces jours derniers. En certains endroits où ils ont été fauchés par les
mitrailleuses, ils sont les uns sur les autres. Un grand nombre de squelettes,
de corps décomposés, jonchent également la terre. Ceux-ci dorment leur dernier
sommeil depuis le mois de mai où a eu lieu la première offensive.
À ce moment, certaines unités avaient poussé très loin en avant, jusque
près de Givenchy, mais les canons de Lorette qui n’étaient pas
éteints les avaient décimés et forcés à se replier.
Nous les identifions par des lambeaux de vêtements ; il y a des zouaves, des Marocains de l’infanterie et des boches : un petit tas d’ossements, de poussière noirâtre autour duquel l’herbe a poussé plus dure, c’est tout ce qui reste de ce qui fut un homme.
Je m’étonne même de ce que les Allemands, dont le service sanitaire est, dit-on, bien organisé, n’aient pas depuis ce moment ramassé leurs propres morts, et cela dans leurs lignes. Quoiqu’il en soit, je ressens une certaine satisfaction d’être en cet endroit après être resté de si longs jours au haut du talus sans pouvoir progresser.
2 compagnies de mon bataillon
sont à la disposition du 231ème qui est légèrement en avant et elles prennent
la position qui leur est assignée. Des boyaux de communication sont établis
sans retard.
La fusillade est incessante et le bombardement continue. Des prisonniers allemands sont emmenés à l’arrière et deux d’entre eux emportent une mitrailleuse que nous avons prise. Comme ils se reposaient un peu dans le bas du talus non loin de nous, ils tirent leur quart de leur poche et, dévissant leur mitrailleuse, ils se désaltèrent avec l’eau qu’elle contenait, ce qui étonne les hommes des compagnies qui les regardent faire.
A la nuit, nous remontons avec le commandant et les 2 compagnies
disponibles dans notre ancienne tranchée de 1ère ligne où nous passons la nuit.
La pluie a repris et n’arrête plus. Nous sommes heureux de retrouver notre trou
qui est toujours intact. Bien que nous soyons entassés, je suis gelé de froid
et tous mes effets sont trempés.
Le mercredi 29 septembre
Nous redescendons, toujours
sous la pluie, à 4 heures du matin. Le bataillon
renforce et soutient le 231ème. Nous montons à mi-pente où se trouve le colonel
du 231ème. 2 compagnies restent auprès de nous, tandis que les 2 autres
comblent les vides entre les unités. Le terrain où nous sommes est tout
bouleversé par les obus ; c’est un véritable chaos.
Il semble qu’une panique se produise
dans le 231 (*)
; la position est dure à tenir ; de nombreux blessés descendent de la ligne de
combat ; le colonel les examine tous, car beaucoup veulent se faire passer pour
blessés afin de s’éloigner un peu de l’enfer. Les tués sont aussi en grand
nombre.
La
liaison est mal assurée avec l’artillerie, et le 75 nous tire dessus, en dépit
des fusées qui sont lancées en vain.
Un
peu à droite, le 282 se laisse prendre un angle de tranchée et 2 mitrailleuses
; il y a des prisonniers. Il y a un certain désordre inévitable en de pareils
moments.
Et
la pluie tombe toujours ; on ne peut plus s’arracher de la boue ; nous sommes
dans un état lamentable.
Vers le soir, nous apprenons que le 231ème et le 282ème, qui ont
eu de lourdes pertes, seront relevés et que le bataillon prendra le secteur
depuis le boyau international, « la tranchée nouvelle » et le boyau 97, ce qui
forme un angle rentrant dans nos lignes. En allant communiquer à sa compagnie,
le fourrier Cachon (**) est
blessé par une balle de mitrailleuse qui le traverse au-dessous de l’omoplate.
Et c’est par une mitrailleuse à nous, c’est-à-dire une de celles que les boches
ont prises au 282 et qu’ils ont retournée sur le même emplacement qui est
presque sur la crête et qui commande une bonne partie du terrain.
En raison du bombardement et des difficultés d’établir la ligne, ce n’est qu’au jour que les dernières unités du 231ème peuvent partir. En certains endroits, le 231 était mélangé avec le 282 et en d’autres, sur d’assez longues distances, il n’y avait personne, le terrain étant absolument retourné par les obus.
Au cours de la journée, le régiment déclare 7 hommes tués et 19
blessés, 2 disparus.
(*) : Ce n’est pas signalé dans le JMO du 231e RI
(**) : CACHON Henri, sergent-fourrier
Le jeudi 30 septembre
Un peu d’ordre renaît et la position s’organise. En allant communiquer à la 24ème compagnie, Filhol (*) est blessé d’une balle de notre mitrailleuse, dans les mêmes conditions que Cachon.
Il a le bras traversé à hauteur de l’épaule et le major nous dit que sa blessure, sans mettre ses jours en danger, est sérieuse. Il est probable que son bras restera ankylosé. Comme il était parti depuis un peu de temps, nous avons entendu le tacatac de la mitrailleuse et nous avons eu le pressentiment que c’était pour lui. Il revient jusque vers nous, puis il se trouve mal et on l’emporte sur un brancard.
Le mauvais temps continue,
nous sommes trempés et n’avons rien à manger ni à boire. Voilà notre régime :
faim, soif, froid et … pruneaux que nous envoient les boches.
On a découvert, dans le saillant du ravin où étaient installés les Allemands et qui est maintenant derrière nous et légèrement à gauche, un grand nombre de grenades allemandes. Des corvées vont les chercher, en montent sur la ligne de feu et en font un dépôt vers nous. Nous n’en manquerons pas.
Nous avons pris de la sorte une grande quantité de matériel. Le poste de secours est installé dans des anciennes guitounes allemandes du fond du ravin et que notre artillerie n’avait pas démolies.
Je vais dans l’après-midi faire un tour en portant un ordre.
Les abris des Allemands sont très bas et tout petits. Ils sont peut-être solides, mais peu pratiques. 2 prisonniers sont encore trouvés dans l’un d’eux. Ils sont mourants de faim.
Je me rends compte maintenant de la position qu’ils occupaient et ne m’étonne plus que l’attaque n’ait pas pu déboucher. Les tranchées de ce saillant sont absolument intactes sur la pente du ravin, et au-dessus d’eux ils avaient un champ de tir magnifique.
Par contre, le parapet de nos tranchées forme un mur à pic, et bien entendu tous ceux qui dégringolaient cette pente rapide étaient fauchés par les mitrailleuses et le feu de l’infanterie et le lancement des grenades. Les blessés n’avaient même pas la ressource de remonter pour réintégrer leur tranchée. Les parapets sont formés d’un grand nombre de sacs de terre empilés les uns sur les autres ; les boyaux sont très étroits ; les postes de guetteur ont l’air particulièrement bien aménagés. Un stock de grenades est dans une petite cavité à portée de la main.
Des cadavres sont un peu partout, souvent à moitié enterrés ; dans le bas du boyau international, ils sont entassés les uns sur les autres et forment le parapet de la tranchée. Certains sont déjà décomposés et doivent être là depuis longtemps.
Un fait encore plus pénible que cette horrible vision me frappe : c’est que beaucoup d’hommes et même des officiers visitent les cadavres et les détroussent, et je suis effrayé de voir un grand nombre de porte-monnaie gisant béants sur le terrain. Un homme de la 23ème compagnie est même blessé par une balle en allant ainsi sur le terrain détrousser les cadavres ; il n’a que ce qu’il mérite.
À quel sentiment de cupidité obéissent donc tous ces hommes qui osent profaner ainsi et en un tel moment les corps de ceux qui sont restés sur le champ de bataille ? Ce ne peut être que par inconscience. Peut-être même, tombant à leur tour, n’auront-ils pas le temps de profiter de ce qu’ils dérobent à la mort, et beaucoup accaparent des objets qui ne leur sont d’aucune utilité et qui étaient peut-être des souvenirs de ceux qui sont là couchés et dont les familles trouveraient une consolation en recevant ces objets qui leur rappelleraient un être cher disparu.
Après la mêlée, tous ces cadavres qui jonchent le terrain seront relevés et identifiés et un inventaire de ce qu’ils ont sur eux sera dressé et le tout renvoyé aux familles.
Combien auront le droit de s’étonner du faible montant de cet inventaire ?
Vers les 8 heures du soir, le bombardement reprend avec un
redoublement de violence.
De grosses marmites tombent sans arrêt dans le fond du ravin, tandis que les 1ères lignes sont canonnées par les 77 et 105. Une attaque allemande se déclenche, mais elle est facilement enrayée par notre feu.
La nuit qui est arrivée est sillonnée par les fusées lumineuses et
les fusées-signaux, ainsi que par les éclairs des départs et des éclatements.
Des phares font de larges trouées de lumière en certains endroits et laissent
ensuite la nuit plus obscure.
(*) : FILHOL Kégulus
Au cours de la journée, le régiment déclare 9 hommes tués et 29
blessés.
Extrait du JMO du régiment à la date du 30
septembre :
« L’état sanitaire
quoique satisfaisant, ne pourra se maintenir, les hommes n’ayant pas pu prendre
depuis le 24 aucun aliment chaud, ce ne sont plus que des paquets de boue (…)
Dans la plupart des tranchées et boyaux, les hommes ne peuvent se tenir que debout
ou accroupi, ce qui est surtout la cause de la grande fatigue. »
Octobre : Artois
1e octobre
Le vendredi 1er octobre, avant le jour, le 239ème qui est sur notre droite en angle attaque ; le 5ème bataillon suit son mouvement et notre ligne est rectifiée ; les 2 mitrailleuses perdues par le 282 sont reprises sur leur même emplacement ; l’une d’elles était bel et bien braquée sur le boyau international, comme nous le pensions. Quelques prisonniers qui n’avaient pas encore été envoyés à l’arrière sont délivrés, des blessés, et l’on raconte que les Allemands, en se sauvant, ont tué ceux qu’ils ont pu et que des scènes de sauvagerie se sont produites.
Une portion du 239ème fait une
grave erreur de direction, s’engage entre les 2 lignes et va se briser à notre
gauche sur la tranchée des Walkyries. (*)
Dans l’obscurité, et les hommes n’étant pas prévenus de l’attaque qui devait se produire, les nôtres ne les reconnaissent pas et ils sont ainsi pris entre deux feux.
Mais le jour arrive et dès lors on s’aperçoit de la fatale méprise
; les hommes du 239 qui, se voyant canardés des 2 côtés, s’étaient blottis dans
des trous d’obus, rentrent comme ils peuvent dans nos lignes.
À 11 heures, la 1ère ligne du 289ème sur notre gauche est
violemment bombardée. Nos batteries répondent aussitôt avec efficacité.
Il fait un peu de soleil, mais le vent est froid. Tous les hommes sont exténués. On trouve encore quelques prisonniers qui étaient dans des abris à moitié éboulés ou blottis dans des trous. Ils n’ont rien mangé depuis plusieurs jours et ne payent pas de mine.
Je cause avec l’un d’eux, un grand jeune homme, et je peux comprendre qu’il revient avec son régiment, le 4ème de la Garde, de Russie. Ils sont arrivés il y a une quinzaine de jours. Il faisait partie de la « Landsturm ».
Au cours de la journée, le régiment déclare 12 hommes tués et 19
blessés.
(*) : Voir la carte de cette tranchée >>> ici
<<<
Le samedi 2 octobre
Nous recevons l’ordre de nous porter sur la droite, dans le boyau de Kiel et la tranchée de Hambourg ; le 289ème prend notre place et ainsi de suite ; nous sommes alors sur le saillant qui nous dominait quand nous étions de l’autre côté du ravin.
Notre artillerie a tout bouleversé ; les abris sont tous effondrés, les boyaux et tranchées sont comblés et les réseaux de fil de fer des ennemis sont complètement détruits. Quel chaos ! Les trous d’obus, les uns sur les autres, forment des cratères, et la terre est toute calcinée.
Tout le plateau est jonché de cadavres, des Français et des Allemands. Beaucoup sont ensevelis dans les abris et dans le fond de la tranchée, et quand l’on veut creuser pour faire des guitounes ou réparer la tranchée, on est arrêté par ces corps. Du matériel de toute sorte traîne partout où est enterré : sacs, fusils, baïonnettes, gamelles de toutes formes, des munitions, etc.
Quelle triste vision !
Il fait assez beau temps et de
suite on commence à faire des travaux pour organiser la position. Mais nous
sommes en vue des boches ; et des « saucisses » ennemies, juste en face de
nous, nous regardent. Il est même étonnant que la relève ait pu se faire en
plein jour sans anicroche.
Mais nous ne perdons rien pour attendre, et les obus ne tardent pas à arriver. Notre position a l’air bien repérée.
Vers midi, nous recevons l’ordre de relève, et nous devons aller
cantonner à Villers-au-Bois. Les fourriers, nous partons en avant pour
faire le cantonnement. Nous évitons les boyaux qui sont remplis d’eau et de
boue et dans lesquels on s’enlise, et nous passons à travers champs.
Nous ne recevons pas un coup de canon.
Au Talus des Zouaves, en passant où il y avait quelques tombes, je cherche si je ne trouve pas celle de Leau, mais sans succès.
Par la suite, nous apprenons que peu après notre départ un violent bombardement s’est déclenché sur nos positions. Le Lieutenant PRot (*) de la 23ème compagnie, qui par bravade ou peut-être même pour cacher sa peur se montrait sur le parapet de la tranchée, est blessé par un obus.
À 8 heures du soir, alors que nous avions fait le cantonnement,
nous apprenons vaguement que le régiment doit aller à Mingoval. Nous
décidons de casser la croûte d’abord et nous partons ensuite. Nous grimpons
tous les 5 sur le fourgon du bataillon que Larcher
remmène à Mingoval.
Nous nous casons comme nous pouvons, qui sur le siège, qui sur la bâche du fourgon. Cette dernière position n’a bien sûr rien de bien agréable, car la papote du fourgon est formée de cerceaux, le toit est donc en demi-cercle et il n’y a aucune aspérité pour s’accrocher.
Gare aux chocs ! Mais bath !
Si nous dégringolons, nous le verrons bien, et ce sera peut-être l’évacuation.
En passant à Camblain-l’Abbé, nous demandons des renseignements, et sur des indications précises cette fois, nous repartons dans le même équipage pour Mingoval.
A l’heure où nous y arrivons, 11 heures du soir, tous les habitants
sont couchés ; nous les réveillons pour faire le cantonnement ; nous sommes reçus
comme des chiens dans un jeu de quilles, et avons toutes les peines du monde
pour faire un cantonnement tout au moins provisoire.
Les compagnies arrivent dans la nuit et se placent tant bien que mal. Je couche dans une écurie, près d’un veau, et je dors bien durant quelques heures.
Au cours de la journée, le régiment déclare 6 hommes tués et 24
blessés.
(*) : Le sous-lieutenant PROT Henri est officier à la 23e
compagnie.
Le dimanche 3 octobre
Le dimanche 3 octobre, de bon matin, je
me mets à la recherche d’un supplément de cantonnement pour ma compagnie qui
est trop à l’étroit.
Le lundi 4 octobre
Le mauvais temps continue ; quel cauchemar que cette pluie !
On nous distribue des effets.
Mercredi 6 octobre
Le mercredi 6 octobre, à midi, l’ordre arrive de partir immédiatement pour la relève : 5ème bataillon, en 2ème ligne, part le 1er ; 6ème bataillon, en 1ère ligne, départ 1 heure 30.
Nous avons encore du vin à distribuer, les jours en retard que le ravitaillement ne nous avait pas amenés. Chacun se débrouille pour en emporter le plus possible ; on boit le reste pour qu’il n’y en ait pas de perdu ; c’est pour les jours où nous ne pouvions pas en avoir et c’est aussi pour les jours à venir où nous mourrons de soif dans les tranchées.
Nous suivons avec la liaison
le commandant CHALET qui n’est pas content d’apprendre que son P.C. est à la tranchée
d’Odin avec la compagnie de réserve. Nous attendons les compagnies au boyau
international.
Durant ce temps, nous nous mettons à manger sur le parapet, car dans le boyau, c’est un va-et-vient continuel ; corvées, coureurs, etc.
Sur la gauche, un véritable feu d’artifice se déclenche : fusées de toutes couleurs et de toutes formes, étoiles, chenilles, en pluie, etc. auxquelles viennent bientôt se mêler des éclatements de shrapnels et de percutants. L’action ne vient pas jusqu’à nous, et notre coin reste calme.
Les compagnies arrivent et nous les emmenons sur leurs emplacements respectifs.
Le reste de la nuit où nous essayons de nous reposer, nous sommes
gelés de froid après avoir été trempés de sueur toute la soirée.
Le jeudi 7 octobre
J’explore le terrain dans notre secteur. Quelle sinistre vision !
La raison se refuse à envisager un tel chaos !
Le vendredi 8 octobre
L’artillerie française nous tire dessus. Les 90 prennent la tranchée où se trouve la 21ème compagnie dans le bas et la remontent, un obus tombant tous les 20 ou 30 mètres, et toujours en plein dedans. Les hommes sont démoralisés ; à chaque instant, on en envoie au commandant dire qu’il fasse arrêter le tir. Le commandant, qui est pendu au téléphone, criant que si l’artillerie n’arrête pas immédiatement le tir il fait évacuer la tranchée, se retourne vers celui qui arrive (notamment pour Schaller) et « l’engueule » en lui disant qu’il doit rester à son poste de combat.
Quelques hommes sont contusionnés. Le temps
est meilleur.
On fait des travaux de sape dans la direction du chemin creux.
Le soir, nous entendons un violent bombardement sur notre gauche,
dans la direction de Bully-Grenay.
Dans la nuit, les petits postes de la 21ème protégeant les hommes
du génie qui travaillent aux sapes ont surpris des patrouilleurs allemands et
ont blessé l’un d’eux qui est resté sur le terrain à environ 40 mètres de notre
tête de sape.
Au jour, on s’aperçoit qu’un ruban blanc a été posé en avant de
notre ligne et parallèlement au chemin creux. Le caporal Thierry va en rampant jusqu’au blessé
allemand et rapporte son fusil et ses papiers : rien d’intéressant. On ira le
chercher à la nuit.
Mais des difficultés surgissent : fusées, grenades, fusillade, léger affolement. L’expédition rate ; elle est remise au lendemain à la pointe du jour.
Le samedi 9 octobre
Le blessé est ramené dans nos lignes, mais le sergent Schaller, Alsacien d’origine E.V.G. disparaît au cours de l’expédition. Un mystère plane et l’on parle déjà de trahison.
Un brouillard intense et froid enveloppe le champ de bataille.
(*) : D’après le JMO, le sergent SHILLER Martin se serait perdu dans le brouillard, et aurai
certainement été fait prisonnier.
Le dimanche 10 octobre
Nomination du Lieutenant Jouannais ; nous devons être relevés le soir ; nous recevons l’ordre de partir, les fourriers à 1 heure de l’après-midi pour faire le cantonnement à Villers-au-Bois.
Le soir à la nuit, le sergent Schaller revient ; il explique qu’il
s’est trouvé désorienté dans le brouillard, a entendu parler allemand en
croyant arriver aux tranchées françaises, qu’il a rebroussé chemin, puis
finalement, le brouillard s’étant levé, il s’est trouvé entre les lignes, mais
près d’une voiture abandonnée sur la route qui se trouve à environ 7 ou 800
mètres de notre emplacement sur notre droite. Il s’est tapi dans un trou d’obus
où il a passé la journée.
A la nuit, il s’est approché avec précaution de nos lignes en tâchant de se repérer ; à quelques mètres, il s’est levé d’un bond et a sauté dans la tranchée en criant : « Ne tirez pas ! ». (*)
Les hommes du 289 qui tenaient
le secteur où il revint dans la tranchée commençaient à être pris de panique et
se sauvaient déjà. Ils furent vite remis de leur terreur quand ils s’aperçurent
que ce n’était pas ce qu’ils croyaient être une attaque allemande. Un violent bombardement s’était
déclenché sur nos tranchées.
Au cours de la journée, le régiment déclare 7 hommes tués et 20
blessés.
(*) : Le JMO stipule :
Le sergent SCHALLER de la 21e
compagnie, que l’on croyait disparu, rentre dans nos lignes (…), il a passé la
journée blotti dans un trou d’obus, épié par l’ennemi qui tirait sur lui à
chaque mouvement. Rentré dans nos lignes à la faveur du brouillard, et
rapportant des renseignements utiles, il est tué 2 heures après, avec le
caporal-fourrier Willaume, par un
obus qui blesse encore 2 hommes. »
SCHALLER Martin François
Xavier, (alias SEGUIN),
sergent, mort pour la France à Souchez le 10 octobre 1915, tué à l’ennemi. Il
était né à Riedisheim (Alsace) le 6 février 1878. Il est inhumé au cimetière
militaire de la Targette, à Neuville-Saint-Vaast (62), tombe 2663
WILLAUME Henri Louis, caporal-fourrier, mort pour la France
à Souchez le 10 octobre 1915, tué à l’ennemi. Il était né à Paris le 14 avril
1884. Pas de sépulture miliaire connue.
Le lundi 11 octobre
Nous subissons un intense bombardement suivi d’une attaque. Toutes les unités sont alertées. Les officiers sont de planton au téléphone.
Dans la nuit, des marmites tombent sur Villers-au-Bois.
Le mardi 12 octobre
Beau temps ; nous sommes « désalertés » dans la journée. L’attaque a été à peu près ratée et n’a pas été menée à fond. Je souffre de mon épaule et de partout, même étant couché.
Le mercredi 13 et les jours suivants
Nous menons la vie de cantonnement et repos jusqu’à la relève.
Le lundi 18 octobre
Nous allons relever le 276ème aux anciennes tranchées de 1ère ligne. Je reste aux 31 abris pour la distribution de vin. Riboux dit aller à Chelers avec le T.C. Nous nous installons comme nous pouvons.
Je couche avec Charron.
Le mardi 19 octobre
J’assure la distribution du vin. Je prends un aperçu de la vie à l’arrière des lignes, ce qui m’inspire un profond dégoût.
Riboux vient manger avec nous, les chevaux des officiers sont restés à Villers-au-Bois. Je m’apprête à remonter en ligne, ma mission étant terminée.
Le mercredi 20 octobre
Je remonte à la route de Béthune avec les hommes de soupe.
Polbeau est descendu pour je ne sais quelle mission. Je trouve la liaison installée luxueusement à l’ancien emplacement de l’E. M. du général.
Le jeudi 21 octobre
Le temps est toujours brumeux et le soir il tombe une petite pluie fine qui ramène aussitôt la boue dans les boyaux. J’ai travaillé dans la journée à une bague que je destine à Madeleine. Ces petits travaux fixent la pensée et l’esprit n’est pas torturé par notre propre situation.
Le vendredi 22 octobre
Le temps s’est éclairci et il fait un froid sec.
Nous relevons le 289ème qui prend notre place. Le 5ème bataillon est en 1ère ligne, le 6ème en 2ème position (tranchée d’Odin, Nietzsche et Krupp). Adieu le confort du P.C. du général !
Étant resté à Béthune pour attendre le commandant du 289, j’arrive seul après les autres et il faut que je me fasse une place. Nous logeons dans les anciens trous boches où il faut faire le serpent pour entrer, car ils ont été assez malmenés.
Le samedi 23 octobre
Le beau temps est revenu. La journée est assez calme, mais néanmoins il y a 5 tués à la 23ème compagnie par un seul obus. Je travaille aux porte-plume dans les moments d’oisiveté.
(*) : Au cours de la journée, le régiment déclare 5 hommes
tués et 5 blessés.
BENOIT Georges, SAUMON Rémi, LHERAULT Paul, GAZEAU Alfred, HIVET
Pierre, tous tués par un seul obus dans la tranchée d’Odin.
Le lundi 25 octobre
Nous partons avant le régiment pour Chelers où nous faisons le cantonnement.
Le mardi 26 octobre
Le régiment arrive à 2 heures ¼. Il fait froid.
Le colonel loge au château.
Le mercredi 27
Il fait un temps de chien ; pluie et boue.
Le samedi 30 octobre
Grand branle-bas : le colonel Monroe
passe le régiment en revue. Puis c’est la parade d’exécution d’un pauvre type ;
grand spectacle pour frapper les esprits. Tout cela est bien pauvre.
Puis c’est la vie du cantonnement, sans but précis.
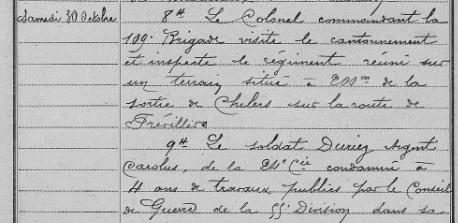
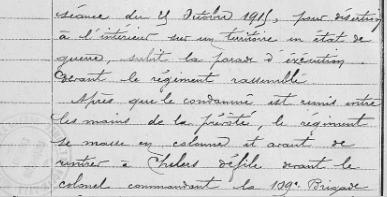
Fin 1915 : Artois, les tranchées, la boue
Le mercredi 3 novembre
Nous embarquons en auto et démarrons à 3 heures de l’après-midi.
Nous allons à Villers et suivons la route de Saint-Pol à Arras
jusqu’à Acq et nous arrivons au Pendu.
Les fourriers partent en avant pour faire le cantonnement. Les
compagnies arrivent 10 minutes après nous, et nous avons une altercation avec
le commandant CHALET qui aurait voulu trouver le cantonnement préparé. Les
compagnies étant parties immédiatement après nous, il nous aurait fallu des
ailes pour effectuer le trajet et nous assurer le temps matériel de faire le
travail.
Rien ne change dans le métier militaire. Si quelque chose ne va pas, la
faute en incombe toujours à l’échelon inférieur qui ne peut rejeter la
responsabilité sur un subordonné.
Les compagnies se logent au petit bonheur.
Le jeudi 4 novembre
Le
commandant CHALET qui veut avoir le dernier mot refait lui-même le cantonnement
en entraînant dans son sillage l’adjudant de bataillon et les 4 fourriers, et
tout se tasse. Des isolés du 276ème descendent des tranchées dans un état
pitoyable.
Le vendredi 5 novembre
Une réunion des officiers a lieu à 9 heures dans la salle de classe.
Les compagnies font une heure d’exercice, histoire de ne pas laisser rouiller
les muscles des hommes et d’assurer la discipline, de reprendre la troupe en
main.
Il fait un temps froid et il y a un fort brouillard qui nous pénètre.
Le dimanche 7 novembre
Notre bataillon relève le bataillon du 282ème R.I. en première ligne à la route de Givenchy. Il n’est pas tombé de pluie depuis 4 jours et cependant les tranchées sont dans un état effroyable, un homme du 282ème est resté enlisé de 7 heures du soir à 6 heures du matin.
Le poste du commandant se trouve à droite du boyau de Kiel en arrière des compagnies. Heureusement, c’est le calme complet.
Le lundi 8 novembre
Nous pouvons nous adonner à la confection des bagues dans notre guitoune. Nous apprenons que la Serbie a remporté une victoire.
Quel intérêt cela peut-il avoir ? Victoire ! Défaite ! Pour nous, c’est toujours la vie infernale.
Le mardi 9
Il fait un vent froid ; nous essuyons quelques coups de canon qui ne cassent rien.
La pluie se met à tomber ; c’est ce qu’il y a de pire pour nous, et toute la nuit nous sommes inondés.
Mercredi 10 novembre
Le mercredi 10 novembre, l’affreuse pluie froide continue. Les tranchées et boyaux s’éboulent, croulent sous l’arrosage ; on ne suit pas à les relever ; on s’enlise dans la boue. Nous ne sommes plus que des blocs de terre glaise dégoulinante et sommes transis de froid.
Et nous continuons à vivre !
C’est ce qu’il y a de plus étonnant. Un bruit court, lancé probablement d’un P.C. informé, que les Serbes auraient acquis un succès avec l’appui du corps expéditionnaire français en Serbie. Tout cela nous laisse sceptiques.
Un affreux article de journal
passe dans les tranchées et a le don de mettre en colère tous les poilus qui le
lisent et le commentent.
Il est du 9-11 et est signé Edmond Haraucourt :
« Eux (les poilus) ne
connaissent pas la guerre. Il n’y a qu’à l’arrière qu’on la connaît. »
Vraiment, on ne peut se ficher du monde plus cyniquement.
Le jeudi 11 novembre
L’ordre de la relève arrive pour le soir.
La pluie cesse le matin et le soleil fait son apparition.
Mais l’après-midi, il se remet à pleuvoir et il fait froid. Quelle
vie !
Le commandant du 276ème qui nous relève arrive vers les 9 heures du soir en tête de son bataillon, mais celui-ci s’embourbe et ne peut avancer. Le commandant CHALET, envisageant la situation, nous fait partir (les 4 fourriers) au point de rassemblement désigné pour donner l’ordre aux commandants de compagnie d’emmener leur unité individuellement.
Nous passons sur le terrain,
car il ne faut pas penser prendre le boyau encombré par le 276ème qui y est
enlisé. Je me fais la réflexion que si les types d’en face effectuaient une
attaque à ce moment ils auraient la partie belle, car nous serions dans
l’impossibilité d’esquisser une défense.
Il est vrai qu’ils sont probablement dans les mêmes conditions que nous.
Après maintes péripéties, nous
arrivons à 5 heures 1/2 à la route des Pylônes près de Villers.
Là, nous prenons une voiture qui nous amène jusqu’à Tincques. Nous voici à destination. Quand nous arrivons à Chelers, nous trouvons déjà des isolés qui sont arrivés (comment ? et par quel sens intuitif ?).
Dans quel état nous sommes ! On se demande comment l’on peut supporter tout cela. C’est inimaginable !
Je jette tous mes effets dans l’eau et les laisse à tremper et dégorger la boue. Heureusement que j’ai trouvé de quoi me changer. Les compagnies n’arrivant que dans l’après-midi, on se met en devoir de se nettoyer, ce qui n’est pas une petite affaire.
L’effectif du bataillon rejoint le cantonnement par petits groupes agglutinés au hasard, et il en arrivera encore le lendemain. Et la pluie tombe toujours !
Les jours suivants sont
consacrés au nettoyage et à la mise en état des effets, équipements et armes.
Le lundi 15 novembre
Punition de Poulet.
Le mardi 16
La neige fait son apparition. Exercice pour les gradés.
J’ai la visite de Marius Chabrolle.
Le jeudi 18 novembre
Je vais à Marquay voir Camille Bazin du 17ème chasseurs qui, lui non plus, n’est pas enchanté de la longueur de la guerre.
Le vendredi 19 novembre
Nous quittons Chelers, nous partons à 10 heures 30.
À Villers, je suis pris d’une défaillance et ne peux plus mettre un pied devant l’autre. Tranchée de Béthune.
20 novembre
Le samedi 20 novembre au soir, je me sens un peu mieux. Je ne sais ce qui m’a produit cette dépression.
Ce matin à 6 heures, le 289 a fait sauter un fourneau de mine et
occupé l’entonnoir, ce qui lui a valu une trentaine de blessés, dit-on.
Il a gelé assez fort, temps humide, froid.
Le colonel fait passer une note au sujet d’une lettre anonyme qui lui a été adressée au sujet des nombreuses punitions infligées aux hommes du régiment depuis quelque temps. La lettre contenait un article de « l’Homme enchaîné ».
Le 24 novembre
Nous quittons la tranchée de Béthune à 7 heures du matin. Rien de saillant ne s’est passé au cours de notre séjour.
Nous nous rendons à Chelers. La division est relevée. Vers quel coin, vers quel enfer allons-nous aller ?
Dans quelle fournaise va-t-on nous engager ?
Le 25 novembre
Nous faisons les préparatifs de départ. Les ordres se succèdent.
À minuit, réveil.
26 novembre
Le 26 novembre à 1 heure du matin, nous partons pour Saint-Pol.
Il neige, il pleut, il vente, il fait froid. Escortés de ces éléments contre lesquels il nous faut lutter, nous arrivons à 5 heures à St. Pol où nous embarquons dans le train à midi.
Nous restons donc 7 heures sous la neige et dans le vent et nous sommes transis de froid. Nous passons la journée et la nuit en chemin de fer.
27 novembre
Le 27 novembre à 3 heures du matin, nous arrivons à Fismes où nous débarquons et nous allons cantonner à Courlandon qui est situé à 7 ou 8 kilomètres. Nous nous installons comme pour un long séjour.
Nous allons ensuite à Romigny d’où je pars en permission, puis Châlons-sur-Vesle.
Permission
![]()
Je
désire contacter le propriétaire
Vers d’autres témoignages
de guerre 14/18