Carnets de guerre du sergent-fourrier Alexandre ROBERT
du 204e régiment d’infanterie - Année 1916
Mise
à jour : octobre 2014

Alexandre ROBERT en septembre 1915
![]()
Sommaire
Le sommaire ne fait pas
partie du carnet, il a été rajouté volontairement pour une meilleure navigation
Mars : Marne, Champagne, bois Clausade
Avril-mai : bois des Buttes, bois de la Miette, les exécutions, les tueries
Juillet : Champagne, la conférence d’un ancien prisonnier, Verdun, la côte 304
Août : Cote 304, les bastonnades du commandant CHALET
Septembre : secteur de Verdun, ouvrage de Thiaumont, secteur Margueritte.
Octobre : Verdun, Fleury, Thiaumont, côte du Poivre
Novembre-décembre : même secteur, Jubécourt, le camp des Pommiers.
![]()
Janvier-février : Marne
Le lundi 24 janvier 1916, à Châlons-sur-Vesle, revue à grand spectacle du général Franchet d’Esperey. Remise de décorations avec grand orchestre et étalage rutilant. Puis ensuite travaux divers, vaccinations, etc.
Le 5 février 1916
Le régiment reçoit des félicitations adressées par le général commandant l’armée pour l’exécution des travaux. Notre période de repos va prendre fin. Nous avons passé une période douce et calme qui va prendre fin.
Nous faisons des préparatifs de départ.
Le 9 février 1916
Le bataillon va cantonner à Pévy.
Le 11 février au soir, la compagnie va à Cormicy.
Le 12 février
On nous fait la 3ème piqûre de vaccination anti-typhoïdique.
Le 18
Coopérative.
Le 19 février
La 21ème compagnie revient à Pévy.
Le 20 février
La neige se met à tomber. Les compagnies reçoivent des sabots. On nous fait faire des exercices de signalisation. Et la neige tombe toujours.
Le 24 février
Vu le froid qui règne dans les baraquements, des soldats vont dans les environs se procurer du bois et allument des feux. Alors les punitions tombent.
Le café est additionné d’alcool pour nous réchauffer.
Mars 1916 : Marne, Champagne, bois Clausade
Le 4 mars 1916
Le bataillon va relever le 5ème au Chauffour. Je demeure à Châlons-sur-Vesle avec le T.C. (*) et loge dans une villa tant bien que mal.
(*) : Train de combat : Voir >>>
ici <<<
Le 6 mars
Neige toujours, mais le soleil daigne se montrer dans le courant de la journée. M. Hermet part en permission. Gagon vient me voir.
Le 7 mars
Assez forte gelée.
Un intense bombardement qui dure 4 heures ½ sur le moulin.
Le 8 mars
La neige recommence à tomber à la nuit.
Le 10 mars
Dans la direction de Bercy et Craonne, nous entendons un très fort bombardement qui dure une bonne partie de la journée.
Le soir, départ de permissionnaires, le lieutenant Philippe Vedel et un de la 19ème.
Le 11 mars 1916
Bourgeois part en permission d’un mois. Il est fermier de Perrault-Pradier auquel il paie annuellement 4000 Francs de fermage, est conseiller municipal. Il avait demandé une allocation qui lui avait été refusée et ne cessait de récriminer.
Il neige toujours.
12 mars
Le 12 mars au soir, je vais avec la corvée d’eau rejoindre le bataillon à Chauffour et couche dans le fossé de la route.
Le 13 mars
Je vais reconnaître avec Vermelin l’emplacement de la compagnie.
À 3 heures du soir, des officiers du 75ème territorial viennent reconnaître le secteur. Je vais les conduire et leur donner les explications nécessaires.
Aussitôt revenu, je mange en vitesse et nous partons faire les cantonnements à Châlons-sur-Vesle. Nous devons relever le 292ème suivant un ordre secret le 15 au soir.
Le 14 mars 1916
Il fait un beau temps qui est toujours très apprécié.
Le soir, à 9 heures, nous arrive l’ordre de relever le 289ème dans la nuit-même. Rien de changé aux heures de départ, seulement les commandants de compagnies devront aller le 15 au matin reconnaître le secteur et leurs emplacements.
Le 15 mars
Les commandants de compagnies partent reconnaître le secteur, mais suivant un ordre s’arrêtent à Roucy où ils font les cantonnements de leurs unités. Le bataillon part de Châlons-sur-Vesle à 10 heures ½.
À Venteley, le commandant fait faire la grand’halte. Il nous fait partir (les fourriers) en avant et nous arrivons à Roucy.
Le jeudi 16 mars
Nous attendons des ordres durant une bonne partie de la journée.
Finalement, les commandants de compagnies reçoivent l’ordre d’aller reconnaître le secteur du 289ème. Les fourriers de ce régiment arrivent à Roucy et prennent nos emplacements.
Le bataillon part à 8 heures du soir.
Nous passons par Pontavert, le bois Clausade où se trouve le P.C. du colonel et où viendront les cuisines au cours de la nuit. Une attaque se produit et un petit poste du 289ème est enlevé.
La fusillade est vive, des grenades éclatent de toutes parts et le canon se met de la partie.
Dès son arrivée, une section de la 21ème compagnie est envoyée en renfort et s’engage dans le combat à la grenade qui dure toute la nuit dans la tranchée Victor Emmanuel, au bout de laquelle était le petit poste qui a été enlevé. Notre situation n’est pas brillante et nous sommes maintenant pris de flanc.
Le JMO du régiment signale la perte de 3 hommes tués et 10
blessés.
Le vendredi 17 mars
Le combat a cessé ; les boches nous envoient toujours quelques obus, ils visent surtout le bois Clausade et le bois Marteau. Il fait beau temps et j’en profite pour reconnaître le secteur et me familiariser pour effectuer les liaisons.
Le samedi 18 mars
Le commandement fait exécuter des travaux de défense. Nous changeons de poste.
Le commandant reprend l’ancien abri qui avait été bombardé et délaissé.
Le dimanche 19 mars
Nous sommes bombardés par un tir très précis de 150 sur le P.C. du commandant qui avait déjà bien souffert.
Il fait un temps magnifique et nous devons rester terrés et faire le gros dos à chaque nouvelle arrivée des 150.
Le lundi 20 mars
Le commandant se fait construire un autre P.C. à la lisière du bois de la Mine, le bombardement d’hier ayant complètement démantelé l’ancien abri qui était certainement bien repéré d’après des renseignements précis.
Le mardi 21 mars
Je suis appelé pour accompagner le commandant qui est demandé à 9 heures ½ à la carrière par le colonel.
Le colonel Monroe commandant la Brigade est avec lui. Ils reconnaissent ensemble le secteur pour l’organiser défensivement.
Ce serait notre ligne de repli. Il est donc probable que l’on envisage une attaque d’un côté ou de l’autre.
Avril-mai 1916 : bois des Buttes, bois de la Miette, les exécutions, les tueries
Le lundi 3 avril
Le lundi 3 avril à 8 heures, nous sommes alertés.
Vive fusillade. Éclatements de grenades et bientôt aboiement des canons. Puis tout rentre dans l’ordre et quelques blessés sont évacués.
Et c’est ensuite la monnaie courante des obus qui nous arrivent par intermittence ou qui passent au-dessus de nous pour aller en face. Et nous percevons les trains des grosses pièces qui passent très haut dans un sens ou dans l’autre et s’en vont à des kilomètres en arrière semer la destruction.
Le mercredi 5 avril
Nous sommes relevés par le 5ème bataillon de notre régiment et nous nous rendons au Faité dans les baraquements que nous ne devons occuper qu’une nuit. Nous recevons des effets à distribuer.
Le jeudi 6 avril
Prise d’armes pour la remise de décoration à Voslajievitz et à Bonneton. Nous recevons ensuite l’ordre de partir pour Roucy à 24 heures pour faire les cantonnements.
Au petit matin, sur la route, nous sommes arrêtés par un poste de gendarmerie. Nous n’avons aucun ordre de mission à présenter ; nous sommes des isolés que la consigne ne doit pas permettre le franchissement de cette frontière. Un dialogue sans aménité de notre part s’engage.
Évidemment, les gendarmes se sentent en infériorité et sont très courtois ; mais la consigne est la consigne. Ils ne doivent laisser passer aucun isolé sur la route se rendant à l’arrière. Je propose d’attendre tout simplement notre unité en cet endroit et les gendarmes s’expliqueront avec le commandant.
Mais, de guerre lasse et par sentiment du devoir, nous passons, non pas sur la route, mais derrière la guérite, dans le terrain vague, et reprenons la route. La consigne est respectée, les gendarmes n’ont pas failli à leur devoir. Nous arrivons alors sans encombre à Roucy où, après avoir fait les cantonnements, nous attendons nos unités qui s’installent.
Le samedi 8 avril
Je vais visiter les batteries de 220 qui sont installées non loin de là.
vendredi 14 avril
Le vendredi 14 avril au soir, nous repartons sur la Miette relever le 282.
Que de déplacements ! On s’y perd dans les allées et venues.
Le samedi 15 avril
Au cours d’un bombardement, nous avons 2 tués et 2 blessés par le 75 qui tire trop court. Ce qui donne lieu à enquête. Nous devions faire une attaque qui est décommandée.
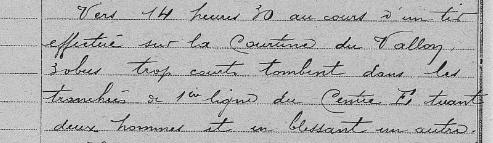
Extrait
du journal du régiment (JMO) qui relate les faits
Le dimanche 23 avril 1916
C’est le jour de Pâques, et nous sommes toujours là, dans la boue des tranchées, sous les bombardements, à guetter au parapet, nous plaquant au sol à chaque sifflement d’obus.
Quelle force nous pousse à continuer à vouloir vivre dans
de pareilles conditions ?
C’est insensé !
Le lundi 24 avril
Le boyau de communication Petrograd est repéré et copieusement arrosé.
Le mardi 25 avril
Nous envoyons une distribution supplémentaire. Nos œufs de Pâques arrivent avec un peu de retard. Néanmoins, ils sont reçus avec honneur. Il fait beau temps. Cela commence à 8 heures avec des torpilles dont on fait une ample consommation. Tout d’abord, la réaction des boches est faible.
L’attaque a lieu à 4 heures ½, 2 compagnies du 204 y prennent part, avec des unités du 289, du 246 et du 276. Du P.C. du commandant où nous nous trouvons, nous n’entendons rien tout d’abord, mais en allant communiquer et assurer la liaison, c’est une autre histoire.
Un combat aérien se livre, juste au-dessus de nos têtes, mais ce n’est pas l’instant d’en suivre les péripéties.
Le bois des Boches est pris sans coup férir ; ma compagnie, la 21ème, atteint la Miette.
Et la nuit arrive sur ce désordre indescriptible. On ne sait plus très bien où l’on se trouve et à chaque instant je risque de me faire surprendre par les boches.
Le JMO indique 9 tués et 20 blessés.
mercredi 26 avril
Le mercredi 26 avril 1916 à 4
heures ½, la contre-attaque des boches se déclenche ; nous apprenons que la
plus grande partie du bois des Buttes est pris. Nous avons une centaine de prisonniers qui sont
cueillis dans les abris par le génie qui assure le nettoiement derrière les
lignes d’attaque.
Un bombardement intense continue dans tout le secteur.
Le jeudi 27 avril
Le commandant revient au P.C. vers 6 heures. Nous faisons le bilan des
pertes.
Au 204, 34 manquants dont 8 tués et 2 disparus.
Le vendredi 28 avril
J’apprends de nouveaux détails sur l’attaque.
Le 246ème n’a pas avancé et a même été contraint de reculer face à la
contrattaque allemande.
Enfin, il a hésité.
Le 289ème est parti à l’assaut sans recevoir un coup de fusil et, fait
symptomatique, le génie n’a eu qu’à recueillir les boches dans les abris où ils
se terraient. Ils ne demandaient qu’à se rendre, et on assure que des Français
en ont fait autant.
Le communiqué fait état de cette opération, mais nous ne nous y
reconnaissons guère.
Le temps est chaud.
Maintenant on s’organise et on tâche de refaire ce qui a été détruit.
2 mai 1916
Le 2 mai 1916 arrive l’ordre de relève.
Les fourriers, sous la direction du capitaine Chambreuil, nous partons des tranchées à 10 heures 30. Il
fait une chaleur torride. Nous tournons dans le bois de Gernicourt et
arrivons à Romain où le cantonnement est très laborieux, spécialement
pour les officiers.
Le 3 mai
Nous allons sur la route attendre les compagnies à 3 heures du matin ; elles arrivent à 8 heures ½. Tous les hommes sont épuisés, mais le soir ils reprennent leur gaîté, heureux d’être encore là et de ne pas avoir à se garer des torpilles ou autres engins de mort.
Le jeudi 4 mai 1916
Il fait beau temps et j’en profite pour prendre un bain dans le ruisseau.
Le vendredi 5 mai
Nous assistons au déplacement d’une saucisse.
Le soir, la pluie commence à tomber.
Le lundi 8 mai
Nous remontons en 1ère ligne et assurons la relève au bois Clausade.
Au moment où ma compagnie passe sur la passerelle de Pontavert, elle essuie une rafale d’obus qui sème la pagaïe ; heureusement, il n’y a pas de mal.
Le mardi 9 mai
Nous nous occupons à aménager notre abri que les obus ont à peu près démantelé.
Dans l’après-midi, nous sommes bombardés et un 77 tombe sur notre abri et fait écrouler toute la terre qui nous a cependant garantis.
Travail à refaire.
Le 11 et le 12
Le calme est revenu avec le beau temps. Nous touchons le prêt.
Le samedi 13 et le dimanche 14 mai
La pluie recommence à tomber, il fait un temps bouché et bas.
À la tombée de la nuit, nous allons au bois de la Mine relever le 5ème bataillon. Je reste de planton pour attendre le commandant de Chevilly du 289ème.
Je fais la causette avec le capitaine Noël et je ne puis rejoindre la liaison qu’à 1 heure du matin.
Le lundi 15 mai 1916
Pluie toute la matinée et le beau temps revient le lendemain.
Le 17 et le 18 mai
Les avions boches rodent sans discontinuer au-dessus de nos lignes.
Le vendredi 19 mai
Nous avons 4 blessés : Colas (*), Schwob, Amy et Dreyfus. (**)
Ils ne se sont pas garés à temps des shrapnels.
(*) : CoLas Laurent, 40 ans, mourra de ses blessures. Il
est mort pour la France à l’ambulance 237 à Sapignicourt (Marne), le 21 mai
1916. Il était né à Chamoux (Yonne), le 10 août 1876.
(**) : Schwob André, Amy Clément, caporal Dreyfus
Jules
Le samedi 20 mai
Arrive une note de la division relative à l’intoxication dans les abris. Le commandement semble s’apercevoir seulement maintenant que l’explosion des obus dégage de l’oxyde de carbone qui peut être fatal dans les abris. Il est également question de la liaison par les avions et ballons.
Il est affecté pour cet usage à chaque division 1 avion et 1 ballon.
Le mardi 23 mai 1916
Dans la nuit, à 2 heures du matin, grand branle-bas sur Berry-au-Bac. Torpilles et bombardement nourri. Le calme revient avec l’aube. Le temps continue d’être magnifique.
Dans la journée, il est procédé à l’exécution des 4 condamnés par le conseil de guerre du 296ème qui a été présidé par notre colonel. (*)
Il y a, d’après les dires, un père de 4 enfants dont le crime était d’avoir engagé les copains à ne pas marcher.
Ils n’avaient rejoint leur compagnie que le lendemain.
Je fais une tournée dans le bois et en rapporte une provision d’oseille sauvage avec laquelle je confectionne une soupe en dépit des quolibets de certains camarades qui d’ailleurs font honneur à cette cuisine qui nous change un peu du menu ordinaire.
(*) : Non signalé dans le JMO. Par contre, il y est indiqué
« aucun incident particulier dans cette journée »
Le 24 mai
Il fait toujours beau temps ; le matin à 4 heures ½, je vais avec Cavin jusqu’au canal où nous prenons un bon bain. Dans la journée, une note demande, pour la section aérienne, des photographes et des dessinateurs des classes antérieures à 1901.
Le lundi 29 mai
Remue-ménage dans le commandement. Le lieutenant-colonel Collon est promu colonel commandant la brigade, le colonel Monroe passe à la 69ème.
Juin : Aisne, Champagne
Le jeudi 1er juin
C’est aujourd’hui l’Ascension. Le régiment se transforme et a 3 bataillons.
En effet, depuis août 1914, comme tous les régiments de réserve,
le régiment comptait 2 bataillons (numérotés 5 et 6).
Les 2 bataillons du 282e RI (suite à sa dissolution)
sont séparés : Le 5e bataillon du 282e RI passe au
204e RI et le 6e bataillon passe au 289e RI.
Ils sont numérotés 4. La 109e brigade d’infanterie compatit donc
avant cette date 3 régiment à 2 bataillons, et après cette date 2 régiments à 3
bataillons.
Le 204e RI compte, au 1e juin 1916, 248
officiers et 2230 hommes.
Le dimanche 4 juin
Le commandant CHALET part en permission et c’est le capitaine Chambreuil qui prend le commandement du bataillon pendant son absence.
Le lundi 5 juin
C’est la relève et nous allons à Conches où nous arrivons à 2 heures du matin.
Le mardi 6 juin
La pluie fait sa réapparition ; nous procédons à l’installation des unités. Je suis exténué. Dans son désir de bien faire, le capitaine Chambreuil envoie sans arrêt des notes de détail sur tous les sujets.
Le mercredi 7 juin
Au cours de la nuit, nous avons dû livrer un combat épique avec les rats.
Le lieutenant-colonel Lachèvre prend le commandement du régiment. Il fait distribuer une brochure dont il est l’auteur.
Le jeudi 8 juin
La pluie continue.
Je vais visiter la coopérative du 289ème qui me semble une excellente et heureuse initiative.
Évidemment, son fonctionnement ne peut être assuré qu’en période de stagnation, ce qui est plutôt rare en ce qui nous concerne.
Le vendredi 9 juin
Nous passons la journée à la confection des états qui nous sont demandés 3 ou 4 fois sous des formes différentes.
Le samedi 10 juin
Le beau temps revient dans la matinée.
Pour la seconde fois, le capitaine commandant le bataillon fait demander dans les compagnies les noms des Chefs de sections proposés pour passer officiers.
Il en faut 4 dans le bataillon, et il n’y a pas beaucoup d’engouement.
Les commandants de compagnies doivent proposer d’office ceux qu’ils croient aptes. On parle vaguement que la division serait relevée.
Les tuyaux circulent. Je voudrais bien aller en permission avant. J’ai le N° 11 dans ma compagnie.
Nous recevons une note du colonel au sujet des relations des officiers avec les sous-officiers et les hommes.
Le dimanche 11 juin
C’est la Pentecôte.
Le soir, nous allons relever le 5ème bataillon au bois Franco. Nous nous installons sans accroc.
Le lundi 12
Nous sommes avertis qu’une somme de 1175 Francs est disponible pour distribution aux hommes nécessiteux du régiment. Nous recevons une note pour les armées signée Pétain sur les abris allemands dits « Stollen ».
Il semble que nous ayons intérêt à construire des abris de ce type pour :
Ø Abriter les troupes contre les plus forts bombardements.
Ø Faciliter leur sortie même dans le cas de plusieurs entrées venant à être obstruées.
Ø Donner aux hommes davantage de confort, ce qui devient de plus en plus nécessaire avec la prolongation des hostilités. Etc. etc.
Des officiers du 306 venant de Verdun sont depuis une huitaine de jours à Fère-en-Tardenois. Ils viennent visiter le secteur. Ils doivent nous relever le 17 ou le 18. Depuis quelques jours, le bruit se confirme que la division va être relevée. Où irons-nous ?
A Verdun ou, comme certains bruits l’annoncent, dans la Somme pour l’offensive qui s’annonce prochaine ?
Le 14 juin
Le commandant CHALET rentre de permission et le capitaine Chambreuil rentre à sa compagnie.
Le 15 juin
Le capitaine Chambreuil est blessé et évacué. Des officiers du 251ème qui est cantonné près de Fère-en-Tardenois viennent reconnaître le secteur et je les conduis aux compagnies. Ce sont eux qui viendront nous relever dans 5 ou 6 jours.
Le 306 est dissous, c’est ce qu’ils m’apprennent.
Le 16 juin
Le général de division et le colonel viennent assister et reconnaître les effets d’un tir de barrage d’exercice de notre artillerie qui dure 3 minutes.
Le 17 juin
Le colonel nous fait passer une
note du général Tauflieb :
« Sur le mordant des troupes qu’il n’aime pas voir inactives et sur la
propreté des armes »
Puis arrive l’ordre de la relève. Le 5ème bataillon est, dit-on, parti cette nuit.
Nous partons pour Prouilly. Les fourriers et le campement doivent se rassembler avec ceux du 4ème bataillon à la Plâtrerie à 9 heures et nous arrivons à Prouilly à 2 heures du matin.
Le 18 juin
Le bataillon arrive à 8 heures du matin. Nous touchons de la paille le soir.
Le lundi 19 juin
Le campement part à 5 heures du soir. Le bataillon à 6 heures 30 pour Vézilly. Nous faisons les cantonnements avec le lieutenant Gigot. Je trouve un lit avec des draps.
Le soir, départ de 5 permissionnaires.
Le mardi 20 juin
Je dois partir demain en permission. Notes à communiquer toute la nuit.
Le mercredi 21 juin
Je suis chef du détachement pour emmener les permissionnaires. Nous partons de Vézilly à 4 heures et allons embarquer.
![]()
ICI COMMENCE LE TROISIEME CARNET INTITULé :
« Du 29 juin 1916 au 18 décembre 1916 »
![]()
Jeudi 29 juin 1916
Ma permission étant terminée, je prends le train à 12 heures 45 à la gare de l’Est. La division étant changée de place, nous sommes dirigés sur Troyes, où nous arrivons vers les 5 heures.
Là, on nous apprend que nous devons nous diriger sur Vitry-la-Ville ; le train n’étant qu’à 10 heures 50 du soir, nous sortons de la gare et allons casser la croûte chez un bistro. Je suis avec le sergent-major de la 23ème, Defranchi, et Bourgoin, l’ordonnance du capitaine Chambreuil.
Après avoir mangé, nous allons faire un tour dans la ville qui a l’air très agréable avec ses vieilles maisons. Il y a beaucoup de vie, et j’aimerais être aussi favorisé que les nombreux soldats qui sont ici au dépôt.
En effet, il y a à Troyes tous les dépôts des régiments du 20ème corps. Après avoir fait le tour de la ville et des promenades qui sont magnifiques, nous revenons chez notre restaurateur où nous avons laissé nos colis et, comme la nuit arrive, nous nous acheminons tout doucement vers la gare.
Nous faisons encore une pause d’une petite heure sur un banc d’un square près de la gare, ce qui nous permet d’examiner les allées et venues de nombreuses hétaïres. Nous embarquons enfin et le train nous emmène dans la direction de Châlons.
Le vendredi 30 juin
Nous débarquons à Châlons vers les 5 heures ½ et nous reprenons aussitôt un train qui nous emmène à Vitry-la-Ville. Sur la foi d’un renseignement, beaucoup de permissionnaires attendent le train de 6 heures 11.
Une petite demi-heure et nous débarquons à Vitry-la-Ville où nous trouvons un débit ouvert, ce qui nous permet de prendre le café et de nous restaurer. Comme nous avons 6 ou 7 kilomètres à faire à pied, nous attendons, Defranchi, Bourgoin et moi, des voitures à viande qui vont ravitailler à Songy où est notre bataillon.
Nous montons sur la plate-forme des anciens autobus et sommes bientôt rendus, mais tout couverts de poussière.
À mon arrivée, j’apprends que les permissions ne sont pas arrêtées comme je le croyais : Cavin, Guinard, Pautrat, de la liaison, sont partis.
Polbeau fait les fonctions d’adjudant de bataillon et je dois le remplacer à mon tour à son départ. Riboux se débrouille pour ne pas avoir de tintouin, tout en ayant tous les avantages et la considération. Nous sommes ici dans la zone des Étapes, juste à la limite de la zone des armées.
Quelques femmes de militaires sont venues voir leur mari, car avec un simple laissez-passer on peut circuler librement. Le village est un peu disséminé ; on y trouve tout ce que l’on veut, et à bon marché. Si nous pouvions passer une bonne période ici, mais c’est peu probable.
Nous sommes en réserve de la 4ème armée qui est en Champagne et, de la façon dont vont les choses, de grands événements vont avoir lieu d’ici peu. Les Anglais ont commencé le bombardement ; les Russes continuent d’avancer et les Italiens reprennent l’offensive.
À Verdun, bien que les Allemands s’acharnent toujours sur ces positions, nous tenons toujours, et si l’offensive concertée de tous les alliés se produit d’ici peu, la place ne tombera pas.
Si les actions que nous allons entreprendre réussissent, peut-être est-ce la fin de cette horrible guerre avant l’hiver prochain. Ce serait à souhaiter, car vraiment je ne me sens guère de courage pour faire une 3ème campagne d’hiver. Tous mes camarades sont de mon avis à ce sujet.
Le samedi 1er juillet
Je me lève à 7 heures.
Le foin sur lequel j’ai passé la nuit me change de mon lit. Enfin nous ne sommes pas mal logés.
Toute la nuit, j’ai entendu le
roulement des trains qui passent sans discontinuer sur la ligne toute proche.
Il paraît que le 5ème corps qui était
dans l’Argonne est passé dans la journée d’hier, se dirigeant sur la Somme
probablement.
Certains ont vu le 76ème et le
89ème.
Ce matin, le temps est superbe.
Poulet, le sergent-major de ma compagnie, est parti en permission, mais Polbeau ne partira que demain
probablement.
Le commandant CHALET rentre de Châlons dans la soirée et nous dit
aussitôt de nous préparer à partir, par voie de terre. Les « tuyaux » circulent
aussitôt dans les compagnies. Nous attendons jusqu’à 23 heures des ordres qui devaient venir et qui ne nous parviennent
pas. On nous dit seulement que les permissions sont suspendues.
Polbeau est bien ennuyé, sa femme devant l’attendre le lendemain à Laroche.
Et puis juste au moment de partir il est compréhensible que l’on soit
démoralisé, alors qu’on ne sait, en cette période, ce qui arrivera par la
suite.
Juillet 1916 : Champagne, la conférence
d’un ancien prisonnier, Verdun, la côte 304
Le dimanche 2 juillet 1916
À une heure du matin, les ordres arrivent, très détaillés ; tout ce qui
concerne les compagnies est le départ fixé à 3 heures ½ ; le campement devant
se trouver à cette heure à Ablancourt.
Nous devons aller à Vanault-le-Châtel, 4ème et 6ème bataillons.
Distance environ 22 kilomètres.
Nous nous préparons aussitôt les notes copiées et communiquées et partons
à 3 heures ½ de Songy, le
campement régulier du 6ème bataillon.
À Ablancourt, nous ne trouvons personne du 4ème bataillon, mais
le 5ème part. Le campement du 4ème avec le capitaine nous rejoint bientôt et
nous prenons la direction de Vanault en passant par la traverse.
À la 3ème pause, nous rencontrons le T.C. et j’en profite pour mettre mon sac dans le fourgon à bagages du bataillon. Cela me soulage beaucoup, d’autant plus que le soleil commence à monter.
Il fait chaud ; nous passons devant un bataillon du 289ème ; nous traversons une région qui n’a pas l’air très fertile. C’est à peine si des sapins rabougris ont l’astuce de pousser dans le terrain crayeux. Ce doit être la Champagne Pouilleuse.
Sur notre gauche, dans le lointain, nous apercevons des saucisses alignées le long du front.
Notre petite colonne s’allonge et quelques hommes restent en route vaincus par la chaleur.
Enfin nous traversons un village. C’est Bronne et Vanault-le-Châtel vient ensuite. Nous faisons aussitôt le cantonnement.
Le village est composé de grands bâtiments bâtis en planches et en terre. Nous disposons de beaucoup de place, mais l’artillerie a cantonné avant nous et il y a eu des chevaux partout où l’on pourrait mettre des hommes. Je case ma compagnie du mieux possible.
Tous les officiers sont logés, même l’adjudant et le sergent-major ; pour moi, je couche dans la paille. Nous allons ensuite à 500 mètres du village où le régiment fait la grand’halte et nous ramenons nos compagnies, la clique en tête du bataillon. Le commandant me fait passer en tête pour montrer le chemin. Je défile donc tout seul devant le colonel sur la place, sans équipement ni même de cravate.
Je place ma compagnie et vais ensuite manger une bouchée ; je gobe 2 œufs que nous avons trouvés à acheter et je m’endors après cela du sommeil du juste.
Je ne me réveille qu’à 17 heures ½, quand Roy, mon cycliste, vient m’apporter une lettre, la 1ère de Jeanne depuis que je l’ai quittée. Nous dînons ensuite.
À notre arrivée dans le village, la plupart des gens étaient à la messe, et il m’a été donné d’assister à une procession. Un reposoir avait été établi devant l’église. Les femmes de cette région ont pour coiffure une charlotte très compliquée.
À 9 heures du soir, un concert a lieu sur la place du village.
Ensuite le colonel se promène dans le pays et visite les sentinelles aux issues.
Le lundi 3 juillet
Je me lève à 7 heures après avoir passé une bonne nuit dans de la paille fraîche et abondante. Je vais aussitôt boire un litre de lait et gober 2 œufs. Je me soigne tandis que je peux trouver ce qu’il faut.
Le temps est gris et après quelques coups de tonnerre dans le lointain, l’eau se met à tomber à torrents.
A 11 heures du soir, un cycliste est venu nous réveiller et apporter une note que nous ne communiquons qu’après notre réveil. C’est un télégramme de la brigade. Les permissions sont suspendues.
Pas de déplacement pour aujourd’hui. Nettoyage du cantonnement et travaux de propreté. Le général Pétain doit venir voir les officiers. Le colonel passera dans les cantonnements vers les 11 heures.
Et la pluie continue de tomber. Pourvu qu’elle n’ait pas de répercussion fâcheuse sur notre offensive qui est maintenant déclenchée dans la Somme.
Nous apprenons que l’ouvrage de Thiaumont est repris une autre fois par nous, et un journal de l’édition de province nous donne quelques aperçus sur la marche des événements.
Mon frère Marcel, avec le 20ème corps, se trouve encore une fois dans la fournaise, en face de Péronne.
Le général Pétain vient seulement voir le colonel et le commandant passe ensuite dans les cantonnements et réunit les officiers et sous-officiers. Il leur dit que nous sommes appelés à aller à Verdun et leur explique la situation. La pluie cesse enfin dans l’après-midi.
Une note nous apprend que le régiment doit partir probablement demain matin. On se prépare ; on partirait peut-être en auto. Je vais me coucher de bonne heure et m’endors comme un loir.
Le mardi 4 juillet 1916
À 7 heures du matin, quand je me réveille, je suis tout étonné de ne pas me trouver à Verdun.
Hier soir et toute la nuit, nous avons entendu un bombardement continu dans le lointain. Je crois que ce doit être en Champagne du côté de Tahure, car nous l’entendons dans la direction du Nord.
Le communiqué de la T.S.F. de 0 heure 50 nous apprend notre nouvelle avance dans le sud de la Somme, alors que les Anglais sont restés sur leurs positions.
Depuis quelques jours, nous touchons à l’ordinaire des pommes de terre nouvelles, ce qui nous étonne. Ce doit être les primeurs de Bretagne que l’on a trouvé le moyen de nous faire parvenir tout de même au lieu de les laisser perdre.
Le mercredi 5 juillet
Toute la matinée le temps est couvert et vers les 10 heures ½ la pluie commence à tomber.
Les compagnies vont à l’exercice. On entraîne surtout les hommes à la signalisation et au lancement des grenades.
Hier soir, on nous a donné les mots de la 2ème et de la 4ème Armée. Nous faisons maintenant partie de la 2ème et nous sommes toujours dans la 4ème.
À 14 heures, une conférence doit avoir lieu par un caporal nommé Goupil qui a été prisonnier en Allemagne. Les compagnies cantonnées dans le village y assistent. J’y vais avec Polbeau, juste au moment où la pluie tombe à verse.
La réunion a lieu dans une grange et est déjà commencée quand j’arrive.
Le caporal avec l’ancienne tenue est juché sur la plate-forme d’une batteuse et à côté de lui sont assis le colonel et le commandant CHALET.
Le conférencier n’est pas un orateur, et il raconte comme il peut ce qu’il a vu et enduré en Allemagne. Sa causerie est courte et il fait surtout voir la situation matérielle des prisonniers.
Dès qu’il a fini, le colonel se lève et commence à dire qu’il est honteux, dans une pareille conférence, de ne pas toucher un mot des souffrances morales qui sont endurées par les prisonniers qui se sentent sous le joug des « sales » boches, et que le caporal conférencier n’avait pas été envoyé pour traiter une question de mangeaille et de bien-être ; il dit aussi qu’il est honteux qu’un groupe de 36 hommes soit fait prisonnier en bloc, comme c’est le cas de ce caporal.
Qu’en tout cas si l’on se fait prendre, on ne doit rien révéler et opposer un mutisme absolu même aux mauvais traitements et à la privation de nourriture. D’ailleurs, tous les noms des prisonniers qui ont donné des renseignements sont enregistrés comme nous le faisons de notre côté, car chez les Allemands, habitués à être menés à la schlague et commandés par leurs officiers et sous-officiers d’une autre classe que celle des hommes, on peut avoir beaucoup de renseignements, et comme il s’en est déjà aperçu lui-même, cela arrive quelquefois chez des Français.
Mais nous irons chercher toutes ces fiches ; nous les conquerrons, et alors ces lâches seront mis au ban de la nation.
Le colonel ne veut pas nous faire de menaces (un certain mouvement s’était produit dans l’auditoire), mais il fait appel au contraire aux sentiments les plus élevés des hommes.
En tout cas, comme peut-être bientôt nous nous trouverons face à face avec l’ennemi, jamais un groupe du 204ème ne sera fait prisonnier. Chacun luttera jusqu’au dernier. La contradiction est terminée.
À plusieurs reprises, comme le caporal voulait dire un mot, le lieutenant-colonel lui imposa silence.
Les compagnies rentrent dans leurs cantonnements et les hommes commentent la séance à laquelle ils viennent d’assister.
À 5 heures, réunion des officiers et chefs de section avec le colonel. Les journaux nous apprennent la reprise de Thiaumont pour la 4ème fois par les Allemands.
Que d’hommes doivent être restés autour de cet ouvrage !
Dans la Somme, je crois que l’on souffle un peu.
Le soir, retraite.
Le jeudi 6 juillet
Le beau temps revient un peu. Cavin est rentré de permission hier soir.
Il y a encore des changements dans les compagnies, il y a 7 brancardiers par compagnie au lieu de 4 qui tous passent au P.E.M. La 24ème est définitivement au dépôt divisionnaire depuis le 1er et toutes les compagnies doivent toujours être à l’effectif de 200.
Pour refaire cette nouvelle organisation, il y eut toute une bouillabaisse, et les ordres et contre-ordres se succédaient. Les décisions avaient tous les jours plusieurs pages remplies de mutations et certains hommes ont changé 3 ou 4 fois de compagnie pour, finalement, revenir à leur compagnie d’origine. Ils étaient portés tous les jours en mutation. Je me trouvais heureusement en permission durant la plus grande partie de tout ce bouleversement.
Maintenant, cela commence à se tasser.
Les compagnies vont à l’exercice et la clique et la musique répètent. Quant à nous, à la liaison, nous n’avons pas grand travail et nous ne sommes pas ennuyés. Nous continuons de nous soigner du mieux possible et Roy nous a fait 2 fois des œufs à la neige.
Je bois mon litre de lait tous les jours en plus.
À 18 heures, un concert est donné sur la place au cours duquel Pallier, le caporal-cycliste que ses talents de chanteur ont fait caser près du colonel, chanta la Marseillaise avec accompagnement de la Musique.
À ce moment, nous étions à table, et nous n’assistâmes pas au concert, mais les cyclistes nous rapportent qu’il n’y avait pas la foule. Juste le colonel et les officiers autour de la Musique, tandis que les poilus dans leurs cantonnements faisaient juste voir le bout de leur nez par les portes entrebâillées.
Nous apprenons que le départ doit avoir lieu samedi et que le capitaine Prudon doit aller demain faire la reconnaissance des cantonnements.
Le vendredi 7 juillet
À minuit et demie, alors que nous dormions tous, un cycliste du colonel nous apporta l’ordre général pour le changement de cantonnement.
Le 289ème part dans l’Est aujourd’hui, du côté de Fleury-sur-Aire, et la division doit serrer sur l’est de sa zone.
Le 204ème, les 2 bataillons de Vanault-le-Châtel partiront demain pour Contault-le-Maupas, à 7 kilomètres d’ici. Dès le matin, la pluie commence à tomber, monotone et sans discontinuer.
Quel sale temps ! On ne se dirait vraiment pas au mois de juillet, et c’est un temps bien peu propice à notre offensive qui a bien l’air de piétiner sur place, peut-être de la faute des Anglais qui n’avancent vraiment pas. C’est encore nous qui paierons les frais pour ce coup-ci.
Dans la journée, un contrordre arrive, d’abord une dépêche de la brigade annule l’ordre de mouvement et on doit attendre d’autres ordres. La division doit se porter tout entière vers l’Est par voie de terre.
On se tient prêt à partir.
Les nouveaux ordres arrivent à 11 heures ½. Le régiment doit aller à Noyers et Auzécourt.
Départ à 4 heures 40 ; campement à 3 heures 45. Après avoir communiqué à nos compagnies, nous tâchons de nous reposer un peu. À chaque fois que nous partons ainsi, c’est la même chose.
Nous sommes sur pied toute la nuit, et le matin nous partons les premiers.
Le samedi 8 juillet
Toute la liaison dormait encore profondément quand Monnet, le caporal-fourrier de la 21ème, vient nous réveiller à 3 heures 30. Nous n’avons rien de prêt, mais nous faisons vite à mettre nos chaussures et boucler nos sacs. Je trouve encore le temps d’aller glisser le mien dans le fourgon du bataillon.
Nous avons 20 ou 22 kilomètres à faire et le sac en moins, c’est appréciable. Si je me fais attraper, je le verrai bien. Nous devons être fâchés avec le beau temps, car des averses tombent toutes les 10 minutes. Heureusement, j’ai conservé mon capuchon de zouave.
Nous passons par Charmont, où nous prenons le campement du 5ème bataillon. Le capitaine Café, qui est de jour, s’en va alors en avant pour la répartition du cantonnement.
Nous traversons ensuite Nettancourt ; un bataillon du 276ème est devant nous et nous nous embarrassons dans son T.C. Nous arrivons enfin à Noyers où nous restons avec le 4ème bataillon. Le 5ème et l’E.M. du régiment vont à Audécourt, où se trouve déjà l’E.M. de la brigade. Le cantonnement n’est pas brillant, mais il y a de la place pour les hommes et des lits pour tous les officiers.
Nous sommes ici dans la Meuse, et en faisant les cantonnements je m’aperçois que les gens ne sont pas du tout les mêmes qu’en Champagne. Beaucoup moins avenants, ils se débinent tous, les uns les autres.
Alors que je cherchais des lits, je me suis attiré plusieurs fois cette réflexion :
« Vous n’avez qu’à
aller chez Me une telle… ; si elle n’a pas de lit, elle prêtera bien la moitié
du sien ; et ce ne sera pas la 1ère fois, allez. »
On me cite aussi complaisamment 3 dames du village qui ont eu des enfants depuis la guerre sans le concours de leur mari, et cela avec une pointe de méchanceté non déguisée. L’humanité est loin encore de la perfection, il me semble, et elle s’en éloigne en ce moment plus qu’elle ne s’en rapproche.
Quand nous avons terminé, nous allons chez une débitante, très aimable
celle-ci, qui veut bien nous faire cuire une omelette. Mais, les œufs cassés,
on annonce que le régiment qui faisait la grand’halte non loin du pays se met
en marche, nous remettons le repas à plus tard et allons attendre les
compagnies et, une fois placées, nous revenons manger notre omelette.
Il est 13 heures et j’ai vraiment l’estomac dans les talons ;
je n’ai rien pris depuis la veille. Nous trouvons de la bonne bière.
Le soir, nous touchons un peu de paille, ce qui
n’est pas du luxe vu l’état des cantonnements, et je me couche dans une espèce
de grenier avec Polbeau.
Le dimanche 9 juillet
Je dors d’un sommeil de plomb jusqu’à
7 heures. Sur la décision d’hier soir, une messe est annoncée pour 9
heures. Des ordres arrivent déjà pour le nettoyage du cantonnement sous les
ordres des « sous-officiers chefs de ferme ». Le colonel veut rehausser le
prestige des sous-officiers et leur autorité, et à chaque fois qu’il en trouve
un en défaut, il le casse. Guinard
et Nault reviennent de
permission, ce qui nous fait une occasion de boire la goutte.
Le beau temps fait son apparition, probablement parce que nous restons
en place.
L’exercice commandé pour l’après-midi est décommandé. Nous devons
partir demain.
Les ordres arrivent comme d’habitude à 11 heures ½ du soir ; nous copions les notes, puis je vais les communiquer
aux officiers que je réveille ainsi que le sergent-major.
Je reviens me coucher ; il est près de 2 heures du matin et le campement doit partir à 3 heures 30. C’est
ainsi ; à chaque fois que nous faisons une marche, nous passons auparavant une
nuit à peu près blanche.
Le lundi 10 juillet
À 2 heures 30, on vient nous réveiller, mais j’attends encore une bonne demi-heure pour me lever. Je boucle mon sac et je vais le porter dans le fourgon de bataillon. Nous avons une vingtaine de kilomètres à faire, le régiment devant cantonner à Lisle-en-Barrois et Vaubécourt ; l’E.M. doit rester à Lisle-en-Barrois.
Nous passons par Auzécourt où, une erreur ayant dû se produire, nous trouvons le campement du 5ème bataillon avec un P.P. et un officier, le lieutenant Boursier, alors que le lieutenant Jouannais avait été désigné, la 21ème étant de jour.
Nous passons ensuite par Villote-devant-Louppy où la pluie se met à tomber à verse. Le 276, qui y était cantonné, se prépare à partir.
Puis, à Lisle-en-Barrois, nous attendons des ordres pour la répartition du cantonnement, et comme la pluie redouble, nous nous mettons à l’abri sous un hangar.
Au bout d’une demi-heure ou ¾ d’heure, le colonel Lachèvre lui-même arrive et nous donne la répartition.
Le 5ème bataillon et le 6ème vont à la ferme des Merchines, le 4ème à Vaudoncourt, l’E.M. et la C.H.R. restant à Lisle-en-Barrois. Nous n’avons plus que 2 kilomètres ou 3 à faire.
Le cantonnement est vivement fait. Il y a une grange immense où tiennent 2 compagnies, les 21 et 22.
Mais les officiers couchent tous dans la paille. Dans le château, il y a juste 4 lits pour les 2 commandants et capitaines, une autre chambre est pour les médecins, et les commandants de compagnies et autres officiers couchent ensemble dans des mansardes où il y a un peu de paille, qui n’est même pas très propre.
Aussi ils font tous des drôles de têtes quand nous les menons à leur logement et ils font des réflexions à ce sujet. Cependant les hommes sont encore plus mal logés et il y a parmi eux des soldats qui couchaient avec les hommes il n’y a pas bien longtemps et qui maintenant trouvent inadmissible qu’on ne leur procure pas un lit.
La liaison, pour une fois, est mieux logée que les officiers, dans un petit pavillon à droite de l’entrée du château et qui sert d’école. Nous avons beaucoup de paille. La ferme semble très importante ; elle a environ 300 hectares, dit-on. C’était auparavant une ferme-école. Les bâtiments, les écuries sont immenses ; le château est assez important et un joli parc l’entoure, dans lequel il y a 3 étangs, une volière, un jardin potager, etc. La patronne vend de l’épicerie et du vin qui est débité par 2 territoriaux.
C’est le fils, qui a environ 17 ans, qui fait marcher la ferme.
Le beau temps est revenu ; il fait même chaud.
En me promenant dans le parc, je vois déjà un soldat qui pêche dans l’étang avec une ligne qu’il s’est fabriquée, et qui plus est : il prend quelques poissons. Dans la cour, je vois un gros tas d’obus vidés qui ont été ramassés dans les alentours. Car on s’est beaucoup battu dans cette région, en août et septembre 1914.
Les villages où nous sommes passés ont beaucoup de leurs maisons démolies et brûlées.
Des tombes émergent dans les champs de place en place, et beaucoup de soldats qui sont venus du 4 reconnaissent les endroits où ils sont passés. Quelques-uns même nous désignent l’endroit où ils ont été blessés. C’est en effet le 5ème Corps qui se trouvait par ici.
Le soir, l’ordre de départ pour le lendemain matin nous parvient tout de même avant la nuit.
Nous devons partir à 5 heures 30 et nous rendre à Foucaucourt, par Vaubécourt et Evres, où doit rester l’E.M. du régiment.
Le mardi 11 juillet
Bien que l’étape soit très courte, je glisse néanmoins mon sac dans la voiture de matériel. Nous allons avoir du beau temps.
Nous traversons Vaubécourt où je vois au passage beaucoup de ruines, puis Evres qui est dans le même cas. Il y a beaucoup de lignes de chemin de fer à voie étroite dans cette région et, depuis la guerre, on en a fait une à voie normale qui doit relier Verdun à Revigny.
Foucaucourt également a beaucoup souffert de la guerre. Nous avons vu encore un grand nombre de tombes le long de la route, et dans le cimetière même de Foucaucourt sont enterrés de nombreux soldats français et allemands. Certains voisinent même dans les mêmes tombes.
Les cantonnements sont sales ; on voit que l’on se rapproche du front. Un assez grand nombre d’automobilistes sont cantonnés dans le pays. Nous voyons passer les T.R. du 46ème, du 31ème, etc. Les bruits que le 5ème Corps était parti dans la Somme étaient donc faux.
Nous sommes ici à une vingtaine de kilomètres de Vauquois. Nous voyons au loin de nombreuses saucisses et nous entendons très bien le canon. A quelque distance de nous commence le terrain accidenté et boisé de l’Argonne.
Le siège de la brigade est à Triaucourt. La division doit se diriger sur la rive gauche de la Meuse, du côté d’Avocourt, car on passe communication aux compagnies un petit schéma reproduisant la répartition des forces allemandes dans cette région.
Le mercredi 12 juillet
Les compagnies vont le matin à l’exercice et le soir il y a instruction pour les spécialistes. Des équipes de fusil- mitrailleur sont formées : 2 sergents, 4 caporaux et 32 hommes par compagnie ; on va toucher, je crois, 2 fusils-mitrailleurs par section. Tous les soldats ont maintenant leur spécialité : grenadiers, signaleurs, canons de 37, fusil-mitrailleur, pionniers, etc…
Les journaux nous annoncent que notre progression continue toujours dans la Somme et en Russie. La fin de cette horrible guerre viendrait-elle bientôt ? Ce serait à souhaiter.
J’ai appris ces jours derniers que mon frère Marcel a été blessé dans l’église de Curlu durant la prise de ce village le 1er juillet. Une balle lui a fracassé l’avant-bras gauche. Je suis presque content de le savoir ainsi blessé, car je n’avais pas de nouvelles de lui depuis le commencement de l’offensive.
Et j’espère que sa blessure n’aura pas de suites graves et qu’elle lui procurera un long séjour à l’arrière. Il en a assez vu et assez fait lui aussi. Après avoir déjà été blessé à Neuville-Saint-Waast, être resté 16 jours sur le Mort-Homme, dont 5 sans boire ni manger, et avoir fait l’offensive de la Somme, on peut le remplacer par un de ceux qui sont tranquillement à l’arrière.
Dans la soirée, un message nous parvient disant qu’il n’y aura pas de mouvement demain pour le 204.
Le jeudi 13 juillet
Quand je me réveille, il pleut à verse et le temps a l’air bien pris. Les signaleurs vont à Evres mais ne font que se tenir à l’abri de l’eau. Une division a dû être relevée, toute la nuit il est passé des voitures et dans la matinée aussi. Le canon sonne sans discontinuer dans le lointain.
Le Caporal Clément de la 23ème compagnie est cassé pour une histoire avec le capitaine Astruc de la gendarmerie divisionnaire.
Il a cependant l’air absolument de bonne foi, mais le colonel, contre toute justice, donne satisfaction aux gendarmes, et il lui dit que dans quelques jours il aurait l’occasion de regagner ses galons.
Jolie satisfaction !
Dans la soirée, et d’après les ordres du colonel, le commandant communique une note invitant les officiers à verser gracieusement leur obole pour acheter des prix pour une réunion sportive que l’on doit organiser demain à l’occasion du 14 juillet.
Le colonel a versé généreusement 10 Francs.
Le vendredi 14 juillet
Il n’y a pas d’exercice pour les compagnies. Le matin est réservé aux travaux de propreté et les hommes continuent d’enlever la boue et les ordures qu’il y a dans les cantonnements, ce qui n’est pas une mince affaire.
La réunion sportive commence à 13 heures et la pluie fait son apparition dès l’arrivée de la Musique. Mais ce ne sont que des averses et dans les éclaircies les épreuves peuvent se disputer.
Il y a du sport sérieux et du sport gai : concours de saut en hauteur, courses de 100 mètres haies, de 1000 mètres, de 100 mètres en tenue de campagne ; lancement de grenades, courses à dos de mulet, sans selle, à dos d’homme, en sac, etc.
Certaines de ces épreuves provoquent le fou rire et, vu l’état du terrain, détrempé, de nombreuses chutes se produisent. Après toutes ces épreuves se dispute un match de football entre le 5ème et le 6ème bataillon.
Le 6ème gagne par 5 buts à O. La 21ème compagnie eut un grand succès dans cette réunion ; elle enleva une grande partie des prix, et l’équipe de football du 6ème était composée en partie d’hommes de la 21ème. 3 seulement étaient des autres compagnies.
Le caporal Thierry se distingua tout particulièrement en gagnant avec un brio remarquable le concours de saut et l’épreuve du kilomètre ; il était aussi 2ème du 100 mètres, 2ème au lancement de la grenade et ne put gagner les 100 mètres en tenue de campagne à cause d’un accident. Durant cette réunion, tous les officiers étaient présents et quelques-uns avaient du travail pour assurer le départ et l’arrivée des épreuves.
Le colonel Lachèvre était présent. Les prix consistaient en bouteilles de Champagne, blagues, pipes, couteaux et autres petits objets.
Le soir, à la tombée de la nuit, eut lieu une retraite par la clique. Le canon tonne fortement.
Le samedi 15 juillet
Nous apprenons par le communiqué et les journaux du matin que les Anglais continuent à gagner du terrain. Ils auraient pris toute la 2ème ligne ennemie depuis Bazentin-le-Petit inclus. Il fait meilleur temps aujourd’hui ; nous n’avons toujours pas d’ordre de départ.
La division est à Lavoye et la brigade qui devait quitter cet endroit doit y être restée.
Le dimanche 16 juillet 1916
Nous apprenons que nous devons partir demain pour le bois de Saint Pierre, près de Brocourt. Le commandant, qui a toute liberté, décide de partir à 7 heures ; la pluie ayant recommencé, il ne fera pas trop chaud.
Le colonel reste à Evres pour l’instant et il n’y a que le 6ème bataillon qui doit partir.
Le lundi 17 juillet
Nous partons selon les ordres donnés la veille.
Un fin brouillard tombe, mais il se dissipe bientôt. Nous passons par Waly, Froidos, Rarécourt et Jubécourt.
Il y a beaucoup de troupes de toutes armes dans ces deux derniers villages. Tout le long de la route, nous enfonçons jusqu’à la cheville dans une boue liquide, la pluie étant tombée à verse toute la nuit.
Près de Brocourt, nous voyons à proximité d’une ligne de chemin de fer à voie étroite des hangars sous lesquels il y a des quantités d’obus de gros calibre. Nous arrivons enfin au bois de Saint-Pierre où nous prenons place dans des baraquements qui sont vides.
Le bois est rempli de troupes de toutes sortes, il y a de la boue en quantité, c’est dégoûtant.
Nous arrivons vers les midi. Je suis fourbu.
J’avais emporté au départ un bidon de lait que j’ai bu dans les premières pauses. Ensuite j’ai bu ½ quart de vin qui ne voulait pas passer, ce qui m’a beaucoup fatigué. Nous mangeons la soupe dès notre arrivée.
Vers 4 heures, le commandant reçoit l’ordre de partir le lendemain pour le bois de Béthelainville, et le soir le bataillon sera poussé en soutien en un point appelé « Miramas ». Les voitures du T.C. resteront au bois de Saint-Pierre provisoirement. Seules les cuisines roulantes et la voiture médicale iront à Béthelainville.
Le lieutenant-colonel est venu en auto causer au commandant CHALET. Nous devons prendre les tranchées entre la cote 304 et le Mort-Homme. Nous tâchons de nous coucher de bonne heure, mais il m’est presque impossible de dormir de toute la nuit.
Ce sont les uns ou les autres qui rentrent chacun leur tour, puis, ensuite, des plantons apportent des notes, notamment vers les 11 heures ½ un communiqué disant que les Russes ont fait 12000 prisonniers au sud de Lousak et pris des canons et du matériel.
C’est très joli, mais je ne dors toujours pas et pour comble je sens la vermine qui me taquine, et cela en dépit des isolateurs en treillage sur lesquels nous sommes couchés et qui ne sont pas précisément doux.
Au-dessous, c’est d’une saleté repoussante.
Le mardi 18 juillet
Réveil à 4 heures, et nous nous préparons aussitôt pour le départ qui est à 5 heures.
Nous recommençons à marcher dans la boue.
Il y a un fort brouillard, mais il ne pleut pas. Nous prenons bientôt la grande route après avoir traversé 2 lignes de chemin de fer, dont une nouvelle. A une certaine distance avant d’arriver à Dombasle, nous voyons un parc du Génie où il y a une grande quantité de matériel. Un train complet n’est pas encore déchargé. Des obus sont tombés autour il y a peu de temps.
Nous traversons Dombasle qui est ravagé. Pas une maison qui soit intacte, et nous n’apercevons pas un civil.
À la sortie du village, nous voyons l’emplacement d’un dépôt de munitions qui a sauté il y a environ un mois, nous dit-on. L’emplacement est ravagé et l’on ne voit plus que de vastes entonnoirs et la terre a été fouillée par les obus. Nous en voyons beaucoup qui ont éclaté et certains ont été projetés à une énorme distance.
Nous arrivons au bois de Béthelainville où il y a déjà beaucoup de troupe de bivouaquées, notamment des zouaves. Des compagnies qui sont relevées redescendent.
On n’entend pas beaucoup le canon ce matin. Nous nous installons dans l’endroit le plus propice pour passer la journée. Le bivouac est d’une saleté repoussante. Des trous d’ordures qui sont pleins se dégage une odeur infecte et les asticots courent tout autour. Des biscuits, des boîtes de singe, du matériel de toute sorte traîne partout.
On distribue à chaque homme des vivres et des munitions. 2 jours de vivres de réserve, ce qui fera 4 avec les 2 jours que nous avons déjà, 5 grenades, 2 sacs à terre, des fusées et le complément, à 200 cartouches.
Les cuisines roulantes resteront ici, le reste du T.C. étant au bois de Saint-Pierre, et elles amèneront la soupe à environ 500 mètres d’Esnes. Les cuisiniers des officiers resteront ici pour l’instant.
Nous devons partir ce soir pour aller en soutien en un point appelé « Tarascon-Miramas ».
Dans l’après-midi, le général de Maud’huy vient nous rendre visite, il jette à la volée quelques paquets de tabac aux poilus qui se précipitent pour les attraper. Puis il réunit les officiers pour leur parler.
Comme les hommes formaient un cercle autour d’eux, Cavin veut les faire partir, mais le général dit qu’ils restent au contraire, et il nous fait un petit speech ; il nous parle de la situation qui est toute en notre faveur, du secteur où nous allons aller et des difficultés que nous aurons à surmonter.
La principale est le mauvais temps, ce que je crains fort ; nous resterons 9 ou 10 jours au plus aux tranchées, dont 2 en 2ème ligne et 7 en 1ère. Ensuite, nous irons au repos loin en arrière ; au rafraîchissement, comme dit le général.
Il s’en va ensuite voir le 289ème qui est à côté de nous, après avoir fait allusion au manque de discipline qui caractérise le Français, ce qu’il faudrait s’occuper de redresser après la guerre. Il me fait l’impression d’un vrai moulin à paroles.
La pluie est tombée une bonne partie de l’après-midi, mais elle cesse vers le soir.
Les guides viennent à 8 heures 45 ; il y en a 1 pour chacune des 4 compagnies et 1 pour le commandant. Ce sont des guides qui ne font que cela, et je crois que c’est une bonne innovation. Ils connaissent le terrain dans tous ses détails et ils ne risquent pas de faire faire fausse route. Nous descendons dans Béthelainville où se trouve la division.
Après la traversée du village, nous passons à travers champs et rejoignons la route de Vignéville ; nous faisons la pause au haut du village. Des batteries doivent être placées dans tous les coins, et les lueurs des départs apparaissent de tous côtés.
Après Vignéville, nous tournons à gauche et, après avoir suivi la route un certain temps, nous suivons un boyau, le boyau de Chartres, nous côtoyons le parapet, car le boyau par lui-même est impraticable. Nous sautons plusieurs boyaux, et en un endroit où le boyau était plein d’eau et jalonné de gabions, nous faisons un véritable exercice d’acrobatie ; un ruisseau passe tout à côté, heureusement il ne fait pas très noir et l’on voit vaguement où l’on pose le pied.
Les fusées lumineuses et les éclairs rapides des coups de canon font vaguement entrevoir la crête et le terrain qui nous entourent. Nous ne recevons aucun obus et nous arrivons enfin à Tarascon où des guides nous attendent. Les compagnies arrivent peu après et nous les plaçons.
Il n’y a que des boyaux à peine ébauchés au fond desquels il y a 20 ou 30 centimètres de boue liquide. Pas d’abris ; des petites anfractuosités dans la paroi du boyau, c’est tout. Le P.C. du commandant n’est pas bien brillant non plus. Les compagnies que nous remplaçons sont déjà montées en 1ère ligne. Un capitaine adjudant-major est resté pour passer les consignes.
Nos guides nous expliquent un peu le terrain. En face de nous se trouve la cote 304 que l’on distingue très bien, puis plus à droite, vers le NE, le Mort-Homme, occupé par l’ennemi. Dans la journée, il ne faut pas se montrer sous peine de se faire bombarder.
Mais la nuit, on passe sur le terrain, où cependant passent beaucoup de balles, venant du Mort-Homme, de la cote 304 où les Allemands sont sur la crête en certains points, et du ravin entre ces deux collines. Nous avons remplacé un bataillon d’infanterie coloniale. Nous nous casons comme nous le pouvons pour nous reposer car, avec ce que nous avions sur le dos, nous sommes fatigués.
Je me couche dans un coin du boyau ; il est 2 heures.
Le 19 juillet
Malgré une violente canonnade que j’ai entendue sur la rive droite de la Meuse, j’ai dormi et, quoique je fusse replié sur moi-même dans mon coin, je me suis reposé. Je sors de mon trou à 5 heures du matin.
Il fait un beau soleil, trop chaud même, car je crains qu’il nous amène encore de l’eau. J’explore un peu le terrain.
En face de nous, la cote 304, et dans le bas le ravin de la Mort qui est pris d’enfilade du Mort-Homme. Au NE, la crête du Mort-Homme, de laquelle nous sommes en pleine vue. Toutes les crêtes sont ravagées, mais sur les pentes et dans les ravins il y a encore beaucoup de verdure.
Il est vrai que nous avons reculé, mais le terrain n’est pas bouleversé comme à Lorette ou en Artois. C’est calme, et c’est à peine si quelques obus tombent dans le secteur.
À notre gauche, à 500 mètres vers l’ouest, le village d’Esnes est accroché au flanc d’une colline. Il ne reste guère que des pans de murs. Le cycliste Heyd de la 22ème, qui était resté en arrière, étant de planton à la division, a toutes les peines du monde à nous retrouver.
Il est passé par la route, de Béthelainville à Montzéville et Esnes où il a couché.
Entre Esnes et le point où nous sommes se trouve un moulin, et toute la vallée est marécageuse. On y enfonce jusqu’aux genoux. C’est cependant le seul passage, je crois, pour monter aux 1ères lignes.
Dans l’après-midi, les Allemands tirent sans discontinuer avec des obus de gros calibre à quelque distance de nous sur un point au S.O. d’où nous sommes. Des avions règlent leur tir. Les nôtres sortent aussi ; il fait beau et ils peuvent observer.
Sur tous les points, les 2 artilleries font preuve d’une certaine activité.
À 5 heures du soir, le commandant CHALET reçoit un ordre et va reconnaître les 1ères lignes avec un officier de chaque compagnie. Nous devons aller relever demain soir le bataillon de gauche du secteur A.
Nous nous trouverons donc au Bec de Canard et remplacerons l’infanterie coloniale. Nous suivons des yeux les officiers qui passent forcément à découvert jusqu’à leur arrivée au P.C. du colonel qui commande le quartier A et qui se trouve dans le bas du versant de la cote 304.
À ce moment, l’ennemi tire sur Esnes et tout le village disparaît dans la fumée.
Les officiers des compagnies reviennent à la tombée de la nuit, et le commandant reste aux 1ères lignes. Les compagnies vont travailler, la 21ème va chercher des outils au parc du génie à Esnes et va travailler à la tranchée de Martigues qui est la tranchée de soutien du secteur où nous allons, à l’extrémité de la croupe formée par la cote 304.
Le jeudi 20 juillet
Rien de nouveau dans notre secteur ; l’artillerie donne toujours par intermittence.
Dans l’après-midi, le commandant CHALET envoie des ordres pour la relève. Nous prenons bien les 1ères lignes entre l’extrémité de la cote 304 et le Bec de Canard.
Il faut s’attendre à être attaqués et les compagnies doivent tenir une petite fraction en réserve (1/2 section par peloton) pour faire des contre-attaques immédiates.
Le soleil se couvre dans l’après-midi. Pourvu que la pluie ne reprenne pas !
Nous montons en 1ère ligne à la tombée de la nuit. Nous traversons le fameux ravin de la Mort après être passés par le moulin d’Esnes où nous faisons une provision d’eau. Nous arrivons au poste de commandement sans encombre.
Mais quel spectacle dans le Ravin de la Mort !
Ce ne sont plus que des trous d’obus qui se touchent et qui ont été bouchés les uns par les autres. Un petit ruisseau coulait dans ce ravin et tous les entonnoirs sont pleins d’eau.
On traverse sur une espèce de passerelle faite de planches et de caillebotis jetés en travers des trous d’obus. Des objets de toutes sortes, massacrés, du matériel brisé gît partout, et il doit aussi y avoir des cadavres. Mais nous sommes chargés, nous passons vite et n’avons guère le temps d’examiner tous les détails de ce chaos.
Nous trouvons le commandant CHALET au P.C., un nouvel abri qu’il est en train de faire construire, dans la tranchée de soutien, la tranchée de Martigues. Il nous conduit lui-même en 1ère ligne au P.C. du commandant du bataillon colonial que nous relevons et il y reste tant que la relève n’est pas terminée.
En fait de P.C., il n’y a là qu’un petit trou où un homme peut se tenir assis avec une plaque de tôle dessus.
Le capitaine adjudant-major restera ici, ainsi que le médecin et les fourriers et cyclistes des 21ème et 22ème compagnies. Je suis ici au milieu de ma compagnie et tout près du lieutenant. La 22ème est sur la gauche, et séparée de la 21ème par un peloton de la 23ème. La tranchée est de ce côté assez bien, mais il n’y a aucun abri digne de ce nom.
Où se trouve le peloton de la 23ème, il y a une source et les hommes ont les pieds dans l’eau et la boue. La 22ème occupe une tranchée qui fait saillant dans les lignes boches, en forme de triangle, et c’est un point particulièrement délicat et qu’il faut tenir coûte que coûte, car il surplombe une bonne partie de nos tranchées et les prend d’enfilade. D’ailleurs la mission est partout la même : tenir à tout prix.
À minuit et demie, une escadrille de bombardement passe au-dessus
de nous ; mais elle ne doit pas aller très loin, car elle revient ½ heure ou ¾
d’heure après.
L’ennemi tire dessus au jugé, et il nous est impossible de distinguer
les avions dans la nuit, bien qu’il fasse un beau clair de lune. Mais nous
voyons très bien les éclatements des obus que les Allemands leur envoient.
La nuit précédente, il était déjà passé une escadrille.
La relève est terminée vers les
2 heures 30 ; le commandant rejoint son poste de commandement et je
m’assois dans un trou pour tâcher de sommeiller.
Le JMO du régiment signale la perte de 5 hommes tués et 11
blessés.
Le vendredi 21 juillet
Je sors de « mon lit » à 6
heures ½ ; il m’est impossible de me reposer ; puis mes pieds étant au
milieu de la tranchée, on me marche dessus à chaque instant.
Le temps est beau ; nous avons de la chance.
Quelques torpilles sont tombées sur nos tranchées durant la nuit ; les
balles sifflaient sans arrêt ; un combat à la grenade a eu lieu dans un petit
poste au bataillon qui est sur notre droite ; mais nous ne recevons pas d’obus.
Il n’y a jusqu’à maintenant que 2 blessés légers au bataillon.
Dans la matinée, des officiers d’artillerie du 30 et du 45
viennent pour régler leur tir. Des avions ennemis survolent nos lignes sans
être beaucoup inquiétés. Les nôtres arrivent quand ils sont partis.
Des observations ont permis de constater que les Allemands faisaient
des travaux dans leurs tranchées en face de nous pour une attaque soit par les
gaz, soit par les « Flammenwerfer ». Le commandement a décidé de faire sur ces
travaux un bombardement destructif par les 155. Ce bombardement est fixé pour
demain et les ordres en conséquence sont communiqués dans la soirée.
La zone à bombarder est divisée en 4 tranches qui seront « travaillées
» séparément.
Pour demain, on ne doit s’occuper que de la zone de droite et la zone 3
en partant de la droite. Le bombardement durera 2 heures 30.
La zone 1 de droite sera bombardée dans la matinée à partir de 7 heures
; la zone 3 l’après-midi à partir de 14 heures.
Pour le matin, c’est surtout le bataillon qui est à notre droite, le
8ème colonial, qui est intéressé. Il évacuera ses tranchées de 1ère ligne ainsi
que notre compagnie de droite, la 21ème, qui évacuera l’emplacement d’une
section et la placera dans ses 3 autres sections.
Pour la zone 3 dans l’après-midi, toute la 21ème évacuera et se placera
: un peloton à droite chez les coloniaux, un peloton dans le peloton de la
23ème à gauche. De cette façon, si des coups tombent trop court, ils ne nous
feront pas de mal. On devra veiller tout particulièrement à ce que l’ennemi ne
sorte pas de ses tranchées pour venir dans les nôtres et à cet effet des
mitrailleuses seront placées en des endroits convenables qui prendront sous
leurs feux tout l’espace à défendre.
Un avion sera durant toute la durée du tir au-dessus des positions pour
régler le tir et avertir aussitôt par signaux et T.S.F. si les Allemands
sortaient de leurs tranchées.
Il sera lui-même défendu par un avion de chasse qui le couvrira
continuellement.
Si toutefois le temps était brumeux et ne pouvait pas donner lieu aux
observations nécessaires, l’opération serait remise.
Ce soir, de 6 heures 30 à 7 heures 30, doit avoir lieu un exercice de signalisation et de liaison avec le ballon 58 qui se distinguera par une flamme blanche et rouge. Les compagnies de gauche et de droite doivent marquer la ligne occupée et le ballon doit répondre.
Le temps est beau.
Le commandant et la 21ème voient bien le ballon, et les signaleurs, par des points et des traits alternés, marquent leur emplacement. Le ballon ne répond pas. La compagnie de gauche (22ème) n’a pas su distinguer le ballon signaleur entre la dizaine de saucisses qui étaient montées à ce moment.
Un peu plus tard, un coup de téléphone demande au bataillon un compte-rendu de cet exercice.
La nuit est venue.
Soudain, un combat à la grenade s’engage vers l’arbre en Z qui se dessine encore très bien sur la crête, à l’extrémité de la cote 304. C’est l’emplacement du petit poste de la 22ème compagnie. C’est ce petit poste que le 412 s’était laissé prendre et qui permettait à l’ennemi d’avoir des vues du sommet de la cote 304.
Il leur avait été repris quelques jours avant notre arrivée par les coloniaux. Je vois une fusée rouge qui est lancée par la 22ème pour demander le tir de l’artillerie qui d’ailleurs s’abstient. Le combat est très vif et dure une bonne demi-heure.
On demande aussi de la 22ème par téléphone le tir de l’artillerie, mais sans résultat.
Est-ce le commandant qui ne le juge pas utile ?
Je ne sais.
Il y a des blessés chez nous, mais nous tenons bon.
Quand le calme est revenu, on compte 2 tués et 10 blessés, tous de la 22ème. (*)
L’artillerie tire ensuite, en représailles, plusieurs rafales. Les sentinelles sont placées devant les lignes, et les travailleurs se mettent au travail, tandis que les hommes de soupe descendent chercher le rata. Comme il n’y a pas de poste de secours d’organisé, les blessés sont pansés par les brancardiers et descendus aussitôt sur le poste central à Esnes.
Le médecin-major Toupet, malgré sa bonne volonté, ne peut rien faire au milieu du boyau et sans lumière.
Une vive fusillade se produit ensuite sur notre droite, et j’apprends plus tard que les Allemands sont sortis sur ce point pour une petite reconnaissance et qu’ils auraient laissé une quinzaine de cadavres sur le terrain.
Mais je ne sais si tout cela est vrai, bien que je le tienne de l’agent de liaison du bataillon de gauche à notre commandant. Je vais ensuite tâcher de me reposer ; il est une heure du matin.
(*) : Le JMO du régiment signale la perte de 2 hommes tués
et 12 blessés.
Le samedi 22 juillet
Je n’ai pu encore dormir, à cause du confort de ma chambre à coucher.
Si je parviens à sommeiller, c’est pour me réveiller 5 minutes après. En désespoir de cause, je suis debout à 5 heures. Le temps s’annonce magnifique, mais il fait très frais.
À 6 heures 40, la tranchée est évacuée comme il a été prescrit, les avions sont à leur poste, les mitrailleuses aussi, et le bombardement commence, tout d’abord très lent. Puis, en même temps que le 75, le 155 tire par salves de 4. La plupart des obus semblent « loupés », mais le Maréchal des logis en liaison (du75) nous explique que ce doit être des obus à fusée avec retard et qu’ils éclatent dans la terre, ce qui les rend beaucoup plus destructifs.
À 9 heures 30, le bombardement s’arrête et les compagnies reprennent leur place. Les Allemands n’ont pas répondu un seul coup de canon, et cette particularité m’étonne beaucoup, d’autant plus qu’ils peuvent très bien nous tirer dessus.
Nous mangeons ensuite la soupe. Il fait une chaleur torride.
L’après-midi, le tir qui devait avoir lieu est décommandé. Nous en profitons pour nous reposer. On dort beaucoup mieux que la nuit où il fait froid, et comme on ne peut faire aucun mouvement dans la journée, c’est ce que nous avons de mieux à faire. La nuit tombée, le combat à la grenade au petit poste de la 22ème reprend et dure une vingtaine de minutes avec accompagnement de torpilles.
Les hommes ont vu les Allemands hors des tranchées et nos mitrailleuses ont balayé tout le terrain à la suite de plusieurs fusées rouges lancées par nous ; l’artillerie se met en branle, et pendant une bonne demi-heure exécute un tir de barrage bien nourri. Puis tout se calme de nouveau. Nous avons encore 8 blessés.
À la tombée de la nuit, le vent étant favorable, on entendait très distinctement les Allemands travailler dans leurs tranchées. Plusieurs guetteurs en avaient même vus dehors et ont entendu des bruits comme s’ils coupaient l’herbe devant leurs parapets.
Ils ne tiraient pas au fusil comme les jours précédents.
Vers les une heure du matin, quand tout est à peu près rentré dans l’ordre dans notre secteur, nous entendons une intense canonnade dans le secteur de la rive droite.
Le JMO du régiment signale la perte de 1 homme tués et 10
blessés.
Le dimanche 23 juillet
Le tir de destruction qui devait avoir lieu ce matin dans les mêmes conditions qu’hier est décommandé. La relève du bataillon colonial qui se trouve à notre droite doit se faire ce soir. C’est le 4ème bataillon du 204 qui doit prendre la place. Il est en réserve à Miramas-Tarascon et nous a remplacés en cet endroit quand nous sommes montés en 1ère ligne.
Le bataillon de tirailleurs qui est à notre gauche doit également être relevé par un bataillon du 289ème.
Vers le soir, le vent fraîchit et j’ai peur de la pluie. Aussi j’arrange mon trou de mon mieux pour, le cas échéant, ne pas être trop envahi par l’eau.
Les journées paraissent terriblement longues, à mener cette vie de taupes pour laquelle nous n’avons pas été faits, d’autant plus que dans la journée il faut faire le moins de mouvement possible.
La nuit tombée, nous avons encore une petite séance.
En lançant une fusée lumineuse à la compagnie de gauche vers le petit poste où il y a tous les soirs un combat à la grenade, 5 ou 6 fusées prennent feu et partent en même temps. Il y avait parmi elles 2 fusées rouges qui servent de signaux pour demander le tir de l’artillerie.
Voilà aussitôt le tir de barrage déclenché, et on a toutes les peines du monde à l’arrêter, la communication téléphonique étant très difficile.
Pour cette fois, peut-être parce qu’il n’en était aucun besoin, nous nous rendons compte que les artilleurs veillaient. Le tir de barrage arrêté, nos batteries tirent ensuite à l’arrière où elles doivent arroser les ravitaillements, relèves et corvées.
Mais nous avons peur que ces tirs nous amènent des représailles et que nos relèves soient prises sous le feu de leur artillerie. Il n’en est rien et nous ne recevons pas un seul obus.
Cette petite séance a aussi calmé les hommes du petit poste, et ce soir ils ne donnent pas signe de vie. En face la compagnie de droite (21ème), les Allemands envoient quelques grenades à fusil qui n’arrivent même pas jusqu’à nos tranchées. Il y a une assez grande distance en cet endroit entre les 1ères lignes, 60 à 80 mètres, et l’ennemi se trouve en contrebas.
Le reste de la nuit est calme.
Dans la journée, le lieutenant Jouannais et les officiers de la 21ème étaient allés reconnaître le secteur de la 22ème compagnie, le commandant voulant relever cette compagnie de façon que les pertes ne soient pas toutes supportées par la même compagnie.
Elle a déjà 25 hommes hors de combat.
Le JMO du régiment signale la perte de 3 hommes tués et 20
blessés.
Cliquer sur la photo pour agrandissement
Le lundi 24 juillet
Un capitaine d’état-major vient à 5 heures pour se rendre compte des positions, spécialement dans le secteur de la 22ème compagnie.
Les brouillards d’hier soir sont dissipés et il fait un temps splendide. Les avions font montre d’une très grande activité et ils se baladent à une si grande hauteur qu’on les perd de vue dans le bleu de l’atmosphère.
Nous les entendons échanger quelques coups de mitrailleuses.
À 13 heures 45, sans prévenir, on nous fait évacuer notre tranchée dans le secteur de la compagnie de gauche (21ème) ; un peloton se case dans celui de la 23ème à gauche, l’autre dans le 4ème bataillon du 204 à droite. La liaison, avec les téléphonistes, nous restons dans l’entrée du boyau qui conduit au P.C. du commandant du 4ème bataillon où est allé le commandant accompagné du capitaine adjudant-major Prudon.
Le bombardement, comme celui d’avant-hier, dure 2 heures ½ durant lesquelles nous cuisons dans le boyau.
À 16 heures 30, la compagnie reprend ses emplacements.
En faisant le mouvement, le sergent Stanislas (*) est tué d’une balle en pleine tête, venue des tranchées allemandes de l’extrémité de l’éperon de la cote 304 qui nous prennent d’enfilade.
Le service médical et le commandant de la compagnie veulent enterrer ce pauvre Stanislas un peu en arrière des tranchées de 1ère ligne, où est déjà Béchon (**), de ma compagnie, en un endroit où, très probablement, les corps ne seront jamais retrouvés.
Je trouve bizarre que l’on ne mette pas un peu de bonne volonté pour descendre des isolés qui sont tués ainsi alors que l’on pourrait très bien le faire. Je vais en parler au commandant qui, lui, n’y voit aucun inconvénient.
Mais le médecin-major Toupet, qui a sur le cœur d’avoir été contraint de venir en 1ère ligne, se retranche derrière un ordre qu’il a demandé au P.C. du colonel lors de la mort de Béchon.
J’étais présent à ce moment au téléphone et on lui a répondu :
« Qu’ici on enterrait
les morts sur place ».
Il se base là-dessus et ne veut pas prêter une équipe de brancardiers.
Il dit qu’il ne veut pas engager sa responsabilité et qu’il pourrait avoir besoin des brancardiers pendant le temps qu’ils seront absents ; qu’il y a d’ailleurs un petit cimetière tout à côté qui est très bien. « C’est là qu’on vous enterrera ! », lui répond M. Jouannais qui est maintenant de mon avis. (***)
Il prend alors la chose en main, et le corps est descendu à Esnes.
Les brancardiers ne sont d’ailleurs pas longtemps absents, car ils passent au poste de relais qui est installé de l’autre côté du ravin de la Mort.
Durant ce temps, une note du colonel est arrivée prescrivant que 4 brancardiers seulement par compagnie resteront en 1ère ligne, et que les 3 autres, les musiciens, iront à Esnes.
Tout d’un coup, ils ne sont donc plus indispensables en 1ère ligne.
Cela me fait mal au cœur de voir qu’ainsi, du haut en bas de l’échelle, on mette tant de mauvaise volonté pour accomplir ce qui n’est en somme que le devoir le plus élémentaire.
À la tombée de la nuit, un combat à la grenade s’engage à notre gauche dans le secteur du 289 sur la cote 304. Des fusées rouges sont lancées. Notre artillerie commence à tirer devant notre compagnie de gauche, le barrage se déclenche également devant le 289ème.
Mais l’ennemi riposte presque aussitôt et il arrose tout notre secteur à shrapnels et percutants de petit calibre, tandis que de grosses marmites, passant au-dessus de nous, vont éclater à l’arrière sur les routes et les 2èmes lignes. Quelques obus allemands tombent entre les lignes, et l’un d’eux couvre ma toile de tente de terre.
Quand le calme est revenu, nous comptons 2 blessés à la C.M.6 et nous apprenons que le 289 avait envoyé des patrouilles en avant des lignes et qu’elles avaient été aperçues par l’ennemi. Il aura peut-être lui aussi cru à une attaque, ce qui expliquerait le déclenchement de son artillerie qui était muette ces jours derniers.
Les hommes de soupe pour lesquels nous craignions rentrent tous.
Je rentre dans mon trou ; il est une heure et demie.
Un peu avant la nuit, nous avons entendu un Allemand crier dans sa tranchée. Il venait d’être touché par une grenade à fusil lancée par le lieutenant Merle. En entendant ses hurlements de douleur, nous éprouvâmes tous un sentiment de pitié pour cet homme qui souffrait comme nous bien que ce fût un ennemi.
Quelle vie nous menons tout de même d’être ainsi continuellement à l’affût, tel le chasseur de son gibier et de se tuer mutuellement !
Le JMO du régiment signale la perte de 1 homme tués et 9
blessés.
(*) : Stanislas René Lucien, sergent,
mort pour la France à Esnes (cote 304) le 24 juillet 1916, tué à l’ennemi. Il
était né à Levis, canton de Toucy, Yonne, le 12 novembre 1891. Il est inhumé à
la nécropole d’Esnes, Meuse, tombe 1263.
(**) : BECHON MICHEL, soldat, mort pour la
France à Esnes (cote 304) le 22 juillet 1916, tué à l’ennemi. Il était né à
Thiers (63), le 26 octobre 1879. Pas de sépulture militaire connue.
(***) : Après cet épisode, le lieutenant JOUANNAIS sera
« aimé » par ses soldats. Il sera malheureusement tué le 24 septembre de cette même année.
Alexandre et d’autres soldats iront souvent fleurir sa tombe.
Le mardi 25 juillet
Je suis réveillé à 4 heures 30 par Guinard, le fourrier de la 23ème, qui amène du P.C. du commandant le capitaine Farnier pour que je le conduise au lieutenant Merle qui est désigné comme officier observateur.
Le lieutenant Mathey l’accompagne. Le capitaine Farnier, qui est depuis peu au 204ème en qualité d’ « officier de renseignements », explique à M. Merle qu’il passera tous les 2 jours prendre toutes les observations qui auront été recueillies au sujet des travaux.
Le colonel veut savoir mètre par mètre où en sont les travaux, la largeur et la profondeur des sapes et tranchées, les modifications qui y seront apportées au jour le jour, etc. Ils vont tous deux commencer à relever ce qui existe en commençant par la compagnie de gauche.
Arrivé au petit poste de la 21ème, le capitaine est tué d’une balle qui le frappe dans la bouche et sort derrière le cou (*). On en avertit aussitôt le colonel et le commandant CHALET qui était à ce moment dans le secteur, accompagnant le colonel Collon qui commande la brigade.
Celui-ci écourte sa visite et ne vient pas jusque vers nous. Le corps du capitaine est laissé sur une banquette de tir et sera descendu à Esnes ce soir.
Aucune difficulté ne surgit à ce sujet.
Peu après passe une note demandant aux compagnies ce qui leur serait nécessaire comme matériel pour assurer la sécurité relative aux tranchées. Allons, on s’aperçoit qu’il y a tout de même quelque chose à faire et que l’on peut s’épargner d’être tué comme à la cible.
C’est tout de même regrettable qu’il ait fallu tous ces accidents, et notamment la mort d’un capitaine, pour faire prendre à notre commandement l’initiative d’aménager un peu les tranchées.
Vers midi, un veilleur de ma compagnie, qui est tout à côté, de moi me prévient qu’il observe des Allemands qui vont et viennent sur la crête du Mort-Homme.
Tout d’abord et à l’œil nu, je ne distingue rien, ne connaissant pas bien l’emplacement qu’il me désigne, mais à l’aide d’une jumelle, je vois ensuite distinctement des hommes qui passent sur la crête et à proximité de petites buttes de terre qui ont tout l’air d’anciens emplacements de batteries.
Comme le mouvement continue, je préviens le lieutenant Jouannais. On devrait demander un tir d’artillerie sur ce point, mais M. Jouannais ne le fait pas.
Je fais alors prévenir le commandant CHALET par Dumans qui m’apporte une note en communication.
Le soleil perce l’écran des nuages et la chaleur devient torride.
A la nuit, notre artillerie tire beaucoup et à longue distance.
(*) : FARNIER Jean
Claude, capitaine, mort pour la France à Esnes, ambulance 1/68, suite de
blessures de guerre. Il était né à Lyon, le 9 août 1868. Il est inhumé à la
nécropole de Brocourt-en-Argonne, Récicourt (Meuse), tombe 141.
Le mercredi 26 juillet
Nous sommes prévenus par téléphone qu’un tir de destruction sur la
tranche 2, entre les tranches 1 et 3 déjà battues aura lieu à partir de 8
heures et dans les mêmes conditions que précédemment.
Ce tir devait avoir lieu hier dans l’après-midi, mais il est probable
que l’aviation aura trouvé que les conditions de visibilité étaient
défectueuses et il fut remis. Ce sont au contraire les Allemands qui
exécutèrent un tir de réglage avec leur artillerie de gros calibre, et les
avions ennemis survolèrent nos lignes sans être beaucoup inquiétés durant une
bonne partie de l’après-midi.
Le tir de ce matin devant se faire sur la droite du bataillon de
gauche, la 21ème compagnie devait évacuer une partie des tranchées occupées par
elle et faire serrer la valeur d’une section et demie sur le reste de la
compagnie.
Le capitaine adjudant-major, le médecin, le téléphone et la partie de
la liaison se trouvant dans la zone dangereuse doivent évacuer également. Il
n’y a donc plus de communication téléphonique, le central, fait inouï, se
trouvant en 1ère ligne en cet endroit, en attendant que l’abri du commandant à
la tranchée de Martigues (ligne de soutien) soit terminé. Le commandant
CHALET se trouve à ce moment dans le secteur de la 22ème compagnie,
accompagnant le lieutenant-colonel Lachèvre.
Le bombardement dure jusqu’à 10
heures 30.
De nombreux obus tombent à l’arrière de notre propre tranchée. Je ne sais si le but que l’on se proposait est atteint et si les ouvrages des Allemands sont détruits.
En tout cas un 155 est tombé en plein sur notre tranchée au P.C. du lieutenant Jouannais et a tout bouleversé. Le trou qui servait de lit et de bureau au sergent-major et plusieurs autres niches servant à la liaison de la compagnie et l’ordonnance du lieutenant sont complètement retournés. Il faut remuer des mètres cubes de terre pour retrouver la comptabilité et les vivres des officiers, sacs, etc. La terre est mise dans des sacs et le parapet est refait le soir dès la tombée de la nuit.
Nous avons 2 blessés par des éclats de nos 155. (*)
Le matin, durant sa visite du secteur, le colonel a décoré 2 hommes (**) de la 22ème qui ont été cités à l’occasion de l’attaque du petit poste. Il a trouvé que les travaux n’avancent pas assez vite, ou plutôt que le secteur n’est pas assez aménagé, et suivant ses instructions tout doit être fait en un clin d’œil.
Il règle lui-même un « tableau de service » : la nuit, tout le monde veille ou travaille ; le matin jusqu’à midi est consacré au sommeil ; de 13 heures à la nuit, les compagnies doivent faire un emploi du temps comprenant nettoyage et aménagement des tranchées et boyaux, abris, feuillées, nettoyage des armes, etc.
Il commence à faire travailler dans la journée des équipes dans les sapes. Comme elles sont en pleine vue de l’ennemi qui nous surplombe et nous prend d’enfilade de l’extrémité de la cote 304, ce n’est pas bien prudent et pourrait avoir des résultats déplorables.
Le colonel a aussi demandé à quel endroit a été tué le capitaine Farnier.
Comme le lieutenant Hermet voulait l’y conduire, il n’a pas insisté. Il sait cependant très bien, d’après ceux qui l’ont vu « faire carapace ». Il me paraît qu’il ne se rend pas un compte bien exact des réalités de la tranchée, ce qui bien entendu n’enlève rien des qualités dont il peut faire montre dans l’exécution d’ouvrages littéraires que le ministère de la guerre, qui les publie, doit apprécier à leur juste valeur.
La technique et l’art de présenter les choses mettent souvent plus vite un homme en vue que l’action pratique ; c’est aussi infiniment moins dangereux et l’on peut écarter le danger des responsabilités.
Mais après tout, tout ceci n’est que des impressions personnelles.
Un journal qui me tombe dans les mains m’apprend que les Russes continuent, en l’élargissant, leur offensive et qu’en Courlande, ils auraient avancé sur un point d’une vingtaine de kilomètres.
Dans la Somme, les combats continuent, sanglants. L’aviateur Marchal aurait, à la fin du mois dernier, survolé Berlin où il a lancé des proclamations et ensuite est allé atterrir en Pologne, près de Cholm, où il a été fait prisonnier.
Quel est donc ce nouveau bluff ?
Et quel en est le résultat pratique ?
Est-ce une expérience que l’on a voulu faire ?
Les égoïsmes et les intérêts particuliers se démènent à l’arrière pour tirer parti de la situation et tâcher de s’implanter solidement dès la fin de la guerre.
Sous couleur de défense nationale, et avec un peu d’encens aux « héros qui luttent et qui meurent pour notre affranchissement du joug de l’hégémonie allemande », cela passe très bien dans les journaux.
Hélas, les quelques « héros » qui auront échappé à la tuerie auront bien de la peine, je le crains, à se frayer un passage à travers toutes les libertés qu’ils auront conquises et après la guerre il leur faudra encore certainement lutter et conquérir leur place économique pour laquelle les gens qui sont à l’arrière travaillent avec tant de désintéressement.
A la nuit, le commandant Fabiani du 5ème bataillon vient au P.C. du chef de bataillon, 24 heures avant la relève, suivant les ordres de la 2ème armée, et les officiers viennent reconnaître le secteur qu’ils prendront demain soir.
Les permissionnaires, contrairement aux ordres donnés, ne partiront pas avant la relève, mais seulement quand nous serons au repos.
(*) : Il s’agit de GALLON Daniel et de BERNIER Emmanuel.
(**) : Il s’agit du sergent THIERS Henri et du caporal
LAMOTTE Marcel, tous deux décoré de la médaille militaire.
Le jeudi 27 juillet
Des ordres de détail sont donnés pour la relève ; le bataillon se rassemblera au bois de Béthelainville où il mangera la soupe, et il partira pour Blercourt où il embarquera.
Nous devons aller au repos pour 10 ou 12 jours près de Bar-le-Duc. J’entends parler de Robert-Espagne, mais ce n’est pas très sûr.
Dans la journée, les Allemands tirent quelques obus, mais presque tous en arrière des 1ères lignes. Mais nos artilleurs leur rendent la monnaie de leur pièce, et avec usure.
Durant toute cette période de tranchées, je constate que nous leur avons envoyé plus de 10 fois autant d’obus qu’ils nous en ont eux-mêmes envoyé.
Dans l’après-midi, il tonne et fait de l’orage quelque part, mais nous n’avons pas d’eau. Nous aurons eu de la veine de passer notre période sans une goutte de pluie, chose appréciable.
J’apprends le soir que nous devons aller au repos à Trémont.
La liaison part avec le capitaine Café qui lui-même a donné rendez-vous à ses sections au bois de Béthelainville. Nous descendons en vitesse jusqu’au moulin où nous faisons une petite pause.
Sur les pentes de la cote 304 et dans le ravin de la Mort que nous traversons toujours sur des caillebotis jetés en travers des trous d’obus pleins d’eau, nous sommes désagréablement impressionnés par des relents de cadavres.
En arrivant au moulin, ma chemise est déjà mouillée, la route est très dure et nous avons marché vite.
Nous faisons les montagnes russes, car le sentier qui longe le boyau passe d’un trou d’obus à un autre. Le boyau n’est lui-même pas davantage praticable et n’offre pas plus de sécurité.
Heureusement, il ne fait pas trop sombre et nous voyons à peu près où nous marchons.
Nous prenons ensuite la route de Montzéville, qui est littéralement encombrée par les corvées, les cuisines qui apportent la soupe, les ravitaillements en munitions, en matériel, etc. Même les petits bourriquots du bois de Béthelainville qui arrivent chargés de matériel ; il y en a une cinquantaine qui se suivent à la queue leu leu.
Il n’y a que 2 marocains pour les conduire ; un en tête, un derrière. Nous avons la chance de ne recevoir aucun obus. Nous rattrapons des sections de la 23ème compagnie qui sont parties avant nous.
Je saute alors sur une voiture de mitrailleuse qui était venue ravitailler et je me cramponne pour ne pas tomber, car la mule, poussée par son conducteur, s’en va au galop, et nous passons à cette allure devant tous les convois ; je m’étonne que nous ne versions pas dans les trous d’obus ou les fondrières à travers lesquelles nous passons.
Après mon arrivée au bois de Béthelainville, plusieurs obus tombent dans le bois, et Riboux, qui n’est jamais monté aux tranchées, en profite pour nous prouver qu’il est très en danger à l’arrière.
Les compagnies arrivent petit à petit, la 21ème arrive la dernière, alors qu’il fait grand jour.
Puis voici le commandant CHALET qui donne des ordres pour le départ. Le T.C. partira aussitôt prêt et se rendra à Trémont en 2 étapes. Le bataillon quittera le bois de Béthelainville à 8 heures.
Le vendredi 28 juillet
Il fait chaud sur la route et nous sommes tous fatigués.
Le général de Maud’huy vient nous rendre visite à l’emplacement désigné pour l’embarquement.
Il distribue encore des paquets de tabac qu’il jette à la volée. Cela l’amuse énormément de voir ces hommes âgés se précipiter en se bousculant pour attraper un paquet de tabac.
Les autos arrivent et nous embarquons avant le 276 qui était cependant arrivé le 1er.
Nous filons aussitôt tout en sommeillant dans les voitures.
Après près de 4 heures de route, vers les 2 heures ½, nous arrivons enfin au terme du voyage ; nous avons traversé Bar-le-Duc.
Nous débarquons à l’entrée du village et nous allons aussitôt faire les cantonnements. Je suis rompu de fatigue.
Le commandant nous fait attendre au moins 1 heure ½, tandis qu’il discute avec le major du cantonnement et ensuite il nous donne 10 minutes pour faire le cantonnement qui est soi-disant tout fait.
Mais là où je dois placer ma compagnie se trouve du 112 et le commandant m’envoie balader quand je lui en rends compte et il fait rentrer aussitôt le bataillon. Je suis donc obligé de loger ma compagnie au petit bonheur et dans des maisons qui ne nous sont pas affectées.
Le samedi et le dimanche
Les hommes se reposent et se nettoient. Il y a de l’eau ici à volonté, ce qui est agréable. Nous avons un tas de paperasses à copier et à communiquer.
Le général de Maud’huy est plein de bonnes intentions pour laisser reposer les hommes, mais cependant il faut reprendre la troupe en main, exercer les spécialistes, etc.
En résumé, à partir de lundi, les compagnies vont à l’exercice et les hommes sont plus ennuyés qu’à la caserne. Un grand nombre de femmes viennent voir leur mari, notamment les femmes d’officiers.
Mais ils ne peuvent l’avouer au commandant qui doit tout ignorer, d’autant plus qu’il leur fait des théories à ce sujet. C’est ainsi que l’on voit passer dans la rue M. Viault avec sa femme 20 mètres derrière lui, ou encore M. Jouannais qui mange en popote avec le commandant, tandis que sa femme mange seule 2 maisons plus loin.
Le commandant connaît très bien tout ce qui se passe et il est heureux de pouvoir être désagréable aux officiers dans ce cas. Il exige qu’ils aillent tous à l’exercice, même aux douches, et il fait marcher tout le monde, même son ordonnance et les fourriers et sergents-majors.
Il relève un de ses cuisiniers sous prétexte qu’il était sorti du cantonnement sans autorisation. Il était allé chercher des provisions pour leur popote à Robert-Espagne sur l’ordre de M. Toupet. Le commandant doit être jaloux et n’a pas dû réussir dans son entreprise de conquête de la dame où est installée sa popote, alors qu’il sait que d’autres officiers ont eu ses faveurs.
Août 1916 : Cote 304, les bastonnades du commandant CHALET
Le vendredi 4 août
Le commandant fait un cours de lancement des obus Vivien Bessières auquel tous les sous-officiers devaient assister. Il n’avait pas parlé des officiers et il les envoie chercher.
La crise continue.
Un nouveau cours aura lieu le lendemain et durera 3 heures. Tous les officiers, sous-officiers et capitaines seront présents.
Il demande un rapport pour M. Merle que l’on n’avait pas trouvé et que l’on avait fait passer comme assistant à l’exercice des grenades. Mais le commandant savait très bien (par qui et comment ?) qu’il était en galante compagnie et il n’aime pas beaucoup que l’on marche sur ses plates-bandes.
Je suis allé à l’exercice 2 jours ; mais je ne trouve pas nécessaire de faire 5 ou 6 kilomètres pour aller m’asseoir dans l’herbe et le samedi je ne bougerai pas.
Des petits ballons libres lancés par les Allemands atterrissent dans la région. Ils contiennent des proclamations disant que nos aviateurs ont tué des femmes et des enfants dans les villes libres ; dans cette proclamation adressée aux Français et datée de Berlin du 26 juillet, l’Angleterre est fort malmenée ainsi que Poincaré.
En somme, rien de bien intéressant.
Le beau temps continue et j’en profite pour aller tous les jours prendre un bain dans la Saulx.
À proximité de l’usine de bleu, il y a un barrage, ce qui forme une baignoire magnifique. Il y a 4 ou 5 mètres d’eau, mais elle n’est pas très chaude.
Toute la région est très agréable, et il doit faire bon vivre par ici en temps de paix. Mais comme partout c’est rempli de troupe, ce qui change complètement les conditions de vie du pays et même les mœurs des habitants.
A quelque distance de Trémont se trouve le château de Jean d’Heurs où est installé un hôpital. Nous avons traversé le parc en revenant de l’exercice. C’est une magnifique propriété au milieu de laquelle coule la Saulx.
Dans le parc, qui est un peu négligé depuis la guerre, ont été réunies les plus diverses essences d’arbres et c’est aménagé de telle façon que toute monotonie est exclue et chaque pas offre un coup d’œil différent.
J’ai entendu dire que cette propriété avait 27 kilomètres de tour et qu’elle avait été donnée par l’Empereur au Maréchal Oudinot.
Le samedi 5 août
M. Merle a 4 jours d’arrêts de rigueur et il mange dans sa chambre.
Mais dès que le commandant est parti, il sait où aller et il en profite. M. Hermet a lui aussi sa part. Le commandant redevient de meilleure humeur ; la crise se passe.
Le lieutenant-colonel Lachèvre va trouver les compagnies à l’exercice du matin et il leur fait une théorie sur la manière de piocher et de creuser des sapes et des tranchées.
Il attrape le sergent Quintus de la 22ème compagnie qui avait eu une belle conduite lors du combat à la grenade à la cote 304 et il lui fait remarquer qu’un des hommes de sa ½ section a une musette à laquelle il manque un bouton, un autre a ses épaulières mal cousues à son avis, etc.
C’est vraiment à se demander si nous sommes ici pour faire la guerre, pour repousser l’ennemi, ou bien pour faire les pantins et servir de marchepied à une certaine catégorie de gens.
Le colonel Lachèvre exige que le bataillon travaille à faire des tranchées et des sapes comme exercice, ce dont le commandant CHALET ne voulait pas entendre parler, et il donne en conséquence tous les ordres de détails.
On creusera d’abord une parallèle de départ, puis on travaillera à l’avancement de sapes, chaque compagnie en ayant 2, de modèles différents. On travaillera 48 heures consécutives, des sous-officiers chefs de sapes et des caporaux adjoints étant en permanence sur le terrain où ils monteront la tente.
On devra faire des tranchées et boyaux modèles, comme naturellement il sera impossible de le faire sous les balles et les obus.
Le dimanche 6 août
La parallèle de départ n’ayant pu, vu les difficultés du terrain, être terminée la veille au soir, les compagnies vont y travailler le matin.
J’ai appris par un cycliste que le 317ème, où est Gaston Bonnot, est à Brillon, à une dizaine de kilomètres. Je demande une permission et me mets en route pour aller le voir.
Je profite du ravitaillement du D.D. (*) et pars avec Cachon qui est venu nous voir. Je fais le chemin en voiture jusqu’à Saudrupt, où je déjeune avec les sous-officiers de la 24ème compagnie. Je vais ensuite à Brillon, où j’apprends que mon beau-frère a été blessé à Froideterre au cours de la dernière attaque que son régiment a faite quelques jours auparavant.
D’après les renseignements que me donne le sergent-major de sa compagnie (la 12ème), il ne doit pas être blessé très gravement.
Tant mieux, le voilà pour quelque temps à l’abri à l’arrière.
Je rentre le soir à Trémont et ai fait une course pour rien.
(*) Dépôt divisionnaire
Le lundi 7 août
Les travaux d’exercice commencent le matin ; chaque chef de sape doit tenir un carnet d’attachement, et le colonel fait de fréquentes visites au chantier. C’est cela qu’on appelle le repos ! Nous nous faisons photographier, la liaison ensemble.
Le mardi 8 août
L’ordre arrive dans l’après-midi pour partir demain.
Nous devons aller à Waly ; nous serons enlevés probablement en camions. Les travaux sont donc terminés à 20 heures.
Le mercredi 9 août
Les autos viennent nous prendre à 6 heures.
Le 289ème, le bataillon qui était à Trémont, embarque en même temps que nous. Nous passons par Bar-le-Duc, puis d’autres villages, Fleury, et arrivons enfin à Waly. Nous avons avalé de la poussière à profusion. Le cantonnement est vivement fait, tout notre bataillon est logé dans une grande ferme, et les officiers ont tous des lits dans le pays.
Les maisons sont à moitié bâties en planches ; il y a un petit château entouré d’un parc ; le village est assez propre.
Le vaguemestre qui arrive à 9 heures ½ du soir, m’apporte une terrible nouvelle.
Adrien (*) a été tué dans la Somme.
Voici 2 ans aujourd’hui que j’ai quitté Auxerre et me voilà seul de nous restant sur le front. Quel chagrin doit avoir Rachel ! Quand donc cette tuerie finira-t-elle ?
Nous restons à Waly jusqu’au dimanche 13 août où nous nous mettons en route à 6 heures du matin pour le bois de Béthelainville. Les ordres reçus la veille disaient de faire un long repos au bois Saint-Pierre.
Nous devons être à partir de 21 heures à la disposition du général commandant le groupement. Le temps est couvert, il ne fait pas trop chaud. Nous prenons le même itinéraire que la dernière fois : Froidos, Rarécourt, Jubécourt, et de là nous passons par une piste qui nous mène directement au bois Saint-Pierre où l’on nous fait faire de grands zigzags avant de nous amener tout près de l’emplacement où nous étions la dernière fois.
Nous y arrivons à 11 heures et nous repartons à 13 heures pour le bois de Béthelainville.
Là, on nous place sur la côte à gauche de la route où de solides abris ont été faits pour tout un bataillon. Il y a aussi des réservoirs d’eau et des pompes et l’eau est amenée par la voie de 0,60 mètres dans des wagons-citernes. C’est la 1ère fois que je vois terminé un travail d’ensemble pour abriter les hommes.
Au-dessus du bois se trouve un poste de T.S.F., tout en haut de la crête.
Nous passons la nuit dans les abris.
(*) : Son beau-frère
Le lundi 14 août
Quelques obus tombent non loin de nous, dans la vallée, et les nombreux cuisiniers de toutes sortes de régiments qui sont en bordure du bois commençaient à se défiler. C’est le manque d’habitude.
Les chevaux qui sont parqués dans ces emplacements n’ont pas l’air de s’en soucier beaucoup. Des trains passent chargés de matériel et de munitions. Il y a un parc du génie tout près de nous. Il n’y a plus de boue et c’est un peu plus propre que la dernière fois, mais que d’ordures, que d’objets hétéroclites traînent de tous côtés ! J’ai toujours un cafard monstre et je suis fatigué.
Je sens que je ne suis plus bien costaud ; 2 ans de cette vie que nous menons sont lourds à porter.
L’ordre arrive de partir le soir à 20 heures pour aller en 2ème ligne, à Miramas-Tarascon.
Les guides nous conduisent.
Nous évitons Béthelainville que nous laissons sur notre droite, ce qui nous raccourcit un peu, puis nous passons par Vignéville et, après avoir suivi quelque temps la route, nous longeons le boyau de Chartres. Quelques obus tombent sur Montzéville à notre gauche, et nous entendons dans la nuit dégringoler les tuiles des toits.
Nous arrivons à Tarascon sans autre encombre qu’une averse qui ne dure pas. Les compagnies sont placées à peu près dans les mêmes emplacements que la dernière fois. La 21ème doit fournir 2 corvées de 50 hommes pour porter du matériel au boyau du Prado. Sous la conduite de guides du 412 que nous relevons, elles vont à Esnes où elles ne trouvent pas le distributeur du matériel.
Le commandant est resté à Tarascon où il y a quelques abris à l’épreuve « de la pluie ».
Il n’y a eu rien de fait dans les tranchées où est la 21ème ; mais de nombreux obus y sont tombés ; il n’y a plus d’eau, c’est déjà quelque chose.
Peu après notre arrivée, nous voyons très loin sur notre droite une profusion de fusées de toutes couleurs et de nombreuses lueurs de coups de canon. Mais le vent étant contraire, nous n’entendons pas les coups. Il doit y avoir une attaque du côté de Fleury.
Puis tout redevient normal.
Je me mets en devoir de nettoyer
un peu l’abri que je me suis affecté avec Guinard
et, les ordures enlevées, nous allons non loin
de là sur la route chercher des planches que nous posons par terre pour nous
coucher.
Le mardi 15 août
L’artillerie ennemie fait preuve d’une grande activité ; elle bombarde
surtout avec des obus de gros calibre nos positions de seconde ligne ainsi que
les routes et les pistes. Du point où nous sommes, nous ne voyons guère que
notre 75 qui répond en arrosant les tranchées de 1ère ligne ennemies sur
lesquelles il ne doit guère être efficace.
Une section de discipline a été formée dans le groupement AB.
Les hommes qui la composent ont été proposés par les commandants de
compagnie. Ceux du 6ème bataillon du 204 sont partis de Trémont. Il en
est parmi eux qui ne sont pas bien terribles. Ils ont peut-être eu le tort de
déplaire momentanément à leur chef.
L’un d’eux même, du 289, n’a jamais eu de punition et il a été envoyé parce qu’il était boiteux et ne pouvait jamais suivre sa compagnie. C’est bien le régime du bon plaisir, et il est pénible de voir ces choses. Cette section de discipline est dans la tranchée tout près de nous ; les hommes vont travailler la nuit, et l’on met ½ section pour les garder.
Dans la matinée, le commandant CHALET fait le tour des tranchées occupées par le bataillon ; comme il trouvait dans le boyau des hommes qui n’avaient pas leur équipement ou qui le gênaient pour passer, il commence à leur donner des coups de bâton à tort et à travers ; il s’attire même de fermes répliques, ce qui ne lui rend pas sa bonne humeur.
Plus loin, il réveille des hommes qui avaient travaillé toute la nuit et qui se reposaient pour leur faire le reproche qu’ils n’avaient pas leur équipement sur eux.
Le soir, à la nuit tombante, 6 hommes de la section de discipline, suivis par 2 hommes de garde baïonnette au canon passaient devant le P.C. pour aller chercher la soupe dont la distribution se faisait à 25 mètres environ, où elle est apportée par des mulets de bât. Le commandant CHALET trouve d’abord que c’est trop d’hommes pour cette corvée, puis voyant des bidons, il demande leur emploi.
Le caporal qui conduit la corvée répond que c’est pour le vin et le café. Il dit alors que l’on ne devrait pas donner de vin aux hommes de la section de discipline et qu’ « il verra ça ».
À ce moment arrive un retardataire qui marche en boitant et s’appuie sur un bâton. Je suppose que c’est celui du 289 dont on m’a déjà parlé.
Sur la demande du commandant, il répond qui il est et où il va, qu’il est boiteux et ne peut suivre les autres. Le commandant saute alors sur lui en disant :
« Je vous donne
l’ordre de prendre le pas de gymnastique ! »
L’homme est tout estomaqué ; il répond qu’il est boiteux, et cela très poliment, puis n’ayant plus qu’une quinzaine de mètres à parcourir, continue sa route ; le commandant lui laisse à peine le temps de se retourner ; il lui arrache sa canne des mains en disant :
« 2 hommes ici pour le fusiller ! »
Puis il lui assène 5 ou 6 coups de bâton bien appliqués.
L’homme se contient et, voyant que toute explication est inutile, se tait après quelques protestations. Le commandant le quitte d’ailleurs aussitôt et il rejoint ses camarades. Mais je ne doute pas que ces coups de trique donnés dans la journée n’aient fait l’objet de longues conversations dans la tranchée.
Serait-ce donc là les « héros de Verdun » qui recevraient sans mot dire la bastonnade ?
Les journaux nous offrent des pages entières de littérature sur lesquelles sont étalés à loisir les « cruautés », les « mauvais traitements » infligés aux prisonniers par les Allemands, que certains ont été frappés à coups de bâton, etc.
Quelle est donc la différence avec ici ?
Une seule : c’est que ceux qui les reçoivent ici combattent et donnent leur vie pour le Droit, pour la Justice, pour la Liberté, etc. Puis, peut-être que ceux qui sont ainsi donnés par les chefs sont plus « paternels », sont « donnés en camarades ».
Le moral des hommes qui sont depuis si longtemps dans les tranchées, qui mènent une telle vie depuis deux ans, et qui ne tiennent que par raison, n’est cependant déjà pas très brillant.
Tout ce qu’ils voient journellement, tout ce qu’ils endurent n’est pas fait pour leur donner du cœur, et ce n’est pas avec des coups de trique qu’on obtiendra un bon résultat.
Le réveil pourrait bien être terrible.
Le mercredi 16 août
L’artillerie allemande fait encore preuve de beaucoup d’activité ; les pentes Est de la cote 304 sont beaucoup bombardées avec du gros calibre, ainsi que le prolongement de la tranchée Miramas où est la 21ème, près de la route qui va à Esnes.
Le temps, bien que nuageux, se maintient toujours beau.
Les compagnies continuent de fournir environ 110 travailleurs toutes les nuits, le maximum qu’elles peuvent fournir. Des corvées transportent du matériel d’Esnes jusqu’au boyau du Prado, tout près des 1ères lignes ; d’autres creusent des abris et font des tranchées de soutien.
Une compagnie, la 22ème, travaille tout près de son emplacement, car elle doit rester pour garder l’ouvrage de Tarascon où nous sommes en cas d’imprévu.
Le jeudi 17 août
Toute la journée, nous voyons une violente canonnade sur la rive droite de la Meuse. Nous apercevons distinctement les éclatements et les colonnes de fumée qui obscurcissent l’horizon, mais, chose bizarre, nous n’entendons pas le bruit du canon ; à peine un léger bourdonnement.
À 11 heures 30, un ordre parvient au bataillon du P.C. de la brigade cote 310.
Une compagnie doit partir dès réception de l’ordre et prendre position en soutien du bataillon de gauche du groupement A, c’est-à-dire à la tranchée de Martigues. C’est la 23ème qui est désignée, et la 21ème va prendre sa place à la Rascasse.
Chaque homme est muni de 2 grenades. Le mouvement s’effectue sans attirer l’attention de l’ennemi. C’est une chance car, notamment au ruisseau d’Esnes et dans le ravin de la Mort, il faut passer à découvert.
Nous avons ensuite l’explication de ce mouvement. Le bataillon de 1ère ligne se serait aperçu que l’ennemi a enlevé des fils de fer devant sa tranchée, ce qui supposerait une attaque de sa part, et d’autre part une compagnie ayant subi des pertes sérieuses a dû être renforcée par le peloton de réserve.
A la nuit tombante, la pluie se met de la partie. Je rentre dans mon gourbi, n’ayant rien à faire dehors.
Le vendredi 18 août
Vers les 7 heures, nous recevons l’ordre de relève pour le soir. Nous remplaçons le 412 en 1ère ligne. La 21ème ira dans la tranchée Kieffer où était la 22ème la dernière fois, qui reste en réserve à la place de la 23ème, laquelle prendra les tranchées occupées précédemment par la 21ème.
Je vais à la Rascasse communiquer l’ordre, et comme il tombe encore une petite pluie fine qui empêche les vues, je peux passer à découvert.
Vers les 10 heures, le temps se découvre et le soleil fait sa réapparition. Dans la matinée, un obus ennemi tombe non loin de nous sur un dépôt de munitions, car aussitôt nous entendons distinctement plusieurs explosions et nous voyons une grande fumée s’élever derrière une petite crête vers le sud.
Ce dépôt ne devait pas être bien important. Néanmoins, les artilleurs ennemis prennent ce point comme cible et ils envoient quelques salves d’obus de gros calibre.
En allant à la Rascasse, j’ai encore fait la constatation de la quantité de matériel de toute sorte qui traîne partout dans les boyaux, le long des pistes et des chemins. Justement, je viens de lire sur le « Parisien » un article de Brousse préconisant les économies.
N’y aurait-il pas là quelque chose à faire et, au lieu très souvent de faire venir du matériel de l’arrière qui n’arrive jamais à temps, ne pourrait-on faire ramasser tous ces rouleaux de fil de fer, ces caisses de grenades et de cartouches, ces outils qui se perdent et s’enterrent petit à petit ? Ils ont été abandonnés par des corvées un jour de bombardement, par des hommes blessés, etc.
Je vois aussi un tube de canon de 120 qui a l’air d’être intact et qui pourrait bien être retourné à l’arrière de même que les nombreux fusils et équipements sur lesquels on marche à chaque pas.
La tranchée de la Rascasse est bombardée dans la journée.
Cornille, encore un du début, est tué (*) et le caporal Masse blessé. L’obus est tombé exactement à l’entrée du tunnel qui passe sous la route de Béthincourt à Esnes et qui sert de poste de commandement.
C’est à cet endroit, dans le boyau, que mangeaient les officiers, et si le hasard l’avait fait tomber au moment de la soupe, il y aurait eu davantage de victimes.
Ce pauvre Cornille !
Justement le matin, il disait qu’après 2 ans de guerre il restait encore à la compagnie une cinquantaine d’hommes du début, et je lui répondais que d’abord il n’en restait pas 50, puis que ceux qui restent sont des gens qui ont, comme lui et Larcher, ont été la plupart du temps embusqués et restaient loin des lignes. Il avait été longtemps ordonnance du cheval du capitaine Poitevin.
2 heures après, il était tué !
Le commandant part en 1ère ligne après avoir déjeuné. La liaison, téléphonistes, pionniers, etc. quittent Tarascon dès la tombée de la nuit et les fourriers attendent les compagnies du 4ème bataillon pour les conduire sur leurs emplacements.
Quand ce bataillon arrive, les compagnies font la pause, tandis que les Chefs de section vont reconnaître les tranchées, ce qui provoque une « pagaille ». Heureusement que l’ennemi ne bombarde pas.
Ma mission terminée, je prends le chemin de la 1ère ligne.
En traversant le ravin de la Mort, je constate que l’on a fait des barrages de sacs et des barrières de treillage sur lesquelles on a attaché des sacs à terre pour masquer les vues, car on ne peut, en cet endroit, creuser le boyau, car une source ou un petit ruisseau descendait de ce ravin et se répand maintenant dans les trous d’obus qui ont complètement modifié le terrain.
J’arrive vers minuit au P.C. du chef de bataillon et je me mets aussitôt en devoir de chercher un logement, car les abris ne sont pas terminés. C’est à peine même s’ils sont plus avancés que quand nous avons quitté la tranchée à notre dernière période.
Je trouve enfin place dans un coin de boyau que j’aménage à l’aide de ma toile de tente et d’une capote et une couverture ramassées dans les parages. La relève est terminée et il n’y a pas eu d’accident.
Il est près de 3 heures et le jour paraît déjà quand je me couche.
(*) : CORNILLE Louis,
soldat, mort pour la France le 18 août 1916 à la cote 304, tué à l’ennemi. Il
était né à Bannay (Cher), le 1e janvier 1886. Il est inhumé à Esnes, tombe 728.
Le samedi 19 août
Le commandant me réveille à 6 heures et m’emmène avec lui dans sa visite du secteur.
Un fort brouillard enveloppe toute la campagne, ce qui nous permet de gagner le saillant Kieffer par un boyau qui grimpe la côte et qui est complètement comblé.
Si le temps était clair, l’ennemi qui est dans le bas pourrait nous canarder à son aise. Nous passons sans encombre et arrivons à la 1ère ligne à la limite du quartier A. Nous parcourons ensuite toute la 1ère ligne.
Dans le saillant Kieffer, tous les petits postes ont été reliés par une tranchée qui forme maintenant la 1ère ligne. L’ennemi est à certains endroits à une vingtaine de mètres, mais nous le dominons partout et avons maintenant des vues sur ses tranchées.
Il en est de même au pied de l’éperon, dans la tranchée Reboul.
Il y a eu beaucoup de travail de fait depuis notre dernière période de tranchées, mais quelle désolation encore dans le saillant Kieffer !
Là, on s’est furieusement battu pour la possession de ce bout de la cote 304. Tous les trous d’obus sont des tombes qui ont été comblées par d’autres obus. On rencontre encore des cadavres et l’un d’eux, comme dans une vision tragique, crève de sa main la paroi du boyau !
Du matériel de toute sorte (fusils, sacs, équipements, caisses de munitions) git épars sur la terre ravagée, déchiquetée.
Nous sommes maintenant assez bien organisés et nous avons des munitions en quantité pour répondre à l’ennemi.
Notre bataillon emploie pour la 1ère fois les obus « Viven-Bessières » qui se lancent au fusil à l’aide d’une espèce de tromblon que l’on adapte au bout du canon.
Quand le tir est réglé, ces obus donnent de très bons résultats et ils ont l’avantage que l’on peut toujours se servir du fusil comme à l’ordinaire. Le poids du tromblon n’est pas bien grand.
Du saillant Kieffer où est la 21ème, on domine toute la ligne allemande et française jusque près du Bec, dans la direction du Mort-Homme. Pour ne pas être pris d’enfilade, les Allemands ont établi des ponts de sacs à des distances très rapprochées, mais on les voit cependant très nettement travailler, principalement dans leurs petits postes qu’ils ont poussés en avant de leurs lignes.
Notre tournée est terminée vers les 10 heures.
L’après-midi, il tombe quelques petites averses et le temps reste orageux. Pourvu que nous n’ayons pas trop mauvais temps durant notre période !
Avec le terrain qu’il y a ici et les sources qui sortent dans les boyaux de place en place, nous ne pourrions plus nous en tirer.
Le JMO du régiment signale la perte de 1 homme tués et 6
blessés.
Le dimanche 20 août
La nuit a été agitée et il y eut principalement à la 21ème un fort échange de grenades et de torpilles. Nous avons un tué et 8 blessés à ma compagnie.
Dans l’après-midi, l’ennemi bombarde avec les 150 le rebord du plateau de la cote 304 à notre gauche où est le 289ème qui a pris position dans la nuit, relevant le 411.
A la nuit, notre artillerie tire par rafales violentes et le jeu des grenades recommence.
Le JMO du régiment signale la perte de 5 blessés.
Le lundi 21 août
Le colonel Lachèvre qui est monté à son P.C. de la Rascasse hier vient faire un tour dans le secteur.
Il reproche au lieutenant Jouannais de ne pas faire travailler ses hommes suivant les principes qu’il a établis de « l’école de sape ». On pousse en avant des P.P. (*) de nouvelles sapes destinées à encercler le petit poste ennemi le plus à proximité et à le faire reculer, de façon que les Allemands n’aient plus aucune vue sur le ravin.
Ce à quoi le colonel tient surtout, c’est que le travail soit continué d’une façon ininterrompue, ce qui n’est pas toujours facile quand on n’est qu’à quelques mètres de l’ennemi qui vous envoie un tas de projectiles qu’il ne fait pas bon recevoir.
Après le départ du colonel, le commandant donne l’ordre qu’un sergent-major, un caporal-fourrier et un caporal-adjoint comme comptable ainsi que le caporal-fourrier de la C.M. partent à Jubécourt au camp d’Auxerre nouvellement installé et y restent tant que le bataillon sera aux tranchées comme comptables de leur compagnie respective.
Un roulement sera établi de façon que, suivant les ordres du colonel, un seul sergent-major reste à l’arrière, lequel aura toute la responsabilité au sujet des pièces comptables qui seront demandées dans les 3 compagnies.
Poulet, qui est désigné, regrette d’avoir déjà fait près de 8 jours de tranchées.
Dans l’après-midi, les Allemands nous ayant envoyé quelques grosses torpilles, le commandant fait tirer les canons de 58 qui sont tout près de nous, sur le flanc de la colline. Les avions ennemis survolent nos lignes à très faible altitude sans recevoir un coup de canon ; aucun avion français ne se montre à l’horizon.
Nous recevons quelques obus de 150 qui touchent tout près de nous sans aucun mal.
Le JMO du régiment signale la perte d’un blessé.
(*) : P.P. : Petit Poste
Le mardi 22 août
Vers les 6 heures du matin, il fait un orage ; la pluie tombe à verse, et j’ai bientôt une petite piscine devant mon trou. Il me faut prendre des dispositions en conséquence.
A la 21ème compagnie, un petit poste a reçu un message du petit poste allemand qui est en face à une vingtaine de mètres.
C’est un mot écrit, enfermé dans une bouteille, disant que la paix sera bientôt signée et invitant à ne pas tirer réciproquement. L’Allemand qui l’a rédigé dit qu’il a habité Paris et Bordeaux et qu’il retournera en France après la guerre.
Comme suite à ce message, l’artillerie envoie vers le soir plusieurs rafales de 75 dont 2 tombent un peu court, ce qui prouve que la majorité des coups devait être bien placée. Le colonel donne également l’ordre de faire une démonstration à la grenade et aux obus V.B. contre ce petit poste.
Durant tout l’après-midi, le temps étant redevenu beau, les avions allemands recommencent leur promenade de la veille. Nous avons bien aperçu 5 ou 6 des nôtres dans le lointain, mais ils ont disparu aussitôt.
Les avions allemands descendent très, très bas au-dessus de nos lignes, et nous leur tirons dessus au fusil et avec les mitrailleuses. Mais cela ne les dérange nullement. Nos avions à nous sont tous justes bons à embarrasser les 4 pages des journaux et à faire du commerce aux marchands de rubans et médailles.
Il est tout de même bizarre que, en dépit de l’intense réclame qu’on leur fait dans la presse, depuis 2 ans passés que je suis sur le front, je n’en ai pas vu un seul abattre un avion allemand. J’en ai seulement vu tirer des coups de mitrailleuse à des kilomètres de distance sur leurs adversaires.
À la tombée de la nuit, les Allemands envoient beaucoup de torpilles. Tout l’après-midi, ils ont bombardé avec des 150 le boyau du Prado qui mène à l’arrière et qui est le seul moyen de communication. Les brancardiers qui emmènent 2 hommes de ma compagnie grièvement blessés par une torpille me disent que ce boyau est comblé sur une bonne partie de sa longueur.
Voilà de quoi occuper les travailleurs. Les artilleurs qui servent les 2 pièces de 58 qui se trouvent dans ce boyau étaient allés se réfugier dans la tranchée de la compagnie de réserve et se font attraper par le commandant CHALET qui leur donne l’ordre de répondre à chaque torpille ennemie par 2 des nôtres.
Dans la nuit, nous avons encore un homme de tué à la 21ème.
Le JMO du régiment signale la perte de 5 blessés.
Le mercredi 23 août
Il fait dans la matinée un temps admirable, et nos avions se montrent enfin.
Est-ce un effet des rapports du commandant ?
Le colonel Lachèvre vient faire un tour dans le secteur.
Il donne l’ordre que tout homme qui descend à l’arrière emporte avec lui un des nombreux objets qui sont épars sur le terrain ou que l’on déterre en creusant les sapes et les tranchées : fusils, équipements, sacs, outils, etc. Voilà une bonne mesure.
Dans l’après-midi, l’ennemi nous envoie des torpilles qui tombent sur le versant sud de l’éperon, en face de nous. Alors que j’étais assis sur le bord de mon trou, en train d’écrire, un éclat vient me déchirer mon pantalon, briser mon couteau dans ma poche et, ayant un peu dévié, me fait un beau bleu au-dessous de le fesse.
Je ne serai pas encore évacué pour cette fois.
Les pièces de 58 qui sont près de nous tirent, mais les torpilles tombent dans nos lignes. Leur tir n’est pas réglé. Le commandant fait aussitôt arrêter le tir et, comme un aspirant de l’artillerie était venu le voir, il est convenu que le tir de ces pièces sera réglé demain.
Vers les 10 heures ½, une attaque à la grenade se produit dans le 289 à notre gauche. Tout est vite calmé.
Le JMO du régiment signale la perte de 11 hommes tués et 16
blessés.
Le jeudi 24 août
Vers les 3 heures du matin, les Allemands ont attaqué un petit poste sur le 4ème bataillon à notre droite. Ils s’étaient approchés en rampant et sans être vus et lançaient des grenades tous ensemble. Les nôtres répondirent, les mitrailleuses se mirent de la partie, et l’artillerie prévenue par fusées entra dans la danse.
L’ennemi retourna d’où il venait, non sans laisser 3 morts sur le terrain qu’il parvint cependant à emmener par la suite, malgré une vive fusillade de notre part. De notre côté, nous avions 7 blessés, dont un grièvement.
Vers les 9 heures, l’aspirant d’artillerie vint pour régler le tir des 58 ; il en eut pour jusqu’à 11 heures ½. Mais les emplacements de batteries sont repérées par des avions et bientôt quelques 150 tombent tout près d’eux, et de nous également qui sommes à proximité. Un éclat vient percer la capote qui sert de toit à ma maison.
Décidément, je suis visé.
La pluie qui était tombée vers les 4 heures ½ du matin s’est arrêtée et il fait dans l’après-midi une chaleur torride.
Vers 15 heures 30, alors que j’étais à ma compagnie en haut du saillant Kieffer, quelques obus de gros calibre tombent tout près du P.C. du commandant.
Je fais même la réflexion à Dumans, le maréchal-des-logis adjoint à la C.M. (*) qui était monté avec moi, et je lui disais que toute la liaison devait s’être « planquée » dans les abris. Quelques instants après, le cycliste Deshaies de la 23ème monte nous prévenir que Nault vient d’être tué.
L’obus est tombé juste sur l’entrée de l’abri.
Le commandant était dans le fond et écrivait ; il a reçu 5 petits éclats comme des têtes d’épingle dans la figure et a eu une commotion. Mais son ordonnance était assis dans le boyau et écrivait.
Il a été tué du coup et le boyau était comblé.
Ce pauvre Nault était avec nous depuis le début ; c’est le premier de la liaison qui est tué. Je lui retire tout ce qu’il avait sur lui pour faire l’inventaire, et nous l’enterrons à la tombée de la nuit à quelques mètres de l’endroit où il fut frappé à côté de quelques-uns qui reposent déjà là. Nous lui mettons une croix qui marque l’emplacement.
Il est, paraît-il, défendu de descendre les morts à Esnes et ils doivent être enterrés sur place. C’est le commandant lui-même qui dit cela. C’est bien malheureux, car jamais sa famille ne pourra retrouver sa tombe.
À la 1ère affaire, tout cela sera bouleversé. Je n’ai d’ailleurs pas entendu sortir des lèvres du commandant une parole de regret pour ce malheureux qui l’a servi durant toute la campagne.
Quand on lui eut dit qu’il était tué, sa 1ère préoccupation fut de faire téléphoner à la 21ème compagnie pour qu’on lui envoie un remplaçant. Je ne crois pas qu’il soit allé voir l’emplacement où nous l’avons enterré.
Par contre, dans ses rapports, il a eu soin de faire ressortir avec force détails les 5 éclats qu’il a reçus et la forte commotion qu’il a ressentie, en ajoutant qu’il conservait quand même son commandement. (***)
Le JMO du régiment signale la perte de 1 homme tués et 7
blessés.
(*) : Compagnie de Mitrailleuse.
(**) : NAULT Louis,
soldat de 2e classe, mort pour la France le 24 août 1916 à Esnes
(Meuse), tué à l’ennemi. Il était né à Pargny (Nièvre) le 1e mai
1886. Il ne possède pas de sépulture militaire connue, donc l’avait prédit
Alexandre…
(***) : Le JMO stipule : « …Au cours de ce bombardement, le chef de bataillon CHALET est
atteint de multiples petits éclats à la face, qui lui occasionnent une surdité
de 24 heures …» et ne parle pas
de ce pauvre NAULT…
Le 25 août
La journée se passe sans aucun événement particulier.
On parle de la relève pour le lendemain.
Le 26 août
Il y a 4 blessés au bataillon par des grenades. Des torpilles et quelques obus tombent encore non loin de nous.
La relève a lieu.
Nous devons partir avec nos compagnies. La 21ème étant relevée la 1ère, j’attends les autres fourriers, et nous décidons de partir tous 3 ensemble. Le reste de la liaison est parti dès le début de la relève.
La pluie se met à tomber très fort.
Quand la 23ème est relevée, nous cherchons Polbeau, le fourrier de la 22ème, et avec Guinard nous nous disposions à partir, croyant qu’il nous avait faussé compagnie, et nous pestions contre lui pour ne pas nous avoir prévenus, quand soudain il fait son apparition. Il s’était mis à l’abri dans un trou et s’était endormi. Le 5ème bataillon qui nous relève a entièrement pris ses emplacements. Nous prenons nos sacs et partons.
Mais à peine arrivions-nous au boyau du Prado qu’une vive fusillade, des éclatements de grenades, etc. se font entendre sur notre droite, au 4ème bataillon ou au Bec. Des fusées-signaux demandant l’artillerie partent de tous côtés.
Gare au tir de barrage !
Nous décidons de traverser le ravin de la Mort au plus vite ; c’est l’endroit le plus dangereux et si le tir de l’artillerie ennemie se déclenche, nous serions en fâcheuse posture. La nôtre est déjà en action.
Nous prenons donc le pas de gymnastique et, en glissant dans la boue et sur les caillebotis, tombant et nous relevant dans les trous d’obus, alors que les balles de mitrailleuses passent en gerbes au-dessus de nous, nous traversons le ravin sans accident et arrivons dans le prolongement du boyau du Prado où nous sommes relativement en sécurité.
Il y a d’ailleurs en cet endroit de bons abris dans lesquels nous pourrions attendre la fin de l’action. Nous y trouvons même le Médecin auxiliaire Planchais et ses brancardiers qui ont comme nous-mêmes fait vite pour traverser le ravin.
Nous soufflons un peu dans le boyau ; l’artillerie allemande ne tire pas beaucoup de notre côté ; seule la nôtre n’arrête pas. Au bout de quelques minutes, la fusillade a l’air de se ralentir. C’était probablement une simple alerte ou un petit coup de main quelconque. Nous laissons le médecin dans le fond de son abri et nous prenons le chemin du retour en suivant le boyau, car de nombreuses balles sifflent encore au-dessus de nous et il vaut mieux marcher dans l’eau que recevoir une balle dans la peau.
Nous traversons la vallée sans encombre, passons vers le Moulin d’Esnes et allons ensuite rejoindre la route de Montzéville. Elle est couverte d’une couche liquide d’au moins 20 centimètres en certains endroits.
Presque à l’entrée de Montzéville, nous rencontrons un caisson d’artillerie du 13ème qui s’en va tout près du bois Saint-Pierre. Nous nous installons tous 3 dessus.
Nous traversons Vignéville, puis Béthelainville, et nous descendons finalement en un point que nous ne connaissons pas le moins du monde. Les artilleurs ne connaissent eux-mêmes pas le bois de Fouchères où nous allons nous rassembler.
Nous n’avons pas de carte.
Nous marchons alors au petit bonheur, traversons un village où nous demandons des renseignements que l’on ne peut guère nous donner. Il fait une nuit très noire.
Finalement, nous arrivons à la grande route de Verdun que nous avons déjà prise jusqu’à Dombasle. Et là, vers le passage à niveau, nous trouvons la 21ème compagnie, une partie tout au moins, qui fait la pause en attendant certains de ses éléments. Nous ne sommes plus bien loin du bois de Fouchères où nous nous rendons avec la compagnie ; le jour est arrivé et la pluie ne cesse guère.
Le 27 août
Le commandant arrive au bois de Fouchères ¼ d’heure après nous ; il crie parce qu’il n’y a aucun cycliste avec nous ; la 22ème arrive ensuite, puis le T.C. Le bataillon est à l’abri dans 4 grands baraquements.
Des artilleurs er des territoriaux sont cantonnés dans le bois. Nous trouvons du vin et des vivres dans une coopérative de l’artillerie.
Dans la matinée, nous entendons des coups de canon, des départs ; je croyais même que c’étaient des nôtres, mais les obus tombent sur le parc d’aviation de Brancourt, et nous voyons « nos As » se débiner dans tous les sens sur la crête à quelques kilomètres de nous.
Pour tirer à une aussi grande distance (on calcule environ 18 kilomètres), les boches ont bien réussi.
Le bataillon a reçu l’ordre d’aller s’embarquer à Récicourt le soir à 22 heures à destination de la gare de Mogneville, pour de là gagner le cantonnement de repos de Couvonges. Le capitaine Café (23ème) et un cycliste partent en avant avec ½ section pour reconnaître le train.
Nous quittons le bois de Fouchères à la tombée de la nuit, vers les 20 heures, sans avoir pu nous reposer.
Le temps est noir dans le lointain, et bientôt la pluie se met à tomber en cataractes.
À notre arrivée à Récicourt, nous ne trouvons personne qui puisse nous renseigner où doit se faire l’embarquement, le point variant paraît-il souvent d’après ce qu’on nous dit à la division.
Tandis que le bataillon est arrêté à l’entrée de Récicourt, on court de tous côtés sous la pluie et dans la nuit opaque. Le pays étant souvent bombardé, on donne au commandant le conseil de ne pas stationner. Mais où aller ?
Puis les hommes sont exténués et, surtout par un temps pareil, il ne faut pas leur faire faire des allées et venues inutiles.
Enfin, à force de recherches, on finit par trouver l’endroit qui est à un passage à niveau à 1500 mètres à l’ouest de Récicourt. Nous traversons une partie du pays, puis une rivière, et longeons ensuite la ligne de chemin de fer jusqu’à cet endroit.
Au moment où l’on place les compagnies pour l’embarquement, un incident se produit. Le commandant (*) distribue des coups de trique, et certains hommes n’étant pas contents de ces traitements, des lazzis sont lancés à son adresse.
Enfin le train arrive, tous feux éteints, mais il passe devant nous sans s’arrêter.
Il va jusqu’à Dombasle où, paraît-il, il change de machine et revient ½ heure plus tard.
Nous embarquons à 23 heures ½. La liaison, nous avons la chance de monter dans un wagon de 2ème classe. Nous nous installons le plus confortablement possible après avoir fermé hermétiquement les ouvertures pour pouvoir allumer une bougie. Nous sommes dans un bien triste état : trempés jusqu’aux os ; jamais je n’ai vu tomber l’eau aussi fort et aussi longtemps.
Pour nous réchauffer, nous mangeons et buvons un coup de vin. Puis, terrassé par la fatigue, je m’endors tandis que le train roule toujours sous la pluie.
(*) : Le commandant CHALET
Le 28 août
Je suis réveillé par une sonnerie de clairon ; nous sommes arrivés.
Je descends au milieu d’un grand brouhaha ; le petit jour arrive, la pluie a cessé ; je suis tout étonné de voir que la machine est détachée du train. Il y a longtemps, paraît-il, que nous sommes arrivés, mais le commandant devait dormir comme nous tous. Il est environ 5 heures.
Tandis que le bataillon se rassemble, nous partons en avant avec le capitaine Café pour préparer les cantonnements.
Couvonges n’est qu’à 2 kilomètres. Mais le cantonnement se fait difficilement. Un pâté de maisons, les plus importantes du pays, sont brûlées et toutes les autres sont occupées par divers éléments du génie, du 412ème, etc.
Nous réveillons les habitants, et ce n’est guère avant 8 heures que les compagnies peuvent occuper leur cantonnement qui est loin d’être brillant.
Septembre 1916 : secteur de Verdun, ouvrage de Thiaumont, secteur Margueritte.
Du 28 août au 2 septembre
Nous restons à Couvonges. Nous pensions tous y rester plus longtemps, et beaucoup de femmes avaient été prévenues. Quelques-unes arrivent au bout de 2 ou 3 jours.
J’avais une chambre à Beurey et une autre à Mogneville, et je vais à chaque train attendu à la gare de Robert-Espagne. C’est en vain, les laissez-passer étant difficiles à obtenir à Paris.
Les compagnies font l’exercice ; 2 fois, nous marchons à des exercices de bataillon. Petit à petit, nous nous habituons au pays et à ses habitants et au bout de quelques jours nous avons tout ce que nous voulons.
Le 412 et le génie quittent le village, ce qui nous donne davantage de place. Une fois installés, les hommes sont assez bien. Pour notre part, nous sommes bien reçus chez Me. Maraudelle.
Le 2 septembre au matin
Nous quittons Couvonges pour Génicourt-sous-Condé distant d’environ 18 kilomètres.
Le campement part en avant avec le lieutenant Viault.
Il fait très chaud.
Nous sommes plutôt mal reçus par les habitants, comme partout dans la Meuse. Il y a beaucoup de réfugiés dans le village. Beaucoup de granges sont pleines de foin ou de grain. Nous logeons les compagnies tant bien que mal. Heureusement nous touchons de la paille le soir.
Le bureau de la liaison est à la mairie où je couche avec Guinard et Cavin. Le reste de la liaison couche à notre popote, dans une maison inhabitée.
Polbeau trouve un lit pour sa femme qui a réussi à nous suivre. Nous sommes moins bien qu’à Couvonges sous le rapport ravitaillement.
Mais à Condé, à 500 mètres, on peut avoir à peu près tout ce que l’on veut, mais en payant bon prix. Seulement, il est interdit de quitter le cantonnement et des ordres très sévères paraissent à ce sujet, ce qui n’empêche rien.
Le lieutenant-colonel part en permission.
Le commandant CHALET commande le régiment.
C’est exact, le JMO confirme que la commandant CHALET (le
« bastonneur ») commande le régiment durant l’absence, pour
permission » du lieutenant-colonel, du 2 au 11 septembre.
Le 7 septembre
Nous sommes alertés et devons partir le lendemain matin par le train. Direction la rive droite.
Il y a un branle-bas général. Des permissionnaires rentrent, on boit la gniole, puis de la bière, du vin, etc. Le mélange me rend très gai, et je cause beaucoup à dîner.
Justement, Me Polbeau mange avec nous.
Puis le soir, le contrordre arrive. Nous ne partons pas. Mais le commandant donne des ordres pour se tenir toujours prêts.
Les compagnies reprennent l’exercice. Les travailleurs font, comme à Trémont, des travaux de terrassement durant 48 heures consécutives avec chefs de sape porteurs des piges et des carnets d’attachement suivant les ordres du colonel.
Le bataillon fait des exercices d’attaque de tranchée. Nous avons reçu du renfort le 4 septembre, et le capitaine Café me traite bien impoliment. Je me demande comment un officier français peut se laisser entraîner de la sorte par la colère.
Le général Mangin commande la division, et nous recevons un nombre considérable de notes.
Des ½ journées entières, nous pâlissons sur des feuilles de papier. Les compagnies reçoivent des fusils-mitrailleurs, ce qui porte à 3 et 4 le nombre par compagnie.
M. Hermet part en permission le 8 ; M. Merle revient.
Nous buvons de la bière des brasseries de la Meuse qui est excellente. Nous sommes très bien à la mairie. L’institutrice et sa mère sont très aimables, mais bavardes comme des pies.
Le commandant est en excellents termes avec l’institutrice. Il se met en frais de galanterie et, un dimanche, il l’emmène à la musique. Ils ont un beau succès sur leur parcours, et le commandant paraît un bel homme à côté de la demoiselle qui est toute petite.
Le frère de la demoiselle qui est parti depuis peu comme auxiliaire leur cause du tourment, bien inutilement je crois. Il est au camp de Châlons, bien à l’abri, mais il leur écrit, dit-il, à la lueur des canons et il entend le crépitement des mitrailleuses.
Je crois qu’il y va un peu fort. La demoiselle part pour 4 jours voir des parents. C’est toute une affaire.
Le 20 septembre
Nous recevons des ordres pour partir le lendemain.
Nous serons emmenés en auto jusqu’à Nixéville.
Le 21 septembre
Nous embarquons à 7 heures dans les autos qui sont venues nous prendre sur la route de Condé. Nous profitons de l’occasion pour faire notre plein d’essence, et tous les briquets sont bientôt garnis.
Cette fois, nous n’avons pas de poussière durant le voyage.
Nous passons par Rembercourt, où se trouve le D.D., Chaumont-sur-Aire, Yssoncourt, Heippes, Souilly, Lemmes et nous débarquons enfin dans un vallon, non loin de la gare de Nixéville.
Non loin de nous se trouvent des baraquements où sont des prisonniers allemands.
Le bataillon était à peine rassemblé que quelques obus tombent non loin de nous. Ils sont évidemment destinés à la gare, et les gens qui sont dans les alentours, mécaniciens et autres, vont pouvoir dire qu’ils ont été soumis à un bombardement. Dans le bataillon, bien qu’on ne les attende pas aussi loin des lignes, ces quelques obus sont reçus par des lazzis et de pittoresques réflexions.
Le commandant qui attendait des ordres voit enfin le colonel qui vient d’arriver.
Le régiment entier doit aller passer le reste de la journée dans le bois Davoust, à l’est de la route par laquelle nous sommes arrivés, et il se confirme que nous partirons le soir même.
Nous nous installons sommairement dans des baraquements que le génie et les territoriaux sont en train d’aménager pour l’hiver. Une bonne couche de béton est coulée sur le sol et deux rangées de planchers légèrement inclinés sont aménagées de chaque côté.
Cet hiver, il n’y aura pas trop d’humidité et ces baraquements pourront être tenus propres et chauffés.
Nous déjeunons.
Les vaguemestres apportent les lettres et j’écris une carte à la hâte.
Bientôt les ordres arrivent.
Nous irons ce soir coucher à Verdun, à la citadelle. Le campement doit partir à 14 heures.
A l’heure dite, nous partons, les campements des 3 bataillons et de la C.H.R. sous la conduite d’un guide, un chasseur à cheval. De suite nous prenons une piste, puis, à travers les bois, nous suivons une route en construction sur laquelle travaillent de nombreux prisonniers allemands. Ils font un travail qui semble dur, cassent des cailloux, les déchargent des camions qui les amènent tandis que d’autres les extraient d’une carrière près de laquelle nous passons.
Mais tous ces prisonniers paraissent jeunes et bien portants. Ils sont encore mieux là que dans les tranchées sous les marmites.
Plus loin, au beau milieu de la forêt, nous passons près du camp des prisonniers entouré d’une triple barrière de fils de fer. Nous en apercevons en passant qui font la cuisine ; quelques territoriaux les gardent.
Toute cette main d’œuvre à bon marché va créer tout un réseau de routes qui facilitera les opérations militaires en cette région et, quand la paix sera enfin revenue, sera d’un grand secours pour l’activité économique du pays.
Ensuite nous traversons d’immenses bivouacs occupés par l’artillerie.
La route est alors à peine tracée et nous enfonçons dans la boue jusqu’aux chevilles, si bien que les cyclistes restent en arrière, ne pouvant réussir à faire rouler leur machine dans un tel terrain.
Puis soudain nous débouchons à la lisière du bois, sur les pentes d’un coteau descendant dans une vallée qui va directement à la Meuse que nous apercevons au loin.
L’horizon est borné de l’autre côté par une chaîne de hautes collines qui semblent descendre presque à pic jusqu’au lit de la rivière. À notre droite, les bois se continuent le long de la vallée.
Sur notre gauche et un peu en avant se trouve un fort que nous contournons à une certaine distance.
Sur les collines qui sont en face de nous, nos batteries se révèlent par l’éclair des départs des coups de canon ; le son ne nous parvient que très atténué.
Nous passons une petite crête où nous traversons une route, et Verdun nous apparaît, à moitié caché derrière de grands arbres. La cathédrale surplombe toute la ville de ses deux tours carrées. Nous longeons alors un petit chemin qui était bordé de villas qui devaient être agréables avec leurs jardins.
Maintenant tout est abandonné et délabré. Des artilleurs cantonnent dans ce faubourg. Nous traversons une autre route pour prendre un boyau qui nous conduit devant la citadelle et nous mettons le pied sur le pavé des rues de Verdun.
Nous sommes arrivés.
On met à notre disposition un bâtiment qui devait servir autrefois de magasin à vivres. Des lits militaires y sont installés. Chacun aura sa paillasse ou son matelas. Le cantonnement est vite fait dans ces conditions. Les régiments qui nous ont précédés ont laissé les lieux dans des conditions ignobles. Des tas d’immondices et de déchets de cuisine gisent devant les portes ; c’est une infection.
Par les territoriaux qui sont là et qui font la distribution du cantonnement, nous apprenons que les unités ne font que passer ici et ne restent pas plus d’un jour. Il est donc probable que nous monterons demain aux tranchées.
Le bataillon arrive et se place de très bonne heure ; il fait à peine nuit.
Les officiers couchent dans de petites chambres à 5 ou 6 et ils mangent au mess, à la citadelle, où on leur fait cuire leurs rations
Les hommes font la cuisine par escouade, le long du mur de la citadelle qui, avec le bâtiment dans lequel nous sommes logés, forme une sorte de fossé étroit et très profond.
Le 22 septembre
Dès le matin, vers les 4 heures, des ordres nous parviennent et éclairent la situation. Nous monterons ce soir aux tranchées de 1ère ligne à l’ouest de l’ouvrage de Thiaumont et non loin de Fleury.
Chaque homme touchera : 1 musette, 1 bidon de 2 litres, 1/8 d’eau de vie, ¾ de vin, 1 boule de pain, 1 boîte de conserve, sardines, gruyère, chocolat, biscuits, en prévision que le ravitaillement ne puisse pas s’effectuer ; puis des fusées de toutes sortes, grenades, 2 par homme, 1 sac à terre, etc.
L’approvisionnement en cartouches devra être complété à 200.
L’officier gestionnaire de l’intendance vient trouver l’adjudant de bataillon et lui dit qu’il lui est impossible d’assurer les distributions par compagnie, ce qui prendrait trop de temps.
C’est donc nous qui en aurons la charge.
Jusqu’à 15 heures, c’est un brouhaha indescriptible.
Enfin nous nous en tirons tout de même.
Durant toute la journée, nous n’avons pas vu un seul officier. Le commandant CHALET est parti le matin dans le secteur avec un officier par compagnie qui sont revenus sans avoir pu aller en 1ère ligne, les boyaux n’existant pas, et il est impossible de passer de jour. Charmante perspective !
Le commandant est resté au P.C. du colonel d’où il rejoindra son poste aussitôt que possible.
Donc toute la journée, Messieurs les officiers visitent la citadelle, prennent des photos, etc. Cavin ne peut même pas avoir d’ordre précis du capitaine Prudon, l’adjudant-major qui commande le bataillon en l’absence du commandant CHALET.
Enfin, à 7 heures du soir, nous nous mettons en route.
Nous sommes chargés comme des mulets ; nos 3 musettes sont pleines de vivres, nos sacs ont été rassemblés à la caserne Beaurepaire. Nous sortons de la ville par la porte de France, près de la gare ; nous traversons la Meuse sur le pont de planches à côté de l’ancien pont, passons près du parc à ballons et longeons ensuite les pentes de Belleville.
Nous longeons ensuite un boyau, mais à découvert, traversons le ravin ces Vignes ou du Pied du Gravier. C’est à cet endroit que les guides nous laissent et où nous sommes repris par des guides du régiment que nous allons relever, le 104.
À partir des Carrières, endroit où se trouve un bataillon de réserve, nous grimpons sur le plateau que nous traversons. Les lignes ne sont plus loin maintenant, et les fusées éclairantes nous éblouissent à chaque instant.
C’est l’endroit le plus dangereux.
Sur cette crête, pas même une amorce de boyau ; nous sommes complètement à découvert, et nous contournons les trous d’obus. Le terrain a dû être affreusement retourné ; tout est dévasté.
Mais nous ne nous attardons pas à examiner le paysage à la lueur des fusées qui jettent des ombres sinistres autour de nous. Nous pouvons être surpris par un tir de barrage, et alors ce serait une véritable hécatombe.
Enfin nous arrivons heureusement à l’endroit qui nous est assigné. Nous enfonçons dans la boue jusqu’au mollet en certains endroits. Le 104 est là depuis 11 jours.
J’apprends plus tard que c’est par punition, le commandement ayant fait une attaque sur des rapports et non en réalité. Je ne sais ce qu’il y a de vrai là-dedans.
Le 102 fait partie de la même division que le 317. C’est donc dans ces parages qu’a été blessé mon beau-frère Bonnot. Il doit également repartir en Champagne où il était auparavant. Je vais avec un agent de liaison reconnaître l’emplacement de ma compagnie.
Ce n’est pas loin : une centaine de mètres, mais il n’y a aucun boyau ; rien que des trous d’obus, et l’on est vu de tous côtés.
Douaumont, en face de nous, nous surplombe et l’on ne peut faire un mouvement dans la journée.
C’est charmant.
On nous dit que les bombardements sont fréquents et très violents et que l’on ne peut pas se dépêtrer de la boue. Les lignes ne sont pas bien fixées ; la liaison se fait d’un trou d’obus à l’autre. Quand nous avons pris nos positions, le 104 s’en va ; le commandant reste d’après les ordres 24 heures en plus.
La liaison loge avec le commandant dans un ancien abri à munitions du retranchement Z. Nous nous tassons les uns sur les autres, et nous nous endormons vers le matin.
Le commandant CHALET a donné des ordres pour que les hommes travaillent à faire des tranchées.
Le 23 septembre
Nous nous orientons dans la journée en évitant de nous faire voir, ce qui n’est pas facile.
À 1500 mètres environ à l’est, le fort de Douaumont nous domine ; au nord-est, la côte du Poivre, dont nous sommes séparés par un ravin dans le fond duquel est le 276 ; l’ouvrage de Thiaumont et Fleury vers le sud-est sont cachés à la vue par le mouvement de terrain, mais ne sont pas loin de nous. Nous sommes ici dans le secteur Margueritte, groupement D.E.
De jour, il est impossible de communiquer avec l’arrière ; il n’y a aucun boyau et il faudrait passer à découvert sur le plateau que nous avons traversé dans la nuit et qui est battu de tous côtés.
Des coureurs sont installés pour aller jusqu’au colonel.
Dans la journée, nous ne pouvons même pas aller à nos compagnies. Partout le sol est éventré par les obus et il présente les reliefs et les dépressions d’une mer agitée par les vagues.
Le soir, vers 20 heures 30, un violent tir de barrage se déclenche de part et d’autre et dure une bonne demi-heure. Quand le calme est revenu, nous constatons qu’il y a 2 tués et 14 blessés dans le bataillon.
À ma compagnie où je vais aux renseignements, il y a 5 blessés.
Le JMO du régiment signale la perte de 2 hommes tués et 7
blessés.
Le 24 septembre
Le commandant donne un plan d’ensemble pour creuser des tranchées, car on ne peut rester ainsi dans des trous d’obus ; la liaison se fait difficilement en certains endroits ; il faut absolument organiser le secteur.
Durant les 11 jours que le 104 est resté ici, il a laissé tout à l’abandon et n’a même pas donné un coup de pioche. Tandis que les compagnies creuseront leur ligne en réunissant les trous d’obus, les pionniers creuseront le boyau qui conduit du P.C. du commandant aux compagnies.
Le soir à la brune, je vais communiquer.
M. Jouannais est devant son trou et se prépare à aller sur le terrain pour voir le tracé de la ligne de soutien où est la compagnie et donner des ordres.
Le lieutenant Julien qui devait aller avec lui et moi-même lui disons qu’il attende encore une dizaine de minutes, qu’il ne fait pas assez nuit. Mais il ne veut rien entendre ; il finit son café puis il dit à Julien : « Donne-moi une goutte et nous allons aller voir ce travail. » Il avale sa goutte et monte aussitôt sur le terrain. Julien le suit, ainsi que Thomas, l’agent de liaison.
Le lieutenant Jouannais fait à peine 20 mètres et 5 ou 6 coups de fusil partent. Il est atteint en pleine tête et tombe sans un cri. Nous allons aussitôt chercher les brancardiers qui l’emportent alors qu’il râle faiblement.
Il meurt en route.
Pauvre garçon ; je l’estimais beaucoup ; il est victime d’une imprudence fatale.
Le JMO du régiment signale la perte de 4 hommes tués et 9
blessés.
(*) : JOUANNAIS
Charles Gilbert Gabriel, lieutenant, mort pour la France le 24 septembre
1916 à Fleury-devant-Douaumont, tué à l’ennemi. Il était né le 20 octobre 1884
à Moulins (Allier). Il ne semble pas avoir de sépulture militaire en 2014.
Par contre, sur sa fiche militaire il est indiqué :
« inhumé au cimetière militaire de Glorieux, tombe 50 ». Ce cimetière
a-t-il disparu suite aux bombardements ? Il se trouvait pas loin du front…
Le lieutenant JOUANNAIS sera cité à l’ordre de la 2e
armée (ordre 468) sous ces termes :
« Officier de valeur
d’un courage sans défaillance, donnant toujours l’exemple du sang froid et du
dévouement, a été tué en piquetant sur le terrain le tracé d’une nouvelle
tranchée devant la première ligne. »
Le 25 septembre
Le lieutenant Gigot vient dans la soirée prendre le commandement de la compagnie.
Il a encore fait beau temps aujourd’hui heureusement.
Durant la nuit dernière, les hommes ont fait leur possible, mais en fait d’outils ils n’ont que ceux qu’ils ont ramassés sur le terrain. De plus, l’eau s’est amassée dans les trous d’obus, le terrain étant argileux, et le travail est rendu très difficile de ce fait ; puis il fait une nuit opaque.
Il faudra plusieurs jours pour que la ligne soit creusée. Ils se remettent au travail dès la tombée de la nuit, mais bientôt un combat à la grenade a lieu sur notre droite du côté de Fleury et les obus se mettent à pleuvoir. Durant ce tir de barrage, il y a encore quelques tués et une dizaine de blessés dans le bataillon.
Le JMO du régiment signale la perte de 5 hommes tués et 40
blessés.
Le 26 septembre
Il fait un temps magnifique ; aussi dès le matin les avions boches survolent nos lignes. Ils descendent à faible hauteur, repèrent nos lignes, lancent des fusées, arrêtent leur moteur pour prendre des photos et tout cela sans être dérangés le moins du monde.
Nos « As » sont probablement trop occupés dans la 1ère page des journaux ; ils ne peuvent être partout. Un avion boche tire même avec sa mitrailleuse sur la 1ère section de ma compagnie qui est tout entière dans un vaste entonnoir d’une douzaine de mètres de diamètre.
Dans l’après-midi, nous sommes bombardés par des obus de gros calibre. Nous avons à la 1ère section 5 tués et 5 blessés et ils ne peuvent être évacués qu’à la nuit. Les morts sont également descendus.
Ils sont enterrés au cimetière de Glorieux où est le corps de M. Jouannais.
Le lieutenant Gigot tient à ce que les ordres soient exécutés et le travail fait. Il secoue Julien, qui n’a même pas été avec sa section depuis que nous sommes aux tranchées.
Il en est ainsi pour beaucoup de nos officiers, généralement ceux qui crient le plus fort. Ils sont juste bons à crâner quand nous sommes au repos, alors que d’autres qui ne disent rien, comme le lieutenant Merle, font aux tranchées leur travail consciencieusement.
Le JMO du régiment signale la perte de 9 hommes tués et 10
blessés.
Le 27 septembre
Le temps continue à se maintenir au beau ; c’est une chance pour nous. S’il avait plu, nous n’aurions pas pu nous retirer de ce galimatias.
On fait redescendre à l’arrière, par les corvées de soupe ou autres, tout le matériel qui est ramassé. Il y a des fusils en quantité et un tas d’autres choses à moitié enterrées dans la boue.
La 23ème a trouvé une mitrailleuse boche en avant de sa ligne. Le cadavre d’un Allemand étant à côté, le colonel a fait demander une patte d’épaule pour servir de renseignement. Ce qu’il y en a des cadavres dans ce terrain, c’est effrayant !
Vers le P.C. du commandant, on dévie le boyau que les pionniers creusent pour passer à côté d’un cadavre dont les pieds sortaient de la boue.
Toute cette journée, l’aviation fait preuve d’une très grande activité.
Un capitaine d’artillerie du 45ème qui vient de prendre position vient faire une reconnaissance et choisir un observatoire, puis c’est un capitaine du 289 qui vient pour reconnaître le secteur, ce qu’il ne fait pas d’ailleurs, les travaux n’étant pas suffisamment avancés pour permettre de se balader de jour dans le secteur.
Le commandant lui-même n’est pas allé voir les 1ères lignes et le colonel n’est même pas venu au P.C. du chef de bataillon. Des bruits d’une prochaine relève circulent.
Le soir, un tir de barrage se déclenche de nouveau. Il y a 2 blessés à côté du P.C. où sont tombés de nombreux obus. Mais il n’y a pas trop de mal dans les compagnies.
Maintenant, la ligne de tranchée est creusée sur toute sa longueur, et la 1ère section de ma compagnie a pris son emplacement.
Bien que la tranchée ne soit pas encore à la profondeur voulue, les hommes sont cependant un peu plus à l’abri que dans les trous d’obus.
Le JMO du régiment signale la perte de 2 hommes tués et 16
blessés.
Le 28 septembre
À 1 heure du matin, la note au sujet de la relève nous parvient.
Le capitaine commandant le bataillon du 289 et un jeune sous-lieutenant arrivent avec le jour et prennent connaissance des consignes
Le temps est nuageux toute la journée et nous craignons de la pluie pour le soir. Mais le temps se maintient malgré tout.
Le 289 arrive d’assez bonne heure et les compagnies s’en vont aussitôt relevées. Nous partons les derniers vers les 1 heure du matin avec le capitaine Prudon.
Le commandant reste jusqu’au lendemain de même que 1 officier et 1 gradé par section dans chaque compagnie. Pendant le trajet pour revenir, je constate que des boyaux sont ébauchés pour établir la communication. Nous suivons le même chemin qu’à l’aller.
Le JMO du régiment signale la perte de 1 homme tué et 5 blessés.
Le 29 septembre
Nous arrivons sans encombre à Verdun.
Le capitaine Prudon connaît la ville, heureusement, car nous n’avons pas de guide et nous aurions été fort embarrassés pour trouver le quartier Saint-Nicolas où le bataillon est cantonné.
Le commandant est logé au 72 de la rue Saint-Sauveur et le bureau du bataillon que nous trouvons à force de recherches est au 80 de la rue Saint-Nicolas.
Notre cuisinier nous avait préparé une soupe à l’oignon que nous mangeons de bon appétit, et nous allons nous coucher sur des matelas que nous trouvons dans la maison ou la cave.
Le petit jour commence à poindre.
Le 30 septembre
Je me lève après avoir dormi quelques heures et vais voir l’emplacement des compagnies qui sont dans les remparts, dans des galeries voûtées percées de meurtrières.
Il y a une petite quantité de paille pourrie et un nombre infini de poux. En certains endroits, l’eau coule à travers les voûtes.
C’est affreux comme cantonnement. J’apprends que le 204 est ici en réserve de groupement. Les compagnies iront travailler chacune leur tour.
Le 5ème bataillon descend le soir ou plutôt dans la nuit.
Octobre 1916 : Verdun, Fleury, Thiaumont, côte du Poivre
Le 1er octobre
Conformément aux ordres reçus le commandant, qui est descendu des tranchées hier soir avec les officiers et les gradés qui y étaient restés, réunit les officiers et sous-officiers de son bataillon et nous donne connaissance de la nouvelle organisation des unités à réaliser immédiatement.
Les hommes seront à l’avenir groupés par spécialités, et la section formera une unité de combat. 1ère escouade, grenadiers ; 2ème V.B. et F.M. ; 3ème et 4ème, voltigeurs ; plus un groupe spécial comprenant tambours, clairons, tailleur, cordonnier, ordonnances, etc. Le P.E.M. est organisé dans les mêmes conditions et forme une section.
Cette organisation nouvelle répond logiquement aux transformations de l’armement de l’infanterie qui s’est opéré ces derniers temps. Le groupe des spécialistes, c’est-à-dire la 1ère ½ section de chaque section, devra toujours être au complet et puisera ses éléments dans les voltigeurs.
Le commandant nous envoie, les fourriers et cyclistes, reconnaître le bureau de la place, du colonel, la division, etc. et cela nous donne l’occasion de visiter la ville.
Elle a bien souffert.
Des rues entières sont complètement détruites par le bombardement et les incendies. Dans d’autres quartiers, où les maisons n’ont pas été touchées par les obus, c’est un gâchis épouvantable.
Les meubles sont cassés, brisés, le linge et tous les objets traînent par terre en tas. Quel pillage ! Et l’on ne pourra guère mettre tout ce travail sur le dos des Allemands puisqu’ils ne sont pas parvenus dans la ville. Je m’aperçois que c’est partout la même chose. Il y a bien aussi des civils qui ont dû mettre la main à la pâte les premiers temps.
Maintenant, il n’y en a plus un dans la ville.
Je ne rencontre que quelques pompiers qui sont restés à leur poste.
Des territoriaux et des équipes du génie sont occupés à déménager ce qui reste dans les maisons et à les nettoyer. On veut faire disparaître les traces les plus apparentes de l’odieux pillage qui a eu lieu. Des consignes sévères sont édictées par la place. On ne doit pas circuler en ville sans un « ordre de mission ». Des ordres formels sont donnés pour faire « respecter la propriété privée ».
Il est bien temps maintenant.
D’ailleurs, comme toutes les consignes, elles sont plus ou moins appliquées, et ceux qui sont chargés d’en assurer l’exécution ne sont pas toujours des saints. On raconte quelques histoires de chiens de bergers dévorant les moutons.
En passant devant la cathédrale, nous jetons un coup d’œil à l’intérieur.
Tout a été déménagé. Le bureau de la place est dans la citadelle où il n’y a rien à craindre.
Le 49ème bataillon de Chasseurs, celui où a servi Poincaré, est cantonné dans la citadelle depuis 3 mois. Il peut tenir en cet endroit. La ville est mise en état pour être défendue pied à pied.
Partout des fils de fer ; dans les rues des abris pour mitrailleuses ont été installés. La ville devait être assez agréable en temps de paix. Jamais je n’ai vu des fortifications aussi formidables, et je me demande comment Vauban, alors que l’on ne disposait pas des engins de destruction que nous avons maintenant, avait pu prévoir des défenses d’une telle solidité.
En passant à la citadelle, nous achetons des dragées (4 Francs le kilo) qui sont vendues dans un bazar militaire. Ce doit être des stocks des fabriques de dragées Berguier et autres que l’on écoule ainsi.
Nous communiquons une note venant du Ministère au sujet de drap fin et de souliers plus soignés à l’usage des officiers. L’intendance forme le projet de fournir ces effets d’habillement directement aux officiers, qui pourront ainsi les avoir à meilleur compte que dans le commerce, ce qui leur permettra de réaliser des économies appréciables, (on n’est pas plus diplomate).
Cette note demande que les unités fournissent les besoins approximatifs mensuels pour la constitution des stocks. Les besoins ne sont pas bien grands, vu que les officiers s’habillent sur les effets destinés aux soldats. Au lieu de leur donner une indemnité d’habillement, on ferait beaucoup mieux de les habiller en nature.
Le 2 et le 3 octobre
Les compagnies vont travailler à faire des boyaux dans le secteur de Belleville.
Le mauvais temps revient. Ceux qui sont dans les tranchées doivent être bien mal dans la boue. Les bataillons qui sont relevés descendent dans un triste état. Quelle vie nous menons !
Le 3
Le commandant passe une revue du bataillon pour s’assurer que la nouvelle organisation est bien réalisée.
Je vais avec Garnier et Grély porter les couronnes sur la tombe de M. Jouannais au cimetière des Glorieux, où je vois également les tombes des autres soldats qui ont été tués durant notre période de tranchées. Nous portons 3 couronnes, une de Me. Jouannais, une des officiers et la 3ème des sous-officiers, capitaines et soldats de la 21ème compagnie.
Cette dernière a coûté 56 Francs 50.
Une collecte faite dans la compagnie a rapporté la somme dérisoire de 7 Francs 50. Les sous-officiers payent la différence.
Ce même jour, les compagnies touchent leur quote-part des 5 000 OOO de Francs qui ont été votés par le Parlement comme secours aux ordinaires. La somme est répartie au prorata des bonis, et les unités qui ont le moins en caisse touchent le plus.
La 21ème touche 484 Francs, les autres de 300 à 400.
Le 4 octobre
Nous communiquons une note relative à la liaison d’infanterie par avion et par ballon. Petit à petit, on s’organise et on devient pratique.
Basile Bazin (*) vient me voir et ne me reconnaît pas ; moi non plus d’ailleurs. Il est au 11ème d’artillerie à pied, et sa batterie (du 90) est près du cercle militaire ; ils sont là depuis le milieu du mois d’août.
Ils tirent en moyenne 1000 coups par jour avec leurs 6 pièces, sur les routes, pistes, etc. Des bruits d’attaque prochaine circulent, et en effet de nombreuses pièces d’artillerie, de gros calibre surtout, sont amenées de ce côté.
(*) : Basile BAZIN
est né dans le même village qu’Alexandre ROBERT. Il mourra pour la France le 22
mars 1919 à l’hôpital de La Tronche à Grenoble (Isère) des suites d’une maladie
contractée en service. Il était à cette période au 160e régiment d’artillerie à
pied.
Il était né à Tronchy (Yonne), le 2 janvier 1892. Il est inhumé
à Grenoble, dans le carré militaire, tombe N° 25.
Le 5 octobre
La 21ème va travailler dans la matinée ; le nouveau régime des permissions est paru à la décision ; je ne sais pas ce que cela rendra. Si tout va bien, je devrais y aller à la fin de ce mois.
Nous devons remonter aux tranchées aux mêmes emplacements, dans la nuit du 6 ou 7. Il a plu beaucoup dans la nuit. Quelle gadoue allons-nous trouver là-haut ?
Le commandant donne les ordres pour la relève.
Le 6 octobre
Les commandants de compagnie partent avec le commandant à 2 heures du matin.
Vers les 9 heures, l’intendance nous amène les vivres et munitions supplémentaires, même taux que la dernière fois. Tous les bataillons qui montent en 1ère ligne touchent ces distributions.
Depuis le début de l’offensive, quelles quantités de vivres supplémentaires ont dû être ainsi distribuées à l’armée de Verdun !
Nous faisons la répartition entre les compagnies après déjeuner, ce qui nous prend une bonne partie de l’après-midi. Le nombre de 700 rationnaires a été donné pour le bataillon.
C’est largement suffisant, car si l’on compte tous ceux qui restent à Verdun, il n’y en a guère que 670. Nous aurons encore notre charge à monter ce soir. Heureusement, il fait beau temps.
De nombreux avions se promènent sur la ville, et les Allemands les canonnent inlassablement, sans grand mal. Jusqu’à présent, je n’ai jamais vu descendre un aéro par les canons.
Nous partons le soir à 19 heures avec le capitaine Prudon : la liaison, les pionniers et les téléphonistes.
Au lieu de passer, comme en venant, par le centre de la ville, nous longeons la Meuse, ce qui raccourcit beaucoup. Il fait un beau clair de lune, ce qui est agréable, et nous fatiguons beaucoup moins. Il y a un mouvement intense de camions, de voitures, de caissons, etc. Nous passons, comme la dernière fois, par la côte de Belleville, où nous faisons une pause, puis, longeant à une certaine distance la route de Bras, nous traversons le ravin des Vignes, puis la Carrière où nous trouvons encore le 246ème qui est là depuis 12 jours et fait des travaux.
Cliquez sur la carte pour retrouver les lieux décrits
Nous grimpons ensuite sur le plateau à l’extrémité de la côte de Froideterre. Il n’y a encore aucun boyau, et nous passons la crête en contournant les trous d’obus.
Heureusement qu’il fait clair de lune, cela nous évite de nous jeter dans les entonnoirs remplis d’eau et de boue.
Nous arrivons enfin au retranchement Z où est le P.C. du chef de bataillon. Nous trouvons toutes choses dans l’état où nous les avons laissées Seuls des caillebotis ont été placés dans le boyau sur une trentaine de mètres.
Le 289 que nous relevons n’a pas eu beaucoup de pertes durant les 8 jours qu’il est resté ici : 6 tués et une vingtaine de blessés. Les compagnies prennent leurs anciens emplacements. La 21ème en soutien relèvera demain la 23ème en 1ère ligne.
On peut maintenant communiquer par la 1ère ligne, mais il y a de la boue dans laquelle on enfonce jusqu’aux genoux.
Le 7 octobre
Le 289 avait fait un beau plan, mais qui ne correspond guère à la réalité. Le commandant fait le sien pour expliquer dans quelles conditions il trouve le secteur. Seuls les P.C. des commandants de compagnie doivent être construits.
Dans l’après-midi, nous sommes bombardés et les obus tombent tout près du P.C. Une pierre de la grosseur du poing est projetée dans l’abri et vient crever un appareil Vermod qui est devant moi.
Le temps se gâte.
La soirée se passe dans le calme.. Notre artillerie fait cependant montre d’une certaine activité.
Le lieutenant Doumer est venu voir où en sont les travaux. Il est toujours aimable.
Le 8 octobre
Le temps se met franchement à la pluie et il ne fait pas chaud. On ne peut se dégager de la boue. Le lieutenant Hermet (*) est légèrement blessé dans l’après-midi par nos 75 qui tirent trop court.
Le colonel, frappé du fait que certaines unités de son régiment qui ont assisté aux mêmes combats proposent beaucoup plus d’hommes pour les citations que d’autres unités, fait faire le relevé par compagnie de toutes les propositions depuis le 1er juin.
Quelques tuyaux circulent : le 4ème serait à la côte du Poivre, un bataillon du 276 aurait été emmené au repos à Berney, le 289 serait parti en auto ; nous retournerions sur la rive gauche ; notre régiment serait relevé au bout de 4 jours, avant l’attaque, etc.
D’un autre côté on parle officiellement et le colonel appelle le commandant au téléphone pour lui donner des indications au sujet des tirs préparatoires d’artillerie. De tout cela, je ne peux retenir que le fait suivant : une attaque est en préparation, et d’après l’artillerie qui a été amenée, elle serait d’une grande envergure.
Le fait même que nous ayons pris les tranchées pour la 2ème fois tendrait à prouver que nous ne sommes pas compris dans les troupes d’attaque. Le mauvais temps va peut-être retarder les opérations.
Dans l’après-midi et toute la nuit, nous sommes bombardés par du 150, un tir lent et régulier. Le boyau qui conduit du P.C. Z où est le chef du bataillon, aux 1ères lignes, est bien repéré, ainsi que la tranchée Jouannais (**) où est maintenant la 23ème compagnie en soutien.
Cette compagnie a 2 tués et quelques blessés.
(*) ; HERMET Émile,
sous-lieutenant à la 21e compagnie. (JMO)
(**) : On note de suite que le nom du Lieutenant JOUANNAIS
(tué le 24 septembre) a été donné à une tranchée. C’était assez fréquent.
Le 9 octobre
Un lieutenant-colonel du 4ème et des officiers viennent reconnaître le
secteur. Ils sont encore du côté de Bar-le-Duc et vraisemblablement viendront
ici pour faire l’attaque.
Les travaux qui ont été poussés très activement permettent maintenant
de passer sans trop de risques par la 1ère ligne ou par la tranchée
Jouannais, 3 lignes successives qui commencent à être organisées en dépit
de la boue et de l’eau où l’on enfonce en certains endroits jusqu’aux genoux.
Le commandant me charge de conduire le lieutenant-colonel du 4 jusqu’au bataillon de droite où je ne suis jamais allé. Je trouve cependant le chemin et reviens crotté comme « un poilu ».
Le 75 qui fait le barrage en oblique devant notre secteur tire encore dans nos lignes. Ce point est délicat et le commandant fait les réclamations en conséquence.
Dans l’après-midi, un exercice de lancement de fusées a lieu pour bien repérer les points de la ligne. Le poste du colonel ne pouvant apercevoir la gauche du bataillon, un relais est établi.
Le bombardement de notre coin par les boches continue ; heureusement il n’y a pas beaucoup de mal. Une patrouille est faite par la 22ème compagnie (droite). C’est un ordre de la division, on doit en faire toutes les nuits.
Le 276, à notre gauche, en a fait les nuits précédentes. Le 4ème d’infanterie est en ligne, dit-on, 2 bataillons sur la côte du Poivre et un en réserve à la Carrière.
Le JMO du régiment signale la perte de 2 hommes tués et 5
blessés.
Le 10 octobre
Nous avons été dérangés toute la nuit par des plis venant du colonel. Une de ces notes est amusante. Il nous dit d’avoir des tempéraments de Peaux-rouges, et il fait encore de la réclame pour les bouquins du capitaine Laffargue. Des punitions arrivent encore pour des soldats qui ont été pris dans Verdun sans laissez-passer par les gendarmes.
Des tirs de réglage auront lieu dans la journée. L’heure en sera donnée à temps pour effectuer les évacuations nécessaires.
Hier, on avait demandé l’état des officiers ayant 20 ans de services pour être inscrits sur le tableau de la Légion d’Honneur, et des sous-officiers ayant 10 ans de services pour la médaille militaire.
À ma compagnie, seul Dumans se trouve dans ce cas. Il est depuis le début sergent-artificier.
Cette nuit, les obus boches ont bien endommagé les boyaux, et les grosses marmites continuent à tomber non loin du P.C. Z du chef de bataillon. Le commandant, dont nous sommes les locataires, fait consolider son abri par les pionniers. Ce ne doit pas être spécialement pour la liaison qu’il le fait faire, mais comme il n’est pas souvent dans les tranchées, il se sentira plus en sécurité.
Mon sergent-major Poulet est allé, cette nuit, coucher en 1ère ligne où il se trouve plus en sécurité qu’à côté du lieutenant Gigot où les marmites tombent bien près. Il fait beau temps aujourd’hui et nous sommes heureux de voir le soleil.
À 10 heures, je me mets à faire notre cuisine sur le pas de notre porte, mais les obus boches ne me laissent pas finir ; ils envoient des mottes de terre dans mes pommes sautées, ce qui fait dire au capitaine Prudon que :
« Pour une fois, on verra la liaison claquer du bec ».
Nous lui en donnons le démenti, et je me remets à faire une omelette, que cette fois nous mangeons. Le commandant lui avait d’ailleurs fait réponse que :
« Quand il verrait la liaison claquer du bec, il
n’aurait lui-même pas grand’chose à manger ».
Le commandant CHALET nous connaît et il sait que nous ne nous embarquons jamais sans biscuits.
L’aviation est très active.
Les boches tirent beaucoup sur nos avions. Il me semble que nous avons
beaucoup moins de batteries anti-aériennes qu’eux.
Vers les 18 heures 30, nous entendons sur notre droite, du côté de
Fleury, des éclatements de grenades, et bientôt un violent tir de
barrage se déclenche ; les obus tombent dru comme la grêle durant plus d’une
demi-heure, et nos batteries répondent avec usure.
Malheureusement, nous avons des pertes, et dès que le bombardement se
calme un peu, les blessés arrivent.
À ma compagnie, le sous-lieutenant Julien
est tué.
Poulet, le sergent-major, le sergent Cappelaere
et 2 hommes sont blessés. Noirot,
un pays (*) à Poulet,
est tué.
Tous se trouvaient dans un abri en construction où il y avait 2 cadres
de galerie de posés ; un obus est tombé en plein dans l’entrée. Julien et Poulet avaient quitté l’endroit où ils étaient, vers le
lieutenant Gigot, pour aller vers
les 1ères lignes où les obus tombaient beaucoup moins.
Ce que c’est que la fatalité !
Dans l’après-midi, 1 caporal et 4 hommes avaient été blessés par un de nos 75 qui tirent toujours dans nos lignes.
Comme Poulet sera évacué (il a 2 éclats dans la tête), le lieutenant Gigot me demande si je veux le remplacer. Je suis bien embarrassé. Je suis depuis 26 mois à la liaison et je voudrais bien y rester.
D’un autre côté, le commandant CHALET passera probablement bientôt lieutenant-colonel, et je serais alors dans la compagnie, car avec un autre commandant les fourriers ne seraient peut-être pas à la liaison. Les sergents-majors ne montent aux tranchées que 2 fois sur 3, ce qui est aussi à envisager.
Finalement, je réponds oui.
C’est au petit bonheur.
(*) :
« Un pays » : expression signifiant « une personne du même
village »
JULIEN Marcel,
sous-lieutenant, mort pour la France à Fleury-devant-Douaumont le 10 octobre
1916, tué à l’ennemi. Il était né à Avize (Marne) le 30 janvier 1894. Il a été
inhumé à cette date au cimetière M.. de Glorient. Il n’a pas de
sépulture militaire en 2014.
NOIROT Camille,
soldat, mort pour la France à Fleury-devant-Douaumont le 10 octobre 1916, tué à
l’ennemi. Il était né à Savigny (Yonne). Il n’a pas de sépulture militaire
connue.
Le JMO du régiment
signale, durant cette journée, la perte de 14 hommes tués et 22 blessés.
Le 11 octobre
Dans la matinée, les Allemands nous envoient des petites torpilles dont nous ne pouvons repérer le point de départ. Ils nous bombardent par intermittence toute la journée.
La 23ème a 4 tués dont 2 sergents : Lévy et Lepage. (*)
Le soir, le colonel envoie un plan de la division pour la direction des travaux, suivant les données qu’avait le génie hier. Mais quand les compagnies du génie viennent pour travailler, ils ont alors le plan du commandant CHALET qu’on venait de lui faire abandonner.
Finalement, les compagnies du 6ème bataillon travaillent de concert avec le génie à l’exécution de ce plan. Je me demande comment le commandement peut s’y reconnaître dans un tel méli-mélo.
Le JMO du régiment signale, durant cette journée, la perte de 10
hommes tués et 7 blessés.
(*) : LEVY Paul,
sergent, mort pour la France à Fleury-devant-Douaumont le 11 octobre 1916, tué
à l’ennemi. Il était né à Paris, le 89 février 1886. Il est inhumé à la
nécropole nationale GLORIEUX, Verdun, tombe 819.
(*) : LEPAGE Henri
Edmond, sergent, mort pour la France à Fleury-devant-Douaumont le 11
octobre 1916, tué à l’ennemi. Il était né le 13 juin 1879 à Larbroy (Oise). Pas
de sépulture militaire connue.
Le 12 octobre
Nous marchons toute la nuit, toujours pour ces maudits plans, et à 1 heure je vais trouver le lieutenant Gigot pour faire le compte-rendu journalier.
Le temps a l’air de vouloir se mettre à la pluie. Des tirs d’artillerie lourde sont prévus pour la journée dans différentes zones devant notre secteur, et une section de la 21ème à gauche, près du quadrilatère, devra évacuer comme il avait été prévu.
La journée se passe assez bien ; nous recevons comme d’habitude beaucoup d’obus de tous calibres, et la 23ème a encore quelques pertes. Nos batteries répondent avec usure aux batteries ennemies.
Je vais manger à la liaison, mais le soir je couche près du P.C. du lieutenant Gigot, dans un trou d’obus. Je suis plusieurs fois réveillé dans les quelques heures que je puis dormir par des obus qui tombent non loin et qui secouent mon trou.
Le général commandant le groupement doit visiter le secteur.
Le JMO du régiment signale, durant cette journée, la perte de 6
blessés.
Le 13 octobre
Le général qui commande le groupement passe dans le secteur dans le courant de la matinée. Il est accompagné du général Mangin commandant la 55ème D.I., du colonel Lachèvre et des officiers d’E.M., parmi lesquels je reconnais le lieutenant Doumer.
Le commandant est venu les attendre dans la parallèle 2, au P.C. du capitaine Café. Après son passage, le lieutenant Gigot me dit qu’il l’a entendu dire que nous ne serions pas relevés avant quelques jours, et que l’on attend le beau temps. Charmante perspective !
Le général à 3 étoiles n’a pas beaucoup le sourire ; il a au contraire l’air raide et cassant, contrairement au général de Maud’huy.
De 14 heures à 16 heures, notre artillerie doit faire des tirs de destruction et une partie de notre ligne est évacuée pour éviter les accidents : la gauche de la 21ème et le 276ème.
Les éléments se portent un peu en arrière et la danse commence. Les obus de gros calibre tombent dru sur les tranchées et ouvrages ennemis.
3 Allemands fuyant le bombardement se rendent dans nos lignes et sont faits prisonniers par la 21ème compagnie. C’est intéressant, car ils pourront peut-être donner des renseignements utiles pour l’attaque prochaine. (*)
Les batteries ennemies ne tardent pas à répondre aux nôtres ; un avion survole nos lignes à très faible hauteur. Notre position est bien repérée et les 150 tombent tout autour de nous, ébranlant nos nerfs en même temps que nos trous dans lesquels nous nous attendons à chaque instant à être ensevelis ou réduits en bouillie.
Je descends à un moment donné dans un P.C. en construction qui offre un abri relatif ; nous ne craignons rien dans cette galerie, à condition que les obus ne tombent pas dessus ou devant l’entrée.
À 5 heures, le bombardement cesse un peu.
Toutes nos tranchées et boyaux sont démolis et les pertes sont assez fortes : une quarantaine de tués et blessés dans le bataillon. La 22ème a 12 tués. La proportion des tués est considérable, et cela se comprend vu la situation. Un obus tombe dans un trou et tous ses occupants sont tués, alors que s’il tombe à quelques mètres il n’y a aucun mal, le trou garantissant des éclats.
Je descends manger à la liaison ; un grand nombre d’obus sont tombés également autour du P.C. du commandant et le boyau est comblé.
Au moment où je me disposais à remonter, nous entendons le bruit d’un combat à la grenade sur la droite, vers Fleury, et un tir de barrage se déclenche bientôt. Il dure environ ½ heure et ne fait heureusement pas beaucoup de mal.
Une patrouille doit être faite cette nuit à partir de 0 heure 1 par la 21ème.
Elle sera composée de 1 adjudant, Guillodot, 1 sergent, Rondet, 1 caporal, Cordonnier, 5 grenadiers et 5 voltigeurs. Je vais tâcher de dormir dans mon terrier ; les obus continuent de tomber toute la nuit, de temps en temps.
Le JMO du régiment signale, durant cette journée, la perte de 21
hommes tués et 19 blessés.
(*) : C’est exact, les faits sont relatés dans le JMO.
Le 14 octobre
Je me « lève » à 1 heure et prépare les pièces et le compte-rendu de la patrouille de cette nuit qui rentre à 1 heure 35.
Elle n’apporte aucun renseignement intéressant. Les Allemands travaillaient à la réfection de leur tranchée, et aucune défense accessoire ni petit poste n’a été reconnu.
Mais le colonel renvoie le compte-rendu comme modèle de précision et de clarté. On parle de la relève. Mais le bombardement reprend.
Comme j’étais descendu manger avec la liaison, j’attends un peu pour remonter dans mon trou d’obus où je ne me sens guère en sécurité. Bien m’en a pris, car un 1er obus comble mon trou d’obus en enterrant les agents de liaison, dont l’un est blessé.
On le déterre et on va aussitôt se mettre à l’abri dans le P.C. en construction en face. Mais peu après 2 autres obus tombent en plein dans notre trou d’obus et enlèvent la terre que le 1er a jetée dedans, tandis qu’un autre tombe sur l’entrée du P.C. et démolit 2 cadres de galeries, comblant complètement l’entrée.
Trois des occupants sont blessés ; les autres n’ont rien et peuvent sortir quand l’entrée est dégagée. Le bombardement cessant un peu, je remonte voir vers le P.C. du commandant de compagnie et j’apprends toutes ces choses.
Le boyau est complètement comblé.
J’appelle Larcher par-dessus les éboulis et lui dis de chercher la musette contenant la comptabilité de la compagnie qui est enterrée avec toutes mes affaires : couverture, toile de tente, etc. La musette est enfin retrouvée.
Le soir, je couche à la liaison, car je n’ai plus le moindre trou.
Poulet m’envoie une lettre qu’il m’écrit en attendant un train sanitaire qui doit l’emmener dans la zone des étapes. La blessure n’est pas grave heureusement ; il m’envoie très aimablement des renseignements pour prendre la suite de ses affaires. (*)
Le JMO du régiment signale, durant cette journée, la perte de 9
hommes tués et 25 blessés.
(*) : Alexandre va remplacer POULET comme comptable de la
compagnie.
Le 15 octobre
Les officiers des compagnies qui doivent nous remplacer sont arrivés, nous partons enfin ce soir et nous n’en sommes pas fâchés. Nous sommes relevés par le 289ème qui arrive d’assez bonne heure.
Dès que toutes les consignes sont passées, je pars avec le lieutenant Gigot en tête d’une section.
Aux Carrières, nous rencontrons un homme du 4ème à qui nous demandons des renseignements sur son régiment. 5 compagnies sont en ligne à la côte du Poivre, les autres en réserve aux Carrières. Nous arrivons sans encombre à Verdun où les compagnies reprennent leurs anciens emplacements.
Pour ma part, je prends la place de Poulet et m’occupe de toute la comptabilité de la compagnie.
Le JMO du régiment signale, durant cette journée, la perte de 3
hommes tués et 5 blessés.
Le 17 octobre
Les compagnies vont travailler ; on parle beaucoup de l’attaque.
Chauvot vient nous voir. Ils doivent aller au camp Augereau et embarquer dans les autos pour Robert-Espagne.
La pluie tombe toujours. Nous plaignons ceux qui nous ont remplacés, mais sommes nous-mêmes heureux d’être descendus.
Le JMO du régiment signale, durant cette journée, la perte de 1
homme tué et 2 blessés.
![]()
Pas
d’écrits entre ces deux dates
![]()
Le 20 octobre
Vers les minuit, un ordre arrive que nous devons nous préparer à partir immédiatement. Le régiment doit avoir quitté Verdun avant 3 heures. C’est un remue-ménage indescriptible.
Il nous faut distribuer immédiatement les 2 jours de vivres que nous avons d’avance et mettre la cuisine en route pour le repas de demain qui sera mangé au camp Augereau en attendant d’aller prendre les autos près de Nixéville. Je réussis à tout mettre en route.
Nous ne laissons rien, à part une cinquantaine de boules de pain que les hommes ne prennent pas.
Le 21 octobre
Nous mangeons la soupe au camp Augereau où nous arrivons le matin au jour. Il a gelé très fort dans la nuit, et nous n’avions pas trop chaud pour marcher. Il est arrivé un accident à la cuisine roulante. Le bouchon du fond est parti dans un chaos et une bonne partie de la soupe est perdue.
Enfin, les hommes de la compagnie mangent tout de même.
Deux pièces de 400 sont installées non loin d’où nous sommes et tirent sur le fort de Douaumont. Je vais les voir, mais on ne peut les approcher, car la batterie pourrait être repérée par les avions boches.
D’où nous nous trouvons, nous distinguons très bien les toiles qui forment le camouflage et nous assistons à toutes les manœuvres du tir : l’obus qui est déplacé à l’aide d’une grue est aussi haut qu’un homme.
Quel travail doit donner une telle batterie à installer : voies ferrées, plates-formes, camouflage, etc.
Nous quittons le camp Augereau vers 1 heure et allons pour embarquer près de Nixéville, au même endroit où nous avons débarqué la dernière fois. Nous roulons bientôt à bonne allure.
Nous voyons sur notre passage un camp d’aviation où il y a une grande quantité d’appareils qui paraissent tout neufs et prêts à prendre l’air. Nous débarquons à quelques centaines de mètres de Charmontois où nous devons cantonner ; nous attendons là que le cantonnement soit fait, ce qui demande du temps.
La soirée s’avance quand nous prenons possession de nos cantonnements. Vermelin m’a trouvé un bureau où je crois que je serai très bien.
Les 22 et 23 octobre
Nous nous installons ; je mange avec les sous-officiers de la compagnie et constate que leur popote est très bonne et que la plus franche cordialité y règne.
Les jours qui suivent, on reçoit tous les effets d’hiver qui ont été demandés le mois dernier. Mais la distribution est assez difficile à faire, car environ 70 permissionnaires sont partis en 2 ou 3 jours pour nous remettre à jour et en conformité avec la nouvelle loi qui octroie une permission de 7 jours tous les 4 mois.
Je vois avec plaisir mon tour approcher.
Je fais mon possible pour tout mettre en ordre, de façon que si je partais il n’y ait aucune anicroche. Tout cela me donne beaucoup de travail. Le caporal-fourrier Mouvet étant en permission, je prends Sabaterie pour me donner un coup de main.
Les permissionnaires rentrent petit à petit et toutes les distributions se trouvent faites.
Le lieutenant Gigot veut faire certaines choses lui-même ; et il les complique beaucoup. Il ne connaît que le règlement, et il explique les choses à fond. Tout le monde est forcé de comprendre.
Au rapport, il fait de très longs discours qui sont pleins de bon sens. Il rend très souvent les chefs de section responsables de tout ce qui ne marche pas dans leur section.
Enfin, nous réussissons à tout distribuer et à tout mettre en ordre.
Chaque homme a maintenant 3 chemises, 2 caleçons, 2 paires de chaussettes, un tricot, une paire de gants, un cache-nez, presque tous une peau de mouton, une paire de galoches et une paire de chaussons.
Je distribue aussi une quantité d’autres effets de toute nature.
La cuisine roulante qui a été menée à Révigny en réparation est revenue. Nous devions partir pour les tranchées le 6, mais un contrordre est venu et notre départ est retardé de 3 jours.
Le 5ème bataillon doit partir le 8.
Le lieutenant Gigot veut que les hommes aient 2
légumes par jour, plus des suppléments. Aussi le boni descend rapidement et je
le mets au courant de la situation.
Quand nous touchons par exemple du riz ou de la julienne ou des confitures,
c’est 2 repas de légumes qu’il me faut acheter.
Novembre-décembre : même secteur, Jubécourt, le
camp des Pommiers.
Le 7 novembre
Je pars en permission et suis tout étonné que mon tour soit si vite
arrivé. Je passe toutes les consignes à Vermelin
qui me remplacera durant ma permission, et je pars avec le détachement prendre
le train à Givry.
À Révigny, j’attends mon train 6 heures durant les pieds dans la
boue. Tous les cafés et bistros sont bondés par les permissionnaires. Il y a
bien une cantine et des baraquements installés à leur usage, et très bien ma
foi, mais tout cela n’est pas assez spacieux, et c’est à peine si à la cantine
on peut acheter ce dont on a besoin.
On touche du bouillon gratis et dans un autre baraquement contigu à la gare on distribue du thé ou du café et des cigarettes, tandis qu’un phonographe fait entendre des airs d’opéra ou des refrains à la mode.
Enfin, l’heure de mon train arrive ; je passe par Troyes et débarque à Flogny à 8 heures du matin, le 8 novembre.
J’en repars le 10 par le train de 8 heures 15 qui passe à 10 heures 50 et j’arrive à Paris à la nuit tombante. Une journée de perdue en voyage.
Je trouve Jeanne bien patraque. Si seulement cette maudite guerre se terminait ! Je pourrais la faire soigner radicalement, mais jusque-là rien à dire et rien à faire.
Je repars de Paris le 16 par le train de 3 heures.
Jeanne, ma tante et Marcel viennent m’accompagner à la gare de l’Est où je trouve quelques camarades. Nous arrivons à Révigny à minuit et le train de Fleury où nous devons débarquer ne part qu’à 2 heures 50. Il fait un froid terrible et nous cherchons un abri.
Mais c’est comme au départ et le moindre petit coin est occupé. Je rentre dans la gare avec Zambo, l’adjudant du 5ème bataillon, et nous nous casons enfin dans la salle d’attente où seuls sont admis les civils, les officiers et les sous-officiers.
La salle est chauffée et l’on y est relativement bien.
Notre train part à 3 heures ½. Les compartiments ne sont pas chauffés ni même éclairés.
Avec cela, les glaces des portières sont en partie brisées et le froid est très intense. Nous sommes littéralement gelés quand nous débarquons à Fleury le 17 à 8 heures.
Nous nous rendons alors à pied à Jubécourt où se trouve notre T.C. et nous faisons une halte à Rarécourt pour casser la croûte. Nous sommes à Jubécourt à midi.
Le 6ème bataillon devant descendre des tranchées le lendemain soir, je reste donc au T.C. Dumans, le sergent-artificier, m’invite à manger avec eux et m’offre une couchette dans les baraquements. Je m’occupe des cantonnements de ma compagnie dans l’après-midi.
Le 18 novembre
Je vais coucher chez la vieille dame où j’ai installé le bureau de la compagnie et elle m’offre un lit à louer que je m’empresse d’accepter.
Je me couche donc dans des draps avec Mouvet, le caporal-fourrier qui était resté au T.C. et nous attendons que la compagnie descende.
Les hommes vont avoir un bien mauvais temps. Il fait moins froid, mais la neige qui avait commencé à tomber s’est changée en pluie et il y a une boue affreuse.
Le 19 novembre
Vermelin, le fourrier, vient nous réveiller ; la compagnie est arrivée ; il est 3 heures du matin. Je me lève et vais voir le lieutenant Gigot qui attrape Mouvet parce qu’il n’était pas à attendre la compagnie à son arrivée. Les hommes se casent tant bien que mal.
Je donne mon lit à l’adjudant et l’aspirant et vais me recoucher dans mon bureau où se trouve un bois de lit sur lequel on a cloué du treillage métallique. Je n’y serai pas trop mal.
Mouvet couche avec moi.
Dans la journée, la compagnie s’installe et je reprends les consignes de la compagnie. Elle n’a eu que 3 blessés durant cette période de tranchée et 3 évacués pour maladie. Il y avait beaucoup d’eau dans le secteur qu’elle occupait et il y a eu des commencements de pieds gelés.
Le 20 novembre
Le commandant passe dans les cantonnements et prescrit certaines améliorations que l’on ne peut faire qu’à la condition que l’on nous délivre du matériel que nous demandons : planches, claies, clous, etc.
Le lieutenant Gigot part en permission et le sous-lieutenant Merle prend le commandement de la compagnie.
Le 21 novembre
Je vais au T.C. toucher les effets que l’on distribue immédiatement dans les sections. La compagnie a fourni aujourd’hui 50 hommes toute la journée pour faire des chemins dans le camp d’Auxerre où sont le T.C. et tous les services de l’approvisionnement.
Toute la journée, je n’arrête pas une minute et travaille tard le soir.
Quelle paperasse ! Il est presque impossible de confier quoi que ce soit au caporal-fourrier Mouvet ; c’est un très charmant garçon, mais d’un caractère par trop jeune. Il ne pense jamais à ce qu’il fait.
Le bataillon doit reprendre les tranchées le 25.
Le 23 novembre
Le capitaine Loiselet réunit tous les sergents-majors du régiment pour nous parler surtout des effets d’hiver.
Il nous dit que le colonel rend les sergents-majors responsables des erreurs matérielles qui pourraient se produire dans la comptabilité et qu’il n’attend que la 1ère occasion pour faire un exemple, c’est-à-dire casser un sergent-major.
Que les commandants de compagnie ont assez à faire pour commander leur unité sans s’occuper de l’administration. (Heureux encore quand ils ne font pas comme le lieutenant Gigot et qu’ils ne font pas perdre du temps inutilement en voulant trop bien s’en occuper).
Le colonel nous avait d’ailleurs déjà tenu ce langage à Verdun.
En somme, nous passons au moins 4 heures au bureau du colonel pour ne rien faire du tout et ne rien apprendre. Le commandant Bonjean nous a seulement expliqué le nouveau régime des permissions qui allait entrer en vigueur : une permission de 7 jours tous les 4 mois, les convalescences n’entrant pas en ligne de compte. Seulement, tous les petits malades ou petits blessés auront beaucoup moins de permissions de convalescence et cela permettra de faire une sélection.
Les punis, condamnés, y auront droit aussi et ceux qui rentreront en retard, en plus de la peine disciplinaire, auront leur permission écourtée d’autant de jours qu’ils seront rentrés en retard.
Les récidivistes seraient envoyés à la section de discipline.
Le 24 novembre
Alors que nous partons demain matin à 6 heures, on nous donne encore des effets à distribuer. Je fais vite pour rentrer les vieux.
Heureusement, j’apprends que je reste à Jubécourt ; je n’ai donc pas besoin de me faire de bile pour le départ. Je resterai au T.C. avec 1 caporal-fourrier de chaque compagnie.
Cavin apprend qu’il part le lendemain matin en permission pour Madrid en vertu du nouveau régime. Je lui paye son prêt d’avance.
Le 25 novembre
Le bataillon part à 6 heures, car il lui faut avoir franchi la crête avant le jour.
Il passera la journée au camp des Pommiers et montera le soir en ligne. Je m’étais couché très tard pour préparer mes affaires et mettre un peu d’ordre dans les paperasses, mais je me lève tout de même pour le départ.
Le temps s’annonce mauvais.
La compagnie partie, je fais mes malles et monte tout mon fourbi au camp d’Auxerre où je dois être officiellement. Mais je viendrai coucher dans la maison où nous étions installés et où la vieille dame m’offre un lit, celui qu’occupaient l’adjudant et l’aspirant.
Je serais bien bête de ne pas profiter de l’occasion et je serai toujours mieux dans les draps que sur les poux et les 2 ou 3 fétus de paille qu’il y a sur les couchettes métalliques des baraquements.
La période de tranchées se passe très agréablement pour moi.
Je fais un peu de comptabilité, reçois et fais remonter les permissionnaires qui rentrent.
Tous les jours, nous
descendons au village prendre le café ou une bonne bouteille en nous chauffant
un peu, car il fait très froid.
Le matin, nous allons nous débarbouiller avec Bernot et Jouenne à une source à quelques centaines de mètres du camp.
Il ne fait pas chaud, mais cela fait plaisir de pouvoir barboter un peu.
Les premiers jours, et notamment le 25, il a plu toute la soirée et la nuit et la relève avait été très pénible. Mais par la suite la gelée se mit de la partie et le temps clair permit aux avions ennemis de venir au-dessus de nous faire des excursions.
Ils furent d’ailleurs violemment canonnés.
Le 2 décembre
Nous apprenons que le bataillon doit être relevé dans la nuit du 1er au
2.
Nous n’avons pas d’ordres, mais nous décidons de partir dans la matinée
du 3. Le secteur était toujours calme et nous n’avons pas eu de perte. Un seul
blessé par son camarade qui nettoyait son pistolet automatique.
Le 3 décembre
Nous arrivons à pied au camp des Pommiers à quelque distance de Récicourt
vers 10 heures ½.
Le camp est situé dans un ravin boisé. Il y a des abris plus ou moins bien aménagés et d’accès assez difficile. J’aimais beaucoup mieux l’endroit que je viens de quitter et que je regrette, surtout mon lit. Je travaille très tard le soir, car dans la journée je ne peux rien faire de sérieux.
Si je ne suis pas tenu par le lieutenant Gigot, qui décidément aime beaucoup faire des discours et des recommandations, ce sont des hommes qui viennent à chaque instant pour les permissions ou pour un renseignement quelconque.
A minuit, on vient prévenir que la compagnie va travailler le lendemain à 5 heures ½. C’est bien militaire. Je vais me coucher peu après et me lève pour le départ de la compagnie, assurer les distributions, etc.
Il est tombé de la neige la nuit et il y a beaucoup de boue.
Le 4 décembre
La journée du 4 se passe sans incident ; le commandant CHALET prend le commandement du régiment et va à Jubécourt.
Le soir, comme nous commencions de dîner, le lieutenant Gigot nous appelle et nous tient au moins une heure pour peu de chose.
En revenant, je m’enlise dans un tas de boue où je laisse mon sabot. Cela me fait songer que j’ai vu avant de descendre de Jubécourt des bottes en caoutchouc dans le magasin des détails qui trouveraient leur emploi ici. Il est vrai que nous avons bien laissé aussi les chapes et sabots bien empaquetés à Jubécourt. Voilà à quoi servent les effets d’hiver pour lesquels on nous a tant embêtés.
Tout cela n’est rien, si seulement cette maudite guerre se terminait.
Mais les Roumains font leur repli stratégique et en Grèce la voix est aussi au canon.
De mieux en mieux.
Il y a cependant de la lassitude partout maintenant, et même les civils commencent à ne plus tenir. Tous les permissionnaires qui rentrent disent qu’ils ont recommandé chez eux de ne semer que juste le nécessaire pour vivre. Je crois aussi que c’est le seul moyen de finir cette guerre, et on aurait dû l’appliquer tout de suite.
Mais tout le monde avait foi en les beaux et grandiloquents discours des journaux. La désillusion est d’autant plus pénible, mais beaucoup se demandent maintenant, non plus quand nous serons vainqueurs, mais même si nous serons vainqueurs.
D’ailleurs, les sacrifices ont été assez grands et nous avons fait montre d’assez de patience. C’était à ceux qui nous conduisent de voir clair et de ne pas faire de bévues qui sont impardonnables.
Depuis 2 ans que l’on pousse la Roumanie à se faire massacrer, non pas pour le Roi de Prusse mais pour la cause des Alliés, et on ne lui a même pas fourni les moyens de se défendre. Qu’est-ce donc que la fameuse entente entre les gouvernements, le front unique etc. ?
Le 5 décembre
La compagnie va encore travailler.
Il fait toujours mauvais temps et l’on ne peut mettre le pied dehors sans s’enfoncer jusqu’à mi-jambe dans la boue. Les hommes qui restent doivent aller aux douches ; j’y vais moi-même parmi les premiers, mais je renonce à prendre une douche ; l’installation est trop petite pour tous les hommes qui sont là, et au lieu de se nettoyer on se salit ; je me débarbouille dans le ruisseau.
Le lieutenant Gigot est malade ; il a la grippe et ne sort pas de son abri, dans lequel il fait un feu d’enfer. Il m’appelle de temps à autre et me tient quelquefois longtemps. De même pour les sous-officiers à qui il fait de longs discours, bien qu’étant malade.
Le soir, nous entendons une très violente canonnade ; ce doit être du côté de 304 ; elle continue toute la nuit et la journée du lendemain.
Le 7 décembre
Vers midi, nous sommes alertés, ou plutôt on nous dit d’avoir à nous tenir prêts à partir ; puis finalement nous ne bougeons pas. La canonnade va en décroissant.
Vers le soir, nous apprenons de vagues tuyaux ; les Allemands auraient attaqué la cote 304 et auraient pris le saillant Kieffer que nous tenions quand nous y étions.
Le 8 décembre
On nous communique vers les 10 heures d’avoir à aller, tous les sergents-majors, avec nos carnets de comptabilité, au bureau du colonel à 13 heures 30.
Je pars avec Defranchi et Chappart ; nous arrivons les premiers à Jubécourt, où le commandant Bonjean et le capitaine Loiselet nous parlent un peu de tout, mais surtout du nouveau régime des permissions.
C’est maintenant dans les compagnies que l’on établira les titres et que l’on règlera les départs, à raison de 13% continuellement absents.
Encore du travail en plus en perspective.
Je vais voir ma propriétaire qui m’a logé durant mon séjour dans ce village, et après une visite au camp d’Auxerre pour différentes petites choses, nous reprenons le chemin du camp des Pommiers par Brocourt et Récicourt.
Nous arrivons à destination vers les 6 heures ; il fait grand’nuit, et nous sommes crottés comme des barbets, car il y avait une boue horrible tout le long de la route, et les autos et les attelages nous ont bien éclaboussés.
Les 9 et 10 décembre
Je travaille à dresser ma liste des permissionnaires. Les hommes qui sont arrivés en renfort le 6 dernier et qui arrivent de convalescence vont encore repartir avant les anciens, leur convalescence de 7 jours ne comptant pas comme permission.
Cela fait beaucoup crier, comme le fait de faire partir les hommes sans suivre effectivement l’ordre chronologique des rentrées. Chacun est toujours sûr d’avoir, avec ce système, une permission tous les 4 mois, mais en retardant le départ de certains, il se peut que ceux-ci se trouvent à être tués ou blessés dans la tranchée quand ils devraient être en permission, si le tour était rigoureusement observé comme cela était dans le passé.
Tout cela est bien difficile à régler, et je crois que le bureau du colonel élude les responsabilités. Le commandant Bonjean nous a touché deux mots des embêtements qu’il y a avec les députés et les sénateurs, etc.
Le 10 décembre
Nous avons l’ordre de relève pour le lendemain ; la compagnie doit être en 1ère ligne. Je monte cette fois et le caporal-fourrier reste aux cuisines qui iront probablement au camp de la Source, tout près d’où nous sommes.
La question du ravitaillement est réglée, nous avons touché une ration de pain et une de viande en avance pour permettre de monter la soupe plus tôt ; elle devra arriver aux tranchées avant 19 heures.
Le lieutenant Gigot qui va mieux demande que le cordonnier de la compagnie reste aux cuisines pour réparer des chaussures, mais le commandant CHALET ne fait rester que 2 cuisiniers, le caporal d’ordinaire et 1 homme de corvée pour toucher le ravitaillement qui peut être et de préférence le cordonnier, si bien que les cuisiniers auront fort à faire pour leur travail, surtout à notre compagnie où l’effectif est ¼ plus fort que dans les autres compagnies.
Les commandants de compagnies partent demain à 8 heures 30. Nous ne partirons que vers les 16 heures.
Le 11 décembre
Nous partons comme il avait été prévu à 16 heures du camp des Pommiers. J’emporte la sacoche avec une grande partie des bouquins et de la comptabilité. Cela remplace bien le sac comme poids et c’est beaucoup plus difficile à porter.
Au moment de partir, j’ai fait
adapter une courroie à la sacoche, mais elle me coupe la respiration, et à la
1ère pause j’en ai déjà assez. Quelques centaines de mètres plus loin, vers la ferme
de Verrières, la voiture médicale nous passe devant.
Je la rattrape aussitôt et mets la sacoche dedans, puis je suis les brancardiers, car je ne connais pas du tout le secteur, n’y étant jamais venu.
J’apprends qu’ils ne vont que jusqu’au P.C. du colonel, mais de là je trouverai bien ma compagnie.
Tout le long de la route, il y a une boue effroyable dans laquelle nous enfonçons jusqu’aux chevilles. Les cantonniers ne doivent pas travailler beaucoup. La nuit est très obscure, et tout ce dont je puis me rendre compte est que nous passons dans les bois. Nous arrivons enfin au ravin de la Noue où est le P.C. du colonel et où le conducteur décharge le matériel de popote des officiers et de la liaison.
Le cheval en avait sa charge et dans les côtes, ou quand la voiture était dans un trou, il avait peine à la traîner.
Mais ce n’est encore que la partie la plus pratique de la route. La voiture doit aller jusqu’au P.S. (*) du bataillon, dans le ravin de Béthincourt.
À gauche de la route, elle s’engage dans une piste sur laquelle on enfonce dans la boue jusqu’à mi-jambe. Heureusement, quelques fusées nous éclairent, car nous nous serions infailliblement jetés dans les trous d’obus remplis d’eau dont toute la piste est semée.
Arrivé au P.S., je reprends ma sacoche et pars seul dans la direction que l’on m’indique. Je trouve la 23ème compagnie qui est en réserve dans le même ravin et où je puis avoir quelques renseignements précis par l’ordonnance du capitaine qui est là du matin et par Guinard qui attend la compagnie.
Je prends donc le boyau où j’ai tout le loisir de prendre un bain de pieds ; j’arrive enfin au P.C. du commandant ; là, je trouve Vermelin et nous allons tous deux où doit se trouver la 21ème compagnie. Elle arrive peu après moi ; si j’ai marché vite, j’ai fait le grand tour.
Nous remplaçons la 14ème du 289ème, et le capitaine Rollin qui la commande et que je connais déjà pour avoir vu les beaux plans du secteur faits de sa main me parle de son séjour à Jubécourt, et j’apprends que c’est lui que mon hôtesse a pour ainsi dire mis à la porte parce qu’il s’était introduit et installé chez elle sans même lui demander alors qu’elle n’était pas là.
Je vais voir ensuite l’emplacement du « bureau », un trou où l’on ne peut se tenir assis qu’à condition de courber le dos.
Enfin, il faut savoir se contenter de ce qu’il y a et je serai encore mieux qu’à Thiaumont il me semble. Les consignes sont passées et le 289ème part.
Un officier reste comme il est prescrit.
(*) : P.S. :
Poste de Secours
Le 12 décembre
Je me lève à 3 heures pour faire les pièces et le compte-rendu journalier. Il n’y a rien d’important à signaler. Mais je prévois que la période sera dure.
Le ravitaillement n’et pas bien facile, et à la coopérative installée au P.C. du colonel, on ne peut rien avoir.
Le commandant CHALET prend le
commandement du régiment, le colonel Lachèvre
étant parti faire un stage au G.Q.G.
(*)
(*) : G.Q.G. : Grand Quartier Général
Le 14 décembre
Nous apprenons que l’Allemagne a fait des propositions de paix. Je doute fort que les Alliés y prêtent attention. Pourtant, tout le monde en a assez même à l’arrière, et dans les tranchées, les vieux qui vagabondent depuis si longtemps d’un secteur à l’autre sont tous unanimes à la désirer.
Puisque l’on n’a pas su nous donner jusqu’ici la « paix par la victoire », qu’on nous donne donc la « victoire par la paix ».
Les gouvernements ont peut-être des raisons de parler autrement, mais le sentiment de tous les poilus est le même. Ils ont eu jusqu’ici assez d’abnégation pour oser le dire sans honte, car eux seuls savent les sacrifices qu’ils ont consentis et les souffrances qu’ils ont endurées.
Nous entendons dans la soirée une violente canonnade sur notre droite : 304 probablement.
Le 15 décembre
Les Allemands font montre d’une assez grande activité d’artillerie dans la matinée. Nous sommes prévenus qu’un bombardement aura lieu de 9 heures à 11 heures.
Je me mets un peu à couvert dans la guitoune du lieutenant Gigot où nous restons durant 3 heures. Les boches répondent avec usure à ce que nous leur envoyons ; notre coin est repéré et à différentes reprises l’abri est ébranlé ; mais il ne cède pas ; probablement qu’aucune torpille n’a été assez bien placée.
La bougie fut soufflée une quinzaine de fois et une des 2 entrées en partie comblée.
Vers les 13 heures, un calme relatif revient. Mais quel travail !
Toutes les tranchées et tous les boyaux sont à refaire.
Nous n’avons qu’un homme tué (*) ; c’est peu en comparaison de l’avalanche que nous avons reçue. Nous sommes obligés de passer à découvert pour communiquer avec les sections.
Devant le trou où se trouve « mon bureau » est tombée une torpille de gros calibre qui a creusé un profond entonnoir et bouché hermétiquement l’entrée ; les quelques troncs d’arbres qui restaient sont déracinés.
(*) : Il s’agit de GUILLARD
Jules.
Le 16 décembre 1916
La neige est tombée dans la nuit ; la terre n’est que du mortier et est bien difficile à remuer. On nous apporte encore des bottes de tranchées en caoutchouc de différents modèles avec des chaussons en feutre ou des bandes molletières.
J’en prends une paire, ce qui me permet d’avoir moins froid aux pieds, et un peu plus secs.
Un homme est évacué pour gelure des pieds et il y a beaucoup de malades. Mais les médecins ont je crois des ordres pour ne pas évacuer, et tous ces malades restent au P.S. du bataillon ou du régiment ou au camp des Pommiers, tandis que d’autres vont jusqu’à Jubécourt, où est encore une infirmerie du régiment. Je vais au camp des Pommiers toucher le prêt et remonte avec la cuisine.
Longue et fatigante balade dans la boue.
Le 17 décembre
Encore de la neige ; le matériel que nous demandons arrive en quantité suffisante, mais les difficultés sont très grandes. Les clous sont presque impossibles à avoir et on recommande dans une note de couper du fil de fer aciéré pour s’en servir comme pointes.
Beaucoup de caillebotis que nous touchons ne sont pas montés, et il nous faut les faire sur place, dans la boue des boyaux. Je fais dégager l’entonnoir creusé par la torpille devant « mon bureau » pour en faire un dépôt du matériel.
Une cinquantaine de paires de bottes de tranchée sont restées ensevelies et tout le matériel qui se trouvait là a été brisé et dispersé par le bombardement.
J’apprends que nous serons relevés dans la nuit du 19 au 20 pour aller à la « Coupure d’Esnes », en plein bois, où nous serons encore plus mal qu’au camp des Pommiers. Décidément, nous n’avons pas le « filon ». Nous entendons une violente canonnade dans le lointain sur notre gauche ; on parle de la Champagne.
Le 18 décembre
Le lieutenant Merle est rentré de permission et le lieutenant Hermet est parti. Nous commençons à faire les préparatifs de départ.
Inventaire du matériel, état des abris, etc.
Fin
des écrits pour l’année 1916
![]()
Je
désire contacter le propriétaire
Vers d’autres témoignages
de guerre 14/18

