Souvenirs de la
guerre du caporal Laurent COUAPEL
106e, 155e régiments
d’infanterie, Puis 7ème régiment d’artillerie
Publication : juin 2010
Mise à jour : oct. 2023

Laurent
COUAPEL (1895-1985)
Souvenirs bien incomplets après 50 ans d'un soldat volontaire de la classe 15, mais d’une richesse très intéressante : ses combats (les Éparges début 1915, la bataille de champagne en sept. 1915, Verdun en 1916, son empoisonnement, ses 2 ensevelissements sous terre, ses 2 blessures, la scène de fraternisation...
Quelques passages poignants : sa section est désignée pour amener la nourriture en première ligne. L’attaque d’une ferme à Cumières, le vol de la serpe, la folie d’un commandant.
Les recoupements sur les Journaux des Marches et Opérations (JMO) des différents régiments et sur les fiches «mort pour la France », m’ont permis de retrouver quelques dates précises du récit de Laurent COUAPEL.
J’ai rajouté volontairement ces dates et des explications (en bleues dans le texte) et des paragraphes, pour une meilleure compréhension du récit.
Laurent Louis Ernest COUAPEL est né en août 1895 à Baguer-Pican (Ille-et–Vilaine). Il est incorporé en décembre 1914 pour son service militaire au 25ème régiment d’infanterie de Cherbourg. Il a déclaré être ’’ cultivateur ‘’.
![]()
Sommaire (n’existe pas dans le carnet)
1915 : Les Éparges (Meuse) au
106e RI : Les combats, son empoisonnement
Séjour dans les hôpitaux :
Vittel, Neufchâteau, Lyon
Sept. à déc. 1915 :
Retour au front, bataille de Champagne au 155e RI
Mars à mai 1916 : Verdun : Bois
Bourru, Cumières, la corvée de soupe, l’ensevelissement
Mi-mai
1916 : La permission, la citation et la nomination caporal
24 mai
au 1e juin 1916 : l’attaque de Cumières, la grange
Juin à août 1916 : La fraternisation,
la tête à vache, forêt d’Apremont
Octobre-nov.
1916 : Normandie, Gournay-en-Bray, l’épisode du mauser
Sept.-oct.
1916 : La Somme : le bois de Saint-Pierre-Vaast, la soif, les moutons
La blessure : 11 novembre
1916
Fin
1916, début 17 : Séjour dans les hôpitaux : Bray-sur-Somme, Brest
Mai
1917 : Congé de convalescence d'un mois
Inapte pour
l’infanterie, apte pour être cavalier au 61ème d'Artillerie
Stage
d’artillerie, caserne des Ursulines, Saint-Brieuc
Retour au front,
intégration au 7ème d’artillerie
Juin-juillet
1918 : Agent de liaison des avant-trains au 7e d’artillerie : Aisne
Les Vosges, la grippe
espagnole
Nov.
1918-1919 : L’armistice, l’Alsace, Bordeaux, la démobilisation
![]()
GUERRE DE 1914/1918
Souvenirs bien incomplets après 50 ans d'un soldat de la classe 5
Le 2 août 1914, quand le tocsin a sonné, nous étions à moissonner dans un champ que nous appelions le « Vergerdrean ».
Ça fait un drôle d'effet, nous avions beau nous y attendre, le travail fut fini pour ce jour-là.
Quelques-uns des moissonneurs recevaient leur feuille de route dès le lendemain.
Presque aussitôt, les trains ont commencé à passer bondés de soldats. Les wagons étaient décorés de branchages, avec des inscriptions à la craie : « TRAIN DE PLAISIR POUR BERLIN ». Les mobilisés en pantalons rouges et capotes bleues chantaient comme s'ils allaient à une noce.
Quelques jours plus tard, il y avait changement de musique. Les trains repassaient avec des brancards suspendus contenant des blessés. Les moins atteints, souvent avec un bras en écharpe, étaient aux portières, mais ils n'avaient plus le sourire.
Le premier blessé de nos voisins est rentré chez lui un bras traversé par une balle. Il s'appelait Joseph HUET. Nous allions le voir et le questionner, mais il ne savait pas grand-chose, puis d'autres blessés, des disparus, des morts ont endeuillé la commune.
Nous étions neuf de la classe 15 à Baguer-Pican (*) : Paul BRUNE qui fut ajourné au conseil de révision.
Les huit autres bons pour le service armé :
François DAROT (**), Jean DESLANDES (***), Hippolyte CHAUMONT, André VERGNE, Judicaél LEBELTEL, Auguste MANET, Auguste LOGNONE (****) et moi.
En circulant par la commune, de l'un chez l'autre, nous chantions. Je me souviens de ce couplet :
« Là-bas dans la
plaine, j'entends pleurer (bis)
C'est la voix de
nos soldats blessés qui crient aux armes,
C'est la voix de
nos soldats blessés qu'il faudra remplacer.
Nous les
remplacerons ces braves, ces braves,
Nous les
remplacerons ces braves guerriers. »
La plus grande partie des moissonneurs ayant été mobilisée, le travail ne manquait pas pour ceux qui provisoirement restaient au pays.
Notre père fut à son tour appelé à Saint-Malo, comme sergent-instructeur
Puis le tour de la classe 15 arriva, nous sommes partis le 18 décembre 1914.
Nous avons eu la chance d'être quatre appelés au 25ème d'infanterie à Cherbourg, caserne Proteaux : Hippolyte CHAUMONT, Jean DESLANDES, François DAROT et moi.
Après les adieux aux parents et aux voisins, nous avons embarqué gaiement.
Arrivés le soir à la gare de Cherbourg, nous avons été accueillis par un sergent qui nous a conduits à notre chambre. Nous étions deux affectés à la même escouade : François DAROT et moi. Nous avions comme chef d'escouade le caporal JAILLIER ; comme sergents THOMAS et CHENARD et comme adjudant MERCIER.
(*) : Situé en Ille-et-Vilaine, à
quelques km de Dol-de-Bretagne
(**) : François DAROT a été tué
le 16 août 1917, en Belgique, à Boesinghe. Il faisait
partie, à cette date, du 110eème régiment d’infanterie. Son nom est gravé sur
le monument aux morts de Dol-en-Bretagne. Il est
inhumé à Ypres.
(***) : Jean Baptiste DESLANDES a
été tué le 25 février 1916, au bois Bouchot, dans la Meuse. Il faisait partie,
à cette date, au 272ème régiment d’infanterie. Son nom est gravé sur le
monument aux morts de Baguer-Pican. Il est inhumé à
Lacroix-sur-Meuse (55).
(****) : Auguste LOGNONE est mort
pour la France accidentellement à Troyes (Aube), en tombant de voiture (à
cheval), le 5 décembre 1916. Il était conducteur de voiture au 18e escadron du
train et des équipages. Son nom est gravé sur le monument aux morts de Baguer-Pican. Il est inhumé à Suippes (51).
1915 :
Les Éparges (Meuse) au 106e RI : Les combats, son empoisonnement
Nous avons fait environ quatre mois de classe.
Nous allions faire l'exercice sur les glacis et au tir à La Varde et pour terminer nous avons fait un mois dans les Landes, à St Pierre l’Église, puis revenus à la caserne, notre adjudant nous a demandés s'il y avait des volontaires pour le front.
François DAROT et moi avons levé la main avec d'autres camarades.
Quelques
jours après, nous étions habillés de bleu horizon et nous
partions rejoindre le 106ème régiment d’infanterie dans la Meuse à Rupt.
La première chose qui m'a frappé en arrivant dans ce patelin, ce fut une troupe de soldats qui descendaient des Éparges. Ils avaient de la boue jusqu'à mi-jambe et avaient coupé leur capote à la hauteur d'une tunique pour qu'elle ne traîne pas dans la boue.
Nous sommes tombés dans une escouade où il y avait déjà un gars de La Boussac : PIGEON.
Très gentil, nous avons tout de suite sympathisé. Il était déjà un ancien et nous a un peu mis au courant.
Nous étions arrivés au front les derniers jours d'avril.
Le 1er mai, nous montions en tranchées, dans le bois de Mouilly. En montant en ligne, nous avons entendu siffler les premiers obus qui nous passaient sur la tête pour aller éclater au loin.
Arrivé en ligne dans la nuit, le caporal m'a emmené quelque part dans le bois relever une sentinelle pour deux heures de faction. J'avoue que j'étais complètement désorienté. Les fusées éclairantes, l'éclatement des obus plus ou moins rapproché : s'il m'avait fallu retrouver ma tranchée seul, j'en aurais été incapable.
Au bout de deux heures, j'ai été relevé.
Le lendemain, nous avons été désignés François DAROT et moi, pour être camarades de combat. Il fallait que l'un des deux soit au créneau.
Le deuxième jour, j'ai vu le premier tué : notre caporal étant sorti de la tranchée pour satisfaire un besoin, a reçu une balle dans la tête.
Dans le courant de l'après-midi, le lieutenant et le sous-lieutenant sont passés dans la tranchée demandant un volontaire pour grimper sur un arbre. Ils supposaient que la balle qui avait tué le caporal le matin, avait été tirée de la tranchée qui était à environ 80 mètres de nous.
Le but, en grimpant sur un arbre, était de se rendre compte si cette tranchée était occupée en permanence, ou si l'ennemi n'y venait qu'en patrouille. Je me suis proposé et j'ai réussi à grimper sur un gros hêtre d'où il y avait une bonne visibilité sur la tranchée en question.
Pendant 1h30 ou 2h00, j'ai regardé de mon mieux si je voyais quelque chose bouger, mais n'ayant rien constaté, il faisait chaud, je n'avais pas beaucoup dormi les nuits précédentes, je fermais les yeux malgré moi. Pour ne pas m'endormir, j'ai sorti mon couteau et j'ai commencé à graver mon nom sur l'écorce de l'arbre. J'étais occupé à cette opération quand le sous-lieutenant BASIRE (*) est survenu et m'a prié de descendre.
Il m'a demandé si j'avais constaté quelque chose.
Sur ma réponse négative, il m'a dit que ce n'était pas étonnant étant occupé à autre chose qu'à faire ce qu'i1 m'avait commandé. Ce compliment m'a un peu refroidi.
(*) : Il s’agit du sous-lieutenant
SCHIRTZ DE BASIRE, de la 11e compagnie (composition du 106e RI rédigé dans le
JMO)
Le secteur n'était pas mauvais, mais il y avait cette particularité que je n'ai jamais vue ailleurs.
Quand une sentinelle tirait un coup de fusil, instantanément, tout le monde était au créneau et commençait à tirer. Il en était de même des Allemands, ce qui faisait une pétarade qui durait quelque fois une demi-heure. La première fois que j'ai vu cela, je croyais bien que nous étions attaqués, mais il n'en était rien.
Les coups allaient en diminuant, puis tout rentrait dans le calme.
Nous avions comme adjudant, un boulanger dans le civil, du nom de FUSIL. Il avait un nom prédestiné car il était tireur d'élite.
Nous avons été relevés après une quinzaine de jours de tranchées.
Nous étions au repos dans un village où il y avait encore des civils.
C’était calme, mais les cantonnements étaient affreusement sales. Depuis qu'ils étaient occupés par des soldats, je crois que la paille n'avait jamais été changée. C'était en grabats et plein de vermines, si bien qu'au bout de quelques jours, nous étions dévorés par les poux.
Les anciens commençaient à s'y habituer. J'en ai même vu qui en détenaient dans de petites boîtes et à l'heure de la récréation, ils pariaient une tournée avec un copain.
Le jeu consistait à étaler un journal avec un petit cercle au centre. Dans ce petit cercle, ils plaçaient deux poux : un gros noir et un petit rouge, car il y en avait au moins deux espèces. Les noirs avaient les pattes plus longues, mais les rouges étaient plus nerveux. Les chances étaient à peu près équilibrées. Celui dont le pur-sang atteignait le premier la lisière du journal avait gagné la tournée.
Nous faisions des marches tous les deux jours.
Vers 3 heures du matin, il y avait alerte et comme nous ne savions pas si nous reviendrions au cantonnement, nous étions forcés de prendre tout notre barda : fusil, cartouches, grenades, sac au complet avec à l’intérieur : linge de corps, conserves alimentaires, et à l'extérieur : souliers de repos, couverture, peau de mouton, toile de tente, gamelle, outils.
Il fallait compter 40 kg. Nous partions avec un quart de jus dans le ventre et revenions à l'heure de la soupe, avec 30 kilomètres dans les jambes.
A l'entrée du village, au retour de la marche, le général entouré de son état-major nous attendait. Il fallait se mettre au pas cadencé, alors que nous avions du mal à traîner nos godillots. J'avais comme petit outil une serpe, elle m'avait été volée. Le sous-lieutenant DE BAZIR, chef de ma section (*), me dit :
« Vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est d'en faucher
une autre ».
N'étant pas né voleur, cela me répugnait.
(*) :
Cet élément est important, le sous-lieutenant SCHIRTZ DE BASIRE étant de la 11e
compagnie, 3e bataillon, nous pouvons en conclure qu’à cette époque Laurent
COUAPEL était de cette compagnie
Cependant, le lendemain, nous étions en marche et passions à côté d'un cantonnement de soldats. L'un d'eux était occupé à couper du bois avec une serpe. Il avait planté son outil sur le billot, s'était écarté de quelques pas et regardait dans nos rangs pour voir s'il y avait des gars de connaissance.
Le sous-lieutenant DE BAZIR, qui marchait en tête de section, me désigne la serpe de la main. Je me trouvais juste en face, j'attrape la serpe et la mets sous ma cape.
Le reste de la journée, nous ne faisions pas grand-chose.
En plus, des camarades déjà cités, j'avais fait la connaissance d'un gars des environs de Guingamp qui était aussi à mon escouade. Il s'appelait Louis COEURET.
Au retour d'une marche où nous avions absorbé de l'eau puisée dans un puits où il y avait des cadavres, beaucoup ont été pris de coliques. (*)
J'étais du nombre.
(*) Un
camarade de Laurent a écrit après son départ qu'il avait été retiré les
cadavres de trois soldats allemands du puits où ils avaient puisé de l'eau
Le lendemain matin, nous avons passé la visite. Le major qui m'a ausculté était un commandant. Il avait à ses côtés trois autres médecins d'un grade inférieur.
Quand il eut fini de m'examiner, après m'avoir posé quelques questions, il s'est adressé à ses aides et leur a dit :
" Voilà un gars de la campagne, bien bâti et solide. Il est crevé, ils les crèvent ces jeunes gens "
Évacué,
sur ma fiche, il y avait inscrit : ‘’
Embarras gastrite, courbature fébrile ‘’.
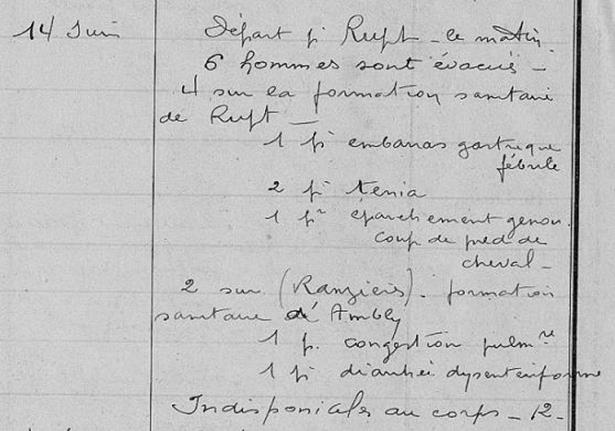
Extrait du journal des Marches et Opérations, service santé
du 106eRI
1ère étape :
Verdun, là, nous avons eu du bouillon de légumes à boire à satiété, ça m'a fait beaucoup de bien.
2ème étape :
Contrexéville, j'ai été hébergé dans un hôtel transformé en hôpital. Nous étions traités comme des rois (hôtel de la Source).
Séjour
dans les hôpitaux : Vittel, Neufchâteau, Lyon
Le matin, la patronne de l'hôtel nous faisait la toilette et nous parfumait à l'eau de Cologne. Sur la table de nuit, il y avait une petite bouteille de malaga.
La nourriture était excellente. Nous buvions aussi de l'eau de la source.
J'y suis resté huit jours.
Puis j'ai été à Vittel, deux jours.
Ensuite à Neufchâteau, c'était un hôpital militaire. J'ai trouvé du changement avec Contrexéville, d'ailleurs, j'avais de la fièvre. Nous n'avions que du liquide : lait et eau. La maladie s'était déclarée, j'avais la typhoïde, ainsi que toute la chambrée.
Quand la température montait trop haut, les infirmiers portaient le malade sous une douche d'eau froide. Mon camarade de lit y était passé. Il m'a dit qu'il préférait mourir plutôt que d'y retourner.
Au bout de trois semaines passées à Neufchâteau, j'ai été dirigé sur Lyon où je suis resté une dizaine de jours dans un dépôt de convalescents.
Nous étions très bien nourris.
Nous étions libres de sortir et avec quelques camarades, nous avons visité la ville.
Il y a Notre Dame de Fourvière qui est très bien, le jardin d'acclimatation dans un très beau décor approprié à leurs mœurs : des cavernes avec des cataractes. Il y avait également des crocodiles allongés sur le sable à côté d'une mare. Ils étaient aussi immobiles que des troncs d'arbres et pour les faire bouger, nous leurs jetions de petits cailloux.
Quand un caillou leurs tombait dessus, ils ouvraient un oei1et c'était tout. Il y avait aussi un loup, un zèbre, beaucoup de daims et plusieurs autres animaux, dont je me souviens moins bien.
Pour nous désaltérer au cours de nos promenades, nous achetions un litre de vin rouge et une bouteille de limonade : 6 sous le vin et 4 sous la limonade.
J'ai obtenu un mois de convalescence à passer à la maison.
Avec un camarade, je suis passé à paris. Nous y sommes restés 24 heures. Nous avons vu la Tour Eiffel, les Invalides, la Grande Roue, l'Arc de Triomphe, le Jardin des Plantes et d'Acclimatation.
Puis vint l'arrivée à la maison avec le plaisir de se retrouver en famille.
Je n'étais pas complètement rétabli mais le lendemain de mon arrivée, i1 y avait l'étable à curer et ce n'était pas une petite corvée. Le fumier arrivait à hauteur des mangeoires et l'équipe n'était pas forte. Je les ai aidés en prenant une bonne suée.
Le lendemain, j'étais parfaitement remis. Pendant ma convalescence, j'ai reçu une lettre de François DAROT qui m'annonçait que Théophile DESSENS (*) de Broualan s'était fait descendre de l'arbre où j'étais monté dans les bois de Mouilly.
Son corps ayant été ramené, j'ai été à l'enterrement avec
mon frère Ernest qui était en permission.
(*) : Théophile DESSENS est mort à l’hôpital de Ligny-en-Barrois le 7 juillet 1915. Il faisait partie du 106e RI. Son nom est gravé sur le monument aux morts de Brouala.
(**) Ernest Laurent COUAPEL (1896-1957) survivra à
la guerre.
Sept. à déc. 1915 :
Retour au front, bataille de Champagne au 155e RI
La convalescence écoulée, j'ai rejoint un fragment du 106ème à Saint-Aubin-du-Cormier.
Là, j'ai retrouvé un camarade du front : Louis COEURET.
Nous cantonnions au bureau de tabac et nous allions faire l'exercice au camp. Nous n'étions pas malheureux et avions beaucoup de liberté.
Pendant ce stage, j'étais parti un soir avec un vélo qui n'avait que le cadre et les roues, sans permission. J'avais fait un tour à Baguer-Pican revoir les parents et amis. J'étais rentré le dimanche soir pour l'heure de l'appel.
Le moment de retourner au front est venu.
Nous sommes partis pour Vitré nous faire équiper à neuf. Comme nous devions faire la route à pied, le copain Louis COEURET qui avait sa cousine mariée au notaire du Val-Dize, m'avait proposé, si nous trouvions une voiture, de devancer la troupe pour lui dire bonjour en passant.
Un boucher, qui justement s'y rendait, nous a offert une place, ce qui nous a permis de gagner une bonne heure sur le convoi. Sa cousine nous a très bien reçus. Nous avons fait la collation, le repas avait été très gai.
Au moment du départ, mon ami s'est mis à pleurer et a dit à sa cousine :
« Je te dis adieu, car je ne reviendrai pas. »
Nous avons rejoint le détachement à Vitré. Nous y avons passé une huitaine où nous n'avions pas grand-chose à faire.
J'avais mon oncle et parrain, l'Abbé François COLICHET, Recteur à Vergeal. (Environ 12 kilomètres de Vitré).
Un jour, j'invite le camarade Louis à venir avec moi voir l'oncle. Nous avons emprunté deux vélos à un garagiste. Nous n'étions pas très bien tombés car l'un des vélos avait un guidon rigide. Nous le prenions chacun à notre tour, c'est fatigant un guidon qui ne tourne pas.
Pour revenir, ça allait un peu mieux, l'oncle nous l'avait arrangé.
Nous avions été très bien reçus, nous avions déjeuné en compagnie de l'oncle et d'une jeune fille qui était son invitée : le repas avait été très joyeux.
Au moment de se quitter, Louis s'est encore mis à pleurer et il a répété ce qu'il avait dit au moment de quitter sa cousine :
« Adieu, Je ne reviendrai pas. »
Nous le consolions de notre mieux en lui disant qu'il se faisait des illusions.
Bref, le départ pour le front est arrivé.
Nous étions du 106ème d'infanterie. Nous partions en renfort au
155ème d'infanterie. (*)
Nous arrivions au front le 20 septembre 1915.
(*) Le JMO du 155e RI signale que le 23 septembre
1915, un renfort de 178 hommes arrive au régiment, mais sans donner leur
provenance. Safiche matriculaire indique qu’il est
affecté au 155e RI le 17 septembre 1915
Le 22, nous montions en tranchées pour la grande bataille de Champagne. Notre secteur était face à Saint-Soupplet.
Arrivés en première ligne, les 75 nous passaient au ras de la tête pour éclater à 100 mètres au moins.
Les 155 et plus gros calibres passaient en miaulant pour aller pilonner les arrières de l'ennemi. C’était un vacarme et un feu d'artifice inimaginable.
Le 24 au soir, un soldat est passé dans la tranchée, demandant à ceux qui voulaient se confesser d'aller voir l'aumônier dans un gourbi à côté. Pour mon compte, J'y suis allé.
Nous savions que l'attaque était pour le lendemain à l'aube, le 25 septembre 1915, une date que je n'oublierai jamais.
A la pointe du jour, le clairon de notre compagnie a sauté sur la tranchée et a sonné la charge.
Nous pensions qu'avec un pareil déluge d'obus, il ne restait personne dans les tranchées adverses. Nous nous étions trompés, car les balles ont commencé à siffler autour du clairon, cependant, il n'a pas été touché. Après le clairon, notre commandant est monté sur la plainte en disant :
« En avant mes enfants »
Presque aussitôt, nous avons croisé des blessés allemands faits prisonniers. En tête, il y avait un commandant, il avait le ventre ouvert et tenait ses entrailles dans ses bras. Un soldat suivait avec un œil arraché qui lui pendait sur la joue et bien d'autres soldats avec des blessures plus ou moins horribles.
Nous attaquions en colonnes par deux. Je marchais à la gauche de mon caporal DUMONT. Nous n'avions pas fait 20 mètres que j'ai entendu une balle le frapper. Il m'a simplement dit :
« Touché »
Il avait reçu la balle dans l'aine.
Nous n'avions pas le droit de nous arrêter à porter des soins aux blessés. Notre commandant qui était à quelques mètres à ma gauche a reçu une balle en séton (*) dans le cou, son ordonnance lui a fait un pansement sommaire et il a repris la tête du bataillon.
En avant de moi i1 y avait notre sergent de section, le sergent GORDON, clown dans le civil, il s'était barbouillé la figure comme au cirque. A chaque bond, nous profitions des accidents du terrain.
GORDON était superbe, il n'a pas baissé la tête une seule fois, pourtant, une balle avait traversé le sommet de son casque, sa capote était trouée par les balles et déchirée par les éclats d'obus, mais il n'arrêtait pas de nous faire rire avec ses pitreries. Finalement, il n'a pas eu une égratignure.
Pour le soir, nous avions avancé de plusieurs kilomètres, mais à la nuit, nous avons arrêté parce que soi-disant nous étions menacés d'être encerclés.
Les officiers, craignant que les tranchées et abris soient minés, nous ont fait allonger derrière le parapet d'une tranchée. Comme nous étions habillés de neuf, nous avions aussi des souliers neufs, mes brodequins me gênant un peu, pour mieux courir le matin de l'attaque, j'avais mis mes souliers de repos avec le haut en toile. J'avais été mal inspiré.
Toute la journée, il était tombé une petite
pluie fine qui m'avait trempé les pieds.
(**)
(*) : Blessure faite par une arme blanche ou par une
balle, quand celle-ci est entrée sous la peau et ressortie sans pénétrer dans
les muscles.
(**) : Le JMO du 155e RI signale que le 25
septembre 1915, au soir, le régiment avait perdu plus de 500 hommes.
La nuit, il y a eu une forte gelée blanche et pour le matin, j'avais les pieds gelés, pas assez pour être évacué, mais assez pour me faire souffrir pendant plusieurs mois.
Le matin, à la pointe du jour, nous avons aperçu quelques Allemands sortir des tranchées en avant de nous et se diriger vers nos lignes sans arme et se constituer prisonniers. Il en est passé un tout près de moi très jeune et très grand, vêtu de la capote grise et du béret rouge. C'était un bel homme qui ne paraissait nullement impressionné de se trouver au milieu de nous.
Dans la journée, nous avons eu le droit de pénétrer dans les tranchées et dans les abris fabriqués par les Allemands. Je n'avais pas vu ça chez nous. Il y avait des abris où loger une compagnie, taillés dans la craie à 7 ou 8 mètres de profondeur, bien étayés et plafonnés avec des lits superposés. Ce n'était pas étonnant qu'ils aient tenu le coup sous le déluge d'obus que nos artilleurs leur avaient envoyés.
Les jours suivants, nous étions en 1ère ligne, je n'étais pas de garde au créneau et je m'étais allongé dans une petite niche que nous creusions dans le bas de la tranchée en prévision des fusants. Justement, il nous arrivait de gros noirs, nous les appelions ainsi à cause du gros nuage de fumée noire qu'ils dégageaient en éclatant.
L'un d'eux, un 155, venait d'éclater à 10 mètres au-dessus de notre tranchée, projetant sa pluie de shrapnell. Presque aussitôt, un soldat est venu me prévenir que mon copain, Louis COEURET était blessé. Il était à une dizaine de mètres de moi.
Quand je suis arrivé à lui, il était nu jusqu'à la ceinture, le major venait de l'examiner et essayait de le consoler en lui disant qu'il avait la bonne blessure. C’était un shrapnell qui lui était rentré au bas de l'omoplate et se dirigeait vers la région du cœur.
Aussitôt qu'il m'a vu, il m'a dit :
« Adieu, j'en ai pour mon compte»
Et en effet, il est mort le lendemain à l'hôpital. Ses pressentiments ne l'avaient pas trompé.
Au bout d'une huitaine, nous avons été relevés et nous sommes descendus au repos dans les baraquements du 106ème au camp de Chalons.
En descendant, nous avons pu remarquer que les cadavres des hommes avaient été enlevés.
A la lisière d'un petit bois de sapins, nous en avions bien laissé une centaine fauchée par les mitrailleuses ennemies.
Mais, si les hommes avaient été inhumés, les chevaux n'y étaient pas. Il y avait là une cinquantaine de chevaux ballonnés qui dégageaient une odeur épouvantable.
Dans les baraques, nous n'étions pas mal. Il y avait une bonne litière de paille fraîche et nous pouvions nous procurer du pinard à Mourmelon où il y avait encore des civils.
Au bout de huit jours, nous avons repris les lignes dans le même secteur où nous avions attaqué.
Dans la nuit du 7 octobre 1915, notre capitaine nous avait emmenés creuser une tranchée. Nous avions travaillé toute la nuit, nous avions enlevé nos capotes et les avions déposées avec nos fusils sur le bord de la tranchée que nous creusions.
A la pointe du jour, il est passé un avion ennemi qui nous a aperçu et signalé. Aussitôt, les 155 percutants nous sont tombés dessus et le tir était bien réglé. Il en est tombé un sur mon fusil et ma capote qui les a pulvérisés.
J'étais à côté du caporal, un jeune engagé de 18 ans. Nous avons été enterrés tous les deux. Les camarades nous ont dégagés.
Je n'avais rien, le caporal non plus ou du moins, nous ne lui avons trouvé aucune trace de blessure, mais il était mort commotionné.
Quelques minutes après, arrive un bataillon du 154ème d'infanterie, commandant en tête, revolver au poing et qui nous interpelle :
« Qu'est-ce que vous foutez là le 155 ! Voulez-vous filer devant nous ou je vous brûle la gueule.
Votre régiment est en train d'attaquer et vous êtes
planqués là ».
Pour ma part, j'avais trouvé ces
mots parfaitement injustifiés.
Nous n'avions pas revu notre
capitaine depuis le soir et n'avions aucun ordre d'évacuer la tranchée que nous
avions creusée.
Cependant, nous avons obéi et sommes partis avec
le 154.
Arrivés en première ligne, les occupants nous ont confirmés ce que le commandant nous avait dit.
Notre régiment avait bien été attaqué et la plus grande partie de nos éléments d'attaque était restée dans les barbelés avant d'avoir atteint la tranchée allemande. Ils avaient été exterminés par nos 75 qui avaient tiré trop court.
Nous sommes restés quelques jours avec le 154e, puis nous avons rejoint le 155e et nous sommes descendus au repos à Vadney à 10 km du camp de Chalons.
Nous avions 30 km d'où nous étions en ligne pour s'y rendre avec tout le bazar sur le dos. Ça faisait déjà une petite marche. Nous étions relevés vers minuit.
Nous arrivions au village vers 10 h 00. Nous mangions la soupe, un bon coup de pinard et nous dormions jusqu'au lendemain matin.
Pendant ce repos, nous couchions dans une grange. Le fermier nous a demandés pour lui d'épandre du fumier. Il y avait deux rangées de fumier dans un champ très long. Nous étions trois.
Arrivés dans le bout du champ, l'un de nous, un breton des Côtes du Nord qui s'appelait LE CREURER, nous dit :
«
Les gars, prenez la rangée là, je vais prendre l'autre ».
Les rangées étaient égales. Je croyais savoir épandre du fumier et mon camarade était du métier aussi. Eh bien, nous en avons eu assez pour arriver au bout en même temps que lui !
Le fermier n'en revenait pas.
Il nous a offerts à dîner, le repas n'avait rien d'extraordinaire, du lard et des choux, mais comme c'était un plat rare pour nous, nous avons bien mangé.
Nous
avons tenu ce secteur pendant quelques mois. (De
septembre à décembre 1915)
Nous tenions les tranchées une huitaine de jours et huit jours de repos à Vadney ou au camp de Chalons dans les baraques du 106ème d'infanterie.
Pendant cette période, le secteur était assez calme, la nuit nous transportions des rondins pour faire des abris où nous placions des barbelés.
Cependant, une nuit où j'étais sentinelle, il est tombé un obus à gaz si près de moi que les copains m'ont emporté sans connaissance. C'était des gaz lacrymogènes.
Au bout de quelques jours, je ne ressentais plus rien.
Une autre nuit où j'étais au créneau, il faisait beau clair de lune, j'aperçois à une trentaine de mètres comme un homme qui aurait été couché dans un trou d'obus et qui de temps en temps relevait la tête pour examiner notre position, et puis finalement je me suis aperçu que c'était tout simplement un lapin qui baissait la tête pour brouter et se redressait ensuite.
Je profitais d'un moment où il était bien dressé pour lui envoyer une balle.
Il est resté sur place. J'ai demandé au sergent de prévenir les camarades et je suis parti le chercher en rampant. Au moment où je ramassais le lapin, une balle m'a sifflé aux oreilles, tirée de notre tranchée. Le sergent n'avait pas prévenu assez loin, mon gibier avait failli me coûter la vie.
Un jour de neige, il faisait très froid, il passait des oies sauvages, une bande est passée assez près, nous les avons tirées, l'une est tombée, mais dans les lignes allemandes.
Juin à août 1916 : La
fraternisation, la tête à vache, forêt d’Apremont
Cette période est mal placée dans le temps, Laurent c’est
trompé. Volontairement j’ai indiqué la bonne date (juin à août 1916)
Nous avons quitté ce secteur (*) pour prendre les lignes au Ravin de la Source et puis à la Tête à Vache où nous étions, la vallée était profonde et nous étions d'un côté et les Allemands de l'autre.
Cependant, il y avait un endroit où les lignes étaient très rapprochées, si bien que des français qui parlaient allemand, ou le contraire, ont engagé une conversation. Puis, il y a eu des échanges de chocolat, de cigares, de biscuits, c'était la bonne vie.
Mais un jour, (c'était des Bavarois), ils nous ont prévenus :
« Demain, nous sommes
relevés par un régime de Prussiens, vous échangerez autre chose que des cigares
».
(*) : L’historique du régiment indique que :
« Du
1er au 12 juin, le régiment est au repos à Rupt-aux-Nonnains ; de là, par Sorcy (Sorcy-Saint-Martin,
Meuse), il monte en secteur à la Tête-de-Vache, le 19 juin ; secteur assez
calme, sauf quelques bombardements de première ligne par engins de
tranchées. »
Nous pouvons donc situé la date de cette fraternisation avec
exactitude, en juin 1916, et le lieu « la Tête-à-Vache », en forêt d’Apremont, secteur de Saint-Mihiel (Meuse)
En effet, ils ont commencé par nous envoyer des
obus de canons des tranchées, des tuyaux de poêles, des mines à retardement qui
s'enfonçaient tellement profond qu'elles défonçaient les abris.
C’était des engins qui avaient énormément de trajectoire. Nous les voyons en l'air et en se déplaçant rapidement, comme la tranchée était très sinueuse, nous réussissions à mettre un pare-éclats entre nous et l'éclatement. Mais comme ce petit jeu durait toute la journée, ça devenait démoralisant.
Dans ce secteur, nous faisions beaucoup de corvées de troncs de sapins pour étayer et fabriquer des gourbis.
Un soir, au retour d'une de ces corvées, j'étais rentré dans notre sape, dehors il y avait de la neige et il faisait très froid. A l'intérieur de l'abri, il faisait une bonne chaleur, nous avions dégoté un vieux poêle avec un peu de charbon.
Aussitôt couchés, nous nous sommes endormis.
Heureusement que tous ne dormaient pas, car nous avons été intoxiqués. Après avoir donné de l'air, ceux qui étaient éveillés ont eu beaucoup de peine à nous réveiller.
Dans ce secteur aussi, il y avait des petits postes très rapprochés les uns des autres. Échange de bons procédés, nous creusions un couloir souterrain jusque sous le poste ennemi. Nous y placions une mine et si les occupants ne nous avaient pas détectés à temps, ils auraient fait un vol plané.
En avant de notre tranchée, il y avait de beaux bouquets de chardons prêts à s'envoler.
Le matin, alors que j'étais en sentinelle au créneau, nous faisions un carton, histoire de se faire la main. Après avoir effeuillé un chardon, nos balles allaient se perdre dans les lignes ennemies.
Août 1916 : Vosges
En quittant ce secteur, nous avons été à Notre Dame de Lorette dans les Vosges.
C'était un secteur très calme, les lignes étaient très éloignées les unes des autres. Cependant, en arrivant dans ce secteur, nous suivions une tranchée, je remarquai un créneau très haut placé, il y avait une petite esplanade pour s'y rendre, je sautais en vitesse pour ne pas perdre ma place. J'avais à peine eu le temps d'y jeter un coup d’œil, qu'une sentinelle que je n'avais pas remarquée me tire vivement en arrière, en me disant :
« Attention, il y a un
fusil braqué ».
Ce qui veut dire que dans la tranchée allemande qui était à 3 ou 400 mètres, il y avait un fusil sur chevalet et ils arrivaient à faire passer une balle par le créneau, très souvent, peut-être même toutes les minutes. Comme de juste, ce fusil avait été braqué pendant qu'ils occupaient cette tranchée.
Nous sommes arrivés à la place que nous devions occuper. C'était dans un bois.
Il y avait en fait d'abris des trous individuels ou à deux, à environ un mètre de profondeur, bourrés de paille et recouverts d'une toile de tente. Pour les repas, nous avions une table en plein air. Il arrivait de temps en temps un 77, mais ce n'était pas grave. Nous avions un poste avancé que nous occupions à tour de rôle.
Les tranchées étant éloignées, il y avait toutes les nuits des patrouilles entre les lignes. Quand deux patrouilles se rencontraient, il y avait échange de coups de feu et souvent, il y avait des prisonniers.
Il arrivait aussi que les postes avancés fussent attaqués.
Pour parer à toute surprise, nous avions tendu de petits fils de fer, à 50 mètres environ en avant du poste et à 10 cm au-dessus du sol. Ces fils étaient reliés à l'intérieur du poste à des boîtes de conserves. Aussitôt que quelqu'un touchait au fil, les boîtes se mettaient à carillonner.
Le cas s'est produit une nuit où j'étais au poste. Nous avions un caporal comme chef de poste qui était tout nouveau au front. Aussitôt, il nous a dit :
« Tirez les gars ».
Mais quelques anciens lui ont
fait remarquer :
« Et si c'est quelqu'un des nôtres?»
Nous nous sommes mis en position de tir, avons manœuvré la culasse des lebels pour faire comprendre aux arrivants que nous étions prêts à les recevoir. Puis nous avons crié la formule d'usage :
« Halte-là ! Qui vive ! »
Aussitôt, ça a été un vrai
concert :
« Ne tirez pas, nous sommes du 154, nous sommes perdus »
Alors, nous leur avons dit d'avancer.
Quelques secondes après, ils sautaient dans notre poste où ils nous contaient leur aventure (ils ne savaient plus s'ils étaient dans nos lignes ou dans les lignes allemandes), après avoir bu un coup de pinard, heureux d'avoir trouvé un point de repère.
Nous ne sommes pas restés longtemps dans ce
secteur (*), la bataille de
Verdun était déjà en train de se préparer. (**)
(*) : 1 mois
(**) : En fait, je pense que Laurent s’est trompé sur
la date de son « séjour » à Verdun : le régiment est parti dans
la Somme de septembre 1916 jusque fin 1916, et cette période de la bataille de
Verdun est à placer de mars à mai 1916. D’ailleurs, il le confirme plus loin
dans son texte en citant « le vendredi Saint 1916 »
Mars
à mai 1916 : VERDUN : Bois Bourrus, Cumières, le coup de main, la
corvée de soupe, l’ensevelissement
Le JMO indique que le régiment arrive à Germonville
le 12 mars 1916.
Nous y sommes arrivés par Germonville, Froméréville, le bois Bourru, Chattencourt et Cumières : il n'y avait pas longtemps que les habitants avaient évacué.
Pour moi, j'étais logé chez un notaire, tous les papiers étaient épars. Quant aux maisons, quelques-unes avaient des trous d'obus, mais beaucoup étaient encore intactes.
Notre premier stage n'a pas été trop dur. Nous allions nous reposer dans le bois Bourru où nous couchions à même la terre.
Un matin au réveil, j'allumais une pipe. J'entends un avion allemand qui nous survolait - nous les reconnaissions bien au bruit - et aussitôt, j'entends une bombe descendre. Je m'aplatis sur le sol.
Il y a eu une énorme déflagration, les mottes de terre et les morceaux de bois retombaient tout autour, mais aucun ne m'a touché. Il y avait plusieurs morts et blessés parmi nous. Une deuxième bombe est tombée sur des échelons d'artillerie qui se trouvaient sur l'autre versant à quelques centaines de mètres de nous.
A ce moment, nous avons aperçu un chasseur français qui descendait des nuages en piqué.
Trois coups de mitrailleuse : tac tac tac et le bombardier allemand était en flamme. Le pilote a sauté sans parachute. Des camarades ont été à l'endroit où il était tombé, il n'était pas beau à voir, cependant, il ne nous a pas fait pleurer.
Pendant ce stage, au bois Bourru, nous avons eu la visite d'un capitaine d'artillerie, bel homme, grand brun qui allait parmi nous, d'un groupe à l'autre, offrant des cigarettes et posant pas mal de questions plutôt indiscrètes qui nous ont paru suspectes.
L'un de nous a prévenu notre commandant qui l'a appréhendé : c'était un espion allemand.
La deuxième fois que nous avons repris les lignes à Cumières, c'était à environ 150 mètres en avant du village, à droite de la route qui monte au bois des Corbeaux, il y avait 20 centimètres d'eau dans la tranchée.
J'avais comme camarade de combat un nommé ROBIN de la classe 16, tout nouveau au front. Il était sympathique, nous nous entendions bien. Je lui proposais d'aller dans le village chercher quelque chose pour mettre sous nos pieds. Nous avons trouvé une armoire, nous avons pris chacun notre battant, c'était épatant.
Bout à bout, ça faisait une belle petite plate-forme où nous allonger tous les deux, mais c'était dur. En revenant du village, nous avions repéré des meules de foin et de paille. Nous sommes descendus une deuxième fois en chercher chacun un ballot. Alors là, c'était idéal, nous étions couchés comme des rois. Mais, nous avions fait des envieux.
Tout de suite, nous avons eu des imitateurs, un instant après, il y avait tout un va-et-vient entre la tranchée et le village.
Malheureusement, les Allemands ont envoyé une fusée éclairante, quelques-uns ne se sont pas couchés assez vite et ils se sont aperçus du manège. Une volée d'obus incendiaires et les meules de paille et de foin n'étaient plus que des torches.
Cette période de tranchées avait encore été assez calme.
Nous sommes retournés au Bois Bourru pour quelques jours, puis nous sommes repartis toujours dans la même direction.
La nuit, nous traversions le Bois Bourru par la route.
Tout à coup, d'énormes détonations nous ont jetés dans la rigole, c'était des pièces de 155 qui étaient en batterie tout au bord de la route et que nous ne savions pas là.
Ils venaient d'ouvrir le feu ; ce n'était pas dangereux, mais ils nous avaient surpris.
A la sortie du bois, il y avait une ferme que l'on prétendait habitée. Quand nous arrivions là, nous étions sûrs d'avoir des gaz.
Ce jour-là, j'avais sans doute mis mon masque trop tard, j'avais déjà eu des émanations et j'ai beaucoup souffert. Au bout d'un certain temps, j'ai été obligé de le retirer, ce qui n'arrangeait pas les choses.
Après avoir traversé Cumières, nous avons pris une tranchée, toujours à droite de la route, mais un peu plus haut et peu à droite que la fois précédente. Nous avions encore de l'eau, environ 10 cm, mais nous n'avions plus nos battants d'armoire et la nuit était glaciale.
Pour mon compte, J'avais mis mon sac sous mes pieds avec tout ce qu'il contenait, linge et vivres de réserve, pour ne pas avoir les pieds gelés, comme j'en avais déjà fait l'expérience à la bataille de Champagne.
La deuxième nuit, notre chef de section, l'adjudant MAX, un alsacien, nous propose d'essayer de faire des prisonniers. L'opération consistait à attaquer un poste avancé ennemi par surprise. Nous sommes partis au début de la nuit, presque au départ, l'un de nous a marché sur un tas de grenades.
L'une a explosé, il y a eu un mort et des blessés.
Il faisait noir comme dans un four, nous avons commencé à marcher sur des cadavres.
Quand il y avait une fusée éclairante, nous nous fichions à plat ventre, les tranchées étaient complètement bouleversées. Là, il y avait une baïonnette qui sortait de terre, à côté, il y avait une main, plus loin c'était un pied et une tête des cadavres déformés, hachés, si bien qu'aussitôt, la fusée éteinte, nous ne pouvions pas faire autrement que de marcher dessus.
Enfin, nous sommes arrivés à proximité du petit poste que nous devions attaquer, il se trouvait à l'orée du Bois des Corbeaux Je vois encore notre adjudant, très grand, brun, très fort, il portait des lunettes.
Hélas, Je le voyais pour la dernière fois. Il nous a dit :
« Restez»
Il a pris seulement deux hommes avec lui.
« Nous allons essayer de
surprendre la sentinelle et vous viendrez ensuite ».
Une minute ne s'est pas écoulée. Nous avons entendu une détonation et aussitôt les deux hommes qui l'accompagnaient sont rentrés, nous disant :
« Il a reçu un pétard de
cheddite en pleine figure »
L'opération était terminée et manquée. Nous avons repris le chemin de notre tranchée.
Vers Vaux et Douaumont, le canon n'arrêtait pas, c'était un roulement continuel.
Après s'être reposé quelques jours au Bois Bourru, nous avons repris les lignes, mais cette fois à gauche de la route qui monte de Cumières au Bois des Corbeaux.
Les premiers jours de notre stage furent assez calmes.
Mon tour de corvée de soupe étant arrivé, avec cinq ou six camarades, nous avons été au rendez-vous des cuisines. Ce rendez-vous avait lieu habituellement vers minuit, mais les cuisines ayant été canardées en cours de route, nous avons touché le ravitaillement beaucoup plus tard, si bien qu'arrivés à Cumières, il faisait jour.
Vu que nous avions un certain parcours à faire à découvert, nous sommes allés voir le commandant qui était dans une cave à l'entrée du village, pour avoir son avis. Il nous a dit :
« Je vais essayer »
Il était porteur des bidons de pinard. Il a bien fait 50 mètres sans être inquiété, à la pointe du jour, les sentinelles se relâchent un peu.
Bref, au bout de 50 mètres, les Allemands ont commencé à tirer.
Il a encore fait quelques mètres en essayant de courir, ce qui n'était pas facile avec sa charge, puis voyant que ça devenait trop dangereux, du fait que la route allait en montant, la profondeur d'eau était beaucoup moindre qu'au départ, il a sauté dans le boyau. Je pense, d'après ce que j'en ai vu après, qu'il devait avoir pied.
J'étais porteur du pain.
J'en avais bien une douzaine de boules en bandoulière dans une toile de tente. Nous nous sommes dit qu'avec le pinard et le pain, les quelques boîtes de conserve et le chocolat que les copains ont dans leur musette, si je réussis à passer, ils ne vont pas mourir de faim.
Je m'engage donc sur la route, mais forcément, les Allemands avaient compris.
Tout le monde était au créneau, le doigt sur la gâchette. Je suis chasseur, mais croyez-moi c'est beaucoup plus agréable d'être le chasseur que le lapin.
Je n'avais pas fait deux mètres que les balles mordaient la route devant moi et derrière. J'essayais de courir, mais pas moyen avec ma besace. J'ai senti le vent d'une balle qui m'a rasé la figure, tant pis pour le bouillon, j'ai sauté dans le boyau. Je n'avais pas pied et l'eau n'était pas chaude.
Enfin en mettant une main de chaque côté du parapet, mes boules de pain flottant derrière moi je réussissais à avancer. Quand je suis arrivé à la hauteur d'où mon prédécesseur avait sauté, j'avais pied, ça allait mieux, mais j'étais à droite de la route et la tranchée que nous occupions était à gauche.
Par conséquent, il me fallait traverser la route. Il y avait bien un passage souterrain, mais il était plein d'eau. Enfin, j'ai risqué le coup, j'ai essuyé une bonne rafale qui ne m'a pas touché.
Arrivé au but, avec quelque linge sec que
j'avais dans mon sac et que les copains m'ont passé, j'ai réussi à me changer,
c'était le vendredi Saint 1916. (*)
Le reste de la corvée qui avait les bouteillons de soupe et de rata n'a pas passé. Nous avons donc cassé la croûte avec ce que nous avions.
A peine terminé, les Allemands qui savaient exactement où nous étions du fait qu'ils nous avaient vus porter la soupe, nous ont servi le dessert sous forme d'obus de gros calibre.
C'était tellement bien ajusté qu'à chaque éclatement, Il y avait un bout de tranchée à s'écrouler.
Pour ma part, j'avais été enterré, cependant, avec l'aide des copains, j'en suis sorti vivant. (**)
Malheureusement, beaucoup ont été enterrés pour de bon.
(*) : 24 avril 1916.
(**) : Le JMO signale 8 tués et 7 blessés, mais sans
donner la cause.
Le soir, nous avons eu la relève.
Comme nous nous croisions avec nos remplaçants, plusieurs nous demandaient si la place n'était pas trop mauvaise, nous répondions, ça va, pour ne pas les décourager, mais s'ils ont été servis comme nous, je les plains.
Mi-mai 1916 : La permission, la citation et la
nomination caporal
Arrivé à l'arrière (*), je suis parti en permission, ça faisait environ quinze jours que je n'étais pas rentré. Mes parents avaient changé de ferme, ce n'était plus Lerguer, mais La Bazillais-en-Lourmais. (**)
Personne n'était prévenu à la ferme, je me suis dit :
« Je vais leur faire
une surprise ».
J'arrivais de la gare de Bonnemain par la traverse, par derrière les bâtiments, je rentrais dans la grange par une porte de derrière et arrivé à la porte de devant, je voyais ce qui se passait dans la cour, il faisait beau, Ils venaient de manger la soupe, ils étaient assis à la porte pour prendre le frais.
Personne ne m'avait vu, mais j'avais compté sans le chien ‘’ Rapide ‘’ qui m'a tout de suite éventé et qui est venu me trouver en me bondissant dessus joyeusement.
Alors, je suis sorti, après les premières effusions passées, je voyais bien que papa n'était pas tranquille, ce n'était pas normal d'avoir deux permissions si rapprochées. Je lui ai fait voir ma permission, une citation et ma nomination de caporal, après ça allait.
Comme de juste, j'ai fait des surprises ailleurs que chez nous.
J'ai profité de ma permission pour visiter les amis de Baguer-Pican. Il y avait entre autre une famille qui était nos voisins avant le déménagement, que j'estimais beaucoup. Elle se composait du père, de la mère et de deux filles :
Marie et Émilie, l'aînée était tout pour moi (***)
Je n'écrivais pas beaucoup. Le plus souvent possible à mes parents, à la famille que je viens de citer, à mon parrain, à ma marraine et aux oncles et tantes.
(*) : Vers mi-mai 1916, le régiment était retiré des
premières lignes et stationnait à Bar-le-Duc
(**) : La Bazillais-en-Lourmais
est une grande ferme qui existe encore de nos jours. Voir ici.
(***) : Marie JOURDREN deviendra son épouse le
31 mai 1927.
24 mai au 1e juin 1916 : l’attaque de Cumières, la
grange
La date exacte a
été retrouvée dans le JMO : le 24 mai 1916, le 155e RI arrive au bois
Bourrus
Cette permission a dû se passer sans histoire.
Quand je suis rentré, le régiment était à peu près reformé, à la place de l'adjudant MAX, comme chef de section, nous avions le sous-lieutenant DE CHAMPORIN et comme demi-section, le sergent LOMBARD, un mineur du Nord. Le comte de CHAMPORIN était très bon avec nous. Ceux qui nous avaient relevés avaient perdu Cumières, et nous avions à charge de le reprendre.
Nous avions passé la journée dans le Bois Bourru.
Le soir, nous avons pris la direction de Cumières, après avoir traversé le bois, nous prenions la route de CHATTENCOURT, à notre droite, il y avait une ferme, à cet endroit, il y avait toujours des gaz, quand l'ordre est arrivé de mettre les masques.
J'en avais déjà respiré, nous avons reçu une volée d'obus, nous nous sommes mis à l'abri dans des trous au bord de la route.
Je ne pouvais plus endurer mon masque, Je l'ai enlevé, mais comme le gaz est plus lourd que l'air, il y'en avait dans le trou, J'ai été sérieusement incommodé.
Arrivés à environ 100 mètres du village, nous avons commencé à creuser une tranchée, pour ma part, J'étais arrivé à 80 centimètres de profondeur quand un 88 Autrichien a éclaté à 50 mètres, instinctivement, nous avons fait un plat ventre, aussitôt, il en arrive un deuxième à 50 centimètres de mon dos sur le bord de la tranchée que je venais de creuser.
J'ai été recouvert de souffre et de terre, mais pas une égratignure, si c'était le premier qui était tombé à la place du deuxième, j'aurais été haché comme de la chair à saucisse.
Voyant que nous étions repérés, nous avons évacué la position et sommes retournés au Bois Bourru où nous avons passé la journée, la nuit venue (*), nous avons repris la direction de Cumières, cette fois pour essayer de le reprendre, l'attaque devait se faire par surprise, sans aucune préparation d'artillerie, ma compagnie devant aborder le village par la route, une autre compagnie, capitaine CARRIERE, devait attaquer par derrière la voie ferrée, c'est-à-dire par le flanc droit. (**)
Arrivés à 30 ou 40 mètres des premières maisons, un ordre est arrivé :
« Première section, en
avant ».
A peine étaient-ils engagés entre les deux premières maisons, qu'un feu croisé de mitrailleuses les a tous couchés là, sauf un qui est revenu nous donner le résultat, en même temps il est arrivé un mitrailleur de notre compagnie qui nous a dit :
«
Le commandant nous a fait braquer nos mitrailleuses derrière vous et
nous avons ordre de tirer si vous reculer ».
(*) : C’est exact, l’attaque a débutée de nuit, à 21 h., le 26 mai 1916
(**) : Tout à fait exact. Quelle mémoire après 50
ans !
A ce moment, l'ordre est donné à la deuxième section de foncer, ils devaient jeter des grenades par les fenêtres d'où étaient parties les rafales de mitrailleuses, mais il faut croire qu'elles étaient bien abritées, car la deuxième section a subi le même sort que la première.
Je faisais partie de la troisième section, c'était notre tour.
A ce moment, le mitrailleur qui était venu nous dire qu'ils avaient mis en batterie derrière nous sur l'ordre du commandant de bataillon est revenu et nous a dit :
« On vient d'emmener le
commandant, il était fou »
Notre chef de section, le lieutenant DE
CHAMPORIN, m'attrape et me dit :
« COUAPEL, allez donc
voir ce que fait la compagnie du capitaine CARRIERE de l'autre côté de la voie
ferrée ».
Je traverse la voie
ferrée et je tombe sur la compagnie CARRIERE, le capitaine m'a dit
aussitôt :
« Dites à votre chef de section que vous venez avec nous ».
Ma mission accomplie, nous avons donc rejoint la compagnie CARRIERE. J'assistais à la rencontre des deux officiers. Le capitaine CARRIERE dit à notre lieutenant :
« Nous n'avons pas
attaqué, mais nous allons le faire tout de suite et vous viendrez avec nous ».
Notre lieutenant a
répondu :
« Attaquez si vous voulez, mais nous n'irons pas avec vous, notre compagnie est assez décimée».
Et à nous :
« Venez les gars »
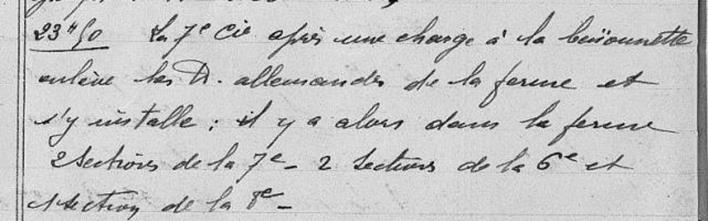
Il y avait devant nous une ferme isolée ou plutôt les décombres d'une ferme. Nous allons essayer de déloger les Allemands qui l'occupent et s'y abriter pour la journée. Nous avons réussi sans mal.
Il y avait parmi les ruines, un hangar qui abritait des outils agricoles.
Ce hangar était encore en assez bon état, nous y sommes rentrés, à ma gauche, j'avais un gars du Nord, déjà d'un certain âge qui parlait difficilement le français. Il tire un coup de fusil en disant :
« Je te le ravigote ».
En regardant dans la direction où il tirait, nous voyons des soldats allemands à la file indienne qui passaient à découvert, la tranchée qu'ils suivaient était obstruée à un certain point par les brèches d'un mur, toute la section l'a imité. Je vois encore notre lieutenant debout, appuyé sur sa canne, regardant le résultat de notre tir.
A ce moment, il reçoit une balle dans la tempe gauche. Une balle bien ajustée, car il n'avait été tiré qu'un coup de fusil et ce coup était parti du village qui était bien à 200 mètres à notre gauche. Il lève les bras et tombe à la renverse raide mort. (*)
Notre sergent lui a enlevé ses papiers et nous l'avons caché dans un petit bout de tranchée recouvert de tôle.
(*) :
Le sous-lieutenant François André Julien Louis VINCENT-LEFEBVRE DE CHAMPORIN,
du 155ème régiment d’infanterie a été tué le 28 mai 1916, comme l’indique sa
fiche.
L'un de nous ayant trouvé une énorme andouille et des biscuits secs dans la musette d'un soldat allemand qui avait été tué le matin, ça nous a permis de casser la croûte, autrement, il aurait fallu serrer la ceinture d'un cran, car il n'était pas question de ravitaillement où nous étions.
Le reste de la journée a été calme car nos lignes étaient trop rapprochées et trop mal définies pour que les artilleurs allemands puissent nous envoyer des obus.
La nuit à peine venue, le capitaine CARRIERE arrive et nous demande le lieutenant, nous lui avons fait voir son cadavre. Alors, il s'adresse à notre sergent et lui dit :
« Préparez-vous à être
attaqués »
Puis à moi et à quatre
de mes camarades :
« Grimpez sur le toit du
hangar »
A peine étions nous couchés sur le toit que nous entendons les grenades et les pétards nous passer sur la tête en sifflant et éclater sur les copains qui sont en bas, aussitôt, ils se sont repliés et après avoir fait un bond en arrière ils ont commencé à tirer dans notre direction, par conséquent nous étions pris entre deux feux.
Nous sommes descendus du toit et sommes rentrés dans le petit abri où nous avions mis le corps de notre lieutenant. A peine étions-nous dans l'abri que je vois un allemand déboucher au coin du hangar. Il avait sur le dos un lance-flammes, il y avait une fusée éclairante, je le voyais comme en plein jour, je lève mon fusil, mais un camarade me tire en arrière en me disant :
« Tu veux nous faire
bousiller ».
Et réflexion faite, il avait raison, car derrière celui-là, il y avait toute une compagnie.
Il a arrosé le terrain avec son lance-flammes, le feu est arrivé jusqu'au bord du trou où nous étions et s'est arrêté là. Nous avions eu chaud.
Presque aussitôt, le feu éteint, nous les avons entendus passer tout à côté de nous et la fusillade a fait rage pendant une demi-heure, nous pensions bien être pris puisqu'ils nous avaient dépassés.
Les coups de fusil se sont espacés, puis il s'est fait un grand calme.
N'entendant plus rien, je dis aux copains :
« Je vais aller voir
ce qui se passe ».
J'enlève tout mon équipement et ma capote, je garde juste mon fusil et en rampant d'un trou d'obus dans l'autre, après avoir parcouru quelques centaines de mètres sans rien voir, que quelques morts dont deux allemands couchés à côté de leur mitrailleuse, je suis retourné avec mes camarades, j'ai repris ma capote et mon sac et leur dit:
« Suivez-moi si vous
voulez, je vais essayer de retrouver mon régiment ».
Ils n'ont pas voulu, je suis parti seul.
J'ai recommencé le même parcours en passant à côté de la mitrailleuse allemande, je me suis arrêté indécis, c'était tentant : celui qui ramenait une mitrailleuse ennemie avait droit à la médaille militaire et une permission de détente, comme je ne savais pas où étaient les Allemands, je l'ai abandonné.
J'ai gagné la voie ferrée et l'ai suivi, un peu avant d'arriver à la station de Chattancourt, j'ai entendu des plaintes, je me suis approché.
Il y avait là plusieurs blessés, dont l'un avait les jambes coupées.
Je leur ai dit :
« Je vous envoie les
brancardiers ».
Je savais qu'il y avait un poste de secours à la station. Je m'y suis rendu le plus vite possible et ils sont partis chercher les blessés aussitôt.
En même temps, je leur avais demandé s'ils savaient où était mon régiment. Sur leurs indications, j'ai réussi à retrouver ma section, ils étaient dans une tranchée assez bien à l'arrière.
Parmi mes copains, il y avait un nommé CAMUZARD, un gars des Côtes du Nord. Il m'a donné quelques détails sur le coup de main que nous avions subi après avoir abandonné le hangar où nous étions perchés, ils s'étaient repliés par petits bonds en arrière.
En se retournant pour tirer, à un moment donné, il n'avait plus de cartouches et il avait sur les talons un grand diable d'allemand. Lui qui était tout petit en se sauvant, il arrive à la Meuse, il a sauté dans la rivière et a traversé à la nage.
Il faut croire que l'Allemand n'était pas bien méchant ou qu'il était comme lui ; qu'il n'avait plus de cartouches, autrement il n'aurait pas traversé.
Pour l’attaque de
Cumières le 155e RI a perdu plus de mille hommes... Extrait du JMO :
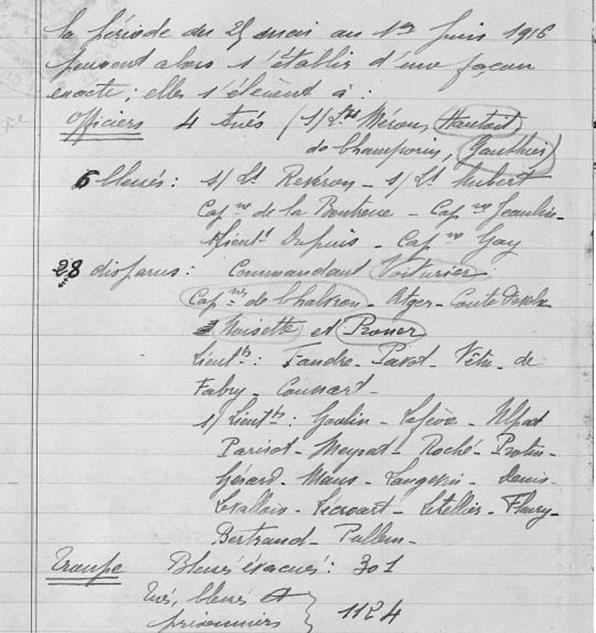
La nuit, nous avons été relevés pour de bon, au matin nous étions à Froméréville, un petit village en bordure du Bois Bourru, il y avait déjà de la troupe qui portait l'écusson du 47, je savais que j'avais un cousin Joseph COUAPEL, des Tertres de la Claie, lui de son côté savait que j’étais au 155 d'infanterie et me cherchait.
Quand nous nous sommes rencontrés, il ne m'a pas reconnu, j'étais poilu, boueux, défiguré par le manque de sommei1 et les privations. Après avoir échangé quelques mots, nous avons compris qu'il n'y avait pas d'erreur.
Après s'être embrassé, il me dit :
« Viens avec moi ; je
suis cuistot des officiers, j'ai tout ce qu'il faut pour te restaurer ».
Après avoir prévenu
mon lieutenant qui m'a donné son consentement en me disant :
« Tu nous rejoindras à
Sivry-le-Perche, à environ 10 km ».
Je vais donc avec le cousin à sa popote. Il m'a servi un bifteck large comme une assiette, un bout de fromage, un bon coup de pinard, un café arrosé de rhum. J'étais complètement ragaillardi. Après l'avoir chaleureusement remercié et dit au revoir.
J'ai bourré une pipe et pris la route de Sivry-la Perche, où je suis arrivé de bonne heure dans l'après-midi. Là, j'ai appris par les camarades que la colonne avait été mitraillée tout le long du parcours par un avion allemand. Je me suis dit :
« C’est tout de même
beaucoup de chance, bien réconforté et tranquille à faire la route, alors que
les copains, le ventre creux ont été obligés de faire du plat ventre dans les
rigoles ».
A peine la nuit venue, nous nous sommes couchés.
Pour moi, avec une dizaine de camarades, nous avons trouvé abri dans un grenier où il y avait un peu de paille. Comme de juste, après plusieurs jours sans sommeil, aussitôt couchés, nous dormions comme des souches.
Il y avait environ deux heures que nous dormions quand une sentinelle est entrée dans le grenier en criant :
« Alerte, tout le
monde debout, rassemblement sur la place ».
Impossible d'enfiler nos chaussures, les pieds nous avaient gonflés et nos chaussures détrempées qui avaient plutôt rétréci.
Nous avons pris nos souliers à la main et tout notre bazar en pagaille sur le dos. Nous avons été à l'endroit indiqué. Aussitôt, notre commandant de compagnie sans faire attention à notre tenue, nous emmène vers une petite colline qui domine le village.
Arrivés au sommet sans autre explication, les chefs nous invitent à nous coucher.
Nous n'étions pas là depuis une demi-heure que les obus incendiaires ont commencé à pleuvoir sur le village en bas. Aussitôt des incendies ont éclaté un peu dans tous les coins.
Une heure après, de Sivry-la Perche, il ne restait que des décombres fumants. Les Allemands avaient bien combiné leur affaire. Ils nous savaient là puisque l'un de leurs avions avait mitraillé le reste du régiment jusqu'au village. Ils avaient pensé :
« Quand ils seront
endormis, nous allons griller les derniers ».
Comment notre commandant a-t-il prévenue à temps, je ne l'ai jamais su.
Le lendemain, nous prenions la direction de l'arrière.
A l'heure de la soupe, nous étions sur une colline où il y avait beaucoup d'herbe. Nous avons formé les faisceaux et nous nous sommes couchés dans l'herbe.
En bas, il y avait un village (*) avec ses maisons couvertes en tuiles rouges, les arbres fruitiers, surtout des pruniers étaient en pleines fleurs.
Du village, montaient des voix humaines qui s'interpellaient, des chiens qui aboyaient, des vaches qui meuglaient, des coqs qui chantaient, c'était la vie après la mort. Le paradis après l'enfer.
(*) : Il
s’agissait certainement de Rupt-aux-Nomains (Meuse)
Hôpital SAINT JOSEPH (COMBOURG) où je
suis immobilisé pour une fracture du fémur.
Je profite du 60ème anniversaire de la
bataille de VERDUN et que je ne peux
rien faire, pour continuer mon récit.
Quel contraste entre cette belle nature et
l'horreur que nous venions de quitter. Des arbres qui n'étaient plus que des
trognons calcinés, des maisons rasées,
une terre brûlée et déchiquetée, où il n'y avait pas un pouce de terrain qui
n'avait pas été labouré.
Enfin, nous
espérions le cauchemar fini au moins pour un moment.
Octobre-nov. 1916 : Normandie, Gournay-en-Bray,
l’épisode du mauser
Là encore, la mémoire de Laurent lui a fait défaut.
Le séjour à Gournay-en-Bray (à l’est de Rouen) se situe entre le 18
octobre et le 15 novembre 1916, donc après son séjour dans la Somme.
Notre colonel nous avait promis que nous descendions au repos tout près de Caen à Gournay en Normandie, pour un mois.
Ma compagnie était réduite à une petite section. Des camions nous ont emmenés à Gournay.
Aussitôt arrivés, la moitié est partie pour 15 jours en permission. Je n'étais pas du nombre, comme j'en avais déjà eu deux, coup sur coup.
Quand les premiers rentreront, nous partirons à notre tour.
Pour ma part, j'étais logé dans une ferme. Il y avait une maison bourgeoise et un peu en contrebas, un immense bâtiment qui contenait tout le matériel, le bétail et le fourrage, le tout dans un très beau décor, au milieu d'arbres de toutes sortes. Attenant à ce bâtiment, il y avait un petit pavillon avec des chambres pour les domestiques : c'est là que je logeais. C'était divisé en plusieurs petites chambres. J'en avais une pour moi tout seul : un bon lit, une table et une chaise, une armoire. Bien nourri, rien à faire, c'était la bonne vie.
J'étais descendu du front, en plus de mon barda, un fusil allemand, un «Mauser» tout neuf et 200 balles. J'espérais bien l'expédier à la maison en allant en permission. En attendant, je l'avais caché sous ma paillasse.
La première journée, je l'ai passée à visiter le bâtiment que nous occupions. Dans le bout opposé où nous logions, il y avait d'abord la porcherie, après l'écurie aux chevaux et ensuite l'étable. Entre nous et les vaches, il y avait tout le fourrage : foin, paille, betteraves et autres racines. Tout ça empilé dans le sens de la longueur. Dans le grenier au-dessus, il y avait les grabats de blé qui tombaient dans une cuve par une trappe quand le moulin à betteraves était en marche.
Ces betteraves arrivaient au moulin au moyen d'un long conduit muni de petites lames à l’intérieur qui tournaient à la vitesse du moulin. Le gosse qui s'occupait de soigner le bétail, jetait les betteraves dans la gueule du conduit.
Quand elles arrivaient au moulin, elles étaient propres comme un sou neuf.
Partant du tas de fourrage, il y avait une allée spacieuse avec des rails. Les bêtes étaient attachées le nez face à l'allée. Des deux côtés, il y avait des mangeoires et râteliers.
Pour la distribution du fourrage, le soigneur disposait d'un chariot où il empilait une grosse quantité de fourrage, puisque çà roulait tout seul. Derrière les bêtes, même principe, un caniveau pour l'évacuation du purin et pour le fumier, il y avait des rails et un wagonnet.
Ces allées conduisaient à une grande fosse cimentée et profonde d'environ 2 mètres, mais elle s'en allait en pente douce à environ 40 mètres, il y avait environ 4 mètres de chaque côté des rails, ce qui faisait que les charrettes pouvaient reculer jusqu'au fond sans aucune difficulté et les chargeurs avaient suffisamment de place pour charger des eux côtés.
Celui qui nettoyait l'étable avait un wagonnet de chaque côté.
Le matin, il le chargeait à la fourche, ensuite, il poussait son wagonnet au-dessus de la cave. Il appuyait sur un déclic et instantanément, le wagon était déchargé. Il avait un système de relevage et il remisait son engin qui avait sa place à l'intérieur. Le bâtiment était toujours très propre, pas de danger de s'embouer les pieds.
Comme de juste, nous dormions comme des loirs. Dans la journée, il y avait quartier libre.
Cependant, il y avait une sentinelle qui restait à garder les chambres. Un jour que j'étais de sortie, le soir, j'avais regardé sous ma paillasse si mon «Mauser» était toujours là, mais il n'y avait plus rien. J'ai été trouvé la sentinelle :
« Comment se fait-il que
j'ai été volé, alors que tu étais là pour garder les chambres ? ».
Il m'a répondu :
« Ce n'est pas
possible, je n'ai pas bougé ! Cependant, à un moment, le sergent m'a demandé
d'aller lui faire une commission et il m'a dit qu'il garderait les chambres. »
Alors, j'ai compris, ce sergent était un drôle de zigoto. Il me devait déjà des sous.
Le fermier chassait le sanglier, mais il avait beaucoup de peine à se procurer des munitions pour son fusil de chasse. Un fusil «Mauser» avec 200 balles. C'était une affaire et pour notre sergent qui n'avait jamais le sous, cela en était une autre.
Heureusement pour lui que dans l'entrefaite, les permissionnaires sont rentrés.
Sept.-oct. 1916 : La Somme : le bois de
Saint-Pierre-Vaast, la soif, les moutons
Dès le lendemain, le colon nous a rassemblés, nous pensions que c'était pour nous donner nos permissions, malheureusement, il nous a dit :
« Mes enfants, je
regrette autant que vous, mais au lieu de partir en permission, nous montons
dans la Somme pour attaquer afin de faire une diversion sur Verdun ».
Du fait, j'avais beaucoup moins à regretter mon fusil, je ne l'aurais pas remonté au front. Comme de juste, nous n'étions pas en état d'attaquer.
Il restait une petite section par compagnie.
Nous avons repris les camions et avons été au camp de MAGNY pour refaire le régiment. Nous n'étions pas malheureux, nous n'avions pratiquement rien à faire tant que le régiment n'était pas au complet. Nous jouions au ballon. Je crois que ça a bien demandé un mois.
Quand l'effectif fut au complet, nous avions un nouveau commandant de section, le sous-lieutenant LAMBERT et comme sergent, j'avais un Normand de la classe 14, (Sénateur Ernest) HOIZAY, très sympathique. Le moment venu, le colonel ETIENNE a rassemblé le régiment.
Nous étions à peine sur le terrain que la pluie s'est mise à tomber à torrent. Aussitôt, les officiers qui avaient un imper roulé à l'arçon de la selle ont commencé à les déplier.
Le colonel leur a dit :
« Voulez-vous me replier
ça, tas de poules mouillées. Est-ce que les hommes en ont des impers. »
C’était un homme sorti du rang. Il était dur, mais juste. Si un simple soldat avait une cause valable à lui exposer, il n'avait pas besoin de passer par la voie hiérarchique, il pouvait aller le trouver directement.
En route pour la Somme, notre but était d'attaquer au bois de St-Pierre-Vaast. Une journée de repos à l'arrivée et le lendemain en route.
Nous avons passé les villages de Combles et Maurepas, une pancarte indiquait l'emplacement des villages, mais autrement rien ne pouvait faire penser qu'il y avait eu là des maisons.
Pour le soir, nous étions arrivés à notre point de départ pour attaquer le lendemain. Après avoir pris le jus de bonne heure, nous avons mangé un bout de jambon salé. Nous avions fait le plein de munitions, quelques vivres dans le sac, le bidon de 2 litres plein, les uns de pinard, d'autres de café froid. C’était mon cas. C'était une attaque surprise, sans aucune préparation d'artillerie.
Il faisait à peine jour quand nous avons bondi de notre tranchée.
Nous avons vite été signalés et les moulins à café ont commencé à tourner, ainsi que les obus de 77 et de 85 autrichiens. Mais le terrain était tellement accidenté, il y avait des trous partout, nous progressions entre deux rafales, quelquefois dix mètres, quelquefois 20 à chaque bond. Nous n'avions pas fait 500 mètres qu'il y avait déjà pas mal d'amochés.
Notre chef de section, le sous-lieutenant
LAMBERT fut décapité par un gros éclat de 77. (*)
Au bout de deux heures de combat, la résistance était beaucoup moins importante. L'artillerie allemande n'osant plus tirer de peur de toucher son infanterie. Enfin, vers midi nous nous sommes arrêtés dans un grand trou. Nous étions bien une demi-douzaine. J'étais à côté du sergent HOIZAY.
Nous avons sorti nos provisions et mangé un morceau arrosé du liquide que chacun avait dans son bidon. A peine fini le sergent était couché sur le dos et j'étais sur le côté.
Nous étions à nous toucher. Il arrive un 77 tout près, à environ 50 mètres et aussitôt après l'éclatement, j'entends un vrombissement et un bruit sourd sur la poitrine de HOIZAY Il tend un bras sur moi et pousse son dernier soupir.
Aussitôt, nous avons déboutonné ses vêtements. Il n'avait pas une égratignure. Mais la fusée de l'obus, un morceau de ferraille qui pèse bien 1kilo, lui a défoncé la poitrine. Il en est mort. (**)
(*) : Louis Georges Valéry LAMBERT, sous-lieutenant, mort
pour la France le 7 octobre 1916 à Rancourt. Voir
sa fiche.
(**) : Sénateur Ernest HOIZAY, sergent, mort pour la
France le 7 octobre 1916 à Rancourt. Voir
sa fiche.
Il ne restait que mon voleur de fusil comme chef de section. Mais elle était déjà bien diminuée. Si les gradés étaient tombés, les soldats aussi.
Nous reprenons l'attaque, pour le soir, nous étions à la lisière du bois St-pierre-Vaast. Si l'on peut appeler ça un bois. C'était des troncs d'arbres calcinés qui ne faisaient même pas deux mètres de haut. La tranchée de bordure du bois était confortable.
La nuit approchait, nous avions avancé d'environ 12 km. Nous sommes restés là. Il restait quelque nourriture dans nos musettes. Nous les avons sorties.
Malheureusement, les bidons étaient vides.
Aussitôt que nous avons eu mangé, notre sergent s'il avait des défauts, il n'était pas froussard, demande deux volontaires pour aller avec lui en patrouille. C’était dans le but de voir s'il n'y avait pas d'Allemands dans les parages, pour nous tomber dessus pendant notre sommeil.
Ce n'était pas sans risque, car s'ils étaient tombés sur une mitrailleuse ou même quelques tireurs, leur compte était bon. Ils sont revenus au bout d'une demi-heure, ils avaient déjà exploré assez loin, il n'y avait rien dans les parages.
Ce n'est pas la peine de dire que nous avons bien dormi.
Le lendemain matin, déjeuner sec, le midi repas sec et le soir même tabac. Nous commencions à l'avoir sec aussi le gosier.
La deuxième journée s'est passée de la même façon et la troisième, il n'y avait aucune amélioration, alors là nous étions morts de soif.
Le soir du quatrième jour, on nous a dit :
« Vous serez relevés
demain matin et vous trouverez de l'eau au poste de commandement à 4 kilomètres
d'ici ».
En effet, nous y avons
couru, mais arrivés au poste, il n'y avait plus d'eau, j’ai dit à un
copain :
« Viens avec moi, on va
essayer d'en trouver dans les environs ».
En passant à côté d’un trou de bombe, qui faisait bien 3 à 4 mètres de profondeur, nous apercevons dans le fond un peu de vase liquide, nous y descendons et buvons deux quarts chacun de cette ordure et puis un peu plus loin, nous tombons sur un poste de secours.
Il était très profond.
Nous descendons l'escalier et après avoir frappé, nous entrebâillons la porte et demandons gentiment s'ils n’avaient pas un peu d'eau. Ils nous ont répondu qu'ils n'en avaient même pas pour les blessés. Nous refermons et pendant que je parlementais, mon camarade avait remarqué trois bidons de deux litres pleins à l'extérieur du gourbi. Nous les décrochons et remontons en surface avec et en un clin d’œil les trois bidons ont été sifflés. Il y avait deux bidons d'eau et un bidon de café. Nous avons remis les ustensiles que nous venions de vider en place et sommes partis. Ça allait mieux.
Alors, nous avons vu un spectacle comme nous n'en avions jamais vu. C'était un arabe avec une chéchia rouge.
Il marchait en s’appuyant sur une canne et derrière lui, Il y avait 100 petits ânes marchant à la file indienne. Ils n’avaient ni bride, ni licou, simplement un bât avec un bidon d'eau de chaque côté. Ils se dirigeaient vers le poste de commandement. Nous les avons suivis à quelque distance, comme ils étaient obligés de zigzaguer pour éviter les trous d'obus, à quelque distance on aurait dit un énorme serpent.
Nous sommes arrivés à l'heure de la distribution d'eau. Je crois que nous avons encore bien bu un seau chacun, presque aussi fort qu'une vache.
Après s'être restauré, nous avons pris la direction de Curlu. C’était le point d'eau d'où étaient venus les petits ânes.
Nous avons passé la nuit dans ce village. C’était une oasis au milieu du désert.
La
blessure : 11 novembre 1916
Le soir, nous avons pris la direction de Sailly-Saillisel, un point où les Allemands devaient attaquer. Nous y arrivions vers le milieu de la nuit.
Il n'y avait pas de tranchée. L'endroit où nous avons atterri était un trou d'obus, légèrement aménagé. Du côté des lignes, deux ou trois créneaux formés avec des sacs de terre, la journée s'est passée sans anicroche.
Le soir, quand la nuit est tombée, nous avons touché du ravitaillement. J'étais chargé de la distribution du vin. J'attrape un bidon et contrairement à mes habitudes, je me servais le premier.
J'avais à peine vidé mon quart que la sentinelle tire un coup de fusil en criant :
« Vlà les Boches ».
Le sous-lieutenant, un nouveau qui nous avait rejoints à CURLU pour remplacer le nôtre, me dit :
« COUAPEL, les grenades »
Ce n'était pas mon affaire, car j'avais toujours été fusilier tireur d'élite, mais je savais jeter une grenade. Tous ceux qui en possédaient les ont apportées dans un tas devant moi et l'un d'eux enlevait la douille et me les passait. Je n'avais qu'à les frapper sur mon bidon de pinard et les jeter.
Je crois que j'arrivais à la cadence d'une à la seconde.
Il était impossible de passer ce barrage, je venais de jeter la dernière à environ 20m, quand un lieutenant d'une autre compagnie, le lieutenant CHARLES passe à côté de nous en criant :
« En arrière, ils sont en
train de nous encercler ».
Nous faisons donc un bond en arrière et nous retournant, nous commençons à tirer en deux rafales, nous faisons un deuxième bond en arrière et ainsi de suite. J'avais 150 cartouches, je venais de tirer la dernière quand j'ai reçu une balle dans le pied. Je m'adresse au sergent HENRI, qui était à côté de moi je lui ai dit :
« Je suis touché ».
Il m'a dit :
« Eh bien, fous le camp ».
Il était arrivé en renfort de la veille, mais je le connaissais depuis longtemps, nous avions combattu ensemble à VERDUN. A l'instant un soldat me crie :
« Attends-moi j'ai
une balle dans un mollet ».
Je lui réponds :
« Viens vite, car dans
quelques minutes, nous ne pourrons plus marcher »
Nous sommes partis ensemble, mais au bout d'un certain temps, nous étions séparés. Il faisait noir comme dans un four. Il fallait profiter des accidents du terrain pour éviter les obus et les rafales de mitrailleuses.
En plus, toutes les cinq minutes, Il y avait une fusée éclairante avec un parachute qui éclairait mieux que le jour, mais ce n'était pas le moment de bouger.
Enfin, cahin-caha, après avoir parcouru environ 4 kilomètres, j'arrive à la route de Bapaume où je trouve un poste de secours.
Il était très profond, je crois qu'il était bien à 8 mètres sous terre. Après avoir descendu l'escalier, j'ai constaté qu'il était très spacieux.
Il pouvait y avoir 100 blessés, je me suis allongé par terre à côté des autres, en attendant mon tour, au bout d'un certain temps, on m'a enlevé la chaussure, nettoyé le pied et mis un pansement. Alors le médecin m'a demandé :
« Pouvez-vous marcher ? »
Après avoir essayé, j'ai vu que c'était inutile. Il a dit aux brancardiers :
« Enlevez ».
Ils m'ont grimpé l'escalier et déposé sur le haut. A ce moment, il est arrivé un obus tout près de l'entrée du poste, mes porteurs sont rentrés dans l'abri mais je ne pouvais pas faire autant.
Nous avons pris la route dans la direction de Bray-sur-Somme, elle était complètement défoncée par les obus.
De temps en temps, quand il en arrivait un, mes transporteurs sautaient dans la rigole et, moi je restais sur la route. Enfin, nous arrivons à un endroit qui était un peu moins défoncé.
Nous avons aperçu une ambulance, elle était presque au complet. Sur six brancards, il n'y avait plus qu'un de libre. On m'a hissé dedans et aussitôt, la voiture a démarré.
La route était meilleure, mais elle était encore loin d'être bonne. Quand la roue tombait dans un trou d'obus, j'étais blessé au pied, le choc n'avait pas tellement d'influence, mais les camarades qui étaient atteints dans la tête ou dans le corps, hurlaient.
Nota : L’attaque et la prise du village de Sailly-Saillisel le 11 novembre, jour de la blesse de
Laurent COUAPEL, a couté au régiment 51 tué, 201 blessés et 10 disparus (JMO)
Fin 1916, début 17 : Séjour dans les hôpitaux :
Bray-sur-Somme, Brest
Enfin, nous arrivons à l'hôpital de Bray-sur-Somme. Des infirmiers nous déshabillent complètement, nous passent à la douche et nous mettent au lit. Deux heures après, on m'emportait pour l'opération. Aussitôt sur le billard, un infirmier me plaque un tampon de chloroforme sur la bouche en me disant :
« Tu dors, tu dors... »
J'entendais
parfaitement, mais avec le tampon sur la bouche, je ne pouvais pas répondre. Il
dit au chirurgien :
« Vous pouvez commencer ».
La douleur a été tellement forte que j'ai perdu connaissance. Je me suis réveillé, l'opération était terminée. Mais, j'étais toujours sur la table d'opération.
Les infirmiers m'ont retourné dans mon lit et à la pointe du jour, je montais en péniche, direction Amiens.
On nous a déposés à l'hôpital tout près de la gare. C'était très confortable, mais l'inconvénient c'est que les avions allemands bombardaient la gare toutes les nuits et que les carreaux des chambres étaient souvent cassés.
Au bout de huit jours, on vient me prendre en me disant :
« Vous êtes évacué sur Brest».
J'étais heureux.
Le frère de ma mère, mon parrain, était infirmier à l'hôpital de Rennes. En y passant, j'ai demandé si je pouvais rester là. Mais on m'a répondu que ce n'était pas possible, mes papiers étant faits pour Brest. Nous arrivions de nuit. Deux marins attrapent mon brancard et m'expédient au grand lycée transformé en hôpital. C'était une chambre d'une dizaine de lits. Presque tous étaient occupés.
Le matin, j'ai fait la connaissance de mes infirmières. La plus âgée avait autour de la cinquantaine, les deux autres environ 20 ans : deux sœurs, Madeleine et Alice, mais elles ne se ressemblaient pas.
Madeleine était brune et Alice, blonde. Elles ont tout de suite entrepris de refaire mon pansement, ce qui n'avait pas été fait depuis Amiens.
Quand elles ont passé une brosse dans le drain, ce n'était pas très agréable, mais enfin, dans l'ensemble l'opération avait été très supportable.
Dans la journée, j'ai fait connaissance de mes camarades de chambrée. Mon voisin de lit était prêtre, l'abbé LEGAL. Il n'y avait pas de blessés de guerre, c'était tous des malades. Dans la journée, il est arrivé dans la chambre, un marin qui avait fait une chute dans un escalier.
A Brest, il y a des escaliers de pierre pour descendre d'une rue à l'autre. Après l'avoir déshabillé, les infirmières ont constaté qu'il n'avait rien de cassé, mais il était sérieusement contusionné.
Tous les matins, Madeleine et Alice refaisaient mon pansement. Après, nous étions libres. Comme je n'étais pas malade et qu'il y en avait d'autres dans mon cas, nous avons organisé un jeu de carte. C'était la manille aux enchères. Je n'étais pas chanceux ou alors j'étais mauvais joueur, mais je perdais régulièrement et dans les quatre, il y avait un parisien qui gagnait à chaque coup.
Heureusement que la somme n'était pas très importante.
Le temps s'écoulait tout doucement, mais la plaie ne se refermait pas.
Un jour, j'ai été convoqué pour passer la radio. Il me semble que le procédé n'était pas le même qu'à présent. Nous étions seuls, le chirurgien et moi dans une chambre noire. J'étais assis, il m'a posé le pied sur une espèce de cadre, ce qui fait que je voyais aussi bien que lui. Il n'a rien remarqué.
Je n'ai rien voulu dire, mais il me semblait voir un point suspect à l'endroit où la balle était sortie et où c'était resté très sensible.
Le lendemain, pour la première fois, j'étais sorti en ville. Je marchais avec des béquilles, mais j'appuyais quand même un peu sur le pied blessé. Quand l'infirmière est venue faire mon pansement le matin (je l'avais rencontrée en ville la veille) elle m'a fait remarquer :
« Vous avez marché hier,
votre pied n'est pas beau. »
J'en conviens, mais je lui fais :
« Qu'est-ce que
c'est que ce bout de ferraille qui ressort ».
C'était le point que j'avais remarqué à la radio et la marche que j'avais fait l'avait fait sortir.
« Oh ! » Qu’elle fait.
« En effet, je vais aller
chercher ma trousse. »
Elle revient avec l'infirmière en chef et tout de suite elle me dit :
« Cramponnez-vous aux
barreaux du lit, on va essayer de vous enlever ça ».
Après deux ou trois essais infructueux, elles me disent :
« Nous allons être
obligées d'aller chercher le chirurgien. »
Je leur ai dit :
« Essayez encore une
fois. »
Ça a été la bonne, elles ont réussi : C'était l'enveloppe de la balle. A cette époque, la balle allemande était composée d'un lingot de plomb enveloppé d'aluminium. Au moment où je l'ai reçue, après avoir coupé les nerfs des quatre petits orteils, elle avait rencontré l'os du pouce. Le plomb s'était séparé et était sorti en dessous.
Quant à l'enveloppe, elle était remontée en dessus n'étant plus dans la trajectoire du trou. Quand ils avaient posé le drain, ils n'avaient pu la déceler. Il avait fallu cette petite marche pour lui faire montrer son nez.
Les infirmières ont poussé un «ouf» de soulagement et moi aussi : A partir de ce moment, la plaie s'est vite cicatrisée.
Nous faisions tous les jours un tour en ville.
Le copain qui m'accompagnait était un très brave type. Il était un peu plus âgé que moi. Il connaissait très bien BREST étant là avant moi. C'était un Breton, mais Je ne me rappelle ni de son nom, ni de son adresse.
Généralement, dans nos excursions, nous prenions juste un vin chaud avec une tranche de citron. Avec lui, je n'avais pas été longtemps à connaître toute la ville : le port et les environs.
Nous poussions même certains jours jusqu'à la pointe Saint-Mathieu. J'allais oublier, les premiers jours de mon arrivée, j'avais eu la visite de mes parents. Je crois qu'ils tenaient surtout à se rendre compte de la gravité de ma blessure. Ils n'auraient sans doute jamais visité Brest sans cela et à moi ça m'avait fait beaucoup plaisir.
L'hiver 1916-17 avait été très dur.
Mais là, nous ne nous en apercevions pas, alors que les copains nous écrivaient qu’ils taillaient leur pain à coup de hache dans les tranchées, tellement il était gelé.
Dans une de nos sorties en ville, j'avais rencontré le soldat BRINQUIN qui avait reçu une balle dans un mollet au moment où j'en recevais une dans le pied. Il avait fait un bout de route avec moi dans la direction du poste de secours.
Sa blessure était en bonne voie de guérison.
Et quelques jours après, Je rencontre également le sergent HENRI qui m'avait dit de filer le soir où j'avais été touché.
Il avait un bras en écharpe. Il m'a fait voir sa blessure : quatre doigts enlevés à la main gauche. Il avait été blessé la même nuit que moi, vers le matin en reprenant le terrain qu'il avait fallu céder la veille.
Il m'a dit :
« Il ne faisait pas
bon le soir, mais il faisait encore plus mauvais le matin. »
Enfin, il paraissait en prendre son parti.
« Je travaille dans
un bureau, Je suis blessé à la main gauche, ça ne me gênera pas pour écrire. »
Un matin, les infirmières rentrent dans ma chambre avec un journal à la main en me disant :
« C'est votre frère qui
vient d'être décoré de la Légion d'Honneur. »
Et elles me passent le journal. Après lecture, Je leur dis :
« Non, ce n'est pas
mon frère, mais un cousin. »
« J'ai en
effet un frère au front qui s'appelle Ernest COUAPEL, mais il est plus jeune
que moi d'une classe, alors que le décoré en question est beaucoup plus vieux :
dix ans environ, mais je le connais très bien. D'ailleurs, nous nous écrivons
régulièrement. »
Ce cousin avait réussi un exploit peu banal : en passant à côté d'un abri il avait entendu parler allemand. Il était armé de son fusil mitrailleur et de grenades. Il a crié :
« Tout le monde
dehors ou je jette une grenade. »
Il faut croire qu’ïl y avait au moins un qui comprenait le français, car aussitôt, il a vu une tête d'officier émerger.
« Jetez vos armes ».
Il est sorti toute une compagnie. Quand le dernier a été dehors, il a commandé :
« En avant, direction le
P.C. français. »
Et c'est ainsi qu'à lui seul, il a fait prisonnier toute une compagnie avec officier en tête. Comme il était déjà titulaire de plusieurs citations et médailles, on lui a décerné la Légion d'Honneur. Je crois qu'il était un des premiers comme simple soldat.
L'état-major lui a proposé une bonne petite place à l'arrière en lui disant qu'il en avait fait assez comme cela.
Mais, il a voulu rester avec les camarades.
A quelque temps de là, il s'est fait tuer en allant chercher un blessé entre les lignes.
D'après ses copains, c'était un rude lapin.
(*) : Le caporal Ernest Jean Marie Victor COUAPEL du
94ème régiment d’infanterie sera tué en août 1917 au bois de Fosse (55). Voir
sa fiche de décès – Voir
sa fiche matriculaire.
Quelques jours après, il arrive un jeune chasseur à pied, beau, bien bâti, la poitrine couverte de décorations, dont la Légion d'Honneur.
Il a fait sensation. Au bout de quelques jours, choyé des infirmières, invité par les personnalités, même l'amiral l'avait eu à déjeuner. Il comptait des exploits rocambolesques, mais la médaille avait un revers.
Un jour, il arrive deux gendarmes à l'hôpital et cinq minutes après, ils ressortaient en encadrant le chasseur en question. C’était un déserteur de la coloniale qui n'avait même pas une citation.
Vers la fin mars 1917, j'ai été expédié à Kervallon, dépôt de convalescents, sur une rivière au sud de Brest. Nous y avons été en vedette. A mesure que nous avancions, la vallée devenait plus profonde.
Arrivés à destination, il y avait des baraques en planches, tout au bord de la rivière, très confortables.
La vallée faisait bien 200 mètres de profondeur. Les bords étaient abrupts et très boisés. C’était très joli. A peine installés, on nous a servi un repas très copieux et ensuite liberté complète et ainsi tous les jours.
Après la soupe, nous escaladions le vallon. Quand nous avions découvert un coin à l'abri du vent et au soleil, nous nous y installions à faire une partie de cartes ou un peu de lecture. Les ramiers venaient roucouler sur les arbres, au-dessus de notre tête, sans s'occuper de nous. C’était la bonne vie pendant trois semaines et puis nous avons remonté la rivière.
Mai 1917 : Congé de convalescence d'un mois
De retour à Brest, on m'a signé un congé de convalescence d'un mois.
Quand j'avais été déshabillé pour être opéré à Bray-sur-Somme, à la place de ma tenue de tranchée, on m'avait donné un béret de chasseurs alpins, une tunique de marsouin, c'est-à-dire d’infanterie de marine, une culotte de zouave et des souliers de repos avec le haut en toile, pas question de manteau.
Heureusement que ce n'était pas l'hiver, car c'est cette tenue là que j'ai reçue pour partir en permission.
J'avais un congé de convalescence d'un mois à passer chez nous. Il y avait un an que je n'avais pas été au pays, j'étais heureux d'en prendre la direction. Parti le matin, j'ai pu admirer le paysage.
Après un trajet sans histoire, je suis arrivé en gare de Bonnemain et direction La Bazillais. (Bazillais-en-Lourmais)
La première rencontre en arrivant à la ferme était toujours notre chien ‘’ Rapide ‘’. J'étais encore à plus de cinquante mètres de la maison qu'il me sautait au cou et ensuite il se chargeait de prévenir de mon arrivée. Un des heureux instants de la vie que ces arrivées en permission. Tout le monde était en bonne santé, la soirée a été gaie.
Le lendemain, j'avais un congé à faire signer à la gendarmerie et le reste de la journée : repos.
Le sur-lendemain, j'ai été voir Baguer-Pican.
En passant à Dol, je rencontre deux gendarmes qui me demandent ma permission. Après lecture, ils me font remarquer que je n'étais pas en tenue. Je leur réponds que j'étais dans la tenue que l'on m'avait donnée.
Après, ils examinent mon vélo : pas de plaque d'identité, ni de contrôle et pas de timbre. Ils me mettent trois contraventions et me menacent de confisquer mon vélo. Je leur dis :
« Comme vous voudrez,
mais emmenez-moi aussi, car je suis incapable de marcher. »
Ils n'insistent
pas.
Je prends la direction de Baguer-Pican comme de juste, ma première visite est la famille JOURDREN. Marie (*) était seule à la maison. Je ne sais pas si ça lui faisait plaisir de me revoir, mais pour moi j'étais heureux. Je suis resté un moment avec elle et pour ne pas la gêner dans son travail, je lui ai demandé le fusil de son père et je suis parti faire un tour dans les champs.
(*) : Marie JOURDREN deviendra son épouse le 31 mai 1927. Ils
vécurent au Moulin de la Forêt de Villecartier en Bazouge-la-Pérouze, où ils ont
élevé leurs sept enfants
Je n'avais pas grand temps avant le repas, j'ai juste traversé une pièce de terre. Dans la deuxième, il y avait de la grosse terre vieille labourée, c'est très bon comme remise. J'avais à peine fait quelques pas, qu'il me passe un gros lièvre, assez loin, Pas l'habitude du fusil, je le manque. Je continue, il me part trois perdrix.
J'en tire une et elle tombe de l'autre côté de la ligne. Pas de chien, je me suis dit :
« Elle est perdue. »
Quand je vois un gars qui passe la haie avec
l'oiseau à la main en me disant :
« Tiens, la voilà ta
perdrix »
Je le reconnais aussitôt, c'était un voisin quand nous habitions à Lerguer. Il était plus jeune que moi. Quand je faisais un tour de chasse le dimanche, il m'accompagnait. Il s'appelait Auguste FOREST. Après salutations, je le remercie chaleureusement. Il me fait :
« C'est normal. »
« Oui, mais bien d'autres
à ta place se seraient cavalés avec. »
Je me suis dirigé vers la maisonnette, car le Père JOURDREN, travaillant sur la voie ferrée, c'était l'heure exacte pour les repas. Ça m'a fait rudement plaisir de revoir toute la famille, car je les aimais bien tous. Après mangé, chacun est reparti à son travail.
Pour moi, j'ai été voir des voisins, des ouvriers avec qui j'avais travaillé avant la guerre et il y avait un conscrit qui avait été réformé et qui s'était marié tout récemment. Ils m'ont invité à partager leur souper et ensuite à coucher.
Le lendemain, après déjeuner, je suis retourné à la maisonnette. Le père JOURDREN regrettait que je ne fusse pas venu le soir manger avec eux et coucher. J'aurais préféré moi aussi.
Après un au revoir, je suis parti voir l'oncle Joseph COLICHET, un frère de ma mère à Bellenoé. Je l'aimais beaucoup, ainsi que Marie ROBIDOU, son épouse. C'était pour moi des seconds parents.
Je suis né à Lerguer, mais quand mon frère Ernest est né, j'avais treize mois. Il a eu une maladie et pour que je ne l'attrape pas, on m'avait envoyé à Belle-Noé chez mes grands-parents qui y habitaient également et j'y suis resté jusqu'à l'âge de 6 ans. C'est avec grand plaisir que je revoyais ce coin là et par l'accueil que j'y recevais et par le décor qui me rappelait tant de souvenirs. Après le repas du midi, l'oncle Joseph me dit :
« Tu vas peut-être faire
une partie de chasse, je vais te prêter mon fusil. »
Comme je ne demandais pas mieux, il m'a donné son matériel pour faire des cartouches. Il y avait bien des douilles, du plomb et des bourres, mais plus de poudre. Heureusement, avant de quitter Villouet, le père Jourdren m'avait donné une boîte de poudre. C'était de la poudre anglaise qui imitait notre poudre M.
J'ai fait trois ou quatre cartouches et je suis parti dans la nature. Je n'avais pas de chien. Je me promenais plutôt que je ne chassais. Quand j'entends des chiens courant et il me semblait que ça prenait ma direction. J'étais sur une lande, mais devant moi, il y avait un champ assez long.
Jusqu'au bout, je vois un lièvre qui saute dans le champ et vient vers moi. Quand j'ai jugé qu'il était à portée, je tire et il reste là.
C'était un très gros lièvre et comme je n'avais ni veste de chasse, ni carnier, j'ai pris le chemin du retour. Après rafraîchissements et adieux, je suis parti pour La Bazillais. Je n'avais même pas dit à mes parents que je serai resté deux jours. Je suis rentré à point pour le repas du soir.
Quel bonheur d'être réunis à la table de famille, après une aussi longue absence.
Après le repas, une pipe, une partie de cartes et au lit, que j'ai trouvé bon aussi.
Le lendemain, on m'a laissé dormir autant que j'ai voulu, et la vie s'est organisée : travail, quelques visites aux amis, quelques parties de chasse : la bonne vie.
Inapte pour l’infanterie, apte pour être cavalier au 61ème
d'artillerie
Mais tout à une fin.
J'avais reçu depuis quelques jours un avis d'expiration de mon congé. Je devais me rendre au 61ème d'artillerie au cantonnement du Légué Saint-Brieuc. Après un au revoir à tous les amis et parents, j'ai repris la route.
Arrivé de bonne heure, j'ai facilement trouvé mon cantonnement. C'était à gauche avant d'arriver au port. Il y avait un porche et rentré dans la cour, il y avait la cuisine et quelques chambres. Nous n'étions pas nombreux, quelques douzaines d'éclopés comme moi.
Tout de suite, le climat m'a plu : le décor, l'accueil des copains, la cuisine, la grande liberté, la possibilité d'aller en permission tous les dimanches.
Le lendemain, j'ai commencé mes explorations avec un camarade qui était arrivé avant moi.
Nous avons été à la plage Saint-Laurent et un peu plus loin, nous avons escaladé des rochers. Là, nous avons découvert un petit coin idéal. Il y avait une petite plate-forme abritée du vent et ensoleillée.
Nous dominions la plage Saint-Laurent et regardions la mer monter. Quand elle est arrivée à hauteur de notre plate-forme, elle a battu son plein et commencé à baisser. Nous y sommes revenus le lendemain avec nos slips de bain. Quand l'eau est arrivée à hauteur, nous avons fait un plongeon.
Quel délice !!! Et en se retirant pour s'habiller, pas de danger de se salir les pieds, la pierre était aussi propre qu'un sou neuf.
Nous n'avons pas oublié le coin.
Une sœur à notre voisine quand nous habitions Lerguer avait son domicile au Légué. Elle a appris que j'étais là et m'a fait dire d'aller les voir. Elle était mariée à un douanier qui s'appelait ARCHENOUL. Avec un autre soldat, nous y avons été.
Elle habitait une jolie maisonnette à flanc de coteau. Elle paraissait heureuse de nous recevoir. Il y avait beaucoup de fraises bien mûres et sur son invitation, nous en avons dégusté. Nous avons passé un bon après-midi en évoquant de vieux souvenirs. Nous étions nés à un kilomètre l'un de l'autre. En partant, elle nous a priés de revenir aussi souvent que nous voudrions. Nous sommes rentrés à l'heure de la soupe.
Le lendemain, nous avons été voir l'arrivée des pêcheurs. La pêche avait été bonne. Il y avait une multitude de poissons frétillants au fond des barques.
Sur notre demande, ils nous ont vendu une friture que nous avons portée à cuire dans un petit bistrot.
Ce jour-là, nous n'avons pas fait honneur à la cuisine du camp.
D'après ceux qui étaient depuis quelque temps au cantonnement, c'était le moment de poser sa candidature pour la permission dominicale.
Nous avons donc été au bureau et le samedi matin, nous recevions un papier nous accordant notre liberté pour 24 heures. Aussitôt, nous prenions le train. Pour moi, direction Dol-de-Bretagne.
J'arrivais en gare vers 10 heures, je descendais en ville où je savais trouver Maman qui y faisait son marché. Je savais que «Bichette» était remisée à l'hôtel MOREL.
Là j'avais tous les renseignements dont j'avais besoin. Si elle n'était pas à l'hôtel j'allais faire un tour au marché et nous ne tardions pas à nous rencontrer. Je l'aidais à transporter ses denrées et à midi nous allions manger au restaurant. Après manger, il ne restait généralement pas grand-chose à faire et nous prenions de bonne heure la direction de La Bazillais. La jument trottait bien, nous n'étions pas longs à faire la route. La voiture était attendue, il y avait toujours quelques friandises pour le goûter. Cette fois, la séparation n'avait pas été longue, mais ça faisait quand même plaisir d'être réunis. ‘’ Rapide ‘’ n'était pas le dernier à manifester sa joie.
Il voyait sans doute quelques petites promenades avec le fusil en perspective. Vingt-quatre heures, c'est vite passé.
Un petit coup de main le samedi soir pour avancer le travail du dimanche matin : déjeuner, soins à donner aux bêtes, messe, à la sortie, réunion des copains chez Marie LEFOUL, où nous passions un moment agréable à discuter des nouvelles, ensuite c'était l'heure de la soupe. L'après-midi, une petite promenade dans les champs avec ‘’ Rapide ‘’, le gibier était abondant, aussi le carnier était toujours plus ou moins plein, il n'était jamais question de bredouille.
Maman mettait toujours quelques morceaux avec quelques produits de la ferme dans la musette pour retourner au Légué et comme l'ordinaire était déjà pas mal, nous n'étions pas des sous-alimentés.
Nous étions là depuis un mois ou un peu plus quand un lundi je rentrais de permission. En arrivant au cantonnement, je rencontre notre capitaine.
Je salue. Il me répond et me fait signe d'approcher. Il me demande :
« Vous rentrez de 24 heures »
Je réponds affirmativement.
« Dans ce cas, vous
auriez dû rentrer pour la soupe d'hier soir et non pour celle d'aujourd'hui »
Je réponds :
« Mon capitaine, pour le
travail que nous faisons ici ! »
« Ah ! Vous
n'avez rien à faire. Après la soupe, je viendrais. Je vous ferais voir quelque
chose. »
Il était exact au
rendez-vous et aussitôt, nous avons pris la direction des champs. En marchant,
il me dit :
« Vous êtes cultivateur ?
»
« Oui mon capitaine. »
« Nous avons
loué un champ où nous avons semé des pommes de terre pour votre alimentation,
mais elles ont besoin de nettoyage. Vous me direz ce que vous en pensez. »
Arrivé au champ, je
voyais bien de l'herbe, mais pas de patates. Je lui demande :
« Depuis combien de temps
le travail a été fait et comment ? »
Il me répond :
« Il y a environ trois
semaines, c'était un champ qui était en pâture depuis longtemps. Le cultivateur
que nous avions demandé est venu avec une charrue et a commencé le labour à
environ quinze centimètres et toutes les deux roues, nous mettions la semence
non germée et depuis il fait plutôt pluvieux. Croyez-vous qu'il sera possible
de les nettoyer ? »
En effet, avec des fourches, des crocs, des boucards, des houettes et binettes, tout ce qu'ils réussissaient à se procurer comme outils, ils avaient fouillé. Il y avait déjà un bon tas d'herbe pour la surface travaillée. Comme il me demandait mon avis, je lui dis que le mieux c'était de continuer le travail comme il avait été commencé. Je lui aurais bien dit que c'était un travail saboté, mais ça n'aurait rien changé.
« Eh bien ! Demain,
après la soupe, demandez s'il y a des volontaires pour venir avec vous. »
Le lendemain, je demande s'il y a des volontaires pour le champ de patates. Il y en a eu quatre, avec moi ça faisait cinq.
Nous avons commencé à piocher, secouer et mettre dans des paniers pour transporter au tas. Il y avait du rendement pour une petite surface, nous avions vite un gros tas. Nous étions au boulot depuis environ deux heures quand nous avons eu la visite du capitaine. Il était satisfait de notre travail. Quand il nous a quittés, nous avons encore travaillé un peu et puis j'ai proposé d'aller boire un coup. Comme nous étions tous d'accord, nous avons été à un petit bistrot au bout du champ où nous avons demandé un pot de cidre. Ce n'était pas ruineux.
Quand il a été l'heure de rentrer, nous avons été prendre nos outils et direction la soupe.
Le lendemain, nous étions huit et le surlendemain, tout le monde était d'accord pour aller au champ.
C'était une grande partie des paysans bretons habitués au travail manuel. Ils s'étaient vite aperçus qu'un peu d'exercice faisait beaucoup de bien. Chacun travaillait selon ses capacités et son courage. Personne ne disait jamais rien. J'avais fouillé pour voir à quel point étaient les patates. Les moins profondes étaient environ à 8 centimètres de germe, donc pas grand danger de les abîmer. Il n'y avait pas d'outils pour tout le monde, mais en se relayant, ça marchait.
J'étais au Légué depuis environ trois mois et nous avions déjà nos petites habitudes.
Le soir, nous allions après la soupe faire une partie de cartes en buvant un coup de cidre dans une auberge tout près de notre cantonnement. C'était tenu par deux femmes : la tante et la nièce. La patronne avait une quarantaine d'année, la nièce 19 ou 20 ans. C'était sérieux et bien tenu.
Un soir que nous étions attablés, la tante dit à sa nièce :
« Tu ne
voudrais pas aller chercher des oignons chez ta mère, il n'y en a plus du tout
là »
Après avoir répondu qu'elle voulait bien, la nièce m'a demandé si je pouvais l'accompagner. Nous avons été attelés le cheval à un char à banc.
Ce n'était pas très loin : une dizaine de kilomètres, et le cheval trottait assez bien. La mère ressemblait bien à la tante, elles n'étaient pas des petites pièces, elles étaient taillées en gendarmes.
Nous étions de retour assez tôt et ça m'était égal car nous n'avions pas d'appel.
L’apprentissage de la montée à cheval pour
l’artillerie : La scierie, l’école des petits sourds-muets
Le lendemain, j'ai reçu l'ordre de rejoindre un détachement à la scierie, tout près de la gare de Saint-Brieuc.
Je regrettais le Légué. Notre capitaine était un bon vieux. Les camarades tous très gentils. Nos petites habitudes : promenades, baignades, parties de cartes et même notre champ de patates. J'ignore ce qu’il est devenu.
Ce qu’il y a de sûr, c'est que ça n'a sûrement pas été de la primeur.
Le matin après avoir fait mes adieux, j'ai pris la direction de mon nouveau cantonnement.
En arrivant, je me suis présenté au bureau qui m'a tout de suite mis au courant de ma nouvelle situation. Le fourrier m'a accompagné et m'a fait visiter le cantonnement principal. C'était un vaste bâtiment, surtout en longueur. Il y avait deux rangées de lits et quelques petites tables, ce n'était pas très heureux. Ensuite, nous avons été voir les chevaux, il y'en avait environ cent. Il y avait des chevaux du pays, principalement des demi-sang et des canadiens faciles à distinguer avec leurs têtes brusquées, les oreilles plus courtes et leur pelage uniforme, alezan brûlé. A l'arrivée, ils étaient à l'état sauvage.
Deux hommes s'occupaient du dressage qui consistait à attacher la bête à une corde de dix mètres fixée à un pieu en terre au centre du manège. Aussitôt lâché, le cheval faisait tout son possible pour se libérer.
Il prenait toutes les positions, se roulait, se cabrait, mais c'était du solide, il était obligé de se résigner. Alors le dresseur entrait en jeu. Il était armé d'un fouet, appelé aussi une chambrière qu'il faisait claquer au derrière de l'animal qui partait au trot en tournant en rond et épouvanté par les claquements du fouet, il accélérait jusqu'à épuisement. Le cavalier en profitait pour l'enfourcher, presque toujours le cheval surpris malgré sa fatigue, se cabrait et se laissait tomber sur le dos.
C'était le moment pour le dresseur de sauter en côté, car aussitôt par terre, la canadien lançait ses sabots dans toutes les directions, tous les moyens lui étaient bons pour se défendre, ce n'était pas par méchanceté, c'était par peur, car aussitôt qu'il s'était rendu compte que nous ne lui voulions pas de mal, il devenait un agréable compagnon.
Après l'écurie aux chevaux, nous avons été voir l'école des sourds-muets. C'est là qu'était mon dortoir. Il m'a fait voir une chambre que nous devions partager à deux, c'était très confortable.
Rentré de la scierie pour l'heure de la soupe, j'ai fait la connaissance de mon camarade de chambre. C'était un breton un peu plus âgé que moi.
Il s'appelait PICARD, figure sympathique.
Tout de suite, j'ai pensé que nous allions bien nous entendre.
Au Légué, nous avions un réfectoire. La cuisine était faite par des femmes qui mettaient le couvert et s'occupaient de la vaisselle. A la scierie, nous avions nos ustensiles. Le cuisinier faisait la distribution et débrouillez-vous. Il y avait bien quelques petites tables, mais pas pour tous.
Le camarade Picard qui était déjà là depuis quelques jours me dit :
« Je vais au
bistrot à côté, chez la Mère BOUGEARD».
J'ai été avec lui et nous avons continué tous les jours.
Nous avions une table, nous prenions un coup de cidre qui était bon et un café-crème pour finir. Ça n'allait pas loin comme dépense et nous étions bien.
La salle était au complet de soldats et surtout après la soupe du soir, il y avait de l'ambiance : des chansons, des jeux de cartes et autres distractions. Et nous avons gagné notre gîte aux sourds-muets. C'était très calme la nuit, nous étions très bien là pour se reposer.
Dans les chambres à côté, il y avait une vingtaine d'auxiliaires qui dans la journée étaient occupés à la scierie à donner des soins aux chevaux.
Le matin après une bonne nuit, nous avons été boire le jus et le fourrier nous a donné le programme de la journée.
Après le café, nous allions au terrain de pansage. Il y avait une corde tendue à l'ombre de grands arbres et tous les chevaux qui étaient
Sortables : c'est-à-dire qui voulaient bien se laisser conduire, étaient amenés et attachés à la corde par les auxiliaires et le pansage commençait.
Il y avait un brigadier qui s'appelait ThomassÉ qui nous présentait un cheval de voltige et nous a proposé de faire quelques exercices. Et il a commencé par nous faire une démonstration. J'avais eu l'occasion de voir des écuyères dans les cirques faire des acrobaties sur un cheval, mais il était de taille à leur faire concurrence.
Parmi nous, plusieurs avaient déjà fait du cheval et n'étaient pas empotés pour sauter dessus, mais quand nous avons vu ses exploits à côté nous étions des zéros. Enfin avec ses conseils et de la bonne volonté, nous arrivions à nous perfectionner un peu.
Après la soupe du matin, le fourrier nous a rassemblés. Nous étions sept dans le même cas, blessés dans l'infanterie et inaptes à la marche. Nous étions destinés à finir la guerre à cheval et pour cela il fallait faire des classes.
Il nous a présenté notre instructeur, maréchal-des-logis TOREL : une quarantaine d'année, grand, large d'épaules, moustache blonde, une tête très sympathique.
Après salutations, il nous a conduits à l'écurie et nous a dit :
« Vous pouvez choisir vos
chevaux. Autant que possible, ne prenez pas des canadiens qui n'ont jamais été
montés. Quant à la selle vous en avez deux espèces : la selle d'artillerie
française et la canadienne ».
Cette dernière avait la particularité d'être relevée un peu plus légèrement que la nôtre. Il me semble que nous les avions essayées toutes les deux.
Notre instructeur montait toujours la même bête : une grande jument baie foncé, proportionnée à la taille du cavalier. Il en faisait ce qu'il voulait. Après avoir fait notre choix, les palefreniers ont scellé nos chevaux et les ont sortis dans la cour.
Au commandement du logis, nous les avons enfourchés et en route. Aussitôt sortis en campagne, il nous a fait relever les étriers sur l'encolure et au trot.
Ce n'était pas la première fois que je montais. J'avais commencé je n'avais pas plus de cinq ans à me promener sur le dos d'un âne. J'ai toujours continué à faire du cheval jusqu'au moment de ma mobilisation.
Mais, c'était la première fois que je montais en selle et cela fait une différence d'être sur un cheval nu ou perché sur une grosse selle d'artillerie.
Aussi, j'étais content quand après avoir fait un kilomètre de trot, il a commandé ‘’ au pas’’ et de reprendre ses étriers. Le reste de la promenade a été agréable, le paysage que nous traversions était très joli. Nous avons fait un peu de galop sur un terrain inculte et quelques essais de saut par-dessus un petit talus.
Pour moi qui ai toujours aimé faire du cheval, je trouvais cela passionnant. En passant dans une petite bourgade, notre chef nous a demandé si nous avions soif et comme tout le monde était d'accord pour aller se rafraîchir, il nous a fait passer sous un porche et rentrer dans une cour où c'était très facile d'attacher les chevaux à l'abri du regard des passants.
Comme le propriétaire de cette cour vendait à boire, nous avons été nous attablés et demandés un pot de cidre et deux jeux de cartes. Comme nous étions huit, les deux perdants payaient la tournée et nous avons repris le chemin du retour.
En arrivant dans la cour de la caserne, les auxiliaires qui avaient sellé nos chevaux sont venus les reprendre. Nous n'avions pas autre chose à faire que les monter.
Après la soupe du soir, Picard et moi nous faisions une petite promenade ou nous allions à notre chambre où nous étions très tranquilles pour faire un peu de lecture. Pour les permissions, il n'y avait pas de changement avec le Légué.
Nous avions nos 24 heures tous les dimanches avec une petite rallonge.
Après trois mois de ces promenades à cheval dans toutes les directions autour de Saint-Brieuc et souvent sur la plage du Légué.
Un jour que nous étions sur le sable à faire des exercices, à un kilomètre de nous il y avait des bleus qui en faisaient autant. On voit deux cavaliers qui se détachent de leur groupe et qui se dirigent vers nous à toute allure.
Torel nous fait mettre en bataille et quand ils sont arrivés à trente mètres, nous avons levé les bras.
L'effet a été radical, les chevaux ont freiné et les cavaliers ont fait un plongeon, le nez dans le sable. Heureusement, ils ne se sont fait aucun mal. Les chevaux se sont laissés prendre sans difficulté et les deux soldats ont été quittes pour rejoindre leurs camarades.
Un jour, pendant ces trois mois que j'ai passés à la scierie, nous prenions le café-crème chez la mère Bougeard. Après la soupe du matin le père Jourdren a fait son entrée. Il se dirigeait vers Morlaix et n'avait pas la correspondance. Il avait quelques heures à attendre le premier train en partance pour cette direction. Après avoir pris un café avec nous, nous avons passé ce temps très agréablement.
Une autre fois, j'avais été délégué avec quelques hommes pour aller chercher des chevaux à Belle-Isle-en-Terre. Nous sommes descendus à Belle-Isle-Begard, la gare la plus proche.
Nous sommes arrivés le soir.
Le maire de Belle-Isle nous avait donné des billets de logement. Pour mon compte, je suis bien tombé : bien nourri et bien couché. De grand matin, nous avons visité le bourg. Je me rappelle d'un chevreuil en liberté qui n'était pas plus farouche qu'un animal domestique.
Vers 10 heures, nous avons pris livraison de nos chevaux.
Pour mon compte, j'avais un étalon de quatre ans, superbe. Notre première étape était Guingamp où nous avions une écurie pour les chevaux et pour nous un billet de logement. Je devais loger chez un officier en retraite. Je me suis présenté aussitôt, il m'a dit :
« Je n'ai pas de
chambre de libre, j'ai trois filles, je ne peux pas vous mettre à coucher avec.
»
Il a sorti son portefeuille et m'a donné ce
qu'il fallait pour aller à l'hôtel.
Le lendemain, nous avons pris la route pour Saint-Brieuc.
Quelques jours après, j'ai été convoyé un groupe de chevaux au front, car ils étaient comme nous quand leurs classes étaient faites. Ils prenaient la direction de la bataille.
Nous avons débarqué à Arcy-sur-Aube. Le trajet s'était effectué sans histoire. Nous avions un wagon de fourrage pour les chevaux, paille et foin, avec des couvertures. Nous étions aussi bien que dans un lit. A partir d'Arcy, nous sommes montés à cheval pour conduire nos chevaux à destination.
C'est-à-dire aux batteries du 75, auxquelles ils étaient destinés et nous avons repris le train pour Saint-Brieuc.
Le retour a été assez mouvementé. Plusieurs des convoyeurs passaient à proximité de chez eux et se sont éclipsés. S'ils avaient été raisonnables, tout se serait bien passé, mais quatre jours après notre arrivée à Saint-Brieuc, il y avait encore deux manquants.
Heureusement la discipline n'était pas très stricte, autrement, le chef de détachement aurait été embêté.
Il m'était encore arrivé une petite aventure pendant mon stage à la scierie.
Un jour, nous avions été quatre cavaliers dans la baie d’Iffiniac en vedette pour faire évacuer les pêcheurs en prévision d'un tir réel au canon, et comme notre mission accomplie il restait encore une bonne heure avant le tir, nous avons décidé de prendre un bain. Nous étions deux à nous baigner.
Les deux autres tenaient les chevaux.
Mon camarade savait nager, mais il avait une blessure qui le gênait pour le faire. Il est donc resté au bord Je suis parti à la nage un petit moment. Je me suis retourné et j'ai été surpris de voir le camarade que j'avais laissé au bord très loin. J'ai fait demi-tour, mais rien à faire pour regagner la rive, le courant m'entraînait.
Au Mont-Saint-Michel, on prétend que la mer monte à la vitesse d'un cheval au galop, je ne sais pas si c'est vrai, je n'ai jamais contrôlé, mais à Iffiniac, elle se retire très vite.
Le jour précédent, nous étions déjà venus dans la baie pour la même occasion et j'avais remarqué un rocher qui se trouvait dans les mêmes parages. De temps à autre je laissais couler mes pieds et j'eus la chance de tomber dessus. Cinq minutes après, il était à sec. J'en ai parlé à des gens du pays, ils m'ont dit :
« Personne ne se baigne
ici, quand la mer se retire. »
Stage d’artillerie, caserne des Ursulines, Saint-Brieuc
Les classes à cheval étant terminées, nous n'avions plus beaucoup de travail. Le copain Picard et moi, au moment de la récréation des petits sourds-muets, nous restions à les regarder jouer. Une chose nous a surpris, c'est qu'ils étaient beaucoup plus agiles que les enfants normaux.
Notre tranquillité n'a pas été longue. Nous
avons été affectés à la caserne des Ursulines afin d'y étudier une pièce de 75.
Ce n'était déjà plus si amusant. C'était la vie de caserne, avec sa discipline et l'étude d'un canon ne me passionnait pas du tout. Pendant plusieurs heures par jour, nous étions debout autour de la pièce et un sous-lieutenant nous en apprenait la nomenclature et le fonctionnement. Le rôle du capitaine, du chef de pièce, du pointeur, des approvisionneurs, du tireur. Nous avons étudié environ un mois et nous avons commencé nos préparatifs pour retourner au front.
Pendant le mois que nous avons passé à la caserne, il m'est arrivé une petite aventure :
Un jour, le fourrier a fait passer un ordre.
Tous ceux qui ont plus de deux couvertures doivent plier l'excédent sur le pied du lit. Elles seront ramassées dans le courant de la journée pour être remisées au magasin. Comme j'avais trois couvertures, j'ai mis celle que j'avais en trop, sous ma paillasse, car les nuits étaient assez fraîches et j'aimais être bien couvert.
Je trouvais que c'était assez de geler dans les tranchées. Malheureusement, le fourrier s'en est aperçu. Il m'a puni de deux jours de consignes.
Le soir, je suis sorti comme d'habitude, il m'a aperçu et m'a crié par la fenêtre :
« Vous en aurez quatre. »
Ça aurait pu mal tourner, car je n'avais nullement l'intention de céder. Mais le lendemain, j'avais ma feuille de route pour retourner au front. L'affaire a été classée.
Retour au front, intégration au 7ème d’artillerie
Habillé de neuf et armé d'un revolver et d'un sabre, je suis parti en permission chez mes parents, pour quelques jours.
De là, je devais m'adresser au commissaire militaire du Mans qui devait me diriger sur le régiment à rejoindre. Mais Le Mans est passé inaperçu, je dormais.
A Chartres, je suis descendu et me suis rendu au commissariat militaire qui m'a envoyé au camp de MAILL Y.
J'étais parti de St-Brieuc avec les écussons du 61ème. Au camp, on m'a donné ceux du 4ème et finalement après une dizaine de jours passés au camp, j'ai été affecté et dirigé au 7ème cantonné à Rupt.
Descendu à la gare la plus proche, j'ai aperçu un militaire avec les écussons du 7ème. Je l'ai abordé, j'étais bien tombé, c'était le vaguemestre de ma batterie. Il était venu chercher le courrier avec une carriole à cheval.
Je suis monté avec lui en voiture et nous avons fait connaissance.
Il s'appelait De Kerpoisson et était de Marcille. Il m'a nommé plusieurs gars de la batterie qui étaient de la région : Théophile Petitpas de Marcille, Horion de Combourg, François Esnault de Cuguen et mon chef de pièce : PelÉ de Meillac.
Nous étions un peu en famille. On m'a donné un cheval qui s'appelait ‘’ Charlot ‘’. Ce n'était pas un cheval de course.
Un jour, j'ai appris que le 47ème d'infanterie n'était pas loin de nous. J'y suis allé avec ‘’ Charlot ‘’ voir Théophile Jan, un ami. Sur le parcours, quand nous trouvions un attelage, il se collait aux autres chevaux et pour le sortir de là, ce n'était pas facile.
Enfin, j'ai réussi à joindre l'ami Théophile. Il était pour le moment lieutenant à 2 gallons. Quand je suis arrivé, il était en compagnie d'autres officiers qui ont eu la gentillesse de nous laisser seuls.
Ce qui nous a permis de bavarder pendant quelques heures. Il m'a fait voir ses livres. Pendant que les autres s'amusaient, il étudiait l'anglais et l'allemand. Il était intelligent et tenace. Il avait 11 ans quand je l'ai connu.
Il était venu comme pâtre dans une ferme à 100 mètres de celle où j'étais chez mes parents. Comme il n'y avait pas de jeunesse dans la ferme où il était, aussitôt qu'il avait un moment de libre, il venait chez nous où il y avait davantage de distractions. Nous avons fait de bonnes parties ensemble : mes frères et des voisins : les Mainguy. Nous l'appelions ‘’ Tortiche ‘’. Il était acrobate.
Nous avions une maison d'habitation couverte en chaume. Un jour, il est monté dans le grenier et par une petite lucarne était sorti sur le toit et grimpé sur l'enfaîteau. Il y avait deux cheminées, environ 20 mètres l'une de l'autre. Il circulait de l'une à l'autre au pas de course. A nos exclamations, mon père est sorti et comme de juste, il l'a prié de descendre. Les poignées de paille lui restaient dans la main. Nous avons eu peur pour lui, enfin il a réussi à regagner l'ouverture.
Un autre jour, il y avait un très grand peuplier dans le bas de la cour. Il a grimpé dans la cime et s'est accroché par les jarrets à une branche transversale et se balançait tranquillement. Il savait aussi nager et nous avait appris. Quand il a eu 16 ans, il a quitté la ferme et s'est embauché commis chez le docteur Brichet, à Dol. Le docteur lui prêtait des livres, il continuait à s’instruire.
A 18 ans, il s'est engagé dans les zouaves et a fait la campagne du Maroc. En juillet 1914, il était en permission et est venu me voir.
Il m'a dit :
« Je vais quitter
l'armée, j'ai demandé une place dans les chemins de fer. »
Et le 2 août 1914, c'est la déclaration de la guerre.
Il était sergent, il est incorporé au 47ème
d'infanterie à St Malo et il y a fait toute la campagne et a été mobilisé avec
le grade de lieutenant. (*)
Après s'être promis de se revoir, j'ai enfourché ‘’ Charlot ‘’ qui commençait à s'impatienter et il m'a reconduit au cantonnement à une bonne allure.
Une nuit, nous avons été repérés et un avion
ennemi nous a lâché quelques bombes, dont une est tombée sur nos chevaux qui
étaient attachés à la corde. Il y a plusieurs victimes dont ‘’ Charlot ‘’.
Pour le remplacer, on m'a attribué un petit cheval blanc avec les crins noirs, genre cheval arabe. Comme il venait des Dragons, je l'appelai ‘’ Dragon ‘’. Il n'était pas désagréable, cependant il avait un défaut. Aussitôt que je mettais le pied à l'étrier, il partait au galop.
Je m'occupais surtout du ravitaillement en munitions et en vivres.
Un jour, nous avions été chercher
du vin à la gare de Vic-sur-Aisne. En revenant, je vois des réservistes qui
avaient les écussons du régiment du mari de ma marraine. J'ai demandé à l'un
d'eux s'il ne connaissait pas Yves ClÉment.
(**)
Aussitôt, il m'a indiqué son cantonnement et comme c'était sur notre passage, j'ai été le voir. Il a été un peu surpris et quand je lui ai dit que j'étais en corvée de pinard, il m'a dit que j'aurais dû lui en apporter un bidon.
Je regrettais beaucoup, mais la corvée ayant pris de l'avance, il n'y avait plus moyen.
(*) : Théophile Marie Louis JAN, né en 1893, était
sous-lieutenant en juin 1915 au 47ème régiment d’infanterie. Engagé volontaire,
il était passé effectivement par les Zouaves. Algérie puis Maroc en 1912.
Affecté au 47e RI en août 1914, Il finira la guerre lieutenant, 3 blessures,
titulaire de la croix de guerre avec une étoile d’argent, deux étoiles de
bronze, une étoile vermeil et obtiendra la légion d’Honneur en 1920. Il
repartira au Liban, capitaine puis commandant en 1929. Sa
fiche matriculaire (3 pages).
(**) : Yves François CLÉMENT, 44 ans, était au 78ème
régiment d’infanterie territoriale. Voir
sa fiche matriculaire.
Juin-juillet 1918 : Agent de liaison des avant-trains
au 7e d’artillerie : Aisne
En ce moment-là, nous étions cantonnés dans les grottes de Vassens.
Ce sont des tunnels taillés dans la craie. Je n'en connais pas la longueur, ne les ayant jamais explorés. Ce qu'il y a de sûr, c'est que nous étions parfaitement à l'abri des obus et des bombes, mais pour y entrer et en sortir, il fallait faire vite, car la gueule des grottes était repérée et toutes les minutes environ, il y tombait un obus.
C'est pendant que nous étions là que l'ordre de repli stratégique du maréchal Foch nous est parvenu.
Le capitaine Galéry qui commandait notre batterie, m'a désigné pour faire l'agent de liaison des avant-trains. Il m'a donné comme monture une jument alezan brûlé, très fine et très jolie.
Elle s'appelait ‘’ Embellie ‘’. Elle était plus rapide que ‘’ Dragon ‘’ et je n'avais besoin ni d'éperons, ni de cravache. A la voix et une pression des genoux, elle donnait toute sa possibilité mais elle avait une petite tare, une verrue au poitrail.
Quand elle était attachée à un arbre, elle se grattait jusqu'au sang, souvent ça lui descendait le long de la jambe jusqu'au sabot.
A partir du moment où j'avais été désigné agent de liaison des avants trains, au lieu d'être aux échelons, j'étais aux pièces. Ma jument sellée et toujours prête et moi aussi, je devais être à la disposition du capitaine, de jour comme de nuit.
Une nuit où je croyais être tranquille, je m'étais à moitié déshabillé, quand j'entends le capitaine à l'entrée de l'abri:
«Agent de liaison des avants-trains ».
Je n'ai pas pris le temps de lacer mes bottes, ni de boutonner ma vareuse. Il n'a pas fait attention à ma tenue, il m'a remis un pli à porter au commandant.
Deux minutes après, j'étais en selle. J'avais sur le parcours pour parvenir aux échelons, le pont de Vic-sur-Aisne à passer, il était repéré et les obus tombaient très rapprochés à l'entrée.
Il fallait profiter aussitôt après une explosion pour le franchir, ça été vite fait, ‘’ Embellie ‘’ n'est pas restée à crotter sur le pont.
Ma mission accomplie, le commandant m'a désigné avec le fourrier pour aller préparer les cantonnements à 60 kilomètres en arrière. J'ai fait la route à cheval et le fourrier à vélo.
Vers le soir, quand notre travail a été fini, nous étions surpris que notre batterie ne soit pas arrivée, le fourrier me dit :
«Je suis fatigué,
tu ne voudrais pas prendre mon vélo et aller aux renseignements à la route
nationale. »
C'était à une dizaine de kilomètres du village où nous étions. Son vélo avait la selle trop haute pour moi. Il n'avait pas de freins et était à roue fixe. En outre, je n'avais pas beaucoup pratiqué ce genre de sport depuis que j'étais à l'armée. Je n'étais donc pas à mon aise. J'arrive à une descente, pas très longue, mais très accentuée avec au bas un tournant en épingle à cheveux.
Au milieu de la route, venant à ma rencontre, un chariot de parc d'artillerie attelé de six chevaux. Sur la banquette droite de la route, une pile d'une quinzaine de troncs de peupliers et juste en face, un ruisseau d'environ 2 mètres de large et de l'autre côté, un marécage avec des souches d'osier fraîchement coupées.
J'avais le choix ou les chevaux, ou les troncs de peupliers, ou l'oseraie. J'ai choisi cette dernière.
J'ai atterri la tête la première entre deux rangées d'osier. Je me suis enfoncé la tête assez profond dans ce terrain mou. Quant à mon vélo, il est resté dans le ruisseau, à part la moitié du guidon qui m'était resté dans la main. Les artilleurs ont mis pied à terre, et sont venus à mon secours, mais je n'avais même pas une égratignure. Ils m'ont fourni les renseignements que je cherchais.
J'ai donc fait demi-tour, avec le vélo complet mais la moitié du guidon en main. Ca n'arrangeait pas les choses.
Enfin, je suis arrivé au village où nous avions préparé les cantonnements.
Sur la porte du garage où je devais loger, il y avait une carte d'épinglée avec ces mots :
«Il y a un contrordre,
nous sommes cantonnés à 8
kilomètres d'ici. »
Il me nommait un village, dont je ne me souviens plus du nom.
Comme de juste, il avait pris mon cheval. Il ne me restait plus que son tacot pour les rejoindre.
La nuit était arrivée, une route que je ne connaissais pas, avec un engin pareil, ce n'était pas réjouissant. Cependant, je suis arrivé au but sans nouvelles anicroches. Quand j'ai trouvé le grenier où je devais coucher, je me suis allongé sans même prendre le temps de manger.
Le lendemain, nous avons encore fait marche arrière. J'ai repris ma jument et le fourrier s'est procuré un autre vélo pour remplacer celui que j'avais mutilé.
Pour le soir, après avoir fait plusieurs kilomètres, nous avons fait halte dans un village.
Comme de juste, il n'y avait plus d'habitants. Ils évacuaient en emportant le plus de matériel possible. Cependant, il restait quelques pigeons sur les toits, quelques poules à moitié perdues. Dans les caves aussi, nous avions quelques bouteilles. Il valait mieux en profiter, que les laisser aux Allemands.
Le soir, après la soupe, nous faisions une partie de cartes.
Notre cuisiner qui se nommait Constant Hue, boucher à Saint Malo dans le civil, est arrivé avec deux seaux de cidre et du bon. Nous y avons fait honneur.
Il faut même reconnaître qu'il y avait un peu de vent dans les voiles.
Le matin, après le jus, rassemblement. Le commandant était là qui nous annonce que le repli stratégique était terminé et que nous reprenions l'offensive. Nous avons pris la direction de la forêt de Villers-Cotterêts.
Pour le soir, nous arrivions à la lisière. Nous avons mis toute la nuit à la traverser. Il faisait noir comme dans un four.
Sous les grands arbres, il y avait des véhicules renversés qui provoquaient des embouteillages, interdit de faire de la lumière à cause des avions. Tous les 10 mètres, nous étions arrêtés.
« En avant, halte,
en avant, halte ».
C'était monotone. A un certain moment, je me suis endormi, ma jument suivait le mouvement automatiquement.
A l'aube, nous étions sortis de la forêt, nous sommes arrivés à Villers-Hélon vers 8 heures du matin.
Il y avait un grand et beau château avec une cour murée.
Nous y avons abrité les avant-trains. Quant aux pièces, nous avons mis en batterie aux bords de la route.
A 200 mètres, avant d'arriver au château, à l'emplacement d'une batterie allemande, il restait encore une pièce de 88 autrichien tournée vers la direction où nous arrivions. Quand nos pièces ont été placées, le lieutenant Beauregard a interpellé un groupe de servants :
« Qui veut m'aider à retourner le 88, on va leur envoyer leurs obus sur la gueule ».
Il y en avait un tas à côté. En un clin d’œil, l'opération a été terminée et ils ont commencé à tirer.
Quand survient le capitaine qui commande :
«A vos pièces. »
Et aussitôt, le tir a commencé, mais avec nos 75.
Comme il y avait une toute petite distance entre les avant-trains et les pièces, mon cheval était resté au château. Le capitaine GalÉry était debout derrière les pièces et donnait les directives au tir. J'étais à 10 mètres de lui à ses ordres. A côté de moi, il y avait une petite tranchée, abri creusé par nos prédécesseurs.
Le tir était commencé depuis quelques minutes, quand le premier obus allemand, un 88 autrichien a éclaté tout près d'une de nos pièces.
Le lieutenant Beauregard a été grièvement blessé, ainsi que plusieurs servants. La riposte avait été rapide. Les Allemands s'étaient aperçus instantanément, à l'arrivée de leurs obus, que nous occupions leurs positions qu'ils venaient de quitter. Pendant notre tir, qui a duré environ un quart d'heure, nous avons reçu une dizaine d'obus, tous meurtriers.
A chaque coup, il y avait des mouches. Le capitaine, debout derrière les pièces, a dit à un certain moment :
« Tirez, tirez … Quand il n'y aura plus de chefs de
pièce, je vais le faire. »
Enfin le tir étant fini : il a donné l'ordre d'évacuer la position.
A ce moment, l'aspirant LabourÉ est descendu avec moi dans le petit abri que j'avais mentionné et il m'a dit :
« Il y a de la casse ».
Il m'a cité plusieurs camarades morts ou blessés.
En outre, il y avait le maréchal-des-logis PelÉ qui avait un bras arraché. Il était de Meillac et la guerre finie, il a exercé la profession de facteur. Nous sommes sortis de la tranchée pour gagner le château, comme nous en avions reçu l'ordre. Il arrive un dernier obus qui tue net l'aspirant. (*)
Des quatre chefs de pièce, il restait un valide et la moitié des servants étaient hors de combat.
Le soir de ce jour, je suis parti en permission
de détente : une permission sans histoire.
(*) : L’aspirant Joseph Marie LABOURÉ allait avoir 20 ans. Voir sa fiche.
Les
Vosges, la grippe espagnole
Mon congé terminé, j'ai rejoint mon régiment à Le Valtin, dans les Vosges. Le premier camarade que j'ai rencontré en arrivant au cantonnement m'a dit :
« Qu'est-ce que tu viens
faire ici? Nous avons la grippe espagnole, un tel est mort. »
Et il m'a nommé plusieurs copains qui avaient été victimes de l'épidémie.
Le lendemain de mon arrivée, à deux, nous avons entrepris l'ascension du Valtin. Ce n'est pas très élevé, ni très dur.
Sur le sommet, il y avait une clairière couverte de broussailles, de framboisiers, les fruits étaient juste à point. Nous en avons profité largement. La descente a été rapide. Nous n'avions pas les genoux ankylosés. Nous avons été boire un coup à un petit bistrot au bord de la route. Il y avait dans la façade de la maison, un beau trou fait par un obus qu'heureusement pour les habitants, n'avait pas éclaté. Les tenancières de cette auberge étaient deux femmes d'un certain âge qui n'avaient jamais évacué.
Elles avaient, par conséquent, eu les soldats allemands comme clients avant nous.
Quelques jours après, nous avons eu la visite du cousin Joseph Couapel. Son unité était à environ deux kilomètres de la nôtre. Il nous a invités à manger pour le lendemain soir. Il était cuistot des officiers et se débrouillait bien pour avoir du ravitaillement. Je me souviens qu'il y avait entre autre chose un poulet et une bouteille de rhum. Nous y avons fait honneur. Notre major nous avait dit :
« Buvez un bon coup de
rhum pour ne pas attraper la grippe. »
Après une soirée extrêmement joyeuse, nous avons regagné notre chambre à coucher qui était une caverne sous la montagne. Nous avions des lits superposés. Je couchais dans le plus élevé, le 4ème.
A peine allongé, j'ai commencé à grelotter. J'ai interpellé le voisin en dessous et lui ai demandé s'il n’avait pas froid Il m'a répondu :
« Je suis gelé ».
Les deux autres étaient au même point.
Nous avons été chercher des couvertures aux chevaux, mais rien à faire pour se réchauffer. L'un des quatre, Labbé de la Boussac, ne s'était pas porté malade, il partait en permission le matin. Il nous a dit :
« Je me ferai soigner
chez moi ».
Mais en arrivant chez lui il est mort.
Hôpital de Bruyère
Quant à moi j'étais envoyé à l'hôpital de Bruyères. J'ai passé une première visite en arrivant le soir. Le médecin qui m'a examiné m'a trouvé fort mal en point. Il a décrété une congestion pulmonaire et m'a expédié dans la chambre des plus malades.
Dans cette chambre, il y avait une religieuse qui s'est occupée de moi aussitôt.
Elle m'a fait un enveloppement de moutarde et m'a demandé de le garder le plus longtemps possible. Elle m'a dit :
« Mon petit, c'est votre
vie qui en dépend. »
Elle m'encourageait en me disant :
« Encore un petit peu,
encore un petit peu. »
Ça me brûlait comme du feu.
Et puis le sang m'a giclé du nez si abondamment que le lit était inondé et aussitôt, j'ai ressenti un grand soulagement. Le matin, quand le docteur est passé, il a paru tout surpris de me voir si bien et il a demandé à la sœur ce qui s'était passé. Elle lui a répondu que j'avais eu un très gros saignement de nez, il a reconnu que c'était cela qui avait dégagé les poumons.
Aussitôt le médecin parti, la sœur est venue vers moi avec tout le matériel pour me raser la tête, en me disant :
« Vous avez été très mal,
il faut que je vous rase la tête, autrement vos cheveux tomberont tous. »
Je pensais déjà à la convalescence. J'aurai l'air d'un bagnard. Je n'ai pas accepté. Elle n'a pas insisté. Mais à partir de ce moment, mes cheveux ont commencé à tomber.
Après un stage à l'hôpital, j'ai eu un mois de convalescence.
Nov. 1918-1919 : L’armistice, l’Alsace, Bordeaux, la
démobilisation
C'est pendant ce temps que l'armistice a été signé. Nous ramassions des betteraves ce jour-là. Nous avons continué toute la journée. Le soir, nous avons fait la fête.
Mon congé terminé, on m'a envoyé à la caserne d'Offémont à Belfort. J'y suis resté environ un mois. Nous y étions complètement oisifs.
C'était des parties de cartes interminables.
Un soir, je me suis laissé tenter et j'ai fait une partie de banque. J'avais 80 francs en poche, j'en ai perdu 40.
Je me suis bien promis de ne jamais recommencer.
Un soir que nous parlions de chasse, j'ai demandé aux copains s’ils connaissaient la chasse de nuit à la lanterne. Sur leur réponse négative, nous avons décidé d'en faire une partie. Nous avions des bougies, j'ai pris une bouteille blanche. J'ai mis un peu d'eau froide dans le fond et j'ai trempé le fond dans l'eau bouillante.
Le fond se détache impeccable. J'y ai mis la bougie dedans, j'ai pris un bâton assez long. Il y avait un taillis qui bordait le mur de la caserne. Nous avons escaladé le mur qui était très bas et après très peu de temps, nous avions tué deux geais. Nous sommes rentrés, les
avons déplumés, grillés sur le poêle et dégustés.
Il est arrivé à Offemont, un convoi de prisonniers rapatriés d'Allemagne. Ils sont restés plusieurs jours à s'ennuyer, se demandant pourquoi ils n'étaient pas renvoyés chez eux. L'un d'eux avait même composé une chanson, dont voici le refrain:
« Ils vont,
ils vont
Par les rues
d'Offemont,
Se baladant comme Mongnasse
Les deux pieds dans
la bouillasse
Les yeux remplis du
désir
D'Foutre le camp et
ne plus revenir »
Enfin, j'ai reçu l'ordre de rejoindre mon régiment à Kappel en Alsace.
J'étais heureux de retrouver les copains. C'était un petit village composé surtout de cultivateurs.
Quand je suis arrivé, il y avait de la neige, les gens circulaient à traîneaux attelés de chevaux et ça filait.
La maison que nous occupions était une ferme. La maison d'habitation était spacieuse, la façade nord donnait sur la rue, au sud il y avait une cour, entourée d'une haie de sureau, mélangés avec d'autres petits arbustes. Il y avait aussi des écuries où nous logions nos chevaux.
Le soin aux chevaux était le principal de nos occupations.
Dans la chambrée, j'étais avec deux anciens : Monnereau et Bouscaru, deux gars du midi, qui pendant la guerre avaient été les pourvoyeurs en gibier de la batterie. Bouscaru avait une carabine 6mm canon, rayé et Monnereau, un fusil à charger par le bout.
Comme il partait en permission, ce dernier m'avait confié son fusil et m'avait appris à le charger. Il retirait la charge de poudre d'une cartouche d'exercice de fusil de guerre, l'introduisait dans le canon, un peu de papier sur la poudre, en ayant soin de ne pas la comprimer, une charge de plomb et encore un peu de papier, une amorce sur la cheminée.
Comme il y avait de la neige, le tas de fumier aux chevaux étant déposé au bord de la haie, les moineaux venaient y picorer. De la porte de l'écurie, quand ils étaient groupés, j'en tirais quelques-uns.
Un jour, la neige avait un peu fondu, j'ai été faire un tour sur les champs avec l'intention d'apercevoir un lièvre au gîte. J'arpentais une pièce de gros labour, je scrutais les raies avec l'espoir d'apercevoir l’œil d'un capucin. Au milieu du champ, j'entends un léger bruit et j'aperçois un grand chasseur avec un monocle qui me faisait signe d'approcher. Mais comme je n'étais pas tellement sûre d'être en règle, j'ai préféré tourner les talons et ma chasse a été terminée.
En entrant dans la maison, par la porte principale, il y avait à droite, la porte du bureau et à gauche, c'était notre chambre. Nous avions parmi nous, un drôle de loustic, qui avait le don de faire rire et pour cela il suffisait qu'il se mette à rire lui-même. Son rire était contagieux.
Un jour, que toute la chambrée était en train de se tordre, (les civils étaient obligés de demander au bureau un passeport pour aller en ville), une jeune fille qui venait pour en obtenir un, se trompe de porte et ouvre la porte de notre chambre. Pas un n'a pu lui dire un mot tellement nous étouffions. La pauvre fille a dû penser qu'on était tous fous là-dedans.
Pas loin de notre cantonnement, il y avait un dépôt de chevaux galeux. Il en crevait tous les jours et c'était nous qui étions chargés de les enlever. Un jour, j'ai été désigné comme chef de corvée. Nous avons été avec un chariot de parc attelé de quatre chevaux. Nous avons enlevé quatre chevaux morts et les avons transportés dans la prairie d'un château.
C'était une vaste prairie et à l'orée, il y avait des sapins avec beaucoup de broussailles. Arrivés à destination, les conducteurs ont mis pied à terre et ont basculé les cadavres.
Alors, il s'est produit une chose que je n'avais pas imaginée. Il est sorti des broussailles de la lisière de la prairie une bande de cochons. Il y en avait de toutes les tailles qui sont arrivés sur nous à la vitesse d'une charge de cavalerie et se sont rués sur les bêtes que nous venions de décharger, comme des loups. Les soldats qui étaient avec moi et qui avaient déjà assisté à l'opération m'ont dit :
«Quand nous
reviendrons, il ne restera plus que les os parfaitement nettoyés ».
Nous avons été boire un verre de bonne eau-de-vie au château pour nous remettre le cœur en place.
Tant que j'ai été en Alsace, quand il y avait du cochon au menu, je préférais manger mon pain sec.
Un jour, il est arrivé un ordre. Nous partons pour Mulhouse. Le lieutenant, à cette occasion, est venu me trouver et m'a dit :
« Si tu veux faire la
route à cheval, il n'y en a qu'un à ta disposition, et c'est le cheval fou. »
Je lui ai répondu que je l'aurai monté.
C'était un superbe animal de 4 ans, alezan foncé, à l'allure fière. Le jour du départ, je lui ai donné sa pitance, l'ai pansé et sellé moi-même. Il n'a fait aucune difficulté, quand je l'ai enfourché. Les premiers kilomètres, il se tenait bien à sa place.
A un certain moment, il y avait caché dans un bosquet, au bord de la route, une clique qui faisait sa répétition.
Au moment où nous arrivions, en force la fanfare a éclaté. Surpris, mon cheval a pivoté sur les sabots de derrière et est parti ventre à terre vers l'arrière de la colonne. Le colonel était à la fin quand je suis arrivé à sa hauteur. Je l'ai entendu dire :
« Qu'est-ce que
c'est que ça ? »
Et puis brusquement ne voyant plus personne, ma monture s'est arrêtée. Je l'ai fait faire demi-tour et nous avons regagné notre place.
Jusqu'à Mulhouse, il a été très calme, mais rentré en ville, il avait peur de tout. A chaque moment, du milieu de la route, nous nous retrouvions sur le trottoir. Et quelques fois si près des devantures que j'avais peur finalement de nous retrouver dans une boutique. Enfin, nous sommes arrivés à la caserne et c'est avec plaisir que j'ai mis pied à terre.
La caserne où nous venions d'atterrir était une caserne de cavalerie allemande. Ce que j'ai remarqué en arrivant, c'était la piste : terrain très bien aménagé pour l'entraînement des chevaux, très vaste et parsemé d'obstacles.
Les premiers jours, je ne me souviens pas avoir fait grand-chose. Une petite aventure plutôt comique : dans notre chambre, il y avait l'ordonnance du lieutenant. Il venait de sortir pour quelques minutes. L'un de nous a dit :
« La gamelle sur la
porte. »
Aussitôt dit, aussitôt fait : une gamelle d'eau a été installée bien équilibrée sur la porte légèrement entrebâillée. Malheureusement, ce n'est pas l'ordonnance qui est rentré le premier, c'est le lieutenant qui justement venait demander son ordonnance. Il faut croire que le piège était bien tendu, car le képi qu'est-ce qu’il a pris.
Il a été assez intelligent pour refermer la porte et ne rien dire.
Un jour, le brigadier Rossignol est venu me trouver et m'a dit :
« Demain, je pars en
congé libérable. J'étais chargé de la corvée du fumier. Si tu veux, je te
propose de me remplacer. Voici en quoi cela consiste : le matin, tu
réquisitionnes 4 ou
5 tombereaux, selon ce qu’il y a d'hommes disponibles, tu les fais remplir au
tas de fumier qu'il y a aux écuries et tu les conduis chez Monsieur Becker, un fleuriste qui se trouve en
bordure de la ville. Ce n'est pas dur et il y a de bons pourboires. »
J'ai accepté et le soir même j'ai pris contact avec le contremaître.
Nous avons fait un tour en ville avec Rossignol. A un certain moment, les cafés étaient fermés. Nous sommes rentrés dans une maison spéciale. Pour moi, c'était la première fois et la dernière. Nous avons pris une bière, qui nous a été servie par une femme âgée. Nous étions les seuls dans la salle. Une jeune femme est apparue dans l'escalier, aussitôt le contremaître s'est porté à sa rencontre et lui a dit:
« Pas ce soir. »
J'ai compris qu'il
était un habitué.
Le lendemain, j'ai pris mon service. Rossignol m'avait passé la clé du portail de la basse-cour, je n'avais aucune peine à trouver une corvée pour les conducteurs des tombereaux. Ça leur faisait une distraction et il y avait le pourboire. Avec mon cheval, je prenais la tête du convoi et arrivé au jardin, je laissais les conducteurs se débrouiller pour décharger.
J'attachais mon cheval à la porte d'un café qui se trouvait en bordure du jardin et je dégustais une bière en les attendant.
Le samedi soir, je percevais le prix des charrettes de fumier et le pourboire que nous partagions ou que nous buvions ensemble.
Un jour le capitaine Tysenet nous a prévenus qu'il allait organiser un concours hippique et que tout le monde était invité à y participer, même les muletiers. Je n'avais pas un cheval pour cela. Je préférais rester comme spectateur.
Tous les jours, il y avait entraînement, les curieux comme moi nous étions assis sur une barrière qui séparait la piste de la cour de la caserne.
Ce jour-là, notre Lieutenant avait décidé de monter le cheval fou. Le départ a été bon, il avait fière allure sur la piste et tout à coup, il prend le mors aux dents comme il était coutumier et arrive à la barrière où nous étions assis, en donnant tout ce qu'il pouvait donner. La
barre faisait environ 2 mètres de hauteur. Le devant est passé par-dessus. Il est resté une seconde à l'équilibre et a basculé dans la cour pavée de la caserne. Il a atterri sur le dos et le lieutenant avait une jambe prise dessous.
Résultat : une fracture de la jambe pour l'officier et une patte cassée pour le cheval qui a été achevé.
C'est la fin du cheval fou.
Le lendemain, l'entraînement continuait et nous avions remarqué un sous-lieutenant dont la monture se dérobait chaque fois qu'il arrivait à la Douve : c'était une petite rivière artificielle d'eau stagnante et nauséabonde. Le capitaine Tysenet avait lui aussi remarqué ce manège. Il dit à son ordonnance :
« Va donc chercher mon
vieux blanc, celui-là, il ne l'empêchera pas de sauter. »
L'ordonnance va chercher le vieux blanc et le conduit au sous-lieutenant en échanger du sien et comme de juste le vieux blanc a sauté, mais son cavalier a piqué une tête au beau milieu de la Douve. Quand il a été retiré et qu'il a gagné la caserne pour se changer, il était pitoyable et cependant, je n'ai vu personne pleurer. Les muletiers aussi nous avaient beaucoup amusés.
Enfin, le jour du concours est arrivé, il y avait beaucoup de chevaux et beaucoup de spectateurs.
Il faisait beau, c'était un beau spectacle, il n'y a pas eu d'accident. Cependant, il y a eu une chute qui aurait pu être grave. La barre était aux environs de 2 mètres et un cheval au lieu d'atterrir sur les pattes est arrivé sur la tête. Le cavalier a fait du roulé boulé et réussi à ne pas être pris sous son cheval. Ce qui fait qu'il n'y a pas eu de casse.
J'avais comme camarade un brigadier qui s'appelait DOMÉE. Il était de Bordeaux. Quand nous allions boire un petit coup de blanc d'Alsace que je trouvais délicieux, il me disait :
«Quand nous serons à
BORDEAUX, tu verras. »
Nous savions que nous devions y aller.
Enfin, ce jour est arrivé. Je me souviens avoir passé les tunnels Dijon, St Etienne et arrivée à Bordeaux, où la gare est vitrée.
Le lendemain, le camarade Domée m'a entraîné voir des cousins et des cousines et des parents plus ou moins éloignés. Comme de juste, nous avons goûté le vin de Bordeaux et pas de la piquette.
Si bien que le soir, si je n'avais pas enlevé ses chaussures au copain, il se serait couché avec. Ce qui ne veut pas dire que j'étais beaucoup plus solide sur mes jambes, mais la camelote devait être bonne car le matin nous étions en pleine forme.
De BORDEAUX, je n'ai pas grand souvenir.
Une fois, j'avais été au grand théâtre. Je n'avais rien trouvé de sensationnel. J'avais vu le monument des Girondins que j'ai trouvé original.
Avant la guerre, nous portions des espadrilles avec des semelles en corde que nous appelions des bordelaises et un jour, nous avons visité la rue où elles étaient fabriquées. Les portes et fenêtres étaient ouvertes et nous pouvions voir ces petits artisans, à leur métier, fabriquer des semelles en corde.
Comme travail, nous ne faisions rien et nous étions nourris en conséquence. En sortant du réfectoire, nous allions donc dans un café où nous prenions un artichaut à deux avec du pain et du beurre, pour nous permettre de ne pas trop maigrir.
J'ai obtenu une permission agricole de 15 jours.
Depuis que nous étions à Bordeaux, nous avions troqué les écussons du 7ème pour ceux du 14ème.
Après mon retour de permission, j'ai encore fait un petit stage et je suis retourné à la maison en permission de détente et à l'expiration de cette permission, il ne me restait que 10 jours à faire.
J'ai téléphoné à mon commandant pour savoir s'il fallait retourner à Bordeaux pour si peu de temps. Il m'a répondu de me rendre à la caserne du 10ème d'artillerie à Rennes. Ce que j'ai fait.
La première nuit que j'y ai couché, les punaises m'ont dévoré. Le reste de mon stage, je suis descendu dans l'écurie coucher dans la paille avec les chevaux. Je regrettais bien de ne pas être retourné à Bordeaux.
J'avais mon vélo à Rennes.
Le samedi soir, après la soupe, j'allais faire un petit tour en ville à bicyclette et subitement, il me vient une idée : si j'allais faire un tour chez nous, au lieu de rester à m'ennuyer ici. Deux heures après, j'étais à La Bazillais. En rentrant, le dimanche soir à la caserne, je tombe sur mon maréchal-des-logis qui me demande :
« Où étais-tu ? »
« J'ai été faire un tour
chez nous. »
« Et pendant ce
temps, tu as été désigné de service. Si je ne m'étais pas débrouillé pour te
remplacer, tu n'y coupais pas à huit jours de rabiot. »
Je l'ai vivement remercié et lui ai payé un canon.
Enfin, quatre jours après, c'était la quille, j'avais été dix jours à Rennes.
Quand nous étions démobilisés, nous avions droit à 52 francs pour s'habiller en civil ou à un complet Clémenceau, ce qui avait même occasionné un petit couplet :
« Pour 52 - 52
Francs, j'aurai
Un beau gilet, un
veston, une casquette
Et si le falzar je
ne l'ai pas je m'en passerai.
Mes 52 Francs je
les ai, oui je l'ai ai dans mon gousset. »
C'est avec grand plaisir que j'ai repris ma place à la maison que j'avais quitté le 18 décembre 1914.
![]()

Laurent COUAPEL est décédé le 24 octobre 1985 à 90 ans et son épouse Marie jourdren, le 2 décembre 1985 au moulin de la Forêt de Villecartier en Bazouge-la-Pérouze où ils ont vécus depuis leur mariage, le 31 mai 1927 et où ils ont élevé leurs sept enfants.
![]()
Je désire contacter le propriétaire de ce carnet
Voir
des photos du 106ème régiment d’infanterie
Voir
des photos du 155ème régiment d’infanterie
Suivre
sur Twitter la publication en instantané de photos de soldats 14/18
Vers d’autres témoignages de
guerre 14/18